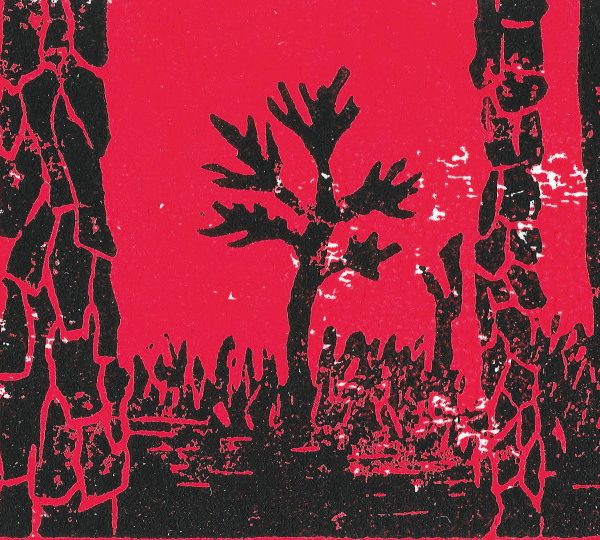Carte réalisée par Quentin Dugay (quentindugay.com)
Au XVIIIe siècle, la mondialisation est déjà à l’œuvre : les empires français, anglais et espagnol se disputent âprement les ressources naturelles du Nouveau Monde.
Si la vision de la conquête héroïque de l’Ouest a encore la peau dure, une nouvelle histoire s’impose depuis une vingtaine d’années. Celle où les Amérindiens cessent d’être un bloc radicalement autre, rarement sujet, ne pouvant que résister ou céder face aux assauts des colons. On doit aux éditions Anacharsis la traduction de deux ouvrages porteurs de cette évolution historiographique : Le Middle Ground de Richard White et L’Empire comanche de Pekka Hämäläinen. On y découvre des peuples colonisés résolument acteurs des changements de l’Amérique du Nord, mais emportés par des mutations techniques, économiques, culturelles et environnementales dont l’ampleur et la rapidité les dépassent fatalement.
Cet article est le troisième d’une série de six publications issues du troisième numéro de Jef Klak, « Selle de ch’val », et publiées en ligne à l’occasion de la sortie du nouveau numéro, « Ch’val de course ».
Télécharger l’article en PDF.
« Le buffalo […] accomplissait sa destinée auprès des indiens en leur fournissant tout ce dont ils avaient besoin : de la nourriture, des habits, un toit, des traditions et même une religion. Mais le buffalo n’était pas vraiment adapté à la civilisation blanche en marche. […] c’était un désaxé (misfit). alors il devait disparaître1. »
Frank Mayer
Coureur 2 de bison
Au début du XIVe siècle, un cycle humide de cinq cents ans commence et l’herbe se remet à pousser drue sur les Grandes Plaines d’Amérique du Nord. Le Bison bison n’en attendait pas plus pour repeupler les quelque trois millions de km2 d’abondance qui s’offrent à lui. La concurrence n’y est pas féroce : à la fin de la dernière grande glaciation, il y a 10 000 ans à peu près, les trois quarts des grands mammifères du coin ont disparu. La faute au réchauffement climatique, sans doute, et aux humains, peut-être, qui avaient débarqué quelque 3 000 ans plus tôt ; le Bison bison n’en sait rien, il n’y pense pas, de toute façon.
Bien sûr, le temps de cette mégafaune du pléistocène est révolu, le Bison bison n’a pas la taille ni les cornes de son fier ancêtre Bison latifrons, mais il fait ce qu’il peut ; tout seul sur les prairies, il repeuple. Il passe l’été dans les plaines riches en herbe, et l’hiver il rejoint les vallées et les collines légèrement boisées, à l’abri du froid. Il n’est peut-être pas bien gros, mais toujours bien assez pour décourager la plupart des prédateurs. Dans les Plaines du Sud, les bisons sont bientôt entre sept et neuf millions, et pas loin de trente millions sur l’ensemble des plaines 3.
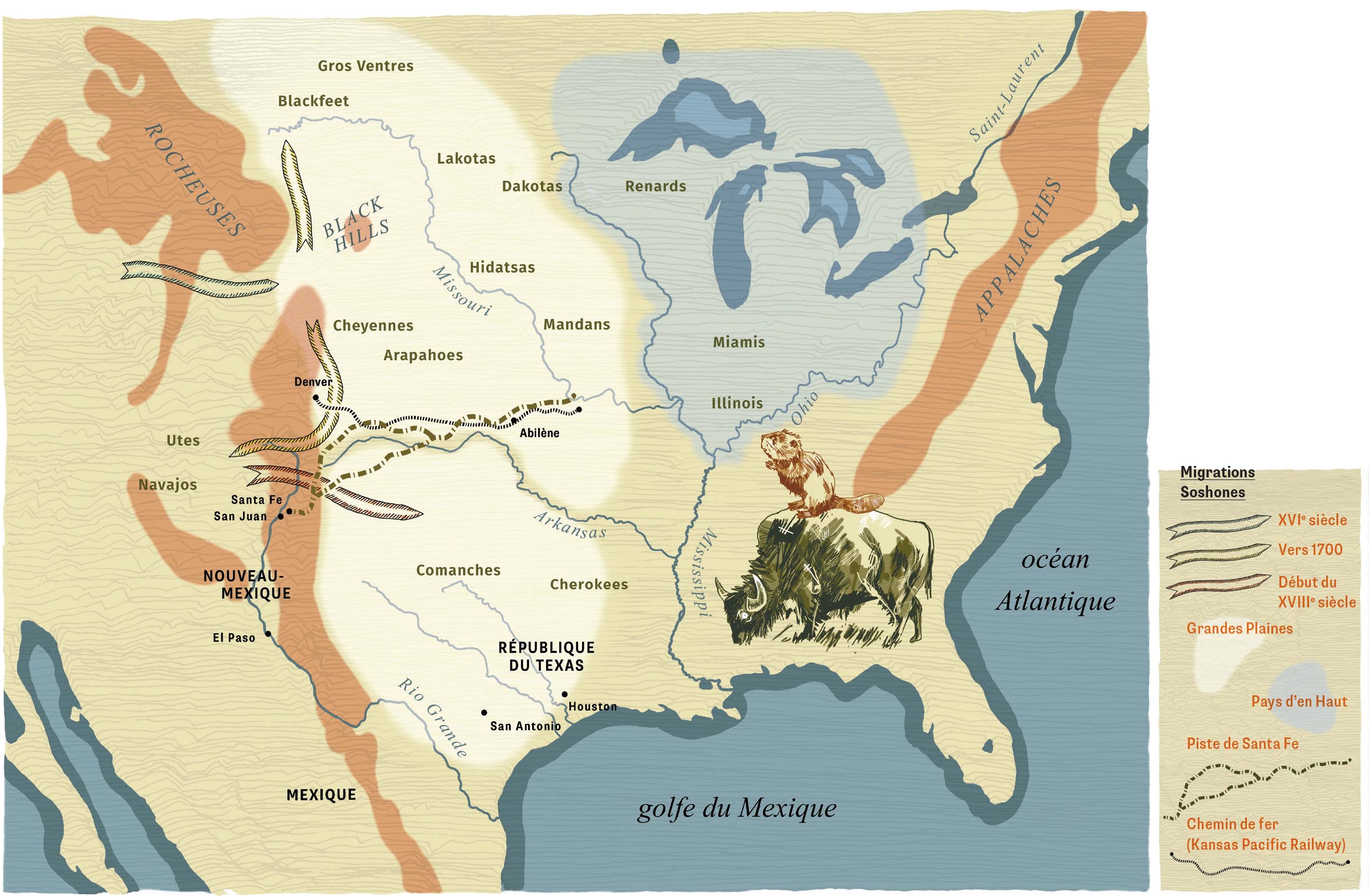
Sud
Au XVIe siècle, les Shoshones vont à pied. Cela ne les empêche pas d’occuper la quasi-totalité du nord-est du Grand Bassin nord-américain, jusqu’aux marges des Grandes Plaines. Ils ont adopté un cycle annuel très précis, adapté aux conditions offertes par les différents environnements qu’ils traversent : montagnes et plaines semi-arides, rives de lacs ou marécages. Quand le temps est clément, ils chassent à l’arc (l’antilope, le cerf et le mouton sauvage), ils pêchent du saumon, ramassent des noix ou des tubercules. Les rigueurs de l’hiver les poussent tous les ans à emprunter la Passe du Sud vers le versant oriental des Rocheuses. Là, dans les sillons entre les montagnes et les prairies, à l’abri du froid, ils chassent le bison et l’élan 4.
Aux alentours de 1600, les Shoshones entrent de plus en plus souvent sur les Grandes Plaines pour la saison des chasses. Pour eux comme pour d’autres tribus plus au nord, les campagnes les plus fructueuses sont les grandes chasses collectives. Il s’agit d’entraîner un troupeau vers de la neige poudreuse, des glaces fragiles ou un précipice, en l’encerclant ou en le repoussant vers de gigantesques entonnoirs patiemment érigés à partir de troncs d’arbres et de pierres. Cela demande une organisation considérable, ne serait-ce que pour rassembler un nombre suffisant d’individus habituellement dispersés. Malgré tout, l’abondance de gibier permet aux Shoshones d’entrer dans une ère de prospérité.
Nord
Au même moment, en Europe, les chasses abusives ont éradiqué le castor scandinave. Privés de matière première de qualité, les chapeliers doivent se rabattre sur le feutre de laine de mouton. Toutefois, ce dernier est trop grossier, les chapeaux ne sont pas vraiment étanches et leur couleur reste désespérément terne. Il y a bien les trappeurs russes qui approvisionnent les marchés depuis la Sibérie, mais les coûts du transport terrestre sont trop élevés. Fatalement, les chapeaux hollandais s’avachissent, et dans le reste de l’Europe l’engouement pour le feutre s’affaisse. En un mot, c’est l’angoisse 5.
Heureusement, les pêcheurs européens officiant dans l’Atlantique découvrent, à l’occasion de pêches à l’embouchure du Saint-Laurent, que les forêts avoisinantes regorgent de castors et que les trappeurs indigènes sont disposés à vendre les peaux à bon prix. Pour les Français, qui cherchent à installer des colonies dans la vallée du fleuve, c’est une aubaine ; d’autant que l’arrivée des premières peaux en provenance du Canada déclenche en 1580 un véritable phénomène de mode en Europe : le prix du feutre de castor explose.
Sud
« Et ils n’appartenaient à personne. Si tu les tuais, ce qu’ils rapportaient était à toi. C’était de l’or sur pattes, disaient les Anciens, et un jeune gars qui avait des tripes et de la jugeote pouvait faire fortune. »
Frank Mayer
À la fin du XVIIe siècle, les Shoshones vont toujours à pieds, mais ils ont déjà commencé à réorganiser leur société autour du bison. Ils se reposent de plus en plus sur l’animal pour se nourrir, se loger ou se vêtir, et ont de fait développé une nouvelle culture et un ensemble de rituels adaptés. Ils doivent à présent se déplacer périodiquement pour suivre les troupeaux, ce qui les oblige à réduire au strict minimum les biens qu’ils transportent eux-mêmes ou qu’ils disposent sur des travois tirés par des chiens, guère capables de porter plus de quarante kilos. Les femmes ont volontiers plusieurs compagnons, et les personnes les plus faibles sont régulièrement abandonnées à leur triste sort lors des changements de camp, si bien que la population totale reste de taille modeste, sans doute autour de 5 000 individus. Cependant, les Shoshones s’adaptent parfaitement à cette nouvelle vie semi-nomade, et les troupeaux de bisons semblent suffire à combler la majorité de leurs besoins.
Les Apaches, de leur côté, ont la vie plus dure. Une série de sécheresses au milieu du XVIIe siècle a décimé les troupeaux des Plaines centrales, les rendant méfiants à l’égard d’un mode de subsistance si aléatoire. En outre, la variole, qui fait rage dans le Nouveau Monde, est susceptible de porter un coup fatal à n’importe quelle tribu. Aussi les Apaches font-ils le choix de diversifier leur économie : sous l’influence notamment des réfugiés pueblos 6, ils réalisent des ouvrages d’irrigation dans les lits des rivières, construisent des maisons en pisé à toit plat, et se mettent à cultiver la terre. Dès la fin du siècle, ils prospèrent sur les plaines, exerçant de fait une pression accrue sur le territoire shoshone 7.
Ces derniers, stoppés dans leur conquête de l’Est, se séparent en deux groupes : le premier part vers le nord chercher des bisons et des noises aux Blackfeet et aux Gros Ventres, tandis que le second prend le chemin du Sud entre les Grandes Plaines et les contreforts des Rocheuses, à distance respectueuse de leurs envahissants voisins.
Les Shoshones partis vers le sud rencontrent bientôt les Utes. En échange de soutien militaire, ces derniers initient leurs nouveaux alliés à leur territoire et à leurs pratiques. Ils leur donnent également un nouveau nom : « Kumantsi », qui deviendra plus tard « Comanches ». De l’automne au début du printemps, ils restent dans les contreforts des Rocheuses et dans les régions boisées pour chasser l’antilope et le lièvre, cueillir des baies, des noix et des racines. Au printemps, ils pénètrent dans les plaines en grands groupes, dans la haute vallée de l’Arkansas, pour y chasser le bison, et l’été est consacré aux raids menés en territoire espagnol, au Nouveau-Mexique. Par ailleurs, les Utes introduisent les Comanches sur les marchés de Taos et de San Juan, où ils échangent des peaux, de la viande et des esclaves navajos contre du maïs, des poteries et des couvertures en coton. Et par dessus tout, contre des chevaux 8.
Après leur révolte de 1680, les Pueblos se sont emparés d’un grand nombre de montures espagnoles qui ont rapidement alimenté un commerce soutenu avec les autres peuples des Plaines. Issus de la race Barbe d’Afrique du Nord, ces chevaux petits et résistants étaient adaptés à la vie des Plaines du Sud relativement arides, mais fournissant un fourrage abondant presque toute l’année. Tout comme le bison d’Amérique 9 000 ans plus tôt, le cheval investit naturellement une des nombreuses niches écologiques laissées vacantes par l’extinction du pléistocène 9.
Les Crees et les Assiniboines appellent le cheval « great-dog », les Sarcees « seven dogs » et les Lakotas « medecine-dog » : l’omniprésence du chien dans les sociétés nomades des plaines facilite l’incorporation du cheval dans leur quotidien, mais les Indiens comprennent immédiatement que ses capacités hors du commun leur ouvrent de nouvelles perspectives. Et pour cause, un cheval peut transporter 100 kg sur son dos et traîner 150 kg avec un travois, soit quatre fois plus qu’un chien. Il permet de se déplacer plus vite et plus loin, en emmenant plus de peaux, de viandes ou d’objets ménagers. Son adoption lève l’ancienne limitation sur la taille des tipis et étend considérablement les territoires de chasse – mais sa plus grande qualité en tant qu’animal de bât reste son alimentation. Tandis que le chien consomme une quantité non négligeable de viande issue des chasses, le cheval puise directement dans une ressource jusque-là imparfaitement exploitée : l’herbe des plaines.
Tout va très vite pour les Comanches en ce début de XVIIIe siècle, notamment grâce à leur exceptionnelle capacité d’adaptation. L’alliance avec les Utes leur donne accès à des armes à feu, des couteaux, des poinçons, des aiguilles ou encore des chaudrons en fer. Ils basculent en une génération de l’âge de la pierre à l’âge du fer. Leur nouvel équipement, plus efficace et plus résistant, révolutionne la plupart de leurs tâches quotidiennes : chasse, préparation des peaux, cuisine, couture, etc. Pourtant, c’est avant tout l’intégration de la culture équestre qui les fait basculer dans une nouvelle ère.
L’emploi du cheval bouleverse leurs pratiques de chasse. En longeant au grand galop les troupeaux de bisons en fuite et en tirant sur des animaux soigneusement choisis, un groupe limité de chasseurs peut à présent abattre de 200 à 300 bisons en moins d’une heure, soit bien assez pour vêtir et nourrir plusieurs centaines de personnes pendant plus d’un mois 10. En outre, le rayon d’action étendu du cheval évite aux Comanches d’avoir à suivre au plus près les troupeaux, et sa capacité de transport leur permet d’accumuler des réserves conséquentes de viande séchée, constituées pendant une saison de chasse allongée par le climat favorable du Sud. Les avantages sont si évidents pour leur peuple qu’ils décident de réorganiser toute leur économie de subsistance autour du bison. La société comanche devient ainsi l’une des rares dans l’Histoire à se reposer aussi largement sur une ressource alimentaire unique. Cette mutation fait littéralement exploser son apport calorique global, engendrant une progression démographique rapide et soutenue, et par conséquent une véritable « comanchérisation » des Plaines du Sud. Ainsi libérés du souci de l’approvisionnement en produits de première nécessité, les Comanches peuvent se consacrer au développement d’un véritable empire commercial et militaire.
L’accès aux seuls biens manufacturés du Nouveau-Mexique ne leur offrant que de maigres perspectives, ils se séparent de leurs alliés Utes et pénètrent durablement dans les plaines, notamment dans la haute vallée de l’Arkansas, lieu important du transit de peaux et de viandes déjà exploité par les Français depuis 1700 avec les Apaches 11. Toutes les conditions y sont réunies pour opérer une conversion totale vers le nomadisme équestre, soit plus qu’une capacité de déplacement accrue : « Le cheval était aux Comanches ce que les bateaux, les fusils et l’or étaient aux puissances impériales européennes – un moyen de transport qui réduisait les unités spatiales à une taille autorisant la conquête, une arme de guerre qui leur permit de jouir d’un pouvoir beaucoup plus grand que leur nombre aurait pu le suggérer, et un bien très recherché sur lequel un empire commercial pouvait être bâti12. »
L’accès privilégié au cheval favorise très vite l’épanouissement de presque tous les peuples des Grandes Plaines. Jouissant d’un environnement propice, les Comanches développent une activité pastorale de plus en plus soutenue qui requiert des déplacements incessants pour fournir de nouveaux pâturages aux troupeaux. Cela pénalise directement l’économie nomade spécialisée dans le bison – qui, elle, requiert des périodes d’immobilité. Au milieu du XVIIIe siècle, les Comanches adoptent une économie mixte de chasse et de pastoralisme, devenant moins des chasseurs à cheval que des éleveurs de chevaux chassant par ailleurs.
Ils deviennent des éleveurs talentueux capables d’assurer une augmentation soutenue de la taille de leurs troupeaux domestiques. La reproduction sélective leur permet aussi de maîtriser l’endurance, la rapidité, la taille ou la robe de leurs bêtes, si bien que le mustang comanche finit par être largement apprécié comme un cheval sûr, rapide, agile, bien proportionné et d’humeur égale 13.
Nord
Au tournant du XVIIIe siècle, les récentes guerres contre les Iroquois ont jeté les Algonquiens du Pays-d’en-Haut 14 toujours plus à l’ouest. Ces migrations et la concentration de population ont perturbé leur cycle habituel d’abondance et de disette. L’intrusion – bien que difficile – du commerce de fourrure a épuisé le gibier dans certaines régions, rendant les campagnes de chasse plus rudes et risquées. Dans ce contexte, la survie reste la priorité et le commerce de fourrure est loin de constituer une sphère à part dans leur organisation : il est complètement intégré à leur économie de subsistance. Les Algonquiens préfèrent choisir des terres propices à l’agriculture et offrant un gibier plus abondant. Peu leur importe que ces terres soient pauvres en castors, puisqu’ils restent largement indépendants du commerce de sa peau.
Même sur les Plaines du Nord, cette indépendance des Indiens restera une épine dans le pied des commerçants européens jusqu’au milieu du siècle suivant. C’est à ce moment que l’acquisition du cheval par les Shoshones et les Têtes Plates, et leur entrée sur les territoires des Blackfeet et des Gros Ventres, poussent ces derniers à rechercher désespérément des chevaux et des armes à feu. Cela marque le début d’un commerce d’armes très actif avec les Anglais et les Français. La Hudson’s Bay Company et la North West Company sautent sur l’occasion et construisent plusieurs avant-postes dans les années 1780, transformant les Plaines du Nord en un vaste district du commerce de fourrures 15.
Incapables de faire prospérer les chevaux dans de trop rudes conditions climatiques 16, les Indiens des Plaines du Nord sont confrontés à une pénurie chronique qui les rend de plus en plus dépendants du commerce européen. Ce dernier se nourrit d’ailleurs des cinquante années de guerre – les horse wars – qui s’ensuivent, ravageant les tribus les plus faibles, incapables de constituer un troupeau suffisant, et régulièrement exposées aux microbes apportés par les colons.
Sud
« L’aventure ? Pas plus que tirer un bœuf dans un enclos. »
Frank Mayer
Au sud de l’Arkansas, les températures sont certes plus clémentes et le pâturage plus abondant, mais le succès des Comanches dans les Plaines n’aurait pas été si éclatant sans le pillage incessant des régions limitrophes. Ils utilisent les raids comme un véritable moyen de production destiné à alimenter leur économie pastorale. Dès la fin des années 1730, ils combattent armés de longues lances à pointe de métal et de petits arcs adaptés à la guerre montée, et ils ont adopté d’épaisses armures de cuir pour se protéger, eux et leurs montures. Leur adresse, associée à la grande mobilité apportée par l’utilisation du cheval, rend les Comanches quasiment insaisissables 17.
Le pillage des colonies jouxtant les Plaines du Sud permet aux Comanches d’augmenter leur capacité à commercer sans réduire les pâturages disponibles pour leurs troupeaux. Les raids procurent aussi des chevaux déjà domestiqués, c’est-à-dire une marchandise prête à la vente, contrairement aux mustangs, dont le dressage requiert beaucoup d’investissement de la part des guerriers. Sanaco, un chef des Comanches de l’Est, refuse par exemple de vendre son mustang favori aux Américains sous prétexte que ce serait « une calamité pour toute sa bande, qui [a] souvent besoin de la rapidité de cet animal pour assurer la réussite d’une chasse au bison. En outre, dit-il, je l’aime énormément 18 ».
La première victime des razzias comanches est le Nouveau-Mexique, qui se trouve étranglé économiquement à la fin des années 1770. La colonie espagnole, qui possédait quelque 7 000 chevaux en 1757, n’en a plus assez en 1775 pour ses soldats, incapables dès lors d’assurer sa défense. La terreur devient telle que les agriculteurs refusent régulièrement de s’éloigner des places fortes pour travailler la terre. Le colon se retrouve lui-même colonisé, non par une occupation effective de ses terres, mais par l’utilisation de celles-ci comme une ressource qu’on peut ponctionner à l’envi. L’Empire espagnol est à ce point humilié qu’il doit alimenter les foires commerciales du Nouveau-Mexique en produits divers – cigarettes, ponchos, lainages et sacoches – afin de racheter ses propres mules, chevaux ou esclaves aux Comanches. Il aura beau décréter un embargo sur la vente d’armes à feu aux Indiens, ces derniers le contourneront en utilisant le nœud commercial du haut bassin de l’Arkansas et les échanges avec les Grandes Plaines du nord et de l’est pour établir un flux substantiel d’importation d’armes à feu. Dès 1767, les officiels espagnols s’inquiètent de l’éventualité que les Comanches soient mieux armés que leurs propres soldats 19.
Alors qu’ils comptaient moins de 1 500 âmes en 1726, les Comanches sont déjà plus de 10 000 en 1750 et sans doute près de 24 000 au début des années 1780. Ils établissent à cette époque un nouveau lien commercial avec la vallée inférieure du Mississippi et la Louisiane espagnole, alimenté par le pillage systématique du Texas. Les raids y seront si intenses que, vers 1810, l’État est pour ainsi dire déserté : les industries du cuir, du textile et du sucre périclitent, et de nombreux troupeaux de bêtes non marquées divaguent, faute de cavaliers pour les surveiller 20.
La puissance militaire et économique des Comanches est directement liée à leur richesse en chevaux. Au début du XIXe siècle, ils disposeront de près de quatre chevaux par individu, soit entre 90 000 et 120 000 bêtes excédentaires. Cette situation quasi monopolistique sur les Plaines du Sud leur assurera une grande stabilité, et surtout l’indépendance par rapport aux puissances européennes et américaines, voire une insolente domination sur ces dernières.
Nord
« Là où on trouvait le buff21, on était les rois de tout ce qu’on pouvait voir – et tuer. C’était une règle généralement bien établie qu’aucun homme ne pouvait rentrer dans un troupeau qui était en train d’être travaillé par son premier découvreur. »
Frank Mayer
Dans le Pays-d’en-Haut, comme dans le reste du continent, « les Européens ont altéré à la fois l’objet, l’intensité et la forme du commerce 22 ». En s’appuyant sur une tradition à la peau dure de propriété commune des biens et des terres, les Indiens permettaient à toute population affamée de chasser le gibier là où elle le trouvait, y compris le castor… mais les fourrures destinées au commerce échappent dès le début du XVIIIe siècle à ce régime. La question de la légitimité à chasser sur un territoire donné devient dès lors pointilleuse et génère nombre de conflits. Elle accroît également d’un cran la pression sur le gibier : les fourrures devenant de plus en plus convoitées, les chasseurs se mettent à négliger les règles élémentaires permettant aux populations d’animaux de se renouveler. De plus en plus de jeunes castors ou de femelles parturientes sont tués, avec bien souvent pour seule justification la certitude qu’un autre ne se priverait pas de le faire.
Une telle évolution est principalement due au grand attrait des Algonquiens pour les produits manufacturés européens. À la fin du XVIIIe siècle, parmi les vêtements qu’ils portent, les Indiens du Pays-d’en-Haut ne fabriquent pratiquement que leurs mocassins, et encore à l’aide de poinçons européens. Outre les armes des guerriers, la quasi-totalité des ustensiles ménagers est d’origine européenne : couteaux, marmites, outils de couture, bols et cuillères en bois23… Dans de telles conditions, certains décideurs du Vieux Continent sont portés à croire que la dépendance des Indiens vis-à-vis des colons est totale. Cependant, tout au long du XVIIIe siècle, ils sauront tirer profit de la concurrence entre Français et Anglais, et des enjeux stratégiques de la région pour lutter contre les logiques du marché. Par ailleurs, ils n’ont pas oublié du jour au lendemain leurs anciennes pratiques et restent capables, en cas de désaccord sur les prix par exemple, de se passer des produits européens : les Piankashaws en 1780, ou encore les villageois de la Wabash en 1782 se remettent à chasser avec arcs et flèches, et à porter des peaux de bisons en guise de couverture.
Sud
« De deux choses l’une : soit les buffalos doivent disparaître, soit les Indiens doivent disparaître. C’est seulement quand l’Indien sera absolument dépendant de nous pour tous ses besoins qu’on pourra le maîtriser. »
Un commandant de l’armée américaine, vers 1875
Incapables de maîtriser militairement les insaisissables Comanches, les Espagnols s’en remettent à la diplomatie et au commerce. En 1786, le gouverneur de la Nouvelle-Espagne, Bernardo de Gálvez, diffuse ses Instructions pour gouverner les Provinces Intérieures de la Nouvelle-Espagne, qui définissent la nouvelle stratégie coloniale. Les Instructions prévoient les moindres détails : les fusils échangés doivent par exemple avoir « des culasses fragiles et être dans un acier moins bien trempé », avec de longs canons les rendant « peu maniables lors des longues chevauchées, ce qui entraînera des dommages constants et des besoins répétés de réparation ou de remplacement ». Gálvez espère ainsi que lorsque les Indiens auront « commencé à perdre leur habileté à l’arc, […] ils [seront] contraints de rechercher notre amitié et notre aide 24 ».
Malheureusement pour les colons, l’étendue du réseau commercial des Comanches leur permet bientôt de s’approvisionner en fusils de qualité auprès des Anglais du Missouri, grâce à leurs alliés Panismahas. Toutes les tentatives espagnoles resteront inefficaces tant que leur nouveau mode de vie assure aux Indiens la supériorité militaire et un rayonnement commercial sans égal sur les Plaines du Sud.
En déclarant, en 1793, qu’« aucun homme n’a le droit de vivre de la chasse sur des terres susceptibles d’être cultivées » et que si « les sauvages ne peuvent être civilisés et n’abandonnent pas leurs occupations, ils dépériront et disparaîtront du fait même de leur obstination », Benjamin Lincoln 25 fait montre d’une méconnaissance profonde de la variété des modes de vie des Indiens d’Amérique du Nord. Il s’obstine à appliquer la vieille équation sauvage = chasse / civilisé = agriculture. Pendant près d’un siècle, d’autres après lui nourriront et justifieront leur foi en la fin prochaine et nécessaire des civilisations autochtones avec des arguments similaires.
Du côté de la Nouvelle-Espagne, on craint que ce soit surtout les colons frontaliers qui « dépériront et disparaîtront » si les Comanches continuent sur leur lancée. À la fin du XVIIIe siècle, les autorités militaires ordonnent au gouverneur du Nouveau-Mexique de trouver un moyen de les inciter à s’installer dans des villages d’agriculteurs pour qu’ils oublient la chasse. Lors d’une période de paix relative, les Espagnols iront jusqu’à construire – en vain – des maisons en adobe munies d’enclos pour les moutons et les bœufs dans l’espoir d’y voir les Comanches se transformer en fermiers sédentaires. La méfiance des Indiens vis-à-vis d’un mode de vie sédentaire 26 s’explique par le destin tragique de ceux qui, comme les Apaches, ont fait ce choix, et se sont ainsi retrouvés à la merci des raids, des sièges, et surtout de la variole qui décime par exemple un tiers des Hidatsas, la moitié des Arikaras et presque tous les Mandans lors de l’épidémie de 1837-1838 27.
Nord
« Le massacre était peut-être une chose scandaleuse et inutile. Mais c’était aussi une chose inévitable, une nécessité historique. »
Frank Mayer
Le castor presque disparu, les chasseurs du Pays-d’en-Haut se tournent vers le cerf à queue blanche 28. Quand ce dernier se fait rare à son tour, les commerçants se mettent à accepter les « menues pelleteries » – c’est-à-dire les fourrures des ratons laveurs, des daims ou encore des ours – jusque-là peu prisées. Durant tout le XVIIIe siècle, l’équilibre des forces coloniales en présence dans la région a beau changer, le commerce détermine toujours plus les pratiques de chasse, et le gibier disparaît.
Au tournant du XIXe siècle, les Indiens se voient obligés de compléter leur activité de chasse avec l’élevage des animaux domestiques – chevaux, bétail, porcs et volailles 29. Cette nouvelle économie mixte bouleverse leur cycle migratoire, et le gibier ne peut plus repeupler les régions habituellement laissées à l’abandon pendant une partie de l’année. Les chasses sont de moins en moins fructueuses, et la conversion est loin de convaincre tout le monde. Certains prophètes expliquent même la disparition des animaux sauvages par l’adoption des animaux domestiqués. En 1803, une vieille Indienne interprète quant à elle la situation ainsi : « La conversion fait de l’Indien un être “domestiqué”, et, une fois “domestiqués”, les Indiens peuvent être massacrés par les Blancs comme du bétail 30. »
Sud
« J’ai appris que le dépeçage était un boulot dégueulasse, désagréable, pénible et répétitif. Évidemment, j’ai jamais dépecé moi-même. J’étais le chasseur, le tueur, et le dépeçage c’était pour les dépeceurs. J’avais de la peine pour ces pauvres gars […]. Mais c’était leur rôle dans la partie. »
Frank Mayer
En entrant dans les Plaines, les Comanches perdent les deux tiers de leurs connaissances botaniques 31. Dès 1750, la cueillette a perdu de son importance, et le poisson est devenu tabou ; la volaille reléguée au rang d’alimentation alternative. Le régime alimentaire des Comanches devient extrêmement riche en protéines et pauvre en glucides. Ce déséquilibre nutritionnel chronique cause des fausses couches, des insuffisances pondérales à la naissance et des altérations cognitives. L’intensification de leur économie de chasse devient dès lors pour eux une question de survie : il leur faut assurer un accès aux marchés pour pouvoir échanger leur excédent de viande, de graisse et de peaux contre des produits agricoles dans les foires commerciales 32. Le passage à une économie principalement pastorale ne change rien au problème : la pérennité de l’empire comanche repose sur son aptitude à maintenir ses troupeaux de chevaux comme accès aux produits qui lui manquent.
Ce besoin vital est à la base de toutes les transformations que connaît la société comanche au cours du XVIIIe siècle. La première concerne leur unité politique de base : le numunahkahnis, ou la ranchería en espagnol. Le cheval a besoin d’environ 10 kg d’herbe par jour 33, et il est relativement difficile en ce qui concerne son pâturage, si bien qu’un troupeau de mille têtes a besoin d’une zone d’au moins trois hectares par jour. Par conséquent, les Comanches sont rapidement obligés, dès le début du siècle, de se scinder en de nombreuses bandes de taille réduite. Ces groupes sont constitués de vingt à plusieurs centaines d’individus sous la houlette d’un chef unique, le paraibo, qui en assure la cohésion. Cette unité sociale de base est une des explications de la flexibilité et de la résilience de la société comanche : « Vue de l’extérieur, cette nation constituait une entité amorphe sans centre identifiable avec lequel négocier – ou susceptible d’être supprimé – et sans structure interne explicite qui aurait pu rendre sa politique extérieure prévisible. De fait, la puissance des Comanches existait non malgré leur organisation sociale informelle voire atomisée, mais bien grâce à elle 34. »
La transformation la plus violente et radicale a trait à l’organisation du travail, au sein même des rancherías. Une famille comanche possède en moyenne trente-cinq chevaux et mules, soit cinq à six fois plus que les besoins basiques en nourriture et transport 35. L’excédent accroît considérablement le pouvoir commercial des Comanches, mais exige également de consacrer de plus en plus de temps à la surveillance et au soin des troupeaux, leurs principales activités à partir de 1800. Certes, l’adoption du cheval a transformé la chasse au bison en une activité extrêmement efficace, libérant une grande quantité de force de travail, néanmoins, les nouveaux débouchés commerciaux requièrent toujours plus de main-d’œuvre dédiée aux tâches pastorales et à la préparation des peaux. La polygynie 36 et l’esclavage leur fournissent la solution.
La nouvelle organisation productive repose sur une division stricte du travail en fonction du sexe et de l’âge : ce sont des hommes qui ont à leur charge la planification stratégique – concernant les déplacements et les zones de pâturage –, la préparation et la réalisation des raids. Ce sont également les hommes adultes qui capturent et dressent les chevaux destinés à la chasse et à la guerre. Les adolescents, quant à eux, n’ont pas le loisir de passer leurs journées à s’exercer à des jeux guerriers. Ils sont responsables d’à peu près cent cinquante chevaux chacun qu’ils doivent déplacer entre les pâturages et faire boire deux à trois fois par jour. Par ailleurs, il leur faut protéger leur troupeau des prédateurs, soigner les bêtes blessées, et rentrer chaque soir les chevaux les plus précieux à l’intérieur du campement. L’hiver est la période la plus rude pour eux, puisqu’ils doivent aller chercher l’herbe ou le complément de fourrage de plus en plus loin du campement, avec des chevaux toujours plus faibles.
Pourtant, ils sont loin d’être les plus mal lotis. La chasse et la guerre montées ont mis en valeur l’audace et la prise de risque, et conféré un prestige important aux activités masculines. Les hommes dominent clairement la sphère publique et contrôlent la redistribution des biens les plus précieux, dispensateurs de richesse. Les femmes, cantonnées à la sphère domestique, se voient assigner depuis le début du XVIIIe siècle une charge de travail de plus en plus harassante. Un observateur contemporain, John Sibley, décrit ainsi leur condition en 1807 : « Elles semblent être constamment et laborieusement occupées à préparer les peaux de bisons, à les peindre et les décorer avec une grande variété de couleurs et de motifs, à fabriquer leurs vêtements et ceux de leur mari, à ramasser le combustible, à surveiller et garder leurs chevaux et leurs mules, à cuisiner, à fabriquer des licous et des cordes en cuir, à construire et à réparer leurs tentes et à fabriquer les selles de monte et de bât 37. » Une femme seule ne peut évidemment pas s’occuper de tous les chevaux capturés par un homme, pas plus qu’elle ne peut préparer toutes les peaux qui s’accumulent avec l’adoption de la chasse montée. Les chefs de famille qui le peuvent prennent donc plusieurs femmes, bouleversant ainsi l’ancien système polyandrique, et augmentent par ce moyen la réserve de main-d’œuvre disponible pour le foyer.
Quant à l’esclavage, il existait dans la société comanche avant le contact avec les Européens 38. Toutefois, ce sont les épidémies de variole du début du XIXe siècle et la pénurie chronique de main-d’œuvre qui en découle qui transforment l’esclavage en institution à visée essentiellement économique et productive. En s’appuyant sur des raids fréquents au Texas et dans le nord du Mexique, les Comanches alimentent leur nouvelle classe laborieuse avec une telle efficacité que, rapidement, leur population se compose de 10% à 25% d’individus serviles.
Nord
« Mais j’étais pas un Indien. J’étais un businessman. Et je devais apprendre à moissonner la récolte de buffalos comme un businessman. »
Frank Mayer
Au grand dam des colons français, la société algonquienne est étrangère à tout pouvoir coercitif. Or, si le regard européen croit identifier des chefs, il s’agit avant tout d’individus influents autorisés par la communauté à négocier avec les étrangers, et non de caciques capables d’imposer leur volonté au reste de la population. Leur capacité à être écoutés, et donc leur puissance politique, dépend principalement de l’étendue des réseaux de solidarité qu’ils peuvent satisfaire. On attend d’eux qu’ils captent le plus de présents possible auprès des Français et qu’ils les redistribuent équitablement. Il ne faut pas, cependant, négliger leur importance : l’ampleur du commerce de fourrure et les nouveaux enjeux liés aux biens manufacturés européens en font des personnages essentiels dans les jeux diplomatiques et économiques des deux camps. Essentiels, mais pas irremplaçables ; d’autant qu’ils ne produisent pas les richesses sur lesquelles se fonde leur pouvoir – ils ne sont que des intermédiaires.
Dans les Plaines du Nord, la stratification sociale est plus précoce et plus marquée, notamment parce que le cheval y est à la fois extrêmement précieux et rare. Ainsi, posséder ne serait-ce qu’un cheval supplémentaire peut avoir des répercussions sociales importantes. Les propriétaires acquièrent non seulement un niveau de vie supérieur, mais accèdent aussi plus facilement au commerce de fourrures. L’arrivée des Américains dans le nord du Missouri, vers 1830, et leur demande exceptionnelle en fourrures de bison accentue le besoin de main-d’œuvre et donc, là encore, l’importance du travail des femmes. Or seuls les grands propriétaires ont le pouvoir d’avoir plusieurs femmes – achetées en chevaux – et de produire toujours plus de peaux. Leur accès privilégié à ces « moyens de production », ainsi qu’aux marchés globaux, leur permet d’employer des gens contre salaire et de leur éviter ainsi tout travail manuel 39.
Sud
Plus au sud, le cheval n’est pas une denrée rare, mais reste très précieux. Les familles les plus riches peuvent posséder jusqu’à trois cents chevaux et mules, ce qui représente une source de capital économique, politique et social immense. Si la plupart des hommes participent aux échanges, peu le font à grande échelle. Ceux qui peuvent se le permettre ont généralement plus de cinquante ans, et ils ont accumulé suffisamment de richesses pour transformer leurs numunahkahnis en véritables unités de production. Ils ont souvent plusieurs dizaines d’esclaves, leurs fils chassent et pillent pour eux, tandis que les courtisans de leurs filles s’attirent leurs faveurs à l’aide de cadeaux 40.
« On rapporte que Chief A Big Fat Fall by Tripping (Chef Gros Lard Tombe en Trébuchant) possédait 1 500 chevaux, mais qu’il était si gros qu’il ne pouvait en monter aucun et se déplaçait sur un travois 41. » De toute évidence, la nouvelle élite comanche du début du XIXe siècle ne passe plus par les exploits guerriers pour se distinguer. Elle préfère louer des chevaux aux jeunes gens contre une part de leur butin, ou encore marier ses filles en échange de travail gratuit pendant quelques années. Inutile dans ces conditions de se fatiguer à chasser ou voler, d’autant qu’on peut facilement perdre la vie dans ce genre d’aventures. Les membres de cette nouvelle aristocratie préfèrent porter leur poids comme un signe distinctif de prestige, ils quittent les habits de chasseur pour des vêtements ostentatoires et se coiffent d’une quantité impressionnante de tresses coupées sur le crâne de leurs prisonnières ou de leurs femmes. Alors que la société comanche était traditionnellement non capitaliste, ces Big Men sont de véritables protocapitalistes. Leurs réseaux étendus de subalternes sociaux et l’accès privilégié aux moyens de production leur permettent d’échapper aux travaux domestiques. Spectaculairement riches, ils ont les moyens de paraître désintéressés, de se soucier du bien-être du groupe en étant généreux en femmes et en chevaux. De cette manière, ils assoient leur autorité morale et leur pouvoir politique et, devenus un réel facteur de stabilité du groupe, ils peuvent songer à fonder leur propre ranchería.
Nord
« Tuer plus qu’on en avait besoin, ç’aurait été gaspiller le buff, ce qui n’était pas important ; ça gaspillait aussi des munitions, et ça, ça l’était. »
Frank Mayer
Dès 1780, le missionnaire morave David Zeisberger alertait ses contemporains à propos des nouvelles pratiques de chasse des Delawares : « En raison du commerce considérable des peaux, les cerfs sont avant tout abattus pour leurs peaux et la viande n’est utilisée que dans la mesure où les Indiens peuvent la consommer durant leur chasse. C’est pourquoi une grande partie de la viande est abandonnée dans les bois aux animaux sauvages. […] Comme un Indien tue de cinquante à cent cerfs chaque automne, on peut aisément comprendre pourquoi le gibier se raréfie 42. » Néanmoins, c’est au tournant du XIXe siècle que le processus s’accélère. Au sud de l’Indiana, dans l’Ohio et l’Illinois, les nouveaux arrivants américains s’emparent de tous les territoires possibles. Persuadés que ce qui se trouve dans la région appartient à qui veut bien s’en saisir, ils massacrent bisons, cerfs, ours et élans. Ceux qui échappent à la tuerie voient leur habitat naturel détruit. Les Blancs forcent également les Indiens à modifier leurs habitudes, à vivre dans des régions plus circonscrites ou à renoncer à la pratique du brûlis. Ces changements privent la faune de territoires libres où profiter d’un peu de répit, ainsi que de sources de nourriture 43.
Dans les Grandes Plaines, les horse wars jouent un rôle critique dans le déclin du gros gibier, et notamment du bison. Le besoin insatiable en armes pousse les Indiens à la surexploitation des troupeaux, lesquels se voient privés des zones tampons séparant habituellement les tribus rivales, et donc de tout refuge. Dans les années 1840, le bison montre des signes alarmants d’épuisement sur les deux rives du Missouri, ouvrant une période de famines qui balayent les Indiens des Plaines 44.
Sud
« On le savait pas, alors, et si on l’avait su, on s’en serait pas fait pour autant, mais nous autres coureurs, on ouvrait le chemin aux éleveurs avec leurs immenses troupeaux et leurs pâturages illimités, plus tard aux sédentaires et plus tard encore aux drive-in, aux “hamburger palace”, aux clubs de femmes et à l’agriculture subventionnée. »
Frank Mayer
L’effondrement de l’empire espagnol, en 1821, entraîne la levée des limitations imposées par les autorités hispaniques : un raz-de-marée de négociants déferle sur les Plaines du Sud par la piste de Santa Fe, et des avant-postes commerciaux américains fleurissent un peu partout. Jusque-là, les Comanches se contentaient de satisfaire des besoins locaux immédiats avec le commerce de viande et de peaux de bisons. En moins d’une décennie, les bisons du territoire comanche se transforment en matière première commerciale, destinée aux marchés industriels lointains, et les troupeaux montrent rapidement des signes de surexploitation. Dans les années 1840, par exemple, les 11 470 Comanches, Kiowas, Cheyennes et Arapahoes tuent plus de 112 000 bisons par an, c’est-à-dire au moins 60 000 au-delà de la limite permettant aux troupeaux de se renouveler 45. En outre, les marchés sont friands du cuir fin et maniable des jeunes vaches de 2 à 5 ans, et les peaux les plus prisées sont produites en hiver, quand les fourrures sont les plus fournies. Or les vaches donnent leurs premiers veaux à l’âge de 3 ou 4 ans et sont en gestation de mi-juillet à avril…
Bientôt, les Comanches commencent à se sentir à l’étroit dans les Plaines. En 1830, les Américains votent l’Indian Removal Act qui force le déplacement des Indiens depuis l’est du Mississippi vers l’ouest. Les territoires comanches sont rapidement envahis par les Cherokees, Creeks, Chiskasaws et Choctaws. Des centaines de Delawares, Shawnees et Kickapoos sont installés au Texas pour servir de tampon contre les pillards. Les Comanches font alliance avec les Cheyennes et les Arapahoes, attirés quelques années plus tôt sur les Plaines du Sud par un climat plus hospitalier et la proximité des marchés du Nouveau-Mexique, pour continuer à exploiter les troupeaux texans 46.
Ces concessions reflètent l’affaiblissement de la position des Comanches au XIXe siècle, dû en grande partie à la pression toujours plus accrue sur leurs territoires, mais aussi à la raréfaction du bison dans les plaines. Acculé par la démultiplication des chasseurs, le grand mammifère est constamment perturbé dans ces migrations le long de la piste de Santa Fe. De plus, les zones tampons aux marges des Grandes Plaines ont disparu, le privant d’un havre traditionnel où les troupeaux pouvaient jadis se reconstituer. Au cœur des plaines, ce n’est guère mieux : à partir de 1825, on estime que d’entre 250 000 et 500 000 chevaux domestiques et plus de deux millions de mustangs sauvages concurrencent le bison sur près de 80% de son alimentation et sur ses besoins en eau. Il souffre aussi de maladies (anthrax, tuberculose et brucellose) introduites depuis la Louisiane dès 1800, ou transmises par les troupeaux domestiques du Texas 47.
Le système économique des Comanches s’avère écologiquement précaire. La fin du petit âge glaciaire 48 et les dix ans de sécheresse qui commencent en 1846 leur portent un coup dont ils auront du mal à se relever. Privés de leur base de subsistance et incapables d’utiliser le pillage avec autant d’efficacité que par le passé, ils en sont réduits à se procurer de la viande de bœuf, des fruits et des vêtements sur les marchés. Quelques-uns se mettent à élever des moutons et des chèvres ; le tabou sur la consommation de poisson et les restrictions sur les volatiles sont levées. Les famines successives les poussent même à manger leurs chevaux. Sans doute près de 20 000 en 1840, les Comanches ne sont plus que 10 000 en 1850 49. Leur société a certes su s’adapter à des changements extraordinaires, mais comme l’a écrit Dan Flores : « Deux siècles se sont avérés trop courts pour leur laisser le temps d’élaborer un système écologique viable autour du cheval […]. Certaines forces, telles le besoin des tribus d’étendre leur nombre et les bénéfices d’une participation au commerce de fourrures, allèrent à l’encontre de leur besoin de préserver les troupeaux de bisons. En outre, nombre des forces qui façonnèrent leur monde échappaient largement aux tribus des Plaines 50. »
En 1871, la demande en bœuf des grandes villes du Nord explose et le Texas, fort de ses cinq millions de têtes de bétail et du terminus ferroviaire de la compagnie Kansas Pacific à Abilène, rêve de saisir cette opportunité. Pour permettre l’avènement d’un capitalisme post-esclavagiste, il ne manque plus à l’élevage texan qu’un accès libre et stable aux herbages et aux voies naturelles des Plaines du Sud.
La survie même des Comanches, qui contrôlent encore largement les Plaines, gâche le rêve américain. Dès lors, l’état-major américain ne tarde pas à lancer une guerre totale contre eux, les privant d’abris et de moyens de subsistance, détruisant leurs camps hivernaux, leurs vivres et leurs troupeaux. Cette campagne militaire d’envergure contraint les Comanches à se déplacer sans cesse, bouleversant ainsi leur cycle de subsistance. Les Américains, qui ont longtemps misé sur la disparition du bison pour affaiblir leurs ennemis, passent à l’offensive en s’appuyant sur une infrastructure impressionnante basée à l’est. Un assaut crucial, la bataille d’Adobe Walls, a lieu en juin 1874, et les Comanches, vaincus et pratiquement sans ressources, rejoignent les réserves en masse. En 1867, de retour de Washington où il avait pu contempler les villes, les usines, les chemins de fer et les fermes à perte de vue, le chef comanche Paruasemena s’était déjà rendu à l’évidence : « Il est trop tard, l’homme blanc possède le pays que nous aimions et nous ne demandons plus qu’à errer sur la prairie jusqu’à notre disparition 51. »
Épilogue
« Ouais, on était devenus efficaces et économes au moment où y avait plus de raison de l’être. On est devenus efficaces trop tard. On avait appris le métier, mais on pouvait plus le pratiquer et ça, c’est toujours tragique. »
Frank Mayer
En 1870, les tanneurs de Philadelphie inventent un nouveau procédé chimique pour la transformation des peaux de bisons en un cuir industriel extensible permettant de fabriquer des courroies pour les machines. Les peaux, déjà très appréciées dans l’Est, voient leur prix exploser, et ce malgré une augmentation soutenue de l’approvisionnement. Cette innovation accélère l’exploitation industrielle du bison des plaines et précipite des milliers d’Américains en quête d’aventure et de profit vers l’Ouest. Ces coureurs de bisons bénéficient d’un support logistique important grâce au chemin de fer, qui assure le transport rapide de la marchandise, et à l’armée des États-Unis qui leur procure volontiers des munitions.
En sept ans de massacres, ils tuent quelque dix millions de bisons sur l’ensemble des Grandes Plaines. Le mammifère ne devra d’être sauvé de l’extinction totale qu’à l’action de quelques éleveurs passionnés, perçus à l’époque comme de sacrés illuminés tant les troupeaux semblent alors inépuisables. Une fois les prairies jonchées de cadavres pourrissants, les personnes les plus entreprenantes de l’époque empoisonnent les carcasses pour piéger les charognards venus s’en repaître. Les ossements, quant à eux, servent à alimenter l’industrie des fertilisants. Décidément, tout est bon dans le bison.
- Toutes les citations en exergue sont tirées de Tueur de bisons, Anacharsis, 2010. Il s’agit d’un entretien réalisé dans les années 1940 avec Frank Mayer (1850-1954), qui courut le bison à partir de 1872. ↩
- Bien qu’armés d’un fusil et tirant à bonne distance, les chasseurs occidentaux de bison se désignent eux-mêmes par le terme de « coureurs », en référence à la technique de chasse des Indiens des Plaines. ↩
- Dan Flores, « Bison Ecology and Bison Diplomacy : The Southern Plains from 1800 to 1850 », The Journal of American History, Vol. 78, no 2, 1991. ↩
- Pekka Hämäläinen, L’Empire comanche, Anacharsis, 2012, pp. 51-54. ↩
- Timothy Brook, Le Chapeau de Vermeer, Petite Bibliothèque Payot, 2012, p. 67-68. ↩
- Les Pueblos étaient un peuple autochtone établi au Nouveau-Mexique. Après avoir été assujettis par les Espagnols au début du XVIIe siècle, ils se révoltèrent en 1680 et en 1696, faisant à chaque fois main basse sur les biens espagnols, et notamment sur un grand nombre de chevaux. Nous en reparlerons. ↩
- Voir L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 65-66. ↩
- Ibid., p. 57. ↩
- « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité. ↩
- Pekka Hämäläinen, « The First Phase of Destruction Killing the Southern Plains Buffalo, 1790-1840 », Great Plains Quaterly, article 2227, 2001. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 64. ↩
- Ibid., p. 386. ↩
- Ibid., p. 394-397. ↩
- Le Pays-d’en-Haut est la région à l’ouest de la vallée du Saint-Laurent, correspondant à peu près au bassin des Grands Lacs, jusqu’à la vallée de l’Ohio au sud. Il est peuplé par une grande variété de tribus de langue algonquienne comme les Miamis, les Ojibwés, les Illinois et les Renards. ↩
- Ibid. ↩
- L’hiver de 1801-1802, par exemple, laissa les Blackfeet et les Gros Ventres pratiquement sans chevaux. Voir ibid. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 82. ↩
- « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité. ↩
- Ibid., p. 132. ↩
- Ibid., p. 173-174 et 305. ↩
- C’est-à-dire « le buffalo », le bison. ↩
- « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité. ↩
- Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 650-651. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 223-224. ↩
- 1733-1810, tout premier Secrétaire à la guerre des États-Unis, de 1781 à 1783 (À ne pas confondre avec Abraham Lincoln, futur président des États-Unis). La citation vient du Middle Ground, ouvr. cité, p. 636. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 214-216. ↩
- « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Culture », art. cité. ↩
- Le « buck », qui à l’époque correspond à la valeur d’une peau de cerf, désigne encore aujourd’hui un dollar. ↩
- Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 656. ↩
- Ibid., p. 682 ↩
- « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité. ↩
- Voir « The First Phase of Destruction », art. cité. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 389-390. ↩
- Ibid., p. 436. ↩
- Voir « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité. ↩
- La polygynie est la relation conjugale où les hommes ont plusieurs femmes, la polyandrie celle où les femmes ont plusieurs hommes. La polygamie étant le nom générique pour le fait d’avoir plusieurs conjoints, hommes ou femmes. ↩
- John Sibley, A report from Natchitoches in 1807, p. 79. <archive.org/details/reportfromnatchi00sibluoft>. ↩
- Voir par exemple Le Middle Ground, ouvr. cité. ↩
- « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 416-417. ↩
- Ibid., p. 415. ↩
- Le Middle Ground, ouvr. cité, p. 661. ↩
- Ibid., p. 660. ↩
- « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité. ↩
- « The First Phase of Destruction », art. cité. ↩
- « The Rise and Fall of Plains Indian Horse Cultures », art. cité. ↩
- « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité. ↩
- Période climatique froide survenue en Europe et en Amérique du Nord du début du XIVe siècle et qui s’achèvera vers la fin du XIXe siècle. ↩
- L’Empire comanche, ouvr. cité, p. 476. ↩
- « Bison Ecology and Bison Diplomacy », art. cité. ↩
- Ibid., p. 518-519. ↩