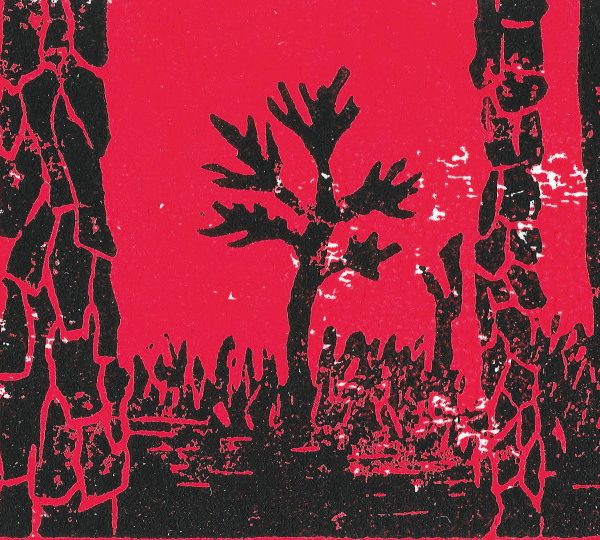Qu’est-ce que les migrant-e-s extra-occidentalisé-e-s nous apprennent en arrivant en Europe de l’Ouest ? Cette question n’est presque jamais posée, selon le philosophe Jérémie Piolat.
L’auteur du Portrait du colonialiste, L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions (éd. La découverte, coll. Les empêcheurs de penser en rond, 2011) a travaillé avec des associations liées à l’alphabétisation des migrant-e-s. Il y a tenté d’apprendre sur lui-même et sur la disparition des cultures populaires dans les pays occidentalisés. Durant ce terrain, il a pu se rendre compte à quel point les intentions émancipatrices des logiques d’accueil restent empreintes de colonialité et de domination culturelle. L’enjeu est alors, au-delà de la décolonisation, la « décolonialisation ».
Ce texte est une transcription reprise par Jérémie Piolat, à partir d’une discussion proposée par les Ateliers d’histoires populaires de Vaour, dans le Tarn, en septembre 2014 (Voir présentation en fin d’entretien).
Texte établi avec le concours d’Alexane Brochard.
*
*
Même si cela semble impossible, pourrais-tu tenter de définir ce qu’est une culture populaire ?
Je peux essayer, à partir de mon expérience et de mes rencontres. À chaque fois que je suis parti quelque part, je connaissais des gens sur place – comme à la fin des années 1990, lorsque je me suis rendu à Yeumbeul, un quartier de la banlieue de Dakar. Là-bas, j’ai été marqué par la rage des jeunes, et l’incroyable manière qu’ils ont de rapper. Mais j’ai surtout été sidéré par leur puissance intellectuelle. Venant de porte de la Chapelle à Paris, j’ai moi-même pu fréquenter ce lieu mis au ban qu’on appelle la banlieue. J’y ai rencontré des gens très intéressants, mais jamais cette force, trouvée à 40km de Dakar, où la situation économique est très difficile, avec 80% de chômage.
Quand je suis parti, je voulais entamer un doctorat en philosophie sur la manière dont les danses populaires ont disparu d’Europe de l’Ouest. J’avais en tête deux ou trois terrains pour montrer ce qu’était une danse populaire : les gitans de la banlieue de Paris, le hip-hop avant qu’il n’entre dans l’arène du marché (bien que tout ce qui se produit dans cette arène ne soit pas déplaisant, loin de là) et les jeunes de Yeumbeul. Un ami franco-Sénégalais m’y a invité pour que je voie comment ça se passe, en me proposant d’apporter une caméra. J’y ai finalement réalisé un film1 – qui est plutôt bon, non pas parce que je l’ai fait, mais grâce à ceux qui sont dedans, ces jeunes qui tiennent des discours extrêmement complexes.
Je me rappelle par exemple de ce type de 19 ans, Alassane N’Diaye, qui, sachant que j’avais fait des études de philosophie, était venu me voir en me disant que la philosophie était « une matière très prenante » et qu’il avait déjà écrit 200 pages sur « les vertus de l’imperfection humaine ». Il m’a expliqué en quoi l’imperfection est ce que nous avons tous en commun : « Que le blanc sache, m’a-t-il dit, qu’au-delà de tous les paramètres qui constituent l’ensemble de son univers restrictif, il a quelque chose en commun avec celui qu’on appelle “nègre”. Et ce quelque chose, c’est son imperfection. » Nous sommes là en présence d’une pensée complexe, nourrie entre autres, par la pratique de l’Islam. Dans le film, Allassane N’Diaye va assez loin, avec d’autres aussi, sur ce qu’est la danse, le rapport entre banlieue et centre-ville ou sur la manière dont la philosophie occidentale a cloisonné le corps et l’esprit. Ce philosophe de rue, manager à cette époque d’un groupe de rap, développait déjà en partie une des thèses relatives à la mise à distance et la mécanisation du vivant que l’on retrouve par exemple dans l’ouvrage extraordinaire de David Abram, Comment la terre s’est tue2. À ce moment-là, j’ai senti être confronté à ce qu’était une culture populaire.
La puissance intellectuelle de ces jeunes de Yeumbeul que j’ai appelés des « philosophes de rue » ne venait pas seulement de l’école (y compris en ce qui concerne leurs lectures), mais aussi et surtoutde leur propre culture, de la manière dont ils dansaient, pensaient, de leur appétit intellectuel insatiable. Cet appétit m’est apparu à l’évidence comme un pouvoir transmis par leur culture, saisie au sens mouvant, évidemment – je préfère d’ailleurs de plus en plus au mot « culture » les mots « pouvoirs3 » et « savoirs ». Leur puissance vient également de la mémoire – et de leur capacité à l’exercer – qu’ils ont de leur communauté. Je pense notamment aux Peuls, qui connaissent en général toute l’histoire de leur communauté, proche et lointaine ; même quand ils sont ou ont été balayeurs ici. Moi, je suis incapable de faire l’histoire de ma propre famille. Il ne s’agit pas d’idéaliser les Sénégalais ou d’autres peuples, mais en France, nous avons souvent tendance à stigmatiser ce qui fait problème chez les migrants ou les extra-occidentaux, en oubliant de mettre en valeur ce qu’il y a d’éblouissant et de puissant chez eux.
Une culture populaire, pour répondre donc à votre question, c’est quelque chose qui ne s’apprend ni dans les conservatoires ni à l’école, en cours de philosophie ou de civisme, mais bien d’abord dans la famille, dans la rue, dans les fêtes cérémonielles, dans les quartiers. Elle n’est évidemment pas atemporelle, mais bien en relation avec les processus historiques et politiques en cours. Elle n’est pas non plus un ensemble de représentations et pratiques inconscientes dont seuls les anthropologues occidentaux seraient à même de dévoiler les véritables tenants. Une culture populaire, c’est quelque chose qui se transmet et se transforme en même temps, de génération en génération. Cela peut toucher à l’art d’accueillir, à celui d’habiter un environnement, de danser, de chanter, de conter, d’accueillir les nouveau-nés, de prendre en compte les étapes majeures de la vie.
En quoi cette vision de ce qu’est une culture entre-t-elle en jeu dans ton travail associatif avec les migrant-e-s ?
Disons que c’est sur cette base culturelle que je travaille avec les migrant-e-s, dans des espaces où, loin de chez eux, ils sont censés se retrouver et s’approprier une langue commune, le français. Ça, c’est le discours officiel, mais ce qui m’intéresse vraiment dans les ateliers que je mène, c’est la mise en lumière de leurs cultures (ou plus exactement des savoirs et pouvoirs issus de leurs cultures, en jeu dans leurs pratiques culturelles) et du regard qu’ils portent sur l’Europe de l’Ouest. Ce que j’ai vu au Sénégal, et dans différents endroits ici, m’a fait comprendre que les « blancs » (comme dirait le Parti des indigènes de la République (PIR), mais moi je préfère dire les « occidentalisés ») n’ont plus de culture populaire.
J’ai senti une absence. En France, il y a des résistances, des renaissances qu’il faut saluer, mais on ne peut nier un certain vide. Certaines régions ont résisté, comme le Pays Basque, la Corse, la Bretagne ou le monde occitan, mais ce n’est pas le cas de toutes les régions de France et d’Europe de l’Ouest. Tout au long de ma vie, les plus grands processus de solidarités auxquels j’ai assisté venaient toujours des immigrés. Ce sont des immigrés algériens qui m’ont appris, par exemple, qu’on pouvait aimer ses parents. Avant de les rencontrer, je n’étais pas au courant : je pensais que la relation aux parents était nécessairement pénible. Un autre rapport à la famille leur a été transmis, que moi et mes collègues européens de l’Ouest, pour la plupart, ne soupçonnons même pas. Le mot même de « parent » n’a pas le même sens, évidemment, là où l’on met les enfants en crèche dès trois mois, se condamnant soi-même à une inquiétante et violente solitude, et là où on les porte, les allaite et les garde près de soi.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problèmes liés à la parentalité ou à l’éducation ailleurs, où tout serait gentiment parfait. Mais cet « ailleurs », et les pratiques qui ne nient pas les besoins de l’être qui vient de naître et de son ancrage corporel, permettent de pointer certains dysfonctionnements d’ici, en Europe de l’Ouest, particulièrement fascinants.
C’est ce genre de rapports que les Européens ont perdu à travers leurs empires coloniaux ?
Ce que je considère comme le fondement du colonialisme, c’est d’abord une mise à distance, puis à disposition, du vivant, relative aux besoins du marché et de l’« oscultation » mécaniste du monde qu’on appelle « science du vivant ». Ensuite, le fondement du colonialisme, c’est une destruction des cultures qui sont rétives à cette mise à disposition. Ça s’est passé d’abord en Europe de l’Ouest (Voir Starhawk, Femmes, magie et politique), puis ça s’est exporté ailleurs, avec une violence exponentielle. Voici l’hypothèse à partir de laquelle je travaille. Je n’étudie pourtant pas vraiment l’histoire du colonialisme ; ce qui m’intéresse, c’est l’observation du quotidien fabriqué par l’absence de culture populaire. Comment cette déculturation se fait-elle sentir dans le rapport à la danse, à la langue, et à l’éducation des corps ?
Comment les migrants vivent-ils au quotidien les formes de stigmatisation dont ils sont les cibles ?
Par exemple, dans la famille d’une amie proche, française, on en vient à parler de l’islam et de jihad. J’explique – ce qui est selon moi la base – que le mot désigne d’abord un combat sur soi. Ce à quoi la mère de mon amie répond : « En tout cas, je préfère être une femme en Europe, qu’une femme en Afrique noire ou au Maghreb. » Il y a des évidences comme ça, qui circulent, sur lesquelles sont fondées les stigmatisations, profondément et très tranquillement racistes et qu’il nous faut déconstruire. Pour cela, on ne peut faire l’économie de prendre le temps d’étudier, de décortiquer, de comprendre ce qu’elles impliquent en terme de regard et d’ignorance sur les autres et sur soi.
Cette persistance de préjugés en tous genres est particulièrement visible dans des lieux associatifs où l’on affirme travailler pour le bien-être, le droit et l’émancipation des migrants. Je trouve en fait déjà cela incroyable en soi que des associations prétendent « émanciper » des êtres humains adultes. J’ai donc expliqué à l’institution qui m’engageait que ce qui m’intéressait, c’était de mettre en lumière les cultures populaires de ces femmes migrantes. Ce à quoi les femmes qui dirigeaient l’association, très sympas au demeurant, m’ont répondu : « Mais ces femmes n’ont pas de culture. Elles sont taiseuses, opprimées à la maison. » J’ai alors réalisé qu’en 2006, des personnes pensaient encore que des femmes maghrébines ou africaines noires n’avaient pas de culture : elles donnent des cours de français à des gens qu’elles pensent privés de culture, des « sans-culture ».
Or, comme je le disais au départ, quand je parle de « culture », c’est dans un sens très précis, comme pratiques culturelles conscientes des communautés. Si quelqu’un danse, il sait qu’il danse. Je ne savais pas, lors du premier atelier que j’ai donné, que c’était dans le cadre d’un programme d’alphabétisation. À la fin de cet atelier, ces femmes migrantes ont commencé à prendre la parole en public, alors qu’on me les avait décrites comme taiseuses. Elles parlaient aussi très bien français. Cependant, ce qui m’intéressait dans ces ateliers, ce n’est pas que les migrants s’améliorent en français, mais qu’ils m’apprennent quelque chose, à moi, pour m’apporter un regard neuf sur la société dans laquelle je vis.
L’apprentissage de la langue française serait donc une fausse bonne idée pour les migrant-e-s qui arrivent ici ?
Je ne dis pas forcément cela, mais si ces ateliers leur ont permis d’apprendre le français, c’est selon moi un « dégât collatéral », car je n’ai pas forcément voulu œuvrer à ça. On m’a même demandé de donner des formations pour les gens qui alphabétisent les migrants : des formations un peu particulières, pour sensibiliser à la créativité linguistique des migrants qui apprennent – ou plutôt se battent avec la langue française. En utilisant des textes écrits dans mes ateliers, édités sans corrections, textes où en général celui qui écrit retranscrit – entre autres – son accent, sa musicalité orale, je voulais faire comprendre aux professeurs de français pour étrangers qu’à l’intérieur des « erreurs » de langage que peuvent faire les migrants qui écrivent en français, il y a quelque chose de beau, qui nous renseigne souvent sur la langue de la personne, sur sa culture, son imaginaire, et surtout sur comment notre langue à nous est faite. Il s’agit donc d’un échange. Je pense que ces écrits non corrigés relèvent d’une sorte (entre guillemets, j’insiste) de « créole immigré ». C’est un phénomène incroyable, une langue qui s’invente, et qui procède de la créolité, en référence avec la manière dont s’est construit le créole antillais, par différents peuples qui se sont retrouvés ensemble dans une même situation d’exploitation et qui ont dû trouver une langue commune.
Un jour, dans un atelier, une femme, Sabah, a écrit « J’ai boucop d’histoire dans mon corps à dire ». Au cours de la formation que j’ai donnée aux professeurs de français, j’ai lu strictement ce qui était écrit sur la feuille, sans chercher à imiter d’accent. Mais pourtant, en m’en tenant à la stricte lecture des sons écrits, l’accent a jailli de ma bouche, malgré moi ; l’accent, une part de la voix de celle qui avait écrit. Face à cette langue, tous les professeurs ont dit y trouver une respiration : « C’est une littérature dans laquelle on entend le corps de celui qui écrit », m’a dit une enseignante. Les personnes migrantes se permettent d’écrire comme ça dans mes ateliers, car je leur dis de ne pas penser aux fautes. Et j’appuie cela sur ma propre expérience : moi, quand j’écris, je peux faire dix fautes par phrase. Si je commence à penser aux fautes et pas à ce que je suis en train de dire, je ne suis pas bon, je n’ai aucune idée. De même, quand ces personnes ne pensent pas aux fautes, elles couchent leur accent sur du papier, et avec lui une part de leur musicalité propre, de leur force la plus intime.
Concrètement, qu’apprends-tu des migrant-e-s dans ces cours que tu es censé leur donner ?
J’ai par exemple pris la mesure du fait que le français est une langue à graphie étymologique : on n’écrit pas les mots en fonction de leur son, mais de leur histoire. Si on écrit « dent » et pas « dan », c’est parce que dent vient d’un mot latin (dentis) dans lequel on prononçait le « t ». Les créoles antillais qui utilisent le vocabulaire français ont refusé cette grammaire. C’est le signe d’une résistance de l’imaginaire, très complexe et fort puissante : ils ont gardé le vocabulaire français, avec des sons issus du croisement des langues africaines, syrienne, chinoise, etc., et écrivent ainsi avec une graphie phonétique.
Prenons un autre exemple très simple avec le mot « oiseau ». Un jour, à Bruxelles, au cours d’une présentation publique d’un recueil écrit par des migrants, un homme d’origine hongroise m’explique qu’il est arrivé en France à l’âge de 10 ans, et qu’il a dû apprendre le français – « une langue horrible », dit-il. Le pire de tous les mots était pour lui « oiseau » : dans ce mot, aucune lettre ne se prononce comme elle le devrait ! La question est : qu’est-ce que cela crée pour nous, qui passons notre temps à lire des sons qui ne s’écrivent pas ? Nous apprenons à associer des sons à des lettres, a, b, c, i, etc. qui ensuite à l’écrit, une fois assemblées, cessent de se prononcer ainsi. Si l’on faisait la même chose avec nos perceptions, on se retrouverait dans ce genre de situation : en voyant une maison verte, je ne devrais pas penser à une maison verte, mais, je ne sais pas, moi, à un carrosse, avec une chauve-souris qui passe par-dessus, et un char d’assaut en-dessous. Ce serait une expérience proche du psychédélique ! Or c’est ce qui se passe en permanence quand nous lisons en français. Les créoles, eux, ont refusé cette dissociation entre signe et son : c’est pourquoi « oiseau » s’écrit « wazo ». La même résistance s’opère chez les migrants, quand ils ont simplement la possibilité d’écrire en pensant au sens, et pas seulement à la grammaire. Ils phonétisent la langue, pour s’en sortir.
Le colonialisme culturel est-il répandu parmi les travailleurs associatifs qui travaillent avec des migrant-e-s ?
Pour répondre à cela, j’aimerais vous lire un court extrait écrit par une formatrice en alphabétisation dans une grande association belge (qui fait par ailleurs un très bon travail) : « Je ressens chez la plupart d’entre eux une réelle soif d’apprendre. J’apprécie beaucoup quand, entre eux, ils s’expliquent des choses que l’un n’aurait pas comprises. Tout comme quand deux apprenants de même nationalité se parlent en français. »
En lisant cela, on dirait que les migrants, dépourvus de culture, sont en train de découvrir le savoir. Mais ils ne sont pas dupes : ils s’adressent à l’institution de la manière dont celle-ci veut qu’ils s’adressent à elle. On croit souvent que le silence des migrants vient d’une faiblesse liée à la précarité inouïe dans laquelle ils se trouvent, mais on oublie en quoi il vient aussi, sinon d’un sage et docte mépris, du moins d’un étonnement sans cesse renouvelé face au regard que portent sur eux les institutions qui se pensent émancipatrices. À cause de cela, pour faire plaisir à leurs alphabétiseurs, on entend parfois des migrants eux-mêmes dire : « Je suis comme un enfant qui apprend à marcher, avant je ne connaissais rien. » Tout se passe comme si se jouait une grande pièce de théâtre où les personnes blanches joueraient le rôle de ceux qui savent, et les migrants celui de ceux qui apprennent.
Pour moi, nous sommes ici dans une situation certainement pas postcoloniale, ni même néocoloniale, mais tout simplement supracoloniale, dans le sens où ne se pose même pas la question : « Et si les personnes qui sont en face de nous n’étaient pas comme on les pense a priori ? » Pas plus que : « Pourquoi, moi qui les rencontre, je pense qu’elles sont comme ça ? » Les chirurgiens ont fini par accepter de se laver les mains en se rendant compte qu’ils étaient vecteurs de mort s’ils ne le faisaient pas, comme le rappelle Isabelle Stengers4. On peut aussi être vecteur de mort, de dissolution de la personne quand on prétend vouloir la soigner, l’émanciper, sans se laver les mains de sa colonialité, sans s’interroger sur son propre conditionnement.
Enfin, ce qui m’intéresse, c’est comment nous pouvons relier cette déculturation, à l’œuvre dans certains cours d’alphabétisation, avec celle que nous, Européens de l’Ouest, avons vécu et vivons encore. Le processus est à présent très avancé et dans une phase « résiduelle », mais il y a toute une histoire vécue dans les régions, qu’on appelait autrefois des « pays ».
Ce colonialisme culturel concerne-t-il seulement la langue ou traverse-t-il d’autres manières d’être ?
Disons que langue, écriture et modes de vie sont très intimement liés. Par exemple, certaines associations refusent de faire des groupes non mixtes, au prétexte qu’il faut libérer les femmes. Ces associations font comme si elles ne savaient pas que, pour les groupes féministes des années 1960, l’un des premiers actes était de se retrouver en groupe non mixte, sans les hommes. Pour les migrants, il faudrait un autre régime de parole, comme si l’on ne pouvait émanciper les femmes qu’en les mixisant, alors qu’elles sont parfois victimes de machisme à la maison. Pense-t-on que les hommes qu’elles rencontrent dans leur cours, eux, ne sont pas machistes ?
Les femmes migrantes avec qui je travaille parlent très rapidement des problèmes qu’elles ont avec leur mari – comme si c’était ce que je voulais entendre (elles ont compris que l’institution a des oreilles pour ce genre de problèmes, les confortant dans l’opinion qu’elle se fait des hommes arabes, africains et en particulier musulmans). J’ai lu des textes de femmes sur leur mari qui disaient que, lorsqu’elles sont arrivées en Europe dans les années 1970, le système était catastrophique, pas les maris, mais le système : les regards, les préjugés qu’on pouvait émettre sur elles si elles faisaient telles ou telles choses. Ce qu’elle mettent en cause, c’est avant toute chose la précarité de la situation d’immigration et d’exil, au sein de laquelle le rapprochement avec la communauté d’origine et le regard de chaque membre de cette communauté sur autrui compte alors énormément.
Un jour, en atelier, une femme, Zoubida Ben, a écrit un magnifique texte appelé « La statue immigrée ». Elle parlait d’une statue, très belle, dans un jardin, avec de beaux cheveux, les joues roses, etc. Un jour, un homme la voit, la met dans une boîte et l’emmène, la plongeant dans la solitude. Zoubida témoignait ici d’un traumatisme dans l’immigration, qui ne vient pas forcément de la méchanceté de son mari, mais du fait qu’elle n’aimait pas sortir, qu’elle avait peur, qu’elle se sentait seule, car elle ne parlait pas français ; elle restait donc chez elle toute la journée. Elle avait quitté un univers avec des couleurs, de la rue, des bruits, pour se retrouver dans celui du cloisonnement.
Les personnes des institutions qui ont lu ce texte m’ont dit « C’est extraordinaire ce que tu as fait Jérémie, de les faire écrire ». Ce à quoi je leur ai répondu « Je ne les ai pas fait écrire, elles ont écrit » ; « Oui, mais tu te rends compte de ce que génère l’alphabétisation : cette femme, qui avant ne faisait que passer le balai chez elle, tout à coup, elle écrit des poèmes. » Ils ne se sont jamais dit que sa puissance expressive pouvait venir de sa culture orale – en l’occurrence, Zoubida est berbère et utilise beaucoup de métaphores charnelles, vivantes. Dans la tête de l’institution, ces textes ne peuvent pas être le fruit de quelque chose qu’elle avait avant d’être alphabétisée – et c’est justement ce regard déculturant qui met en danger les personnes issues de l’immigration.
Quand je demande à certaines femmes « C’est quoi ta langue ? », il leur arrive de me répondre « Mon dialecte ? ». Je me demande où ces femmes, qui ont connu la colonisation de leur pays, ont appris qu’elles n’avaient pas une langue, mais un dialecte, sinon en cours d’alphabétisation ? Il y a une foule de confusions dans leur tête, transmises par les associations d’accueil des migrants. La première langue qu’elles découvrent serait le français, tandis qu’avant, elles devaient se contenter d’un dialecte. Or, du point de vue occidental, ceux qui n’ont pas de langue sont en filigrane ramenés au statut d’animaux, d’où la violence de ces évidences.
Bref, je crois que je ne fais rien de spécial, si ce n’est tenter d’adopter un regard décolonial, sans prétendre être pour autant exempt de colonialité. Mon parcours fait que, quand je travaille avec les migrants, je pense vraiment qu’ils vont m’apprendre quelque chose. Je pense qu’ils ont des réponses à mes problèmes, et à ceux de ma société. C’est ce changement de regard qui fait que, tout à coup, des choses se disent, quand on arrête de les subjectiviser seulement comme des « sans » quelque chose. Quand je rencontre des migrants, je me nourris, et quand je me nourris, je ne les dévore pas. Que s’est-il passé dans l’histoire pour que certains en arrivent à croire que des personnes issues de civilisations où tout n’est pas fondé sur l’écrit, qui ont vécu la violence coloniale, qui n’ont pas su gagner la guerre face à la colonisation, sont des personnes à qui l’on s’adresse comme si on devait les émanciper ?
Oui, mais par rapport à ton expérience, on se dit qu’il y a quand même quelque chose à changer dans ces grands programmes d’alphabétisation…
L’alphabétisation m’intéresse, mais « par ailleurs », en quelque sorte. C’est un terrain qui révèle des choses, justement parce qu’il prétend être émancipateur. Le premier acte militaire de la guerre d’Algérie a été la mise en place de campagnes d’alphabétisation. Il y a des textes sur l’alphabétisation de l’époque expliquant qu’il s’agit seulement d’enseigner le nécessaire de la langue pour que les indigènes puissent travailler sur les tâches auxquelles on les a assignés5. Or il y a encore des associations aujourd’hui pour dire la même chose. Ça s’appelle l’« insertion professionnelle » : quand on demande de donner des cours pour apprendre aux gens à lire ce qu’il y a d’écrit sur les produits nettoyants et les cartes de métro.
En France et en Belgique, il y a des méthodes d’alphabétisation qui ont été créées pour des adultes occidentaux. Ce sont souvent des gens avec des histoires de vie très difficiles, de précarité, de viol, d’alcoolisme. Or ce sont ces mêmes méthodes qui sont aujourd’hui utilisées pour alphabétiser les migrants. Quand on reçoit un Peul de Mauritanie – qui connait le Coran par cœur, qui te raconte toute l’histoire de sa lignée, qui connait plein de gestes hérités de génération en génération – avec les mêmes méthodes que pour quelqu’un du Quart-Monde français qui ne sait pas lire et écrire, on fait rentrer ce Peul dans la même misère, on lui demande de revêtir un vêtement psychique et misérable qui n’est pas le sien. Quand la personne migrante est lettrée dans sa langue, on appelle d’ailleurs cela un « analphabète partiel ». Il y aura toujours des termes comme ça, très insultants de fait.
Nous en sommes amenés à considérer que nous existons seulement parce que nous savons lire et écrire. En dehors de cela, on est nul. Ma propre famille était composée de paysans installés sur les hauteurs de Nice. Beaucoup de gens vivaient de la terre, des jardins qu’ils cultivaient. Tous leurs enfants ont fait des études, et ont grandi dans la honte de leurs parents qui ne savaient pas bien lire et écrire. Le message est passé. Si tu ne sais pas lire et écrire, tu n’es rien, et si tu n’es rien, c’est qu’en dehors de la lecture et de l’écriture, il n’y a pas grand-chose. On comprend alors la déculturation à laquelle sont confrontés les migrants, et à laquelle ils résistent. Elle rend compte du fait qu’on a le sentiment, sans doute fondé sur une réalité partielle et pragmatique, qu’il n’y a rien en dehors de la culture que l’on reçoit à l’école.
Quel lien fais-tu entre la colonisation des pays du Sud et celle, plus interne, qui a été menée à l’intérieur même des empires comme la France, lorsqu’on a interdit aux Occitans, aux Bretons ou aux Basques de parler leur langue et de faire vivre leur culture ?
Dans mon livre6, j’aurais pu parler de la Corse, du Pays Basque, etc., mais je ne l’ai pas fait, car j’avais peur de ne pas assez maîtriser le sujet. À la base du livre, il y a la certitude que, par exemple, si des résistances armées – ou, du moins, fermes – ont existé, et ont parfois remporté des victoires contre la culture dominante, c’est parce qu’il y avait une protection communautaire. S’il n’y a pas cette protection communautaire, il n’y a pas de résistance qui incite l’État à négocier. Le fait que cette résistance existe dans certains pays de France, c’est très important.
On peut partir des traces culturelles qui existent encore en Europe de l’Ouest, dans un travail de reconquête, de recréation communautaire et culturelle. À propos des bals traditionnels, par exemple, j’ai reçu plusieurs messages de danseurs en colère, car j’ai dit que nous n’avions plus de danses populaires. Je pense en effet que les danses populaires ont fini par être cadrées, et ont perdu de la fluidité, de la subtilité dans le rapport aux rythmes. Je ne dénigre pas ces danses, je pense même que c’est à partir de ça qu’on reconstruira quelque chose, mais il serait intéressant de se demander comment elles peuvent se refluidifier…
Quasiment presque toutes les danses extra-occidentales utilisent les hanches, c’est-à-dire libèrent le haut du corps en permettant à l’énergie de circuler. Les hanches sont le centre du corps, le lien entre le bas et le haut. Même dans les danses khmers où les mouvements de hanches sont peu présents, il y a de la fluidité, une fluidité incroyable liée à l’extrême précision de la diversité gestuelle et à l’implication de chaque partie détaillée du corps : le visage, les yeux, le cou, les épaules. Dans la danse, le maître mot est selon moi celui de « fluide » : la manière dont circule l’énergie d’une partie du corps à l’autre.
En Martinique, par exemple, ils ont le Bèlè, qui était une danse cadrante issue des danses de cour occidentales. Les Martiniquais ont créolisé les quadrilles, avec des mouvements fluides, en réintroduisant les mouvements de hanche, sans lesquels l’énergie ne circule pas du bas vers le haut du corps. Ils se sont réapproprié cette danse. Je pense que, comme eux, il faut partir des bals trad’, et les créoliser. Une question de réappropriation des cultures populaires serait donc : comment réintroduit-on les hanches dans les danses bretonnes, qui se dansent pourtant sur une musique fortement pulsionnelle ?
Tu parles beaucoup de l’Occident, et des parcours des migrants vers l’Europe de l’Ouest. Mais même quand on est occidental et que l’on migre vers un autre pays, on subit ce phénomène. Ce rapport n’est pas propre à l’Occident…
C’est vrai qu’en Espagne, par exemple, il y a une ambiguïté, beaucoup de choses hybrides, avec la culture arabe, le flamenco, etc. Mais même sans cela, ils auraient été traités comme des chiens en arrivant en France. Ce regard colonial, déshumanisant, n’existe pas que sur les migrants lointains. Le philosophe Bernard Andrieu7 explique qu’en Occident, il y a une sacralisation du corps, mais à partir du moment où tu deviens malade, chômeur, tu es en voie de déshumanisation, tu n’as pas le droit à ce respect au corps. Les philosophes de la décolonisation, comme Frantz Fanon, Albert Memmi ou Édouard Glissant, ont identifié les conséquences des formes d’oppression infériorisante, qui laissent des traces autant psychologiques que physiologiques – et cela ne concerne évidemment pas que les personnes issues de pays colonisés. L’enjeu pour moi aujourd’hui est d’étudier le colonialisme, peut être dans une sorte d’anthropologie inversée de celui-ci, c’est-à-dire des conséquences du colonialisme sur nos corps d’occidentalisés et nos modes de vie.
La critique du colonialisme ne serait-elle pas qu’un aspect de la critique de la domination en général ? La honte d’être italien ou espagnol ressemble à la honte qu’on retrouve chez les Occitans de parler leur langue, par exemple…
Oui : nous sommes nous-mêmes des colonisés. Je le répète : à l’origine du colonialisme, il y a une mise à disposition du vivant et de toutes les cultures rétives à cette mise à disposition. Le phénomène des enclosures8 en est le révélateur. L’aliénation culturelle commence quand on accepte de travailler la terre selon les exigences du marché, et non plus pour se nourrir. La chasse aux sorcières, c’est avant tout le massacre de toutes les personnes qui ont une pratique thérapeutique, femmes ou hommes, en dehors des exigences du capitalisme. Cela a provoqué entre 500 000 et un million de morts, et c’est un des socles culturels de l’Europe de l’Ouest.
Or les premières victimes de cette histoire, ce sont les Européens de l’Ouest eux-mêmes. Ils ont été obligés d’accepter cette domination, de dénoncer les sorcières, de se couper d’elles pour survivre. On a introduit en nous la haine de notre propre culture, et en cela, on peut parler de fait colonial. C’est ce que dit Starhawk dans son livre Femmes, magie et politique : « Pour tuer une culture, il faut tuer ses thérapeutes. »
*
En guise de conclusion, j’aimerais revenir sur le concept de « culture » en rappelant les définitions assez symptomatiques que le Petit Robert donne du terme. J’en retiendrai trois :
1. Action de cultiver (la terre).
2. Ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une civilisation.
3. Ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines.
Ces trois sens sont à la fois potentiellement complémentaires et conflictuels. Le premier sens est somme toute le plus important : l’action de cultiver une terre, car cela implique la création d’un ensemble complexe de procédés dépassant largement le seul geste agricole, et la capacité d’écoute du vivant, de transmission, dans un réglage des comportements humains permettant d’éviter par exemple l’impossibilité de la culture (de la terre). L’action de cultiver la terre implique la seconde définition : l’ensemble des aspects intellectuels, artistiques d’une civilisation, car ce sont ces aspects qui conditionnent et sont déterminés par la culture de la terre.
Ensuite, la condition sine qua none d’une approche non coloniale d’une culture extra-occidentale est de la considérer sans oublier la seconde définition, soit comme une civilisation productrice de savoirs. Dire cela peut sembler une évidence. Je relativiserais cette impression d’évidence en rappelant qu’actuellement, dans diverses universités, on demande aux anthropologues en construction de bien faire attention aux représentations se cachant derrière les faits, les productions et pratiques culturelles observées. Ce qui revient au final à continuer d’adopter la posture de celui qui pense pouvoir penser pour l’autre. L’autre « fait », tandis que l’anthropologue révèle et « fait savoir ». Au regard de l’histoire, toute approche d’une culture extra-occidentale, sur quelque point que ce soit – l’union, l’échange, l’agriculture, les mythes contemporains – qui ne prendrait pas en compte les aspects intellectuels et artistiques (les réduisant à leur fonctionnalisme par exemple), et qui en cela ne cesserait de les « inconscientiser », aurait bien du mal à se départir d’une certaine forme imposante de colonialisme et de tentative renouvelée de chosification de l’extra-occidental.
Il ne faut pas sous estimer notre propre « enculturement » colonial, même s’il n’est jamais très agréable, évidemment, de le constater. Ce que je dis là relativement à la notion de culture, à travers laquelle on choisit d’appréhender une culture ou une société, me fait penser à ce que dit Alban Bensa quand, dans son ouvrage Après Lévi-Strauss9, il évoque l’avalement par la structure ou la réduction à la structure des mythes et des dynamiques sociales indigènes par Lévi-Strauss :
« (Lévi-Strauss) s’est dit influencé par Marx… J’ai les plus grandes réserves sur ce point. Mais par Platon et Kant, assurément. La montée rapide en généralités pour rejoindre des schémas interprétatifs englobant quantités de cas concrets est encore très représentée dans les sciences sociales : beaucoup d’analyses actuelles projettent sur des sociétés ou des situations des idées simples, voire simplistes. (…) Il faut aussi reconnaître un déni de communication partagée, qui produit un effet de lecture saisissant : face à l’anthropologue tout puissant, l’observé est généralement mutique – aussi silencieux qu’une structure. Cette privation de principe de sa parole dans le texte final ne va pas sans poser des questions hautement politiques. »
En revanche, pour ce qui concerne l’investigation anthropologique du monde occidentalisé, il peut être très intéressant et même salutaire de s’en tenir à la troisième définition du mot culture : Ensemble des formes acquises de comportement. Car si les extra-occidentaux ne sont certainement pas en besoin d’explications relatives à leurs formes acquises de comportement – ils en sont, je pense, au contraire, saturés –, les occidentalisés, eux, en ont terriblement besoin. Il s’agit là de révéler l’« enculturement » colonial de nos modes de vie. Si les Européens vivent les conséquences d’une forme de colonisation qu’ils ignorent, elle est doublée et recouverte d’une colonialisation (fait de rendre colonialiste). La décolonisation passe par la « décolonialisation » en ce qui concerne les Européens de l’Ouest.
*
Ateliers d’histoires populaires de Vaour : présentation
C’est surtout l’histoire des puissants que l’on apprend à l’école, que l’on nous raconte dans les grands médias : celle des « grands hommes » et des grands événements, celle du Progrès, celle des vainqueurs, en fait. Une histoire officielle, monolithique et inévitable.
Les histoires des gens ordinaires, de leur quotidien, de leurs tentatives pour s’organiser entre eux, pour résister, sont le plus souvent ignorées. Certains chemins ont été laissés de côté par la majorité, certaines manières de vivre et certains savoir-faire ont été mis au rancart par les pouvoirs en place. Pourtant les brèches, parfois incroyables, ouvertes par des mouvements populaires ou intellectuels qui ont ensuite été étouffés, sont dignes d’intérêt. C’est à ces brèches et à ces chemins d’une surprenante actualité, que les Ateliers d’ histoires populaires de Vaour (Tarn) sont consacrés. Les conférences sont ouvertes à tous et visent à susciter le débat, y compris sur notre époque et notre avenir.
*
Illustrations : Henry Ray Clark (1936-2006) – Surnommé « The Magnificent Pretty Boy » dans les rues de Houston, il est condamné à 25 ans de prison après un meurtre commis au cours d’un deal de drogue. C’est derrière les barreaux qu’il développe son art, dont quelques toiles ici présentées.
- Philosophes guerriers de Yeumbeul, Jérémie Piolat, K-Films, 1999. ↩
- Comment la terre s’est tue, Pour une écologie des sens, David Abram, trad. D. Demorcy, I. Stengers, éd. La découverte, Les empêcheurs de tourner en rond, 2013. ↩
- Au sens où l’entend Starhawk : «pouvoir du dedans» et non «pouvoir sur». Voir Rêver l’obscur. Femmes, Magie et Politique, éd. Cambourakis, 2015. ↩
- Dans sa préface à Nous ne sommes pas seuls au monde de Tobie Nathan, éd. Les empêcheurs de penser en rond, Seuil, 2007. ↩
- À ce sujet, voir Léon-Jean Calvet, Linguistique et colonialisme. Petit traité de glottophagie, éd. Petite Bibliothèque Payot, (1974), 2002. ↩
- Portrait du colonialiste, L’effet boomerang de sa violence et de ses destructions, éd. La découverte, coll. Les empêcheurs de penser en rond, 2011. ↩
- Bernard Andrieu, Le Monde corporel, préface d’Alain Berthoz (Collège de France), Lausanne, éd. L’Âge d’Homme, 2010. ↩
- C’est-à-dire la mise en clôture des cultures paysannes en Angleterre, dépossédant le peule des « communs » et achevant la chasse aux « sorcières », guérisseuses installées dans les zones non appropriées par les possédants. À ce sujet, voir Starhawk, op. cit., et Isabelle Stengers avec Philippe Pignarre, La sorcellerie capitaliste, éd. La découverte, 2005. ↩
- Alban Bensa, Après Lévi-Strauss. Pour une anthropologie à taille humaine, éd. Textuel, coll. Conversations pour demain, 2010. ↩