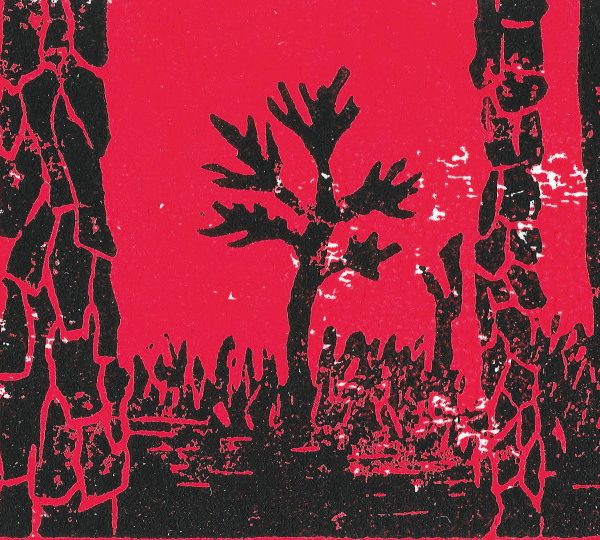Refusant la fatalité de la colonisation, les peuples amérindiens prennent les armes et se révoltent contre le système capitaliste depuis des siècles. Loin de se résumer au folklore des ethnologues, la pensée magique constitue un espace de résistance puissant dans cette lutte permanente. Il s’y joue une vision du monde bien éloignée de celle, prédatrice et mercantile, qui gouverne le regard occidental.
Novembre 1712, Chiapas (Guatemala). La situation de la ville rebelle de Cancuc est critique. Les troupes espagnoles levées contre les insurgés assiègent la ville. Elles sont commandées par don Toribio de Casio, président de l’Audience royale du Guatemala. Quand les Indiens se rendent compte qu’ils ne peuvent empêcher les Espagnols de prendre la ville, ils cherchent une aide surnaturelle comme ultime recours face à la supériorité des armes. Ils font appel à quatre femmes connues pour leur intimité avec les forces de l’univers, afin qu’elles fassent usage de leurs armes magiques contre l’ennemi. L’une est maîtresse de la foudre et du feu, l’autre de l’eau et des inondations, la troisième de l’air et des cyclones, la quatrième a le pouvoir de provoquer des tremblements de terre. L’entreprise échoue. Décidément, les forces spirituelles qui accompagnent les Espagnols sont les plus fortes. Pourtant, don Toribio de Casio garde de cette intervention des sorcières une crainte superstitieuse et n’a de cesse de poursuivre les quatre femmes ; quand il peut les arrêter, il les condamne à être pendues, puis, sait-on jamais, décapitées.
La révolte des Indiens mayas dans la province du Chiapas en ce début du XVIIIe siècle a, par son ampleur, profondément marqué les esprits. Elle avait pour fin de recouvrer la relation au sacré, c’est-à-dire à la pensée dans sa dimension générique. Cette relation avait été confisquée et monopolisée par l’Église catholique, elle l’est toujours.
La rupture avec un système monde donné, en ce qui nous concerne celui du capitalisme, est-elle seulement pratique (à travers la recherche et la mise en œuvre d’alternatives) et théorique (à travers une analyse critique s’appuyant sur une science des mécanismes sociaux), ou bien doit-elle être aussi, et surtout, une dissidence dans la pensée, dans notre manière d’appréhender la réalité, proposant une perspective décalée par rapport aux points de vue convenus ?
La magie propose une relation plus étroite, plus intime, entre la personne et la pensée générique que celle qui a cours dans le monde chrétien, où domine seulement un dieu transcendant souvent bien éloigné des préoccupations quotidiennes des hommes et des femmes. Une communication s’établit alors avec le monde surnaturel de la pensée, peuplé d’esprits plus ou moins redoutables, de génies, de djinns, de loas, de saints, de dieux et de diables, permettant aux adeptes de se ressaisir, ne serait-ce que provisoirement, de la pensée dans sa dimension collective.

Fresque maya de Bonampak
Le monde huichol
Le peuple huichol ou encore wixarika se trouve aux confins des États de Jalisco, Nayarit, Durango et Zacatecas, dans la région dite le Grand Nayar à l’ouest du Mexique. Jusqu’à présent, il a su garder, dans des conditions très hostiles, une autonomie tant sur le plan social que religieux – et j’entends par religieux la pensée dans sa dimension collective. Société et religion sont liées : perdre la pensée des ancêtres, l’ensemble des rituels, des croyances et des mythes qui se trouvent à l’origine de la vie sociale des Huichols, c’est bien dans le même mouvement perdre toute autonomie réelle pour se fondre dans la société métisse, qui les environne et les assiège.
À l’intérieur des huttes cérémonielles, mais aussi un peu partout, dans les grottes sacrées, les patios des ranchs, les places cérémonielles communales ou les champs de maïs, se trouvent des puits généralement recouverts d’une pierre circulaire qui forme couvercle appelée « tepari ». Sur cette pierre sont gravées les figures des ancêtres, le plus souvent sous la forme d’un cerf. Un Huichol ne saurait s’approcher de ces pierres sans une certaine appréhension – c’est que, pour lui, une force spirituelle diffuse, mais potentiellement dangereuse, sourd de ces pierres. L’ethnologue ou le touriste, qui viennent d’un tout autre univers, restent complètement indifférents.
Faisons un pas de plus : si ces pierres ont pour fonction de recouvrir les puits et de protéger les non-initiés de la force terrible qui en émane, c’est qu’à l’intérieur se trouvent les ancêtres, la plupart du temps sous la forme de statuettes, dont Tatewari, le Grand-Père feu. Seuls les initiés, ceux qui ont marché sur la trace des ancêtres de l’obscurité à la lumière, de l’Océan, lieu des origines, à Wirikuta, lieu magique de l’aube, peuvent les approcher sans dommage… et les ethnologues, qui, comme Lumholtz, Diguet ou Preuss, ont pu se constituer des collections visibles aujourd’hui dans les musées de New-York, Chicago, Paris ou Berlin.
La puissance magique des ancêtres huichols n’agit ni sur les touristes, ni sur les ethnologues, comme la puissance des fétiches africains n’a eu aucun effet sur les membres de l’expédition Griaule (cf. L’Afrique fantôme de Michel Leiris). Seule « La Momie » a réussi à se venger de la profanation de nos scientifiques… au cinéma. Pourtant, les agissements de nos scientifiques ne manifestent pas seulement un manque d’égard vis-à-vis de quelques superstitions ou vagues croyances ; plus profondément, ils manifestent un manque d’égard vis-à-vis d’une réalité : celle des peuples et des sociétés qui se sont construits sur d’autres fondements, sur une autre idée de l’échange, que notre civilisation occidentale, chrétienne et capitaliste.
Le peuple huichol est un peuple en résistance, et il est cerné par notre monde occidental, chrétien et capitaliste. La pensée des ancêtres est amenée affronter sans répit une pensée venue d’ailleurs, que les Huichols jugent asociale. Ils pensent qu’elle vient du monde métis et, pour eux, les métis sont les descendants des « monstres cannibales » ; ils ont un comportement incorrect, ils ont perdu la « coutume » ou ils ne l’ont jamais eue, ils ne connaissent pas la loi de la réciprocité 1.

Œuvre de Mariano Validez
En finir avec l’objectivation du monde
Parler de magie, de sorcellerie ou encore de chamanisme, de possession, c’est faire référence à un mode d’appréhension de la réalité différent du mode d’appréhension dit rationnel qui a cours dans notre monde. Ces deux modes se veulent efficients, et ils le sont en général ; ils peuvent agir sur la réalité pour en modifier le cours, en bien ou en mal : la sorcellerie tue, mais elle guérit aussi, la science a le pouvoir de guérir et aussi de tuer, et elle ne s’en prive pas.
On dit que les pratiques de sorcellerie, de possession, de chamanisme défient la raison, et c’est bien de cela dont il s’agit, de défi – et ce défi est toujours actuel. Le vaudou à Haïti, le candomblé au Brésil, le chamanisme un peu partout dans le monde, en Asie, en Sibérie, en Amazonie, les cérémonies de possession en Afrique et en Europe : toutes ces pratiques dites irrationnelles ou magiques se trouvent sur la même longueur d’onde du temps que la pensée dite rationnelle ; je dirais qu’elles font partie de notre modernité, de notre présent.
Notre présent semble dominé par l’activité capitaliste, et le marchand capitaliste conçoit le monde comme sa propriété. Penser le monde comme objet est bien ce qui définit la pensée rationnelle, non ? La magie est une autre façon de penser le monde, elle invite à penser le monde autrement, à ne pas entrer dans un rapport de sujet à objet (qui définit la pensée rationnelle), mais dans un rapport de sujet à sujet. Elle s’inscrit en faux contre la pensée dominante, c’est une pensée en dissidence. Les pratiques magiques sont toujours calomniées, souvent interdites, les religions de la transcendance, le christianisme ou l’islam, veillent. Elles doivent parfois entrer en clandestinité, elles s’adaptent, se faufilent dans les bulles, les marges de l’Unique, elles renaissent et persévèrent dans ce qui les constitue irrémédiablement autres, en rupture avec l’ordre et la police d’une pensée qui se veut conquérante.
Critiquer le système monde capitaliste revient à rompre avec le point de vue du marchand sur le monde, se placer dans une toute autre perspective – ce qui suppose un bouleversement important de toutes nos présuppositions les plus affirmées, de nos représentations les plus évidentes.
Le monde des cartes
C’est un village perdu dans la montagne, à la frontière entre l’État du Guerrero et celui d’Oaxaca. C’est un village mixtèque. Il y a quatre ans, les Indiens chols, tzeltals, tzotzils, tojolabals, mames se sont soulevés dans le lointain Chiapas. Les habitants de ce village ont eu vent de l’insurrection zapatiste, ils restent indécis, ils hésitent encore à prendre les armes. Ils se souviennent de Genaro Vázquez et surtout de Lucio Cabañas avec son armée de los pobres, de sa triste fin et des années sombres qui ont suivi, de la guérilla et de la répression sanglante. L’armée mexicaine hante encore leurs montagnes. Leur histoire est celle des peuples insoumis, des peuples qui n’ont pas accepté la domination d’un monde qui n’est pas le leur. Au centre de gravité de leur histoire, ils hésitent.
Il fait nuit, la lune éclaire d’une lumière blanche les rues du village. Nous sommes dans la maison de notre hôte et ami. Il y a là, outre notre ami, sa femme, son plus jeune fils, son père, un vieillard solide et chaleureux, sa mère qui égraine sans fin des épis de maïs dans un coin de la pièce. Nous devisons tout en mangeant des tortillas et en buvant du café. Arrive une jeune femme accompagnée de sa fille, cette femme est malade, et elle a recours aux cartes du père pour retrouver la part de son âme qui l’a quittée, la laissant sans force, sans énergie. Le père cartomancien, jouant des cartes comme d’autres des couteaux, découvrant des lames pour retrouver des âmes perdues ?
Chaque carte découverte appelle un très bref commentaire de la part du père, parfois seulement le nom de la carte et, à la rigueur, sa signification, mais à partir de là, toutes les personnes présentes, et surtout la malade, se mettent à broder sur les annonces du père ; des plaisanteries fusent, et parfois, c’est la franche rigolade. Tout se passe dans une ambiance bon enfant – mais en langue vernaculaire, en mixtèque, et je ne comprends rien, je devine. Le principe et la technique sont les mêmes que ceux qui sont appliqués par nos diseuses de bonne aventure. Il s’agit, grâce à un support neutre, qui a la neutralité infinie du hasard, l’indifférence absolue des divinités à notre sort trop humain, ici les figures du tarot, de retrouver la mémoire. Il s’agit de retrouver derrière l’oubli le fil de la pensée, de la pensée créatrice de ce que nous sommes, le fil de notre pensée qui est tout aussi bien, avouons-le, le fil de notre destin.
Le sortilège fonctionne. La jeune femme s’est souvenue de sa peur, quand, où et pourquoi elle fut soudain surprise au point de laisser s’échapper une de ses entités qui composent son âme. Il ne lui reste plus qu’à retourner sur le lieu du drame et à prier cette entité errante de réintégrer son être pour que le tour soit joué.

Lucio Cabañas
Des communautés de pensée en dissidence
La magie, le chamanisme, les cérémonies de possession reposent sur une notion qui nous échappe, sans doute parce que nous en manquons, celle d’esprit. Au centre de la vie sociale se trouve la pensée, non dans le sens du blabla universitaire, mais dans le sens que lui donnaient des philosophes chrétiens comme Hegel, de pensée générique : pensée se réalisant sans cesse, reproduisant en permanence sa propre réalité. Dans une société où cette pensée générique est confisquée par une classe sociale, la solution qui se présente alors consiste à recréer une collectivité en marge de la société. Tenter de rétablir une relation plus étroite entre la collectivité et la pensée dans sa dimension générique, par le biais de figures neutres – les esprits, les dieux ou les diables. En fait, il s’agit de recréer une communauté de pensée en dissidence.
On connaît encore à Haïti le Dieu Agassou qui, lorsqu’il possède un de ses fidèles, le contraint à recroqueviller ses mains comme des griffes. Au Dahomey, Agassou, produit de l’union d’une femme et d’une panthère, est l’ancêtre et le fondateur de la lignée royale d’Abomey. « Le culte des esprits et des dieux, ainsi que la magie, furent pour l’esclave à la fois un refuge et une forme de résistance à l’oppression. Le régime de l’esclavage aurait pu les démoraliser complètement et développer en eux cette morne indifférence qui est le résultat de la servitude 2. » Les esclaves des plantations se retrouvaient au cours d’assemblées nocturnes, les calendas, pour célébrer avec des devins les dieux de leur lointaine Guinée, les bokonos et les vodû-nôs, captifs comme eux. C’est à partir de ces calendas que s’est soudain propagé l’incendie de la révolte qui a embrasé l’île, la mémorable nuit du « serment du Bois Caïman », le 14 août 1791.
Ces calendas, ces assemblées secrètes avec leurs danses nocturnes de possession, au cours desquelles la confrérie des adeptes rend un culte à Vaudou, la couleuvre, être tout puissant et surnaturel, me font immanquablement penser à nos sabbats de sorcières, ces cultes païens, interdits par les autorités, mais qui se poursuivaient clandestinement dans nos campagnes.
Je laisse le soin de la conclusion à Alfred Métraux : « Le vaudou permet à ses fidèles de retrouver une forme rudimentaire de vie collective, de manifester leurs talents artistiques, et leur procure le sentiment exaltant d’entrer en contact avec le surnaturel. À Marbial, où cette religion a été quasiment supprimée, un morne ennui s’est abattu sur la vallée et l’existence du campagnard a perdu toute sa saveur 3. »
Oaxaca, le 21 avril 2014