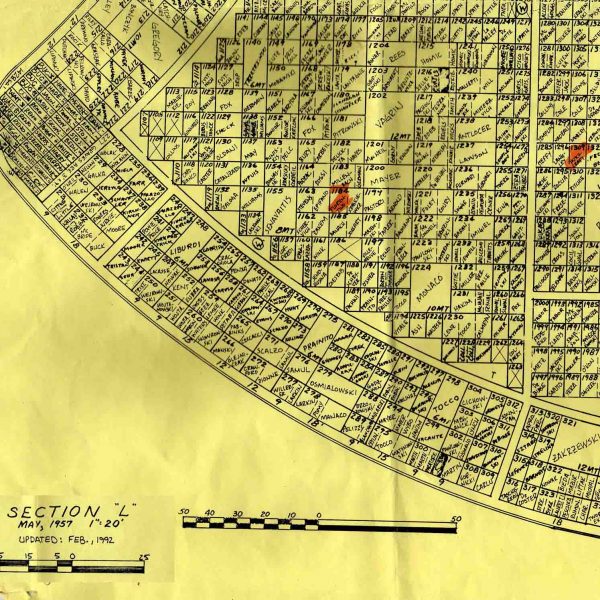En 1969, après avoir enseigné à l’université d’Alger puis de Nanterre, Jeanne Favret-Saada s’installe dans le bocage mayennais pour commencer une enquête de plusieurs années sur la sorcellerie. Loin de se satisfaire d’une posture d’observatrice, et plutôt que d’imaginer, à distance, le fonctionnement du système sorcellaire, elle accepte d’en « occuper » une place, de se laisser affecter, de perdre une certaine maîtrise sur son devenir. Au-delà d’un apprentissage « pour sa vie », Jeanne Favret-Saada tire de cette expérience une analyse inédite du système des sorts et des rôles de chacun.e dans cette entreprise de conjuration du malheur. Trois ouvrages, devenus classiques en sciences sociales, sont nés de ce travail : Les mots, la mort, les sorts (1977), Corps pour corps, enquête sur la sorcellerie dans le bocage, avec Josée Contreras (1981), et Désorceler (2009).
Juliette Volcler (réalisatrice de l’émission radiophonique et du site internet L’intempestive) et Yeter Akyaz (réalisatrice sonore) ont rencontré Jeanne Favret-Saada dans un bistrot marseillais en 2011. Lors de cet entretien, disponible à l’écoute en ligne1, « On parle du discours méprisant des élites (Église, médecine, psychiatrie, école…) sur la paysannerie et sur les pratiques de sorcellerie, on parle de tout ce qu’il s’agit de réapprendre lorsqu’on s’extrait de son milieu social, (…) on parle de la sorcellerie comme d’une manière d’exprimer ce qui ne peut pas l’être autrement ; on parle de la place des femmes dans ce système sorcellaire, de leur puissance et de leur esclavage ; on parle du désorcèlement comme thérapie et apprentissage de sa propre force. »
Ce texte est extrait du numéro 1 de Jef Klak, «Marabout», dont le thème est Croire/Pouvoir. Sa publication en ligne est la cinquième d’une série limitée (5/6) de textes issus de la version papier de Jef Klak, toujours disponible en librairie.
Les propos de l’entretien n’ont que très légèrement été réécrits lors de la retranscription, par souci de fidélité à la forme sonore.
Télécharger l’entretien en mp3
Jeanne Favret-Saada est ethnologue, mais la définition est un peu courte…
D’abord, je suis une tout à fait vieille dame, parce qu’à la fin du mois de septembre [2011], j’aurai 76 ans. Quand j’étais jeune chercheure, j’ai participé à Mai-68. J’étais chercheure et enseignante à Nanterre qui, comme vous le savez, a eu une importance dans cette affaire-là. Nous étions deux ou trois enseignants, avec nos étudiants, à être dans toutes les manifestations. On avait décidé que l’on ne quitterait pas la France l’année suivante, que l’on travaillerait en France parce qu’on avait l’impression qu’il s’y passerait quelque chose. Ce qui était évidemment tout à fait faux. On attendait même la Révolution… C’est vous dire que ça n’a pas été tout à fait ça.
Or moi, Française née en Tunisie, avec des parents juifs, d’origine entièrement tunisienne depuis x générations – depuis toujours –, j’étais venue en France pour faire mes études supérieures à mes 18 ans, et je ne m’étais jamais sentie installée en France. J’aimais beaucoup la langue, la littérature, la France de la Révolution, la France laïque, etc., et je haïssais l’autre [France]. Je n’en voulais pas. De plus, dans les années où je suis venue, il y avait beaucoup plus d’antisémitisme que maintenant, et donc, je ne me sentais pas vraiment admise en France. Durant Mai-68, avec un groupe de camarades, on a été envoyés à Saint-Nazaire avec les « paysans travailleurs » – enfin, ceux que l’on a ensuite appelés les « paysans travailleurs ». On est entrés à la tête d’une manifestation à l’université de Nantes sur des tracteurs, avec des paysans. Là, j’ai dit : « Ça y est, cette France-là, je la veux. »
C’est donc à travers une lutte que vous avez commencé à vous sentir habiter en France ?
Une lutte avec des gens qui étaient justement de la France de la Révolution, de la France des révolutions, qui n’étaient pas la France confite, colonialiste, qu’on rencontrait dans Paris…
Quant à la sorcellerie ?
À la rentrée d’octobre-novembre 1968, j’ai eu un étudiant à Nanterre qui était pion dans un lycée de Laval [en Mayenne] et qui m’a parlé [de la sorcellerie]. Il m’en a parlé avec beaucoup de mépris d’ailleurs, mais ça m’a beaucoup intéressée. Probablement parce qu’il a réussi à faire passer le fait qu’il y avait des vies en jeu – ou plutôt, qu’il y avait de la vie et de la mort en jeu –, et aussi parce que mon précédent travail sur l’Algérie s’était beaucoup occupé des situations de vendettas, de mises à mort, etc. Je suis donc allée là-bas avec quatre ou cinq étudiants.
C’était à la Toussaint 1968 et j’ai tout de suite loué une maison pour venir à la fin de l’année universitaire m’y installer avec mes enfants. Dans un village. J’ai été frappée en arrivant : [il n’y avait] personne dans les villages, il pleuvait comme vache qui pisse et toutes les populations étaient réunies dans les cimetières avec des fleurs éclatantes ! C’est-à-dire : les gens en noir, les fleurs éclatantes et une pluie lugubre. C’était un tel choc que j’ai dit : « Ça, c’est bon pour moi, je viens ! »
Vous parlez du mépris avec lequel votre étudiant a commencé à vous évoquer les questions de sorcellerie…
Oui, il disait : « C’est des gens complètement tarés », évidemment. Bon moi, je ne comprenais pas pourquoi ils devaient être tarés, comment on pouvait dire d’un compatriote, par avance, qu’il est taré. Donc, [dans la continuité] de ces deux ou trois jours autour de la Toussaint, j’ai eu envie de rencontrer ces gens, de les connaître. Ils savaient des choses que je ne savais pas, de toute évidence. J’ai considéré que je devais prendre tout le temps qu’il me fallait – d’ailleurs, mon laboratoire [de recherche] n’a pas aimé qu’un an ne me suffise pas et que je continue indéfiniment à être là-bas ! Mais il fallait le faire dans leur temps ; selon ma possibilité à moi, aussi, d’entrer en relation avec des inconnus.
C’est quand même un aspect du terrain qui est pénible pour tous les ethnologues quand on entre en relation avec des gens qui… Il n’y a que dans les pays coloniaux que les gens se sentent obligés de vous répondre. Là, ils ne voyaient pas du tout pourquoi [me parler] ; et si je ne leur plaisais pas, ils m’envoyaient au bain. Et à la troisième fois de la journée où vous avez été envoyée au bain, eh bien, vous allez vous coucher et vous vous demandez : « Qu’est-ce que j’ai présenté d’insupportable ? Pourquoi ne leur ai-je pas fait envie ? » Petit à petit, j’ai appris comment parler avec les gens.
Ce qui est très frappant, c’est que vous avez tenu un journal quotidien de ce qui vous arrivait pour essayer de saisir, un peu, ce qui se passait – ce que l’on retrouve dans Corps pour corps, votre journal de terrain. […] Vous n’hésitez pas à montrer les errements, les erreurs que vous faites dans la communication, ou plutôt, dans les rapports quotidiens avec les personnes…
C’est surtout que l’on s’est déplacé de son propre groupe, de sa classe d’intellectuels, pour aller dans une autre région qui a non seulement d’autres règles de politesse concernant ce que l’on peut dire et ce que l’on ne peut pas dire, mais où les gens ont aussi recours à la sorcellerie – une [pratique] complètement méprisée en ville – et ont peur du jugement que vous porterez sur eux. Les pensées et leurs pratiques étant secrètes, vous ne savez pas, pendant longtemps, comment tomber juste. Vous dites des bêtises parce que ce qui est à découvrir, vous ne le connaissez pas. Moi, ça ne me vexait pas de m’apercevoir que, là encore, j’avais été une imbécile.
Justement, ce qui est très sensible dans Corps pour corps, c’est que vous arrivez complètement à rebours de ce que vous avait dit votre étudiant et de l’attitude générale de ceux que vous appelez « les folkloristes de la sorcellerie ». Vous partez du principe qu’il y a un discours et des pratiques qui se tiennent autour de la sorcellerie : comprendre d’abord ce dont il s’agit avant de les mépriser, et redonner de la valeur à la parole du peuple.
Oui. Ces gens pensent et pratiquent quelque chose qui est méprisé dans mon groupe. Or, ce sont des Français, comme nous, qui vont à l’école française, à l’école publique, qui vont, je ne sais pas, au catéchisme, qui font leur service militaire, qui regardent la même télé le soir. Ce sont des Français. Et ils ont en plus, dans leur région, un ensemble de pensées, de pratiques relatives à la sorcellerie. Mon idée était la suivante : s’ils « le » disent comme ça et pas autrement – alors qu’ils disposent entièrement de notre langue et de nos moyens de pensée –, c’est que « ça » ne peut pas se dire autrement. Donc, il faut leur faire crédit. Mais que sont-ils donc en train d’essayer de faire, de gérer avec « ça » ?
Ce qui s’exprime à travers « ça », ce sont des rapports humains extrêmement complexes, très difficiles à décoder rationnellement, qui passent par tout un tas de gestes et d’attitudes, de rapports humains qui ne peuvent pas s’exprimer par le langage courant et qui, à travers les pratiques de sorcellerie, créent un réseau de significations et de compréhensions du monde…
Vous avez dit « rationnellement », mais le problème c’est que nous aussi, dans nos vies, on n’est pas plus rationnels qu’eux. Par exemple, essayez de me faire un exposé sur la crise de la dette qui soit un peu cohérent. Même sur l’affaire DSK, qui est infiniment plus simple. Essayez que ce soit cohérent. C’est extrêmement difficile. Bon. Parmi les idées avantageuses que nous avons sur nous-mêmes – nous les citadins, les gens cultivés –, il y aurait que « nous » sommes rationnels et que les autres qui font notre monde ne sont pas rationnels. Ce que nous avons, c’est les raisons pour lesquelles nous faisons ceci ou cela, ce ne sont jamais que des raisons. Ce n’est pas la rationalité qui nous amène là. Avec eux, c’est exactement la même chose, il faut connaître leurs raisons, au pluriel.
Vous évoquez le discours méprisant des élites (les notables, l’Église, l’école, la médecine) qui disqualifient les pratiques de sorcellerie, qui les rejettent complètement.
[Ils disqualifient] même les pratiques paysannes. Par exemple, le directeur de l’hôpital psychiatrique me disait : « Être psychiatre ici, c’est de l’art vétérinaire. Ils n’ont pas de parole. » Ce n’est pas vrai. Quand ils ont commencé à me parler, ils ne s’arrêtaient pas pendant quatre heures. On peut dire qu’ils ont une parole. Interdite ou retenue devant le notable qui peut les interner, mais c’est tout. On ne peut pas dire que ce sont des êtres sans paroles, mais on peut dire qu’ils savent ce qu’est un rapport de force et qu’ils ne vont pas se risquer.
Vous montrez, à travers des exemples, que le discours prétendument rationnel, prétendument scientifique, est chargé de mythologie et de représentations qui ne sont pas plus justes que les représentations qui s’expriment à travers la sorcellerie…
Je peux même vous dire que depuis que mes livres ont été publiés, jusqu’à aujourd’hui – cela s’est produit cette semaine encore –, il y a pas mal de savants et de chercheurs qui m’écrivent pour me demander de les « désorceler ». D’ailleurs, je ne réponds pas, en général, à ces lettres parce qu’ils penseraient que c’est moi qui dois les désorceler, ce que je ne veux pas faire, de toute façon. J’ai eu sept ou huit directeurs de recherche au CNRS qui m’ont directement demandé de les désorceler. Donc il ne faut pas… vous voyez.
Mais là, ce sont des comportements totalement irrationnels au regard de l’univers dans lesquels ils s’expriment…
Être pris dans une crise de sorcellerie, c’est être pris dans des malheurs à répétition. Tout lecteur de mes livres, y compris s’il est directeur de recherche au CNRS, qui est lui-même pris dans des malheurs à répétition, se projette immédiatement sur ce que j’écris et pense tout de suite que j’ai la clef de son problème. Bien qu’il sache qu’il y a d’autres types de personnes qui s’occupent des malheurs à répétition, par exemple les psychiatres, les psychanalystes et toute une série de gens qui ont inventé les thérapies pour ceci ou cela, il ne veut pas s’adresser [à ces personnes]. C’est ce qu’il ne dit justement pas : « Je ne veux pas m’y adresser » ou : « Je m’y suis adressé et ça ne m’a rien fait ». C’est tout à fait absent de leur propos. [Ils disent :] « Je veux que vous me trouviez un désorceleur ». Vous voyez.
Mais ce qui est frappant, c’est de voir comment le moindre de mes lecteurs, pourvu qu’il soit pris dans des malheurs à répétition, se projette immédiatement, parce qu’il a, comme je le dis dans un papier qui sort ces jours-ci2, « la mort aux trousses ». Il sent qu’il a la mort aux trousses, et là, il ne fait plus du tout de discours, il ne fait plus de chichis intellectuels, il ne dit pas : « Ces gens sont irrationnels ! » ou « Moi, je suis rationnel ! » ; il dit : « Je veux en sortir ! ».
C’est un effet auquel vous ne deviez pas vous attendre. Quand des personnes lisent vos livres de travers…
Non, ce n’est pas de travers, au contraire. Je dois prendre ça comme une prolongation de mon terrain : qu’est-ce qui arrive à ces gens ? Quelles ont été les demandes qui m’ont été faites après la sortie de ce livre ? Ils ne sont pas méprisables du tout. Ils sont dans des malheurs à répétition, et ils veulent cette cure-là, spécifiquement, cette façon-là d’en sortir spécifiquement, et pas une autre. Après tout, c’est tout aussi rationnel pour eux que pour quelqu’un du bocage.
Je me trompe peut-être, mais à travers vos écrits, vous avez donné une certaine légitimité à la sorcellerie. La psychiatrie et la psychanalyse ont leur place dans nos sociétés contemporaines. Mais, avant votre recherche, la sorcellerie avait-elle autant sa place ?
Bien sûr que non. Les gens qui en parlaient à l’hôpital psychiatrique étaient internés. On disait qu’ils avaient « une bouffée délirante à thème de sorcellerie ». Maintenant, ça va mieux. C’est-à-dire qu’il y a un certain nombre de psychiatres qui m’ont lue, qui en ont entendu parler, ou bien on leur a expliqué à la fac, je ne sais pas, mais en tout cas, maintenant, ça va mieux. D’ailleurs, les psychiatres et psychanalystes étaient vraiment hostiles à mon travail au début. C’est-à-dire ce que j’avais fait sur le terrain, ils adoraient, mais si je disais que cela sortait les gens de malheurs à répétition, ça, ils ne le supportaient plus. « Mais ce n’est pas une vraie thérapie, les nôtres sont les vraies ! » (rires)
Je dois dire que depuis trente ans, la situation a changé. Maintenant, je suis invitée trois ou quatre fois par an par des écoles de psychanalyse ou de psychiatrie, par exemple [aux cliniques de] La Chesnaie ou de La Borde, mais aussi en Belgique, à Bruxelles, etc., par des gens qui comprennent parfaitement ce dont il est question d’un point de vue thérapeutique dans ces affaires-là.
Vous expliquez que la pratique de désorcèlement est une thérapie qui s’exprime d’une autre manière que les thérapies conventionnelles, officiellement reconnues, comme la médecine…
Et qui, elles-mêmes, s’affichent comme telles. Jamais un désorceleur ne dira « Je suis un thérapeute ». Je pense qu’à partir du moment où l’on se dit atteint par le pouvoir d’un sorcier, c’est pour être pris en charge par un désorceleur qui traite le malheur à répétition et qui vous en propose une sortie. À l’inverse de mes collègues qui traitaient la sorcellerie comme une machine à accuser des gens en tant que sorcier, ou à proférer des énoncés irrationnels (telle personne que l’on connaît bien est toujours là, même quand on ne le voit pas, untel est invisible, etc.), bref, contrairement à ces collègues, je me suis dit « Mais pourquoi les gens prononceraient-ils des choses de ce genre si ça n’est parce qu’ils veulent sortir de là où ils sont ? ».
Un spécialiste leur est proposé : le désorceleur, que l’on trouve tous les cinq, six villages (et ils vont toujours chercher celui qui est le plus loin de chez eux pour ne pas non plus avoir à trop se trouver dans son pouvoir). Si on me demande quelle est la statistique [du nombre de] sorciers, je répondrais qu’il n’y a pas de sorciers… En fait ce sont juste les ensorcelés qui accusent d’autres [personnes] d’être des sorciers. Donc on ne peut pas dire qu’il y a tant de sorciers dans la Mayenne, mais on peut dire qu’il y a tant de désorceleurs. C’est une profession masquée ; on se cache toujours, [on préfère dire] « Je suis cartomancienne, je suis coiffeur, je suis hongreur ». Ils ont toujours des métiers de façade : ils sont agriculteurs, par exemple. Mais leur activité principale, c’est en fait de désorceler.
Dans l’histoire de la sorcellerie, quelles que soient les époques, il a toujours fallu se cacher ?
Oui, à cause de l’Église catholique. Fondamentalement, c’est la répression de l’Église qui joue encore beaucoup aujourd’hui, puisque l’Église s’est associée, pour ces affaires-là, à la médecine et à l’école. Elle a défini une foi rationnelle – ce qui me paraît être une chose incroyable, puisqu’on trouve rationnel de croire que Jésus est né d’une vierge, qui elle-même a été conçue sans péché, qu’il est mort et qu’il a ressuscité… Ça, c’est rationnel ! (rires) Mais c’est rationnel parce que c’est admis par tout le monde. C’est admis par les religions communes. Donc on ne va pas dire que c’est irrationnel, sauf les méchants athées, une corporation à laquelle j’appartiens personnellement.
En conséquence, ça [la foi rationnelle] ne m’a jamais paru plus rationnel que la sorcellerie. C’est un usage plus connu, et c’est tout. Et c’est l’Église catholique qui ne veut pas, qui n’a jamais voulu qu’il y ait une autre autorité localement, qui dise « Moi, j’ai des pouvoirs ; moi, je peux ceci ou cela ». Et donc, c’est comme ça qu’elle a pris le virage depuis un siècle en traitant « ça » d’irrationalité. Alors qu’avant, elle le traitait de superstition : supertes, ce qui est en plus de la foi, et ce qui est faux, c’est l’hérésie.
Concrètement, comment peut-on définir une crise de sorcellerie, telle que vous l’avez constatée dans le bocage ?
C’est la progression d’une famille d’exploitants agricoles, de paysans, dans des malheurs qui se répètent : des voitures ou des tracteurs qui se bloquent, qui tombent dans le fossé, des enfants qui ont des maladies, la femme qui ne peut pas accoucher, la vache qui fait du lait rempli de germes – bien que le fermier soit un bon fermier, qui travaille bien. C’est-à-dire que dans tout l’espace qui est celui de l’exploitation agricole, le domaine de la ferme, se passent des malheurs qui se répètent, [transmis] d’un objet à l’autre de la ferme, ou d’un être à l’autre de la ferme.
À un certain moment, quelqu’un intervient – qui connaît bien cette famille – et s’adresse au chef de famille. Il lui dit « Y’en aurait pas, par hasard, qui te voudraient du mal ? ». Officiellement, celui à qui [on s’adresse] tombe des nues, dit qu’il n’y avait jamais pensé, bien que tout le monde a entendu parler de la sorcellerie dans sa famille, mais qu’il n’y avait jamais pensé et donc, [ce quelqu’un qui intervient], je l’appelle « l’annonciateur ». C’est celui qui annonce son état à un futur ensorcelé et lui propose d’aller voir le désorceleur qui l’a [lui-même] tiré d’affaires il y a plusieurs années. Puis c’est chez le désorceleur que le diagnostic sera posé : Y a-t-il ou n’y a-t-il pas un sort ? Et qui est le sorcier ?
« Y’en aurait pas, par hasard, qui te voudraient du mal ? » – vous avez redit cette phrase [centrale]. Dans vos trois livres, vous portez une attention à la retranscription de la parole des personnes, jusque dans les accents, dans la manière de parler.
Parce qu’au début, je comprenais très peu de choses, et pourtant, ils parlent très bien français. Donc, je ne comprenais pas, j’ai dû apprendre [la langue]. Évidemment, ce n’est pas comme apprendre une langue à tons en Asie (rires), c’est pas du tout aussi compliqué : en trois mois, j’étais au point. Pour cela, j’ai dû apprendre comment ils rythment les phrases, comment la communication verbale est articulée sur la communication non verbale – ce que nous avons nous aussi, que nous utilisons à plein pot, sans le savoir parce que, pour nous, c’est évident. Mais nous avons des jeux de regards, de bouche, de mains, de claquement de langues. Nous communiquons aussi très largement par des moyens non verbaux. Mais quand ce sont d’autres – dont vous ne connaissez pas le système de communication – qui communiquent comme ça, évidemment, il faut l’apprendre.
Vous dites que la pratique ethnographique courante, qui consiste à aller chercher des informations auprès d’un informateur ne sert strictement à rien. Il faut accepter d’être pris dans un jeu de communications, de relations beaucoup plus complexe que cela. Les gens n’ont accepté de vous parler qu’à partir du moment où vous étiez identifiée à une place, à l’intérieur de ce système de sorcellerie.
C’est-à-dire quand ils ont compris que j’étais débordée par ce qui se passait, que moi-même, je ne maîtrisais pas. Par exemple, il y a eu une fois où mon fils a été malade… J’étais là, avec mes enfants qui avaient 6 ou 7 ans, et puis 7 ou 8 ans, et mon fils a été malade. Le médecin était inquiet parce que c’était une orchite, une inflammation des testicules qui pouvait le rendre stérile par la suite. Je n’avais pas le téléphone en ce temps-là, j’allais téléphoner à la cabine du village à tous les laboratoires où il avait fait des analyses à Paris, avant. Et le médecin ne comprenait toujours pas.
Tout le monde entendait la communication, et ils me disaient « Alors les docteurs, ils ont trouvé ? », [je répondais] « Non, ils n’ont pas trouvé ». Quand le médecin l’a guéri, il m’a dit : « Je l’ai guéri mais je ne sais pas pourquoi. » J’ai répété ça autour de moi. Évidemment, [les gens] étaient très contents : ils ont vu que j’avais expérimenté, comme eux, une histoire de maladie incompréhensible. Et donc, après, quand des gens ont commencé à me raconter leurs histoires, c’était très… L’atmosphère d’une ferme où il y a du malheur à répétition, c’est terrible. Les gens sont très prostrés, il fait très sombre, c’est accablant comme atmosphère, donc ça me faisait de l’effet, évidemment.
Ce que j’ai écrit à propos de mon terrain, ce n’est pas de l’information sur un système symbolique d’autrui qui serait là, dans un ciel, qu’il faudrait décalquer puis faire descendre dans mes bouquins. Il ne s’agit pas d’informations, mais d’informations vitales. Il s’agit de quelque chose qui les affecte, et de quelque chose que vous ne pourrez comprendre que si vous acceptez d’en être affecté aussi. C’est-à-dire de comprendre pourquoi une communication humaine, c’est aussi ça. Et pas une communication de singes, d’infrahumains, d’abrutis, d’alcooliques…
Cela fait écho, non seulement à la pratique de l’ethnologue, mais également au rapport du journaliste traditionnel à son environnement, qu’il ne va traiter qu’en termes d’actualité… On le remarque quand on travaille sur les quartiers, je crois, où il est tout à fait naturel qu’il y ait un rejet vis-à-vis du journaliste, puisqu’il n’est présent que dans un rapport de prédation du quotidien des gens.
Et puis le journaliste qui va dans le quartier, il sait déjà ce qu’il veut trouver, il sait déjà ce qui se passe, et il sait déjà ce qu’il va en dire. Il cherche juste un peu de couleur locale. Alors on comprend que les gens n’aient pas envie de servir à faire de la couleur locale pour le journaliste. Ils ont des choses à dire, que le journaliste n’imagine même pas. On voit d’ailleurs, quand des journalistes sont restés six mois dans une banlieue, qu’ils ont récolté tout à fait autre chose à en dire.
Vous dites que la sorcellerie, il faut bien voir que ce n’est pas quelque chose d’anodin, c’est un combat à mort entre deux hommes, et derrière eux, du coup, entre deux familles, entre deux exploitations.
Oui, mais je ne dirais pas [un combat à mort] entre deux hommes, mais entre soi et le malheur qui est incarné provisoirement par quelqu’un que l’on accepte finalement de désigner comme sorcier. Parce qu’on s’imagine que ça se fait comme ça, de désigner quelqu’un. Mais moi, parce que j’ai vu beaucoup de séances de désorcelement, je voyais bien qu’il fallait plusieurs semaines au désorceleur pour y arriver. C’est-à-dire pour que les ensorcelés puissent accepter de faire tomber la responsabilité de ce qui leur arrivait sur quelqu’un dont ils savaient que, possiblement, il lui arriverait des malheurs à répétition et qui puisse supporter que « ça » lui arrive. Donc, il s’agit de déménager le malheur d’une exploitation dans une autre, d’une famille dans une autre, et donc c’est tout à fait le contraire de ce que la presse raconte quand on dit « Ah oui, c’est untel qui m’a fait ça ». Non, pas du tout. C’est une opération très longue, très travaillée.
Au fond, le désorcèlement passe par le fait que le désorceleur va apprendre à l’ensorcelé à réassumer une part d’agressivité nécessaire, largement désapprise par l’Église catholique, entre autres, qui apprend plutôt à tendre l’autre joue… La soumission. La soumission, voilà.
Voilà, c’est-à-dire que les ensorcelés se présentent comme des gens qui sont toujours bons. « Nous », on nous a appris à tendre l’autre joue. « Nous », on ne fait pas de mal. « Nous », on n’a jamais fait de mal à personne. « Pourquoi il ne nous arrive que du mal ? Dites-nous qui nous fait du mal ? » Ce qui est frappant, c’est que quand les ensorcelés arrivent chez le désorceleur, ils ont tout de suite des idées sur des gens de leur famille. Parce que la famille, c’est le lieu des vrais conflits, surtout dans l’agriculture, où il y a des jalousies sans fin autour de qui a hérité, puisque tous les héritages vont maintenir l’exploitation du successeur – et pas du tout les filles, qui ne touchent presque jamais leurs parts (elles l’ont en dette, qui ne sera sans doute jamais remboursée). Les autres frères [du successeur] ont dû aller s’installer ailleurs… [La famille], c’est un lieu de conflits gravissimes.
Et donc, aux ensorcelés, si on leur dit « Qui vous veut du mal ? », ils ont tout de suite des tas d’idées. Et le désorceleur, il dit toujours « Non, non, non, c’est plus loin que vous ne le pensez ». Donc il s’agit de sortir les conflits de la cellule familiale qui doit rester toujours unie. Parce que, comme je l’ai compris, c’est un genre de thérapie qui vise aussi à sauver les exploitations familiales. C’est-à-dire que cette famille, qui a cette exploitation, ne doit pas se défaire, elle ne doit pas se séparer, le couple ne doit pas divorcer, il ne doit pas se fâcher avec ses frères, ses sœurs, ses parents. Il faut que l’origine du mal soit trouvée ailleurs, chez d’autres, non parents. Pas trop loin, parce qu’on ensorcelle avec le toucher, le regard et la parole, parce que la théorie de la sorcellerie suppose une proximité de face-à-face. Pas trop loin, mais pas trop près non plus ; pas des parents.
Et quand le désorceleur a réussi à trouver une figure de quelqu’un, d’un proche que les ensorcelés accepteront de charger de cette responsabilité, alors ça commence à marcher mieux. Parce que ça veut dire qu’ils ont aussi accepté de ne pas se penser comme « tout bon », comme « Nous, on n’est que bons et les autres, ils ne sont que mal » : ils ont accepté de se mélanger un peu avec la volonté, par exemple, de rendre des coups à ceux qui leur en donnent.
Vous évoquez, dans ces affaires qui concernent des familles, la différence entre le rôle des hommes et le rôle des femmes face à une crise de sorcellerie. Et notamment le fait que les femmes ne se trouvent pas dans le rôle de la sorcière, comme on a l’habitude de se le représenter. La femme joue le rôle de redonner de l’assurance à l’homme visé par un sorcier ; elle lui permet de se réaffirmer et donc de reprendre pleinement sa place dans le monde.
Oui. C’est-à-dire que les femmes, épouses d’exploitants (à cette époque-là en particulier, mais enfin, le droit a changé, mais la réalité n’a pas beaucoup changé) ne sont rien dans les exploitations. C’est lui qui est le chef d’exploitation et c’est lui le chef de famille. Donc, si elles pensent que c’est de la faute de leur mari que l’exploitation ne marche pas, elles peuvent partir. Mais que feront-elles ? Quoi ? Elles seront apprenties boulangères à Paris ? Elles n’ont pas fait d’études : elles ont évidemment intérêt à essayer de requinquer leur exploitant de mari. Et donc, elles le font comme les femmes font pour requinquer leur pauvre petit mari qui pleurniche à la moindre difficulté. Elles leur font avaler… les rituels qu’il faut faire. [Ceux] qui, si on les fait, nous mettent dans l’état d’esprit de rendre coup pour coup. Elles leur font faire ce qu’elles-mêmes, elles ont fait très vite et très bien dès le début du désorcèlement. Alors que lui, à cause de son orgueil d’homme rationnel et de représentant public de la famille, il doit éviter de se présenter comme un abruti devant le village, le maire, l’instituteur, le curé. Lui, il traîne la patte tout le temps. Ce sont les épouses qui font ce qu’il faut pour les énergétiser progressivement.
Le désorcèlement est un système de communication complexe, dans lequel tout le monde doit accepter d’être partie prenante à 100%. Les femmes entrent tout de suite à 120%, les maris à 40 ou 50%. Donc, il s’agit d’amener le mari le plus près possible des 100%, et il n’y a que les épouses qui peuvent le faire, parce que le désorceleur ne les voit pas assez souvent, et il n’a pas de temps à perdre avec des gens qui ne veulent pas de sa soupe. S’ils n’en veulent pas, tant pis pour eux. Donc c’est le travail de la femme, qui est à la fois complètement exploitée et à la fois complètement puissante. Mais il ne faut pas dire que les femmes sont puissantes simplement dans cette affaire-là. C’est une puissance pour être esclave, une puissance qu’elles déploient pour être esclave. Mais c’est mieux d’être cette esclave-là qu’une divorcée commis de boulangerie à Paris, avec un studio en grande banlieue…
…et donc impuissante ?
Impuissante parce qu’il n’y a pas, pour les femmes, d’accès possible à une position de puissance sociale.
Dans l’exploitation, c’est comme s’il y avait un contre-balancement, où la femme a une importance, mais invisible…
Oui, c’est ça. C’est-à-dire que quand on dit qu’elles sont puissantes dans ce sens-là, c’est qu’elles ont beaucoup de vitalité : elles se démènent pour survivre, pour que l’exploitation survive, pour que leur mari fasse son boulot. Elles ne vont pas le mépriser. Elles vont au contraire le pousser à devenir enfin un peu orgueilleux, mauvais.
On peut dire en quelque sorte que c’est une forme de solidarité liée à la division sexuelle des tâches ?
Oui. Et pas seulement des tâches : de la propriété, des statuts juridiques. Donc elles n’ont pas d’autre issue que de se débattre pour réanimer leur petit mari.
Vous évoquez longuement les rapports que vous avez eus avec madame Flora qui a été votre désorceleuse. Notamment dans Corps pour corps, votre journal de bord, vous écrivez comment, au départ, elle vous autorisait à assister à des séances. En étant là, vous notiez tout, mais sans arriver à percevoir la logique de ce qui s’y passait. C’est en revenant [sur vos notes] que vous avez fini par saisir comment, à travers l’usage de la parole, elle arrivait déjà à comprendre où se situait le malheur de la personne qui venait la voir, sans d’ailleurs que cette personne ait l’impression qu’on lui posait des questions… Il y avait divination. Au fur et à mesure, vous avez compris ce fonctionnement, non pas dans la position extérieure d’une observatrice qui serait scientifique…
Non, j’étais sa cliente.
Oui, voilà, vous étiez sa cliente : vous avez vous-même été engagée dans un désorcèlement avec madame Flora.
J’étais sa cliente pour ma vie, et d’ailleurs, elle m’a appris des choses. J’étais au même moment en psychanalyse, et elle m’a appris des choses que la psychanalyste était absolument incapable de m’apprendre. Entre autres, à me dépatouiller des rapports de force injustes – ce qui est une chose sur laquelle j’avais toujours achoppé jusque-là. À partir du moment où elle m’a donné, sur plusieurs années, cet entraînement, je l’ai fait sans me fatiguer : dès que je m’aperçois qu’on est en train de me maltraiter, je mets toujours quelques claques morales aux uns et aux autres, jusqu’à ce qu’ils comprennent que je suis là, en face. Après, je m’arrête, parce que moi, j’ai horreur des rapports de force. Mais je peux mettre mon habit de méchante, mon habit de fille agressive avec des collègues, par exemple.
Donc être désorcelée, c’est assumer sa puissance et savoir la montrer, qu’on soit un paysan du bocage, ou qu’on soit une femme dans la France contemporaine.
Absolument, c’est ça. Et savoir la montrer quand il faut, c’est-à-dire quand l’autre joue le rapport de force. Par exemple, il y a des collègues, dans des rapports de travail entre universitaires, qui estiment que quelqu’un ne peut être bon que si tous les autres sont posés comme nuls en face de lui. Donc, il s’agit très vite de lui monter sur la tête, et de le montrer en défaut sur quelque chose de fondamental, publiquement. Après ça, il ne s’y risque plus, mais il faut y penser. Je veux dire que ça m’accablait, je me disais : « Mais enfin, les êtres humains sont des ordures », et puis, après, quand j’ai compris que c’était si simple de montrer la force et de ne plus s’en servir, voilà, j’ai appris quelque chose pour ma vie, d’extrêmement important.
Finalement, après la lecture de vos bouquins et cet entretien, le désorcèlement, c’est juste apprendre à trouver sa place dans le monde parmi…
C’est plus que ça. Parce que la psychanalyse est assez bien pour vous faire trouver votre place dans le monde. [Ce que j’ai appris, c’est] être capable de mobiliser ce qu’il faut de force en face des autres, ce qui est toujours lié à ce que les autres essaient de vous imposer. C’est vraiment la gestion du rapport de force.
Il se trouve, par exemple, que j’avais un père extraordinairement autoritaire (on pourrait même dire un « tyran » domestique) et que j’avais décidé très jeune que je ne voulais ni obéir ni commander. J’ai réussi à faire ça. C’est-à-dire que j’ai refusé de diriger un laboratoire, j’ai refusé tout honneur professionnel qui m’amenait à diriger quelque chose, à commander quelqu’un. Mais j’étais totalement incapable de gérer les rapports de force avec les autres, je fuyais, je m’en allais, je me disais « C’est des imbéciles, je les déteste, je vois pas pourquoi j’aurais à me défendre », et en fait, ça me créait des ennuis, tout le temps.
Madame Flora, elle, prenait les problèmes que j’avais dans mon existence à ce moment-là. Elle me disait « Mais vous n’allez pas vous laisser faire là-dedans, attendez ! ». Et elle comprenait très bien comment fonctionne le CNRS, ou comment fonctionne une maison d’édition (parce que j’avais eu des problèmes avec un éditeur à l’époque). En fait, elle me déployait, y compris par rapport à l’administration de mon laboratoire, des arguments. Elle imaginait des scènes totalement irréalistes, mais avec tant de précisions que ça m’imprimait des schémas : répartir les mobilisations de force au bon moment. Et oui, après ça, la vie était beaucoup plus simple.
C’est un apprentissage de sa propre autonomie et de sa propre résistance.
De trouver la bonne force. Ne pas commander, ne pas obéir. Ce qui existe, c’est savoir déployer la bonne force au bon moment et de ne pas aimer la force, mais ne pas non plus la fuir.
Une définition presque libertaire finalement.
Oui, absolument.
C’est comme si vous disiez « Je ne suis ni inférieure ni supérieure à quiconque ». Comment avez-vous géré les rapports que vous avez eus avec la classe paysanne dans votre recherche sur la sorcellerie ? « Je ne suis ni supérieure ni inférieure à ces gens-là », or, il est possible que des gens, en face de vous, aient joué un rôle soumis au regard de l’image péjorative généralement portée sur eux. Cela s’est-il exprimé ? Comment ? Comment avez-vous déconstruit ça ?
Je pense qu’au départ, j’ai essayé de comprendre comment les gens parlaient et que j’accordais beaucoup d’importance à des façons de parler anciennes. J’avais 32 ans, j’étais jeune quand j’ai fait ça. Pour eux, j’étais de la génération des enfants, des enfants qui n’arrêtaient pas de les mépriser au nom de la culture des Lumières, du « merveilleux » savoir qu’ils apprenaient dans les lycées agricoles, et qui leur ont fait bousiller la France en trente ans (rires). Du coup, ils étaient extrêmement honorés que ces choses, que leurs enfants interdisaient de mentionner, intéresse quelqu’un. Je crois que beaucoup m’ont reçue au départ comme quelqu’un qui était envoyé par la classe des jeunes, mais qui n’était pas comme les jeunes et qui avait envie d’apprendre d’eux toutes ces choses-là qui n’intéressaient personne. Leurs enfants étaient évidemment, eux aussi – comme les journalistes, les savants – sûrs de tout savoir de leurs parents, et que ces derniers n’étaient pas intéressants.
Vous êtes retournée dans le bocage après la parution des livres. Vous avez eu des retours ?
J’y suis restée très longtemps à mi-temps, et j’ai gardé des relations jusqu’aux années 1980 à peu près. Je sais que mes livres se sont beaucoup vendus dans la région et j’étais au Salon du livre au Mans il y a deux ans, au moment de la sortie de Désorceler. Il est passé plein de gens qui m’ont dit « Ah ! Mais c’est vous ? Elle existe ! ». Ces livres ont beaucoup été diffusés dans les bibliothèques de lycées, dans les fermes – surtout Corps pour corps –, et ils ont joui d’un grand respect de la part des gens. Vous savez, c’est rare, parce que d’habitude, les ethnologues ont un procès quand ils s’en vont. Pas parce qu’ils ont méprisé les gens, mais parce qu’ils disent des secrets que l’on pourrait reconnaître. Moi, j’ai fait extrêmement attention à ce que personne, jamais, ne puisse être reconnu. Non seulement j’ai maquillé les noms de villes et de personnes, mais j’ai maquillé les maladies. Donc je pense qu’à part les intéressés, personne, vraiment, ne pouvait savoir de qui je parlais.
En avez-vous rediscuté avec des personnes qui vous avaient parlé [de leur crise de sorcellerie] ? Qu’ont-ils pensé de votre analyse de la sorcellerie ?
Ah non, ça je ne sais pas, parce que Désorceler est sorti très récemment, en 2009. Après Les mots, la mort, les sorts, j’ai été là-bas, c’est sûr. Mais ce qui s’est passé, c’est que la presse, Ouest-France, vexée que je ne leur ai pas donné des papier, ou que je ne me sois pas présentée (je ne sais pas), m’a impliquée successivement dans deux affaires, dont une affaire de meurtre liée à la sorcellerie. Dans le village des assassins et dans le village des victimes, personne ne leur parlait [aux journalistes]. Ils ont [donc] fait une carte en triangle comprenant le village où j’habitais, celui des assassins et celui des victimes, et ils ont dit « Voilà le triangle de la sorcellerie ». Elle existe seulement dans ce triangle-là, la sorcellerie. Tout le truc, c’était que les autres puissent dire « C’est pas nous ».
Et donc vous étiez la sorcière dans cette histoire ?
Non, mais ils ont fait un papier sur moi qui connaissait si bien la région, qui avait habité là longtemps, qui avait su tant d’histoires… En fait, je n’avais jamais été ni dans le village des victimes ni dans le village des assassins. Et ils ont dit que je connaissais particulièrement cette histoire. Après ça, il est très difficile de continuer à parler avec les gens de « ça ». On peut parler, mais d’autres choses.
- « Être fort assez » : la sorcellerie dans le bocage, à écouter sur intempestive.net, ou à télécharger directement ici. ↩
- Jeanne Favret-Saada, « La mort aux trousses », Penser/Rêver, no 20, p. 207-220, 2011. ↩