Au milieu du XIXe siècle, la montée en puissance du secteur industriel et la concentration urbaine modifient en profondeur la société française. Les laissé·es pour compte sont de plus en plus nombreux·ses dans les faubourgs, et les vols font la une des journaux. Pour se débarrasser de ce « trop-plein » et résoudre une question sociale de plus en plus pressante, l’État décide d’établir en terres australes une petite France à l’antipode de la métropole : la Nouvelle-Calédonie. Pour leur plus grand malheur, les Kanak voient leur île se transformer en une colonie pénitentiaire et résidentielle, sur laquelle le pouvoir colonial attribue des bouts de terres spoliées aux ex-bagnards et aux colons libres, dans l’espoir d’en faire des paysans laborieux. L’historienne Isabelle Merle, auteure d’Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie. 1853-1920 (Anacharsis, 2020), revient avec nous sur le rôle et l’évolution de ces rouages de l’entreprise coloniale.
Cet article est initialement paru dans le sixième numéro de la revue papier Jef Klak, « Pied à terre », toujours disponible en librairie.
Images : série « Météores » par Clémentine Poquet.
Comment en es-tu venue à travailler sur l’expérience des colons en Nouvelle-Calédonie ?
À la fin des années 1980, alors que je cherchais à proposer un sujet de thèse, j’ai lu des lettres de missionnaires catholiques postés en Nouvelle-Calédonie entre 1860 et 1870. Je ne voulais pas directement travailler sur ces missionnaires pour des raisons diverses, mais j’ai découvert à travers eux la diversité et la complexité du monde social qui les entourait dans ce contexte colonial.
Il faut quand même se remettre dans l’époque : depuis 1984, on était en plein affrontement entre les indépendantistes du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) et leurs opposant·es. Les revendications d’indépendance kanak, l’explosion de violences puis finalement l’épisode de la grotte d’Ouvéa en 19881, tout cela était très difficile à comprendre vu depuis la France. Les Français·es ignoraient tout du contexte calédonien et de son histoire.
Je suis d’une génération où on a fait un complet black out sur l’enseignement de la colonisation à l’école et au lycée. Je me souviens de cours sur le Tiers Monde, mais les premiers cours où j’ai entendu parler de la colonisation, c’était à la fac. On a commencé par la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie – c’est-à-dire par la fin, ce qui permettait de faire l’économie de ce qui s’est passé avant –, mais c’est tout.
Je cherchais à travailler sur l’histoire particulière des colons, ces Européen·nes qui décident de tout quitter pour s’installer aux colonies. Quand j’ai cherché un·e prof de thèse, j’ai essuyé plusieurs refus car choisir un sujet sur les colons soulevait de la méfiance, qui plus est pendant la lutte pour l’indépendance. Travailler sur l’histoire des colons, à en croire certaines personnes, revenait à afficher une position procoloniale et antikanak, ce qui n’était pas mon cas. Je cherchais à comprendre la perspective des « dominant·es » ordinaires de la période coloniale. Comment des Français·es quittant leur pays ont pu endosser ce rôle de « colon », face à celles et ceux qu’on a désigné·es alors comme « indigènes » ? Tout en gardant à l’esprit que devenir colon et devenir indigène sont les deux faces d’une même pièce.
Au XIXe siècle, c’était très coûteux pour des Français·es de partir, d’autant plus vers des contrées lointaines qu’ils et elles voyaient comme « sauvages ». Dans son roman Je me souviens de Babylone, David Malouf décrit une scène qui m’a beaucoup parlé. Une Écossaise accouche d’un enfant mort-né au Queensland, en Australie, au milieu de nulle part (pour elle, évidemment, parce que pour les Aborigènes, c’est très habité). De son point de vue, c’est la planète Mars, et elle doit y enterrer son enfant. Malouf décrit de manière très belle ce sentiment terrible : elle est obligée de partir et de laisser cet enfant dans un lieu qui n’a, pour elle, aucun sens. Elle rêve d’un cimetière dans le Yorkshire, avec une pelouse, des tombes, avec des noms et une végétation familières. Elle enterre son enfant dans un endroit illisible pour elle, totalement étranger, et le laisse là, tout seul. Je me posais la question du coût de cet arrachement, de cet exil volontaire au nom de la colonisation.
La Nouvelle-Calédonie offre une situation comparable : des Français·es, souvent d’origine modeste, décident un jour de partir. Je me demandais comment on pouvait prendre un tel risque, quitter sa famille, ses ami·es, son terroir, et ce dans une France qui ne voyageait pas. Une immense majorité des Français·es de la fin du XIXe siècle naissaient, vivaient et mouraient dans leur département. Ce déracinement posait question, tout comme l’enracinement en Nouvelle-Calédonie. Qu’avaient-ils et elles gagné dans ce voyage risqué ? Comment étaient-ils et elles passé·es de la situation de migrant·e à celle de colon ? J’étais fascinée par la fabrique du colon, et notamment par les idées qui la portaient, qui soutiennent aussi bien des enjeux de propriétés (la terre) que de pouvoir (devenir patron), le colon réussi étant celui qui devient propriétaire d’un domaine foncier où travaillent, sous ses ordres, des populations indigènes ou importées2. Tous n’y sont pas parvenus et la trajectoire des colons présente de multiples variations.
L’autre versant de la colonisation de la Calédonie, c’est la colonisation pénale. Ce processus sera soutenu par le débat sur la prison qui a lieu en métropole. Au milieu du XIXe siècle, tandis qu’il s’affine, l’appareil de statistiques sur la population révèle une augmentation de la criminalité. Celle-ci est liée à l’émergence de la société industrielle et à la concentration urbaine qui s’ensuit. Les atteintes à la propriété, en particulier, augmentent. Si la délinquance des campagnes tend à diminuer parce que les journaliers sans terre partent vers les villes, celle des zones urbaines s’accroît. La lecture des chiffres fait peur aux gouvernants, et leurs craintes augmentent face à la montée des classes laborieuses, qu’ils commencent à qualifier de dangereuses.
« Que faire avec nos criminels ? » Les révolution-naires français étaient favorables à l’embastillement et avaient comme ligne de mire le panoptique imaginé par Bentham3 qu’analyse très bien Foucault dans Surveiller et Punir : il s’agit d’un bâtiment circulaire contenant des cellules grillagées qui donnent sur une cour centrale, dans laquelle est érigée une tour pour les surveillants et inspecteurs. Ces derniers peuvent tout voir sans être vus. Comme l’écrit Bentham : « Dans le panoptique, l’œil du maître est partout4. » Mais la réalité de l’emprisonnement dans la première moitié du XIXe siècle a souvent peu à voir avec ce panoptique – ce sont plutôt des cellules où s’entassent hommes, femmes et enfants dans des conditions sanitaires déplorables. Des scandales éclatent, en 1848, à Clairvaux notam-ment. Le parlement en vient à défendre l’option britannique de l’époque, à savoir déporter les criminels dans les colonies. Le gouvernement joue de l’idée que ces condamnés vont pouvoir soutenir l’Empire en accomplissant les tâches les plus difficiles, que personne ne veut faire.
C’est comme ça qu’émerge la loi sur la transportation, en 1854. Ce n’est pas simplement une loi punitive, d’exil, même si c’en est un énorme volet : pour contrer les défenseurs de la prison qui crient à l’irresponsabilité, on y accole un projet social. On promet au condamné une terre et un avenir dans la colonie d’exil. Il y deviendra un paysan laborieux et honnête grâce au pouvoir régénérant du travail de la terre. Il côtoiera des « colons libres », venu·es volontairement, qui lui serviront de modèle de comportement honnête. À tous, on donnera de la terre, celle des Kanak en l’occurrence. On l’a peut-être oublié aujourd’hui, mais la colonisation française du XIXe siècle est terrienne : on prend les terres et on installe des gens dessus. À ce moment-là, devenir colon, c’est d’abord avoir une terre. Pour les plus « honorables » d’entre eux, c’est aussi devenir patron et diriger une main-d’œuvre quasi servile.
La colonisation libre est aussi pensée, au milieu du XIXe siècle, comme une réponse à la « question sociale » pressante… Dans Expériences coloniales, tu cites le « Discours sur l’Afrique » de Victor Hugo : « Allez peuples ! Emparez-vous de cette terre ! […] Dieu offre cette terre aux hommes. Dieu offre l’Afrique à l’Europe. […] Versez votre trop-plein dans cette Afrique et du même coup résolvez vos questions sociales : changez vos prolétaires en propriétaires5. »
Dans cette première partie du XIXe siècle, l’idée est de faire partir les pauvres. Les terres de l’Empire qui s’offrent à la population laborieuse française règleront la question sociale. S’il n’y a pas eu de révolution dans le monde britannique, c’est peut-être parce que l’Empire a absorbé la pression. En Irlande, en Écosse, on a poussé les gens dans des bateaux pour les faire partir. Le problème du trop-plein de population qui ne trouve pas sa place, comme celui des déclassé·es, est un thème récurrent du XIXe siècle, qui vise d’abord les populations pauvres, laborieuses. La loi de transportation s’inscrit dans cette filiation : les criminels ne pourront véritablement se régénérer qu’aux côtés de modestes Français·es laborieux·ses et honnêtes qui leur donneront l’exemple.
Il y a aussi toute une utopie coloniale, inspirée des phalanstères ou de la pensée de Proudhon, où l’on s’imagine qu’aux colonies les gens pourront s’émanciper des contraintes de la société française métropolitaine et s’épanouir. Ces idées se sont développées en métropole, et les colonies leur offraient un champ de possibles, sans qu’on imagine que ça allait évidemment heurter les intérêts locaux et autochtones…
Ce fantasme colonial porte une forme de folie : « Le monde s’offre à nous et nous allons le recréer. » Il y aurait là une mission divine annoncée par le Christ, qui s’accorde parfaitement avec l’idéologie du progrès : puisque la civilisation européenne est la plus « avancée », elle a une technicité et un savoir tels qu’ils lui donnent le droit de prendre ces terres considérées comme vierges. Elle se doit de donner des leçons et de prendre possession.

Comment la Calédonie est-elle choisie pour ce projet ?
Dès les années 1830, les partisans de la transportation sont à la recherche d’un lieu, avec l’aide de la Marine. Sortie assez mal en point des affaires napoléoniennes6, elle y trouve un double intérêt, puisqu’elle pourra être le cœur ravitailleur à la fois des missions d’évangélisation et de la colonisation pénale. La Calédonie est repérée dans les années 1840 et mise en réserve pour ce projet de bagne.
Le drame des Kanak, c’est que la Grande Terre est perçue comme une île riche en terres disponibles. Elle a donc été vite considérée comme une candidate idéale pour le peuplement. Les premiers observateurs français ont voulu voir une île sous-peuplée parcourue par des tribus kanak constamment en guerre, de la même façon que les Anglais ont prétendu qu’en Australie les Aborigènes ne constituaient que des groupes épars et nomades, résidant seulement sur les côtes… Dans le projet colonial tel qu’il est imaginé dès les années 1850, les Kanak n’apparaissent pas comme un problème majeur. Les initiateurs s’imaginent qu’il sera facile de s’installer et de refouler cette petite population de « sauvages ». En réalité, la résistance ne sera pas si simple à outrepasser : les guerres démarrent dès 1855, ouvrant un cycle d’affrontements qui trouvera son point d’orgue avec la grande insurrection de 18787 et ne s’achèvera qu’en 1917, par la guerre kanak dans le nord de l’île principale, la Grande Terre8.
Ceci n’empêche pas la colonisation de se déployer et le bagne de Nouvelle-Calédonie s’ouvre sur l’île Nou en 1863.
La Nouvelle-Calédonie est présentée comme plus accueillante que la Guyane9. Qu’en est-il concrètement ?
Elle est plus accueillante parce que c’est une île qui ne connaît pas les maladies tropicales, comme la malaria. Elle est striée de rivières qui coulent le long des montagnes, de part et d’autre de la chaîne centrale, et bordée de terres alluviales assez riches, ce qui la laissait paraître comme un lieu propice à l’agriculture. Au XIXe siècle, on y voyait un climat méditerranéen, alors qu’il s’agit plutôt d’un climat subtropical, où des périodes de forte sécheresse succèdent à des cyclones et des inondations. C’est un climat finalement assez violent qui peut être difficile pour des nouveaux et nouvelles arrivant·es venu·es d’Europe.
Comme on prétendait qu’il y avait très peu de Kanak, cette île paraissait vaste. En vérité, elle ne l’est pas tant que ça : elle fait 50 km de large pour quelque 400 km de long. Et pourtant, il a toujours été difficile de s’y déplacer. D’ailleurs, les routes n’ont cessé d’être un problème majeur pour les colons, notamment parce que les gens étaient placés sur des concessions isolées, sans chemin d’accès si ce n’étaient des sentiers, qu’on appelait « kanak », permettant de rejoindre des pistes entretenues comme on pouvait. On ne voyageait pas tant par voie de terre, mais plutôt par navigation côtière, en faisant des arrêts dans différents villages.
La Calédonie a aussi attiré l’attention parce qu’elle n’avait pas de faune dangereuse. On y trouvait la roussette, le rat et quelques oiseaux qui ne volent pas, comme en Nouvelle-Zélande, ainsi que la poule, arrivée avec les Austronésiens10. En revanche, il y avait beaucoup de moustiques, et c’était infernal, y compris pour les Kanak, qui enfumaient leurs cases. Les colons ont aussi subi des invasions régulières de sauterelles dévastatrices.
Qui sont les transportés envoyés sur l’île ?
En ce qui concerne les transportés de droit commun, qui tombent sous le coup de la loi de transportation, ils sont principalement issus de classes populaires. Il s’agit d’une grande majorité d’hommes jeunes (plus de 60 % ont moins de 35 ans) qui, contrairement aux transportés britanniques pouvant être condamnés pour de petits délits, ont commis des faits délictueux plus sérieux : la moitié à peu près pour des vols avec violences, quelque 30 % pour meurtre ou tentative de meurtre, et le reste pour des affaires de mœurs, des incendies volontaires ou des escroqueries diverses.
Mais ils ne sont pas les seuls à être envoyés au bagne. Dans les années 1870 arrivent les déporté·es politiques condamné·es au titre de leur participation à la Commune ou à l’insurrection de la Grande Kabylie11, qui finiront par être amnistié·es et par quitter l’île, en 1880 pour les premier·es et en 1895 pour les second·es. À partir de 1885, sont aussi envoyé·es sur l’île les récidivistes, tombant sous le coup d’une loi sur la relégation en réponse à la montée de la petite délinquance. Elle infligeait une double peine à des hommes et femmes qui cumulaient de petits délits : après avoir purgé leur peine en prison, ils et elles étaient forcé·es de partir en exil aux colonies. On s’est donc mis à envoyer en Nouvelle- Calédonie des gens condamnés pour un simple vol, pour vagabondage ou atteinte à la pudeur. La population de ces relégué·es, plus mixte et plus âgée que celle des transportés, a été condamnée en grande majorité à la « relégation collective », et donc placée au bagne où elle constituait la catégorie de prisonnier·es la plus méprisée, y compris par les transportés eux-mêmes.
Comment le gouvernement compte-t-il faire participer ces condamné·es à l’effort de colonisation ?
D’abord en les obligeant à rester sur place après avoir purgé leur peine. Au total, on envoie en Calédonie environ 22 000 transportés de droit commun, auxquels il faut ajouter quelque 4 000 relégué·es et 4 000 déporté·es politiques. Les transportés condamnés à moins de huit ans doublent leur peine en résidence obligatoire. La peine minimale aux travaux forcés étant de cinq ans, le temps de résidence ne peut être inférieur à dix ans. Et le billet du retour n’est pas payé. Les autres sont tou·tes condamné·es à l’exil à perpétuité. L’île devient donc une sorte de lieu d’empilement de gens qui, à l’issue de leur peine, à 35 ou 40 ans, n’ont pas le droit de la quitter (excepté les déporté·es après leur amnistie).
Parmi les transportés, ceux qui sont jugés les plus méritants, du fait de leur docilité au travail et de leur soumission aux règles du bagne se voient attribuer des concessions de terres, sur les zones de la côte ouest dont les Kanak ont été expulsé·es. Initialement, ces parcelles devaient être attribuées à des libérés du bagne, mais pour mieux les contrôler on finit par les offrir aux condamnés en cours de peine. Les concessions font quatre hectares : tu as une fourche, un mouchoir, pour pleurer sans doute, et tu te débrouilles. Ce qu’il reste dans les mémoires, c’est l’extrême difficulté de cette installation. Certains ont des origines paysannes et peuvent s’en tirer en plantant des haricots, c’est ce qu’on leur demande, mais la plupart – y compris chez les colons libres – viennent de ce qu’on appelle déjà « la zone », c’est-à-dire des faubourgs. Ils sont a priori sans expérience ni connaissance des travaux paysans et ne savent pas faire. Les hommes sont déjà un peu âgés, la quarantaine au moins, ils ont vécu cette expérience traumatique et exténuante du bagne et se retrouvent dans les vallées perdues de Fonwhari ou Farino, seuls sur leur concession. Ces solitudes sont alignées de quatre hectares en quatre hectares. Des solitudes masculines, puisque rares étaient les épouses à se porter volontaires.
Dans les centres de colonisation pénale, beaucoup abandonnent leur concession parce qu’ils ne s’en sortent pas. Ceux-là rejoignent alors leurs camarades du bagne qui n’ont pas pu accéder à une concession de terre et qui quittent le pénitencier avec un baluchon et l’interdiction de résider sur la commune de Nouméa. Ils doivent alors se débrouiller pour survivre dans le reste du territoire en cherchant à se faire embaucher dans les mines ou sur les propriétés des colons.

Le projet de colonisation ignore le monde kanak. Quelle connaissance ont les colons français·es de ce peuple ? Quels contacts existent alors ?
En 1863, on installe le bagne sur une péninsule où l’occupation kanak n’est que saisonnière, mais les Français·es finissent par investir la Grande Terre. On parle classiquement de 50 000 Kanak, mais les traces archéologiques laissent penser qu’il y aurait eu une population plus nombreuse avant l’arrivée des premiers Blancs. Quoiqu’il en soit, le territoire est totalement investi, la toponymie est extrêmement riche, et les groupes kanak forment un monde à la fois enraciné et mobile qui occupe l’ensemble de la Grande Terre.
Les colons pénaux installés après 1878 dans la vallée de Fonwhary, où la population kanak fut très nombreuse avant d’être complètement expulsée, prétendirent longtemps qu’il n’y avait jamais eu de Kanak. Ils ne voulaient pas voir les traces des billons d’ignames, des tertres de cases, des arbres plantés. Les Kanak cultivent de petites parcelles et font des jachères pour faire tourner : ils dégagent un coin de brousse, puis un autre, etc. Les Européen·nes qui s’installent n’y voient que de la brousse, ils ne distinguent même pas les jardins, ne se disent pas que les trois pins colonnaires sont là pour une raison, que ça peut faire sens. Pourtant, les Kanak étaient des horticulteurs hors pair, capables de mettre en place de vastes tarodières installées en terrasse à flanc de montagne et un système d’irrigation intelligemment conçu qui ont fait l’admiration des premiers observateurs. Mais les descendant·es de colons que j’ai interrogé·es dans les années 1990 préféraient ne rien voir et prétendre qu’il n’y avait rien avant elles et eux. C’est une projection-écran : il n’y avait rien puisqu’ils ont tout créé, et ça justifie tout. Le savoir-faire du monde kanak a donc longtemps été disqualifié par projection autojustificatrice. L’ethnologue Georges Balandier a écrit des choses très intéressantes sur ce type d’aveuglement idéologique produit par la colonisation, qui justifie sa raison d’être par la disqualification de l’autre, de ses capacités, de ses techniques et de son agriculture12.
Mais ce n’est pas toujours vrai. D’autres positions fabriquent des représentations différentes. Le missionnaire qui vit au milieu des « indigènes » pour les évangéliser n’a pas les mêmes intérêts et points de vue que les petits colons accrochés à leur terre. Parce qu’il cherche à persuader des hommes et des femmes a priori peu convaincu·es de la pertinence du message du Christ, il a besoin d’apprendre les langues, de traduire la bible et de communiquer. Certains sont allés plus loin dans la compréhension du monde autochtone, et ont écrit de véritables essais ethnologiques13. Pour le colon installé sur sa terre, l’enjeu n’est pas le même. Prenons le petit colon arrivant de France, s’installant dans un environnement local auquel il ne comprend rien, et sur lequel il projette pour « créer » son jardin, sa maison, ses légumes « comme en France ». Tout l’enjeu est de recréer le monde familier dans lequel il vivait avant. Il n’a ni le temps ni l’envie d’apprendre la langue kanak et de s’intéresser à un monde « sauvage » qui pourrait lui faire perdre ses propres valeurs et repères. Même si certain·es parviennent à naviguer entre les deux mondes, il leur faut la plupart du temps composer avec la peur du déclassement, de la perte de soi, dans un environnement qu’ils et elles ne maîtrisent pas et dont il leur faut se défendre pour « rester soi ».
Les acteurs placés plus haut dans la hiérarchie n’ont-ils pas intérêt à essayer de comprendre ? Ne serait-ce que pour décider où implanter un centre, comment tirer profit du sol, etc.
L’État colonial ne s’est pas posé trop de questions. Plutôt que de vraiment observer, il est plus facile d’inventer des grilles qui répondent aux intérêts de la realpolitik de la colonisation, c’est-à-dire prendre des terres. Pour faire du cantonnement, par exemple, la connaissance intime de ce que les Kanak concevaient comme étant la propriété personnelle n’était pas utile. Le cantonnement, qui trouve son origine en Algérie avant d’être étendu en Nouvelle-Calédonie, justifie juridiquement la stratégie de refoulement des populations locales sur des espaces restreints, qu’on finit par appeler « réserves indigènes ». Celles-ci sont désignées comme relevant d’une propriété collective inaliénable, incommutable et incessible. L’État justifie la pérennisation des terres collectives par la construction d’une fiction qui consiste à appliquer aux Kanak l’image de sociétés ignorant la notion de propriété au profit d’un « communisme primitif ». Or les missionnaires sont les premiers à contredire cette vision : ils affirment que les Kanak, tout au contraire, attribuent précisément des champs à des noms de famille et à des individus. Si la propriété privée telle qu’on l’entend n’a pas de sens, remarquent-ils, l’idée que certains espaces sont solidement appropriés est une évidence. La formule « C’est mon champ », fréquemment utilisée, en témoigne. Mais l’État colonial préfère défendre l’idée d’une propriété collective pour récupérer des terres et contrôler le marché foncier.
Ceci dit, le monde colonial avait besoin de comprendre un certain nombre de choses. Depuis le XVIIIe siècle, le siècle de l’observation, l’Europe sait fabriquer des géomètres pour arpenter le territoire, des gens capables de repérer des roches potentiellement à nickel, du fer, ou encore décider des cultures les plus profitables, et ce, sans avoir recours aux savoirs autochtones. En revanche, pour affirmer son autorité et imposer ce qu’il appelait « la pacification », l’État a besoin, dans une certaine mesure, de connaître les hiérarchies kanak, les hommes influents et la nature des conflits internes.
Il a aussi besoin de savoirs et d’appuis locaux pour mener les guerres. Ceux qui ont vraiment aidé les troupes militaires à mener les combats efficacement, ce sont les auxiliaires kanak. La France avait la supériorité technique, mais elle avait quand même besoin des gens. On le voit dans les guerres de 1878 et de 1917. Côté kanak, l’extrême difficulté a été de transcender les divisions pour élargir les alliances, présenter un front – ce qui est toujours très difficile pour les sociétés segmentaires. C’est le cas aussi ailleurs, en Algérie ou encore en Nouvelle-Zélande.
À partir des années 1880, la colonisation libre est fortement encouragée. Qu’est-ce qui change ?
En 1887, le projet calédonien commence à basculer dans un projet exclusivement dédié à la « colonisation libre ». On passe de l’empire pour les pauvres, version Victor Hugo, à l’empire du petit entrepreneur. Il ne s’agit plus d’inviter le paysan pauvre ou la déclassée à partir s’installer aux colonies, mais d’attirer le petit entrepreneur qui a un peu d’argent, 5 000 francs-or d’après la loi. On fait pour cela appel aux piliers de la Troisième République, aux petits capitalistes et notables.
À partir de ce moment-là, le petit paysant cède la place à l’exploitant, développant une culture du rendement qui annonce une certaine modernité. L’agriculture devient un moyen de dégager du profit. L’Union coloniale, organe de propagande au service de l’émigration des Français·es vers les colonies, fournit des éléments de connaissance. Elle publie un guide de l’émigrant prodiguant des conseils d’agriculture pour mettre en valeur le lopin de terre qu’offre l’État en Nouvelle-Calédonie. Cet organe enseigne également au candidat colon la façon dont il faut traiter la main-d’œuvre locale qu’il pourra recruter : les « races », kanak, javanaise, tonkinoise… et leur supposé tempérament respectif. Tu imagines : tu es un forgeron français, tu pars, on te donne une terre, et puis on te distribue ce livret – « Les Kanak sont paresseux », « Vous traiterez les Javanais avec beaucoup de sévérité », etc. On y décrivait des races de travailleurs, et c’est comme ça qu’on t’apprenait à devenir un patron.
À la fin du XIXe siècle, on a misé sur le café pour soutenir cette colonisation, avec l’idée de couvrir tout le territoire, non seulement les plaines alluviales, mais aussi les zones montagneuses. Cette politique s’accentue entre 1894 et 1902, pendant la période d’exercice du gouverneur Paul Feillet, qui se donne pour mission de diminuer l’emprise de l’administration pénitentiaire et d’attirer davantage d’Européen·nes libres.
Une génération de « colons Feillet » émigre, avant tout en couple, ou en famille restreinte, nucléaire. J’ai pu trouver quelques réseaux, mais les migrations françaises se passent beaucoup moins en réseau que les britanniques. Généralement, on part avec sa famille plus, éventuellement, quelques gens du cru. C’est dans le bateau qu’une sociabilité commence à se créer. Arrivé·es au dépôt des immigrant·es, à Nouméa – il faut s’imaginer la situation –, les gens discutaient : « Où est-ce qu’on va nous installer ? » Le gouverneur venait les visiter en leur listant les centres, puis les futurs colons étaient distribués sur les lieux. C’était quand même une drôle d’aventure.
On note une tendance, pour les premiers fondateurs et fondatrices de centres de colonisation, à se marier entre elles et eux pour éviter toute mésalliance dans un pays peuplé de « Blancs déchus » – les bagnards et les libérés – avec lesquels il est inconcevable d’allier leur fille.
La réputation de l’île était relativement peu vendable au XIXe siècle : il y avait des « sauvages », notoirement anthropophages, et des condamnés au bagne. Convaincre des colons libres en se contentant de leur offrir une terre et de leur dire « Ça va être super ! », ce n’était pas facile. Ils y sont arrivés, ce qui est incroyable.
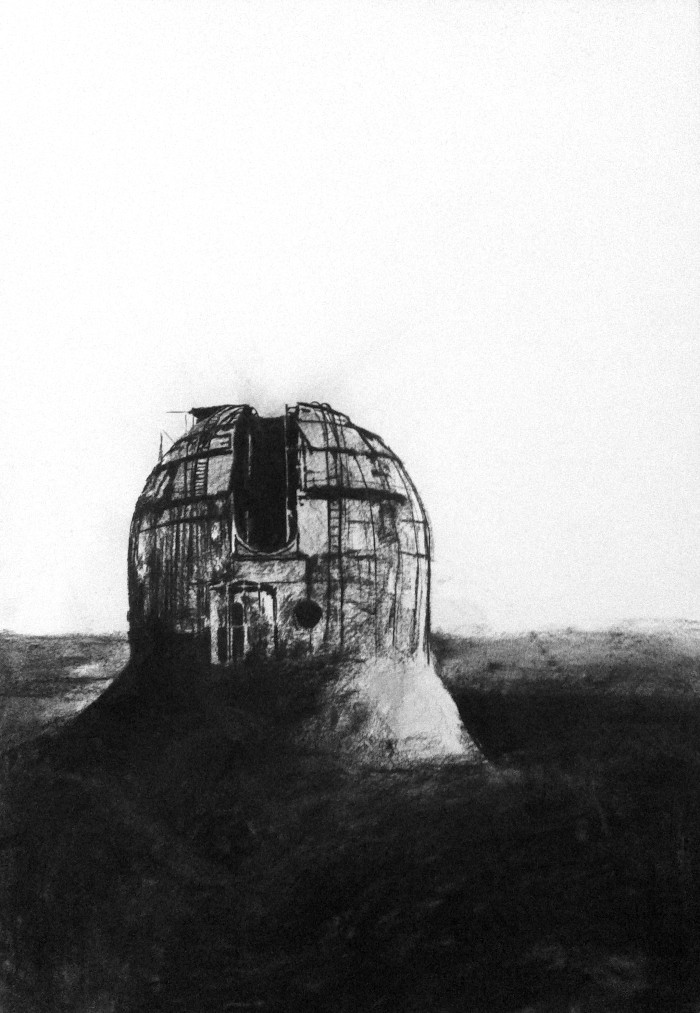
Finalement, l’expérience des « colons Feillet » est un échec…
Disons plutôt que ça n’a pas duré très longtemps. Le ministère des Colonies a soutenu cette stratégie une vingtaine d’années tout au plus, jusqu’au tout début du XXe siècle – où s’enchaînent le départ de Feillet, en 1902, et une crise économique, dans les années 1903-1904. Les dernières tentatives d’installation se feront dans les années 1920, juste après la guerre de 1914-1918, depuis les régions dévastées du nord de la France.
Pour beaucoup de « colons Feillet », l’installation est très difficile. À cet égard, je trouve le témoignage de Ludovic Papin14 extraordinaire. Cet homme est plutôt sympathique, un artisan-ouvrier qui aurait eu un tout autre destin s’il était resté en France, mais qui décide de partir, on ne sait pas trop bien pourquoi, le goût pour l’aventure sans doute. On est à la fin du XIXe siècle. Il arrive à Oué Hava, près de Hienghène, où les Kanak sont resté·es longtemps puissant·es. Il se voit attribuer un lopin où il y a plein de cocotiers, et il trouve extraordinaire de bénéficier aussi facilement d’arbres en pleine maturité. Il ne veut pas comprendre que c’est le résultat du travail des Kanak qui viennent d’être expulsé·es. Mais tout n’est pas simple pour lui non plus : à l’embouchure de la rivière est installé un ancien déporté de la Commune, qui a été de la Sociale15 mais qui, une fois en Calédonie, semble avoir oublié tout ça. Ce dernier fait payer très cher le passage des produits que les colons acheminent par la rivière pour les charger sur le « tour de côte » – le bateau qui ravitaille les centres de brousse en cabotant le long des côtes. S’ajoutent à ça les moustiques, le corps souffrant sous le coup du travail et de la chaleur, et puis l’extrême isolement dans lequel Papin se trouve, dans la mesure où les seuls liens qu’il peut nouer sont forcément avec des Européen·nes. Son premier voisin colon, seul interlocuteur possible, est à six cents mètres de chez lui, ce qui est beaucoup dans ces vallées.
Il voit bien les Kanak s’agiter autour de lui, sans rien comprendre au monde qui l’entoure – alors même que ce dernier est en grande difficulté : le gouvernement procède au cantonnement et à la délimitation des réserves indigènes, obligeant les Kanak à quitter leurs terres pour laisser les colons s’y installer. Il n’a aucune empathie, il est insensible au fait qu’il est sur une terre kanak, qui vient d’être spoliée. Il ne voit rien, si ce n’est des gens qui se promènent beaucoup. Il rencontre même le chef Amane16, et trouve que c’est un garçon tout à fait intelligent et sympathique. Les Kanak, en réalité, sont en train de faire circuler les monnaies de guerre, messages visant à créer les alliances nécessaires à la préparation d’un conflit. Et Papin de déplorer le fait que les Kanak se promènent innocemment et ne travaillent pas assez, lisant les événements qu’il observe à travers une grille déréalisante. Ce qui lui vaudra d’être tué par les Kanak, tout comme ses voisin·es, le couple Grassin, lors de l’insurrection qui explose dans le nord en 1917.
Toustes ne connaissent pas le même sort. Comment font certain·es pour mieux s’en sortir ?
En premier lieu, il y a quelques grands éleveurs sortant de familles ayant du capital, ou arrivés au tout début de la colonisation. Dès avant la guerre de 1878, ceux-là se sont composé une assise foncière très importante, et même quand ils ont été malmenés par la révolte, ils ont pu la reconstituer. Ils pouvaient être, à l’origine, négociants, chercheurs d’or ou marins circulant entre l’Europe, les États-Unis et l’Australie ou la Nouvelle- Zélande, et avaient fini par s’installer en Nouvelle- Calédonie. Se lançant dans l’élevage, ils poussaient le bétail qui détruisait les jardins kanak et faisait fuir les habitant·es pour s’accaparer de vastes domai- nes fonciers.
Mais les petits colons, libres ou « pénaux », peuvent aussi réussir en accumulant les concessions abandonnées par d’autres. Avec Adrian Muckle, nous avons étudié de très près le tissu social colonial dans le nord de la Grande Terre, où se côtoient les espaces de colonisation libre, pénale, et les réserves indigènes. Certaines trajectoires sont étonnantes. Nous avons découvert l’histoire d’un condamné qui arrive à convaincre son épouse de venir avec ses enfants, alors jeunes adultes, ainsi qu’un gendre. Il demande à l’administration pénitentiaire d’étendre son domaine foncier, parce qu’il a une femme et trois fils, et requiert aussi une terre pénale pour son gendre. L’administration n’est pas contente parce que le gendre est de statut libre, et qu’il n’a pas le droit à cette concession. Le cas remonte au plus haut de la hiérarchie pénitentiaire, et même jusqu’au ministère, ce qui est en soi étonnant pour un simple concessionnaire pénal condamné au bagne. Il s’empare progressivement des concessions abandonnées par ses coreligionnaires du bagne pour consolider un domaine foncier. Ses fils vont, comme les colons libres, grignoter les terres de leurs voisins kanak les plus vulnérables. La famille arrive, grâce au bagne et au système de concessions pénales, à se constituer un solide héritage et parvient à passer la barrière symbolique qui séparait, en principe strictement, les « libres » et les « pénaux ». Acquérant un hôtel, elle finira par être connue « honorablement » dans les années précédant la guerre de 1914.
Il y a aussi des gens qui ont fait de l’argent à Nouméa, dans l’import-export, etc., mais ceux qui sont restés cultivateurs, à part quelques exceptions, n’ont pas fait grosse fortune. Dans la colonisation « de brousse », la richesse est extrêmement relative et contextuelle. Elle est fortement liée à la terre : dans ce monde colonial calédonien, on n’existe qu’avec des noms inscrits dans la terre. Ce qui veut dire que tous les libérés qui ont circulé et qui n’ont pas eu de descendance ou de terre ont tout simplement disparu. Il en va de même des candidat·es colons venu·es librement, mais qui ont échoué et ont dû retourner à Nouméa ou demander leur rapatriement en France. Ce qui existe, ce sont les noms de lieux et de familles, et on se retrouve avec deux peuples de paysan·es, kanak et caldoche17, face à face, viscéralement vissés sur la terre.
Les colons qui ont pu s’ancrer se sont ainsi distingué·es des autres arrivant·es mais aussi, bien sûr, des Kanak et des engagé·es. L’identité des hommes ou des femmes du pays colon est étroitement corrélée à la présence des colonisé·es, et le racisme devient culture coloniale. Les travaux des années 1950 sur la colonisation ont mis en avant cette co-construction du colonisé et du colonisateur18. Ce qui différencie, à l’époque, un·e colon français·e de Nouvelle-Calédonie d’un·e Français·e de Toulouse, par exemple, c’est un environnement spécifique fondamentalement structuré par la distinction raciale. Être colon, c’est se distinguer en particulier des indigènes et des travailleurs importés qui leur sont assimilés. Cette culture coloniale était assise sur la logique de la distinction raciale et raciste qui justifiait un sentiment de supériorité et une légitimité. Pour les descendant·es des colons, cet héritage est aujourd’hui difficile à reconnaître et à dépasser.
- Le 22 avril 1988, un groupe du FLNKS attaque une gendarmerie sur l’île d’Ouvéa. Quatre gendarmes sont alors tués et vingt-sept sont pris en otage et divisés en deux groupes. Le premier groupe est libéré trois jours plus tard, mais les seize autres otages sont amenés dans une grotte du nord de l’île. L’assaut y sera finalement donné à l’aube du 6 mai, faisant dix-neuf morts côté indépendantiste et deux côté forces de l’ordre. ↩
- Dès les années 1870, la colonie exploite des travailleur·ses forcé·es à venir des Nouvelles-Hébrides. Avec la prévision de l’arrêt de la transportation de bagnards (effective en 1897), le besoin en main-d’œuvre se fait pressant et l’administration choisit de recruter des travailleur·ses immigré·es sous contrat javanais·es et tonkinois·es, en situation de grande misère sur leurs terres d’origine, et dont le statut est assimilé à celui des indigènes. ↩
- Jeremy Bentham (1748-1832) était un philosophe du droit britannique, père de l’utilitarisme et précurseur du libéralisme. ↩
- Jeremy Bentham, Panoptique. Sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection, et nommément des maisons de force, Imprimerie nationale, Paris, 1791. Disponible sur <gallica.bnf.fr>. ↩
- Donné le 18 mai 1879 à l’occasion d’un banquet commémoratif de l’abolition de l’esclavage, Actes et paroles, vol. IV, disponible sur <gallica.bnf.fr>. ↩
- La Marine française sortit très affaiblie de la période révolutionnaire à cause de la guerre menée par les puissances étrangères, de la désertion de ses cadres aristocrates et de problèmes d’organisation. Napoléon ne lui accorda pas les moyens de se reconstruire, privilégiant des stratégies terrestres dans les guerres qu’il mena. ↩
- Les 25 et 26 juin 1878, les clans kanak de La Foa et de Boulouparis s’allient pour attaquer les Européen·nes de leur voisinage et font une centaine de mort·es, pillent les habitations, incendient les cultures et abattent le bétail. Les raids se poursuivent tout l’été et s’étendent principalement le long de la côte ouest de l’île. Une répression terrible s’abat sur les insurgé·es et leurs familles dès le début du mois de juillet, et les redditions s’enchaînent à partir du 1er septembre, où le plus célèbre des chefs de guerre kanak, Ataï, est tué par les auxiliaires kanak de Canala, ralliés à la France. ↩
- Les affrontements entre Kanak et forces coloniales éclatent dans le nord de l’île dans le contexte du recrutement forcé des contingents kanak pour le front. Après des années de spoliations foncières, de cantonnement, de mise au travail forcé et d’impôt de capitation, la pression exercée pour l’engagement des « volontaires » pour la Grande Guerre met le feu aux poudres. Voir Alban Bensa, Kacué Yvon Goromoedo et Adrian Muckle, Les Sanglots de l’aigle pêcheur, Anacharsis, 2015. ↩
- Qui accueillit un bagne de 1852 à 1946. ↩
- Groupe ethnolinguistique, dont l’origine se trouve à Taïwan et qui s’est répandu il y a 2 000 à 3 000 ans en Océanie, à l’exception de l’Australie, jusqu’aux confins de la Polynésie, l’île de Pâque à l’est, Hawaï au nord et la Nouvelle-Zélande au sud. Les Austronésien·nes sont aussi parti·es vers l’ouest à travers les îles Andaman puis l’océan Indien jusqu’à Madagascar. ↩
- En mars 1871, c’est-à-dire au même moment que la Commune de Paris, a lieu en Algérie la révolte des Mokrani ou insurrection de la Grande Kabylie. Il s’agit de la plus grande insurrection menée contre le pouvoir colonial français depuis le début de la colonisation de la région. ↩
- Voir Georges Balandier, « La Situation coloniale : une approche théorique » dans Cahiers internationaux de sociologie, vol. 11, 1951, p. 44-79, Les Presses universitaires de France, <classiques.uqac.ca>, et Isabelle Merle, « “La situation coloniale” chez Georges Balandier. Relecture historienne », Monde(s), 2013/2, no 4. ↩
- Voir par exemple, Père Lambert, Mœurs et superstitions des Néo-Calédoniens, 1900 (rééd. Nouméa, 1976) et M. Leenhardt, Do Kamo. La Personne et le mythe dans le monde mélanésien,Gallimard, 1947. ↩
- Bernard Papin, Vie et mort de Ludovic Papin chez les Canaques, L’Harmattan, 1997. ↩
- La « République sociale », ou simplement « la Sociale », est une revendication récurrente des différents mouvements de gauche des XIXe et XXe siècles, prônant la prise en compte et l’intervention des forces sociales dans les institutions, notamment sous la forme de protections sociales et de mécanismes de redistribution des richesses. ↩
- Fils du chef de la tribu des Poyes, avec son frère aîné Bouillant, il est une figure centrale de la guerre de 1901 contre les Touho, menée sur fond de résistance à la capitation, un impôt par tête imposé par la France. Il sera arrêté en 1908 et déporté en France, où il mourra durant la Grande Guerre. ↩
- Terme familier désignant les membres de la population calédonienne d’origine européenne issue des vagues d’émigration anciennes de la seconde moitié du XIXe siècle et première moitié du XXe siècle. ↩
- Voir Georges Balandier, « La Situation coloniale », art. cité, et Albert Memmi, Portrait du colonisé précédé de Portrait du colonisateur, Paris, 1957. ↩








