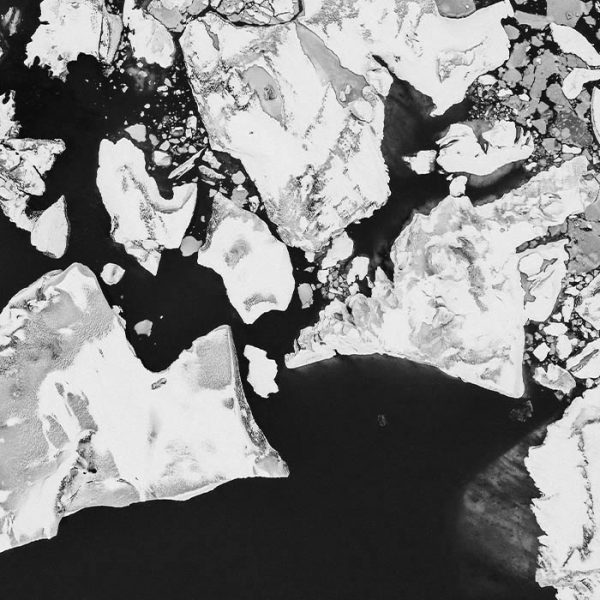Traduit de l’anglais par Xavier Bonnefond et Emmanuel Broda-Morhange
Article original : « The Overproduction of Intelligence », The Brooklyn Rail
Aux États-Unis comme en France, le système éducatif est à la fois un acteur majeur de la reproduction des inégalités et un vecteur important d’ascension sociale pour les populations défavorisées. Dans les années 1960-70, décrocher son diplôme pouvait donner accès à la classe moyenne, à un emploi stable et bien payé, à la culture, à la consommation et au « confort moderne ». Cela permettait en tous cas d’espérer échapper à sa condition sociale. Mais, une fois les communautés ouvrières liquidées et la désindustrialisation réalisée, qu’advient-il aujourd’hui des diplômé⋅es du supérieur que le marché du travail ne peut plus absorber ? Le sociologue et anthropologue Gary Roth propose ici une histoire audacieuse de ces intérimaires, travailleurs et travailleuses à temps partiel et « freelances » états-unien⋅nes qui constituent ce nouveau précariat diplômé.
Télécharger l’article en PDF.
Toute crise économique traîne dans son sillage une réorganisation massive de la société. La Grande Récession de 2008, aussi clémente puisse-t-elle paraître en comparaison des bouleversements passés, a transformé le monde de manière imprévue il y a tout juste dix ans. Que les diplômé·es d’université se retrouvent touché·es dans cette dernière phase de restructuration a pris quasiment tout le monde par surprise. Selon la Federal Reserve Bank de New York, près de la moitié des récent·es diplômé·es, soit 44 %, occupent actuellement des emplois ne requérant pas d’études supérieures 1. Il s’agit là d’un taux d’échec extraordinaire. Certes, l’incorporation des nouvelles et nouveaux arrivant·es dans le monde du travail a toujours été un processus lent, mais les diplômé·es d’université sont face à une situation tout à fait inédite. Servant autrefois de voie d’accès à la classe moyenne, les études supérieures sont à présent pavées d’incertitude et de dettes. Une proportion non négligeable de la population est en récession sociale. Accueillons le nouveau « précariat » – précaire et prolétarisé.
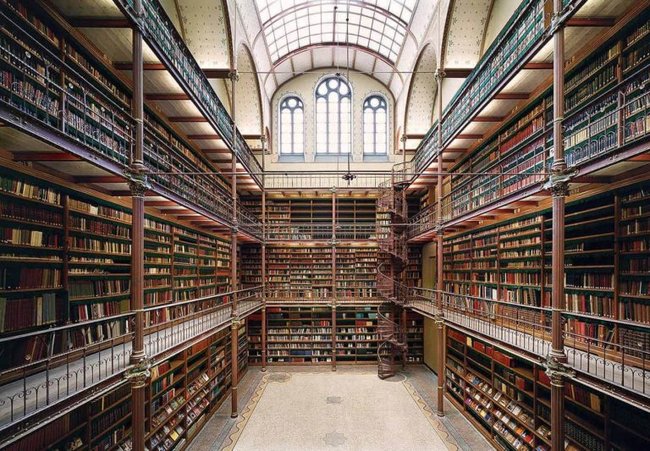
Ce n’est pas la première fois que l’économie moderne produit un tel surplus. Dans les années 1970, une génération de diplômé·es s’était déjà heurtée à un plafond de sous-emploi et de chômage 2. Tout comme aujourd’hui, c’était une période d’importants bouleversements et ajustements économiques aux échelles nationales et internationales. Et comme aujourd’hui, les étudiant·es occupaient une place centrale dans les élans de protestation se répandant sur la planète, avec, dans les années 1960 et 1970, une multitude de mouvements de libération nationale, pour les droits civiques, contre la guerre ou sur les identités et, ces dernières années, le mouvement Occupy et le printemps arabe. Ce qui a brouillé notre compréhension des développements les plus récents, c’est qu’un grand nombre des luttes étudiantes se développaient à l’intérieur du système universitaire ; c’est-à-dire avant que les étudiant·es arrivent sur le marché du travail. Il s’agissait d’une cohorte hautement éduquée insaisissable pour la nomenclature économique existante (qu’on nommerait aujourd’hui « précariat ») ; à la place de quoi les médias collaient des étiquettes tirées d’une psychologie de bas étage pour identifier un « gouffre générationnel » à l’origine d’une « révolte de la jeunesse ».
Cependant, la production de diplômé·es s’est retrouvée en butte à la capacité du système à les absorber. Richard Freeman, qui décrit très précisément ce phénomène dans The Overeducated American, écrit : « [Les] titulaires de diplômes […] dans la plupart des domaines ont, dès le début des années 1970, accepté des salaires à des taux de rémunération réels bien en-deçà de ceux de leurs prédécesseur·es – et bien souvent pour des emplois hors de leur domaine d’études et bien moins prestigieux que celui auquel ils ou elles aspiraient 3. » En d’autres termes, ce qui avait débuté dans les années 1960 comme un rejet de la société états-unienne, dû à ses caractères endémiques relatifs aux inégalités et à la guerre, est devenu une incapacité du système à intégrer dans le marché du travail à cause de changements des conditions économiques. Un demi-siècle plus tard, nous sommes maintenant en mesure d’identifier un schéma récurrent qui n’a été qu’entraperçu à ses prémices : les diplômé·es du supérieur en pleine chute sociale et économique.

La différence entre hier et aujourd’hui, pourtant, c’est que dans les années 1970, la population diplômée à l’université ne faisait pas encore l’objet d’une restructuration économique. Plutôt que la précarisation du travail et sa mutation en emplois à temps partiel sous-qualifiés, c’est la désindustrialisation du prolétariat d’usine qui était à l’ordre du jour. Les rebelles des années 1960 et 1970 avaient une certaine chance. Malgré la stagnation économique qui allait marquer la décennie suivant leur sortie du système universitaire, les diplômé·es du supérieur ont fini pas trouver du travail, tandis que des pans entiers de la classe ouvrière étaient en train de perdre les leurs. L’automatisation des usines et la délocalisation de la production vers des régions du monde à bas salaires constituaient le leitmotiv d’une perte de profitabilité que les machines avaient du mal à compenser. L’informatisation du travail qualifié est un événement récent.
Aujourd’hui, quelque 40 % des 18-24 ans du pays sont étudiants 4. En considérant qu’une même proportion de 44 % d’entre elles et eux ne trouvera pas d’emploi convenable, on arrive à près d’un cinquième (18 %) de l’ensemble de cette tranche. Ils et elles viennent s’ajouter aux 60 % restant des 18-24 ans qui n’entrent pas du tout à l’université et se retrouve dans une situation réellement désespérée, confronté·es à des salaires qui stagnent, quand ils ne baissent pas purement et simplement, depuis les années 1970. Une grande partie du problème vient de ce que beaucoup d’emplois sont à présent à temps partiel ou temporaires, avec des employé·es désigné·es comme « freelances » ou « partenaires indépendant·es ». Les estimations varient grandement – de 20 à 40 % de tous les emplois du pays –, mais dans toutes ces études, une quantité énorme de personnes se retrouvent dans cette catégorie 5. La situation des diplômé·es d’université reflète assez précisément le schéma global aux États-Unis, dans lequel la population se divise entre une classe supérieure ou moyenne-supérieure aisée, représentant entre 18 et 22 %, et tou·tes les autres, allant au devant d’un avenir morose. Une classe ouvrière très large est en train de se former avec, comme dernier apport, une poussée des diplômé·es du supérieur déclassé·es.

C’est le scénario contraire qui s’était déroulé pendant les années suivant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient vu un segment majeur de la classe ouvrière obtenir son entrée dans le système universitaire, et dans la classe moyenne par la même occasion. C’était l’âge d’or de l’ère keynésienne, quand on pensait que les dépenses du gouvernement pouvaient faire fructifier l’ensemble de l’économie avec très peu d’effets pervers 6. L’enseignement bénéficia grandement de ces largesses, en particulier les universités publiques, qui ont continué de se développer depuis. La décomposition de la classe ouvrière, au moyen de son absorption partielle dans la classe moyenne, constitue un des plus grands succès du capitalisme. Les études, spécifiquement les études supérieures, devinrent l’un des principaux mécanismes par lequel les classes sociales furent séparées les unes des autres. C’est ce qui distingua les cols blancs des cols bleus, et aussi l’emploi de bureau du travail en usine ou en entrepôt. Appartenir à la classe moyenne était synonyme d’être passé par l’université. Bien sûr, le fonctionnement réel du système de classes était bien plus complexe et nuancé que ça 7, mais néanmoins, l’appartenance de classe et le niveau d’éducation devinrent – dans l’esprit des gens comme dans le vécu de nombreuses personnes – inextricablement liés.
Le fait le plus important de cette époque reste l’abandon quasi total de l’identité ouvrière par la classe ouvrière elle-même, jusqu’à ses composantes qui restaient ancrées aux professions, aux quartiers et aux revenus traditionnels de cette classe. C’est là également un développement non prévu par les commentateur·trices, quelles que soient leurs orientations et allégeances politiques. Dans The End of Ideology (1960), Daniel Bell a posé les bases du débat pour les universitaires et les diplômé·es du supérieur ; en ce qui concerne la classe ouvrière, les discussions ont eu lieu par l’intermédiaire des journalistes de la presse et des stars des journaux télévisés. Ce n’est pas que les classes avaient disparues, mais plutôt qu’on était soit « classe moyenne » soit pauvre. Dans un premier temps, seul un faible pourcentage de la classe ouvrière connut cette transformation, mais ce fut suffisant pour pousser tou⋅tes les autres à repenser leur identité 8. La « classe ouvrière » en tant que cadre de référence disparut largement des vocabulaires.

Les Trentes Glorieuses ont été le théâtre d’énormes succès matériels. L’expansion simultanée des domaines public et des affaires était d’une importance particulière pour les étudiant·es. Alors que la population des États-Unis augmentait d’un tiers entre 1950 et 1970, celle liée à l’université se voyait multipliée par deux et demi. Le nombre d’emplois de fonctionnaires d’État a doublé pendant cette période. Le nouveau rôle de stimulateur et de régulateur de l’économie endossé par le gouvernement nécessitait une énorme bureaucratie pour tenir tous ses engagements. Et cela a précipité la reconfiguration des classes sociales.
Le monde des affaires subissait également de nombreuses transformations, en particulier son expansion à l’international et le déploiement de niveaux inédits de commerce qui mettait l’accent sur la distribution, le marketing et la vente de biens produits en quantités et en variété inconnues jusque-là. De même, ces activités requéraient de nouvelles bureaucraties pour accompagner et superviser les équipements productifs sous-jacents, qui avaient eux-mêmes gagné en complexité à cause de la mécanisation et d’une division internationale du travail toujours plus avancée. La multiplication soudaine des valeurs d’usage nécessitait un appareil administratif totalement nouveau. Les emplois de cols blancs (de bureau) a augmenté de 75 % tandis que la population active civile n’augmentait que d’un tiers 9. Après trois quarts de siècle d’industrialisation à grande échelle, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’aux décennies suivant la Seconde Guerre mondiale, l’économie était à même d’incorporer une partie de la classe ouvrière dans la classe moyenne pour gérer l’accroissement de ces composantes de la société 10. L’augmentation du niveau d’éducation reflétait les besoins de main-d’œuvre dans la gouvernance et les affaires.

Il n’en fallait pas plus pour que la mue de l’identité de la classe ouvrière s’enclenche. La prolifération de marchandises y suffisait. Pour la première fois dans l’histoire, la classe ouvrière pouvait consommer une grande variété de biens non périssables et durables, tels des appareils de cuisine et des automobiles ; un confort matériel qui, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, avait été réservé aux classes moyennes et supérieures. La variabilité de modèles, couleurs et options, toutes calibrées pour des niveaux de revenus distincts, impliquait que la consommation était stratifiée, quand elle n’était pas carrément individualisée. Les vêtements, en particulier, avaient déjà évolué dans ce sens depuis plusieurs décennies. Tout ceci constituait une forme d’ascension sociale, indépendamment des niveaux de salaire réels. Qu’on soit réellement membre de la classe moyenne semblait ne pas importer quand il s’agissait de la consommation et des choix individuels qu’elle offrait. À l’intérieur même du monde ouvrier, d’autres processus diminuaient l’attention portée à la classe sociale comme marqueur d’identité. Depuis la fin du XIXe siècle, l’univers du travail, pour les cols bleus comme pour les blancs, avait introduit de minuscules gradations dans les titres et grilles de salaire afin de maintenir la compétition entre les employé⋅es, tout en fournissant une petite dose de flexibilité dans leurs professions et leurs revenus 11.
Le monde des affaires a vite pris acte de ces nouvelles tendances. L’attention s’est portée sur la consommation individuelle plutôt que sur la position dans l’appareil productif (valeur d’usage versus valeur d’échange). Et quand, par-dessus tout, les parents de la classe ouvrière se sont mis à élever leurs enfants afin d’intégrer la classe moyenne, l’utilisation de la classe comme marqueur d’identification a été rendue encore plus floue. Dans ces conditions, la « classe ouvrière » est devenue un statut à dépasser plutôt qu’à embrasser. En tout cas, l’identité ouvrière n’avait jamais été stable. La stabilité requérait un monde relativement inchangé d’une génération à l’autre, alors qu’au sein du capitalisme, la transformation des conditions sociales est si rapide que les parents sont souvent décontenancés par les références matérielles et culturelles chères à leurs enfants 12. Dans les relations personnelles, la classe n’était pas le signifiant majeur, mais seulement une variable parmi d’autres, rattachée aux parents et aux conjoint⋅es – leurs groupes ethniques, provenances géographiques, professions, quartiers, et bien d’autres. L’identité était le fruit d’une négociation, pas une entité fixe. Les individus s’attribuaient des descriptions à rallonge, et se catégorisaient souvent comme faisant partie de la classe ouvrière dans un contexte, et de la classe moyenne dans un autre, selon la nature de la conversation et le statut de la personne en face. Une bonne partie de la classe ouvrière s’envisageait en des termes duaux, comme des diplômé⋅es d’université avec des parents ouvriers, ou comme des parents ouvriers avec des enfants de la classe moyenne. Seuls quelques groupes restreints ont continué à parler de « classe ouvrière ». Cette appellation a pris des airs d’antiquité, d’une terminologie principalement utilisée par des catégories se chevauchant au sein de la nomenklatura états-unienne des intellectuels, universitaires, et gauchistes.

Il y a un demi-siècle, la confusion sur la classe a facilité l’ouverture de la population à de nouvelles attitudes concernant la diversité. Alors que les femmes et des minorités venaient grossir les rangs de la main-d’œuvre rémunérée, elles ont poussé à une importante réévaluation des énoncés communément admis à propos de l’homogénéité de la société. Les réactions, positives ou négatives, reposaient sur la vision que chacun⋅e avait du futur. En d’autres termes, la réorientation culturelle était un produit dérivé de l’ascension sociale. En même temps, cette réorientation était vue par certain⋅es comme un déclencheur de la régression sociale.
Dès les années 1960 – une décennie entière avant le vrai début de la désindustrialisation à grande échelle –, les groupes sociaux restant dans la classe ouvrière se sentaient assiégés. Les plus notables d’entre eux ont reçu une attention particulière de la part des politicien⋅nes, d’une droite radicale, riche et religieuse, et des médias en général. Parmi ces groupes, on comptait les artisans qualifiés, qui représentaient une sorte d’« aristocratie ouvrière » en vertu de leurs revenus et de la stabilité de leur emploi. Ils avaient pu conserver leur travail grâce à une grande exclusivité en termes de couleur et de genre ; autrement dit, il s’agissait principalement de métiers exercés par des hommes blancs au sein desquels était entretenue la transmission père-fils qui avait été si répandue dans les usines. Les électriciens, les plombiers, les charpentiers et les petits entrepreneurs constituaient l’une de ses branches, les policiers et les pompiers en représentaient une autre. Pour ces premiers, les licences, les apprentissages et le parrainage assuraient une sorte de monopole de corporations ; pour ces derniers, la syndicalisation se révéla efficace pour garantir un résultat similaire. Ils ont même été parmi les premiers publics sollicités par les radios conservatrices comme source d’influence. Ce groupe pouvait être profondément conservateur sur certains sujets et plutôt progressiste sur d’autres – par exemple, s’opposer aux aides pour les pauvres tout en votant démocrate.

Les travailleurs et travailleuses pauvres constituaient un deuxième groupe de la classe ouvrière. Il s’agissait de personnes n’ayant pas identifié le système éducatif comme levier social, ou ayant été empêchées d’en tirer profit. C’était souvent les enfants d’immigré⋅es venus des régions agricoles des États-Unis ou de l’étranger. Des emplois mal payés dans le tertiaire ou en entrepôt les ont précipités dans la frange précaire de la classe ouvrière, qui s’est depuis lors considérablement développée. Elle est à vrai dire si démunie que le gouvernement doit régulièrement intervenir au travers d’aides supplémentaires telle l’assurance-maladie prévue par le Affordable Care Act, les Earned Income Tax Credits, et les tickets alimentaires 13. Cette partie de la classe ouvrière reste implacablement divisée géographiquement et racialement. Les minorités urbaines en représentent une portion, l’autre réside dans des zones rurales ou périphériques délabrées, en particulier au cœur et au sud du pays. Ce dernier groupe a également été une cible de premier choix pour les fondamentalistes religieux et les politicien⋅nes de droite prônant une doctrine d’autonomie.
Les effectifs du prolétariat d’usine traditionnel, auquel presque personne ne paye attention de nos jours, sont restés relativement stables entre 1970 et 2000, période considérée comme le point culminant de la désindustrialisation. Certes la main-d’œuvre industrielle n’a pas grossi au cours de ces années, alors que la population et le nombre de travailleurs et travailleuses tous secteurs confondus a cru rapidement. Néanmoins, le nombre d’employé⋅es dans le secteur productif est resté plutôt constant. Ainsi, la « désindustrialisation », en tant que schéma descriptif, a autant tendance à cacher qu’à expliquer. C’est seulement au tournant du siècle en cours qu’un réel déclin numéraire s’est installé dans le marché de l’emploi industriel. Jusque-là, le même nombre de travailleurs et travailleuses produisaient une quantité beaucoup plus importante de biens.

En revanche, le type de marchandises produites et leurs lieux de production ont changé ; les centres historiques de l’industrialisation, dans le Nord-Est et le Midwest, ont été largement abandonnés, alors que de nouvelles usines ont été installées dans le Sud et le Sud-Ouest du pays. L’électronique et le plastique ont remplacé la métallurgie. L’apparence des bâtiments industriels a elle aussi radicalement changé, passant d’édifices de briques de plusieurs étages avec de grandes fenêtres à des constructions de type « big box » d’un ou deux étages, avec peu de fenêtres, sauf à l’étage supérieur abritant les bureaux administratifs. De l’extérieur, il est devenu impossible de faire la distinction entre les entrepôts, les centres de distribution, les usines et les grandes surfaces, tels Walmart et Target. Mais les personnes à l’intérieur étaient toujours aussi nombreuses, soit une vingtaine de millions durant les dernières décennies du XXe siècle 14.
À ces nombreux groupes vient maintenant s’ajouter le précariat diplômé : ces aspirant⋅es à la classe moyenne avec des vies d’ouvrier⋅es. Alors qu’une grande part de la classe ouvrière considère appartenir à la classe moyenne, des portions de la classe moyenne s’adaptent en sens inverse. Ceci pointe la nécessité de repenser le système éducatif. Le prêt étudiant, au lieu d’intervenir comme un facilitateur de réussite, est devenu un obstacle à l’ascension sociale, un facteur de prudence dans un marché du travail incertain. Alors que les études de lettres et sciences humaines étaient autrefois considérées comme garantissant l’accès à une existence de classe moyenne, l’attention s’est de plus en plus portée sur les formations professionnalisantes et les métiers liés aux mathématiques, dans la finance et les technologies de l’information, ainsi que sur certains champs disciplinaires intégrés au marketing, à l’anthropologie, etc., qui alimentent directement les professions liées aux mathématiques.
Cette génération d’étudiant⋅es, comme le précariat des années 1970, n’a pas peur des noirs et des latinos, étant donné la diversité des institutions dont elle sort. Ils et elles sont complètement avant-gardistes et charrient avec elles et eux, dans les quartiers urbains pauvres où ils et elles peuvent encore louer à des prix raisonnables, une grande variété d’intérêts artistiques, culturels et intellectuels qui aident à vivifier des quartiers déjà bien vivants.
Ces deux communautés partagent des sensibilités proches à propos des injustices et du politique. Mais le nouveau précariat attire aussi des cafés, des restaurants, et d’autres petits commerces, signe d’un quartier sujet à la gentrification. C’est une situation intenable qui selon toutes vraisemblances ne devrait pas perdurer très longtemps. Ce nouveau précariat vit une existence de classe laborieuse, amortie dans certains cas par les parents. Parmi les classes moyennes-supérieures et supérieures, un salaire familial intergénérationnel semble apparaître, les parents investissant dans le bien-être immédiat de leurs enfants. Pour compléter les études de Thomas Piketty 15 sur la perpétuation des fortunes par l’héritage, on peut avancer que les revenus et la richesse sont de plus en plus utilisées pour amortir au quotidien le déclassement des enfants. Les emprunts étudiants, bien que restant la responsabilité des diplômé⋅es, en viennent lentement à reposer sur les épaules des parents.

Ceux qui ne sont pas aussi chanceux rejoignent les rangs d’une classe laborieuse de plus en plus appauvrie. Selon le bureau du recensement des États-Unis, un tiers de la population est passée sous le seuil de pauvreté en moins de quatre ans 16. Ceci indique un tumulte immense à travers les plus bas niveaux de revenus de la société. La désindustrialisation et la dispersion du prolétariat industriel battent leur plein. Durant les quinze dernières années, l’emploi en usine a diminué de 25 %, la désindustrialisation est finalement devenue une réalité 17. Les salaires ne cessent de chuter, car les nouveaux postes sont moins bien payés que les anciens. Bien entendu, ceci est inhérent au passage de l’industrie vers le tertiaire, de la syndicalisation au néant syndical, du patron direct aux contractuels et aux agences d’intérim. Le secteur du service, sous-payé et à temps partiel, concentre les efforts d’expansion ; c’est-à-dire, les petites entreprises et les chaînes de grandes surfaces font partie des rares secteurs à présenter une croissance économique positive.
Les emplois intérimaires et à temps partiels, qui occupent de 20 à 40 % de l’emploi total, sont particulièrement répandus dans la restauration, la création artistique et l’industrie informatique, où le précariat diplômé tend à s’agréger. Les coupes budgétaires continuent à hanter les services et écoles publiques depuis longtemps détériorées. Les quartiers pauvres – qu’ils soient blancs, latinos, ou noirs – ont été meurtris par la criminalité, les logements insalubres, le manque de transport public, le VIH, les addictions, et les incarcérations. Pas une famille pauvre aux États-Unis n’a été épargnée par ces fléaux. L’instabilité conjugale et les familles monoparentales définissent le précariat ouvrier, tout comme l’enfantement tardif et le retour au foyer parental définissent les vies du précariat diplômé.
Pour les vingt cinq dernières années, le taux de sous-emploi pour les diplômé⋅es âgé⋅es de 22 à 65 ans était resté stable à un peu moins de 33 % 18. Mais depuis la Grande Récession de 2008, 10 % supplémentaires ont rejoint les rangs. C’est le vilain petit secret de l’éducation supérieure – une part importante de la classe diplômée est en train d’être déclassée, tout comme une partie substantielle des classes diplômées qui l’ont précédée.
À suivre
Gary Roth a poursuivi le travail réalisé pour cet article, et publiera bientôt un ouvrage intitulé Classes in Motion: College Students and Social Mobility.
- On définit un·e diplômé·e récent·e comme ayant entre 22 et 27 ans. Voir « Are Recent College Graduates Finding Good Jobs? » par Jaison R. Abel, Richard Deitz, et Yaqin Su, Current Issues in Economics and Finance, 20:1, 2014, résumé dans « Starting Out Behind », New York Times, 7 juin 2014. ↩
- La Grande Dépression des années 1930 a produit un tel précariat, bien que dans une moindre mesure. ↩
- Richard Freeman, The Overeducated American, Academic Press, 1976, p. 4. ↩
- Sources : U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, National Center for Education Statistics. ↩
- 20 % correspondent à 32 millions d’employé·es. Source : Economic Modeling Specialists Intl., cité par Noam Scheiber dans « Growth in the ‘Gig Economy’ Fuels Work Force Anxieties », New York Times, 12 juillet 2015, et par David Weil dans The Fissured Workplace, Harvard University Press, 2014, p. 272. Voir également Government Accountability Office, « Contingent Workforce: Size, Characteristics, Earnings, and Benefits », 20 avril 2015. ↩
- Voir Paul Mattick, Marx & Keynes, les limites de l’économie mixte (traduction de Serge Bricianer), tel Gallimard, 2010, et tout spécialement les chapitres 9 et 11-14. ↩
- Voir Randall Collins, The Credential Society: An Historical Sociology of Education and Stratification, Academic Press, 1979, p. 186 ; Andrew Hacker, Money: Who Has How Much and Why, Scribner, 1997, p. 218; Lawrence Mishel, Josh Bivens, Elise Gould, Heidi Shierholz, The State of Working America, 12th Edition, Cornell University Press, 2012, ch. 4. ↩
- Tout le monde se souvenait encore du succès du G.I. Bill, qui assurait un revenu aux vétérans pour qu’ils puissent s’inscrire à la fac. ↩
- La population est passée de 151 684 000 à 204 879 000 ; les étudiants de 2 281 000 à 7 920 000 ; les fonctionnaires toutes échelles confondues (fédérale, étatique et locale) de 6 026 000 à 12 535 000 ; les cols blancs de 21 253 000 à 37 857 000. Source : Historical Statistics of the United States: Colonial Times to 1970, Part 1, Series A-6, H-700, D-139, D182-183. ↩
- Cela a pris à peu près le même temps pour que la population agricole des États-Unis soit absorbée par les classes ouvrière et moyenne, à tel point qu’elle a presque disparu. ↩
- Voir l’article fondateur de Kathy Stone, « The Origin of Job Structures in the Steel Industry », dans Root & Branch: The Rise of the Workers Movements, Fawcett Crest, 1975, p. 123-158. ↩
- Dans La Formation de la classe ouvrière anglaise (Points Histoire, 2012), E. P. Thompson définit la classe ouvrière en termes de culture, mais ses travaux suivants ont porté sur des périodes antérieures, comme si cette définition par la culture n’était pas complètement satisfaisante. ↩
- Tout ceci constitue une subvention directe au monde des affaires, qui se trouve dispensé de payer des salaires décents, malgré la grogne que suscitent les impôts nécessaires à de tels programmes. ↩
- Statistical Abstracts of the United States, nos 329 (1970) et 607 (2010). ↩
- Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014. ↩
- Voir Mishel et al., ouvr. cité, p. 427; John Marsh, Class Dismissed: Why We Cannot Teach or Learn Our Way Out of Inequality, Monthly Review Press, 2011, p. 28, 40. ↩
- Statistical Abstracts of the United States, no 607 (2010). ↩
- Ceci est vrai depuis 1990. Voir Abel et al., art. cité ; Neeta P. Fogg et Paul E. Harrington, « Rising Mal-Employment and the Great Recession: The Growing Disconnection between Recent College Graduates and the College Labor Market », Continuing Higher Education Review, no 75 (2011), p. 57. ↩