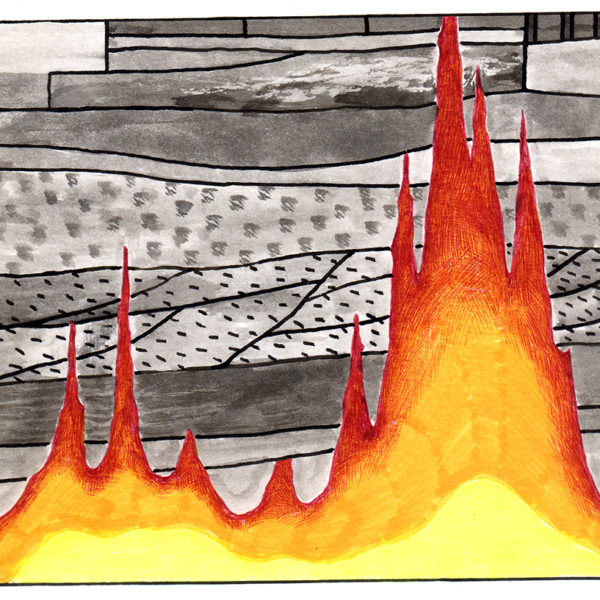Un peu partout, des gens dans la misère s’installent et vivent dans des campements de fortune. Parfois aussi, ils y meurent. C’est ce qui s’est passé le 25 mai 2019 à Strasbourg, dans le campement du parc des glacis, à proximité de la rue du rempart, où précarité sociale et transformation urbaine se télescopent.
Cet article est issu du sixième numéro de la revue papier Jef Klak, « Pied à terre », disponible en librairie.
Gravures par Raoul Villullas.
Strasbourg, le 9 juin 2019
Salut !
Je fais partie du collectif Jef Klak mais, ces derniers temps, j’ai beaucoup moins aidé au bouclage de la revue que je n’avais pensé le faire et que je ne l’ai fait par le passé.
J’habite à Strasbourg depuis trois ans mais c’est longtemps resté un pied-à-terre entre mes différents voyages, à Paris (avec souvent pour prétexte de fabriquer la revue) et ailleurs (notamment pour vendre la revue). J’avais quelques ami·es mais pas beaucoup d’activités ancrées ici. Pendant mes séjours chez moi, la plupart de mes occupations se concentraient sur mon ordi.
J’avais envie de faire des choses dans cette ville, mais je n’y restais jamais assez longtemps pour m’y sentir vraiment installée. En attendant le printemps, alors que les textes pour « Pied à terre » commençaient à arriver, des choses ont commencé à bouger.

De rempart et d’autre
À Strasbourg, j’emprunte fréquemment une rue qui s’appelle la rue du rempart. Elle se situe à l’ouest de la ville, entre le chemin de fer et les anciennes fortifications, datant de l’époque où Strasbourg était allemande. Derrière ce glacis il y a le canal, et sur les deux rives des rangées de jardins ouvriers, puis l’autoroute qui contourne la ville. On y croise beaucoup de ragondins, de hérons et de moustiques. C’est joli et un peu sauvage.
Avant, rue du rempart, il y avait deux terrains où vivaient des Rroms (hongrois·es et roumain·es pour la plupart) dans des caravanes stationnées sur des dalles de béton. La municipalité les a progressivement déplacé·es pendant l’année 2018. Un autre terrain encore plus distant du centre-ville leur a été attribué. C’est plus loin de l’école des enfants, mais c’est pour leur bien.
Avant, entre la piste cyclable qui longe le chemin de fer et la route, il y avait un terre-plein, avec des arbres et de l’herbe, sur lequel des gens avaient planté leurs tentes. Ils ont été délogés, eux aussi. Le terrain a été retourné, labouré, pour qu’ils ne puissent plus revenir. En octobre 2017, la ville a installé de hautes clôtures vertes. Elles enferment les arbres et l’herbe qui a repoussé. Si tu es en vélo, elles te barrent aussi le passage pour rejoindre la route ou les bâtiments qu’elle dessert.
J’ai une copine qui a fait la blague : « Strasbourg, capitale de la clôture ». Je trouve que c’est une bonne blague. À Strasbourg, tout peut être clôturé. Une fois, j’ai même vu un toboggan encerclé par des grillages. Une autre fois des grillages autour d’autres grillages. Mais à Strasbourg, on est très content·es parce que les frontières n’existent plus. On peut aller en tram jusqu’au pays de Hegel et des clopes moins chères.
Pourtant, le chemin de fer trace à cet endroit une frontière. D’un côté, il y a la ville et la gare, dans sa bulle de verre. De l’autre, cette zone étrange de relégation, qui sert de paysage quotidien aux nombreux et nombreuses galérien·nes qui fréquentent les lieux d’accueil de jour et de nuit de la rue du rempart. D’ailleurs, au bout de cette rue, ouvrira à l’été 2019 un « lieu éphémère » baptisé « la Grenze » (« frontière » en allemand) – bar, restauration et activités festives et culturelles en tous genres – sur un terrain qui appartient à la SNCF. Mais ça n’a presque rien à voir.
Une fois, je passais par cette rue avec un copain qui me disait que, depuis qu’il avait quitté la coloc où je vis, il la prenait moins souvent et qu’il le regrettait. J’étais surprise parce que moi, cette rue, je trouve qu’elle ressemble à une cicatrice. Ce n’est pas vraiment que je la trouve laide, mais plutôt que j’aurais du mal à dire qu’elle est belle. Il m’a expliqué qu’il l’aimait parce qu’avec la proximité du chemin de fer, il n’y a pas de bâtiment qui gâche la vue et empêche la lumière de t’entourer. C’est vrai qu’à Strasbourg il y a souvent de belles lumières.
À une extrémité de la rue du rempart se trouve un centre d’hébergement géré par la mairie. Dans une autre partie du même bâtiment, les Restos du cœur servent le petit-déjeuner tous les jours et le déjeuner trois fois par semaine. Pas très loin, en face, il y a le Bastion, un immense bâtiment que la ville met à la disposition de vingt-quatre artistes en échange d’un loyer très faible – cinquante euros par mois.
À l’autre extrémité de la rue du rempart se trouve l’espace Bayard, géré par l’association Horizon amitié. Bayard est ouvert tous les soirs, et en journée seulement pendant la semaine. Des assistants et assistantes sociales y accompagnent une centaine de personnes, sans-abri ou migrant·es, dans leurs démarches administratives. À Bayard, il est possible de se doucher et de laver son linge. On peut y dormir, si tant est qu’on soit capable de dormir assis·e sur une chaise (dans la limite de trente places disponibles). On peut y charger son téléphone (même si on est susceptible de se le faire voler). On y sert du café. On peut aussi y assister à de nombreuses embrouilles : entre personnes accueillies, parfois avec les travailleurs et travailleuses sociales.
L’imprimerie associative Papier gâchette occupe une autre partie du bâtiment qui abrite Bayard, depuis l’expulsion, en 2012, du squat où elle a été créée. La rue est surveillée par des caméras et tous ses bâtiments ou presque sont d’anciens bâtiments militaires. Un seul est encore en activité.
Comme je le disais, avant, rue du rempart, il y avait des gens installés sous des tentes. Puis la ville les a chassés. Je ne sais pas où ils sont allés. Mais je sais que d’autres ont monté des tentes au bord du canal parallèle à la rue. Au début, en 2017, il n’y en avait que quelques-unes, maintenant il y a une bonne trentaine de tentes. Ce sont surtout des hommes seuls qui y sont installés. Il y a des Français, d’anciens policiers, des Kurdes irakiens, des Africains anglophones, des Kosovars, des sans-papiers, des demandeurs d’asile, etc. Dans d’autres campements strasbourgeois, il y a surtout des familles, regroupées par origines géographiques. Souvent, les campements se trouvent à proximité des centres d’hébergement. Il y a des personnes qui vivent tout le temps sous les tentes, mais un grand nombre d’entre elles appellent le 115, et font des va-et-vient entre les tentes, les places d’hébergement quand il y en a, et les différents lieux d’accueil.
Pour maximiser ses chances d’avoir un hébergement via le 115, il faut appeler tous les jours. Si un jour tu n’appelles pas, c’est que tu n’as pas vraiment besoin d’elleux. Ton infidélité ne restera pas impunie. La prochaine fois, tu auras encore moins de chance d’être hébergé·e. Du coup, tu écoutes plusieurs fois par jour la musique d’attente du 115. Même si tu as des connaissances ou des ami·es qui peuvent t’accueillir ponctuellement, il faut continuer à appeler, continuer à dire que tu dors dehors. Ils ont un fichier national de tous ceux et celles qui les appellent et ils savent combien de fois ils et elles ont appelé, s’ils ou elles l’ont fait pour d’autres personnes, ami·es ou famille, depuis quel numéro et dans quelle ville ils et elles cherchent un hébergement.
Passé une certaine heure, de toute façon, même si tu appelles le 115, tu n’as plus aucune chance d’être hébergé·e. Tous les centres ferment leurs portes, ils sont complets. Même une famille avec des enfants peut rester dehors, d’ailleurs, ça arrive tout le temps. Si cette famille est en procédure de demande d’asile, l’État a encore moins le droit de la laisser dormir dehors que si elle est déboutée du droit d’asile.
Bref, des personnes vivent dehors, en France comme ailleurs, et tout le monde le sait. Moi, je n’avais jamais rencontré ces gens qui vivent sous ces tentes. Un jour, j’ai entendu parler d’un collectif qui faisait la cuisine avec une autre association, La roue tourne, qui émane d’habitants du campement à côté du canal. Ils et elles faisaient la cuisine ensemble tous les samedis et les dimanches. Comme j’aime bien cuisiner, je les ai rejoint·es le samedi suivant. Je suis revenue les week-ends d’après.

Manifestation spontanée
Un matin, le 25 mai 2019, mon coloc m’a dit qu’en rentrant il avait vu plusieurs bagnoles de flics à côté du campement, mais il ne savait pas ce qu’elles foutaient là. C’était un jour de cuisine collective, j’ai appelé un copain de La roue tourne, et je lui ai demandé s’il savait ce qu’il se passait. Il ne savait pas mais on a tout de suite pensé à un démantèlement du camp. Alors, j’ai pris mon vélo et j’y suis allée.
Le week-end précédent, un autre camp avait été évacué, pour la deuxième fois depuis l’automne. Des familles vivant sous tentes, pour la plupart albanaises. L’Albanie est un pays sûr selon l’État français qui refuse le droit d’asile à ses ressortissant·es. Su∞samment sûr pour que des familles préfèrent le quitter, avec des enfants en bas âge, et risquer de mourir de froid dans la boue à Strasbourg. Il faut dire que le printemps a été particulièrement froid et pluvieux à Strasbourg. Sur tous les campements, on entendait des gosses tousser. Une fois, une copine a accompagné un enfant avec son père à l’hôpital. L’enfant avait une bronchite, le médecin lui a donné des médicaments et l’a renvoyé dans sa tente en tram. Finalement, cette famille a été hébergée dans un hôtel, avec de l’argent récolté par le collectif de la cuisine.
Ce matin-là, ce n’était pas un démantèlement du camp. Les flics étaient là parce que des habitants les avaient appelé·es après avoir trouvé le corps de l’un d’entre eux pendu à un arbre. Les policier·es ont pris le cadavre et sont parti·es. Il était dix heures à peu près quand je suis arrivée. Des gens s’embrouillaient, cherchaient des responsables : le 115 qui avait laissé le mort sur le carreau, Bayard où il n’allait plus, etc. On a commencé à discuter de ce qu’il fallait faire. Très vite, l’idée d’un rassemblement a pris forme. Parmi les personnes qui s’exprimaient, une majorité voulait donner le maximum de visibilité à cette tragédie. Les gens étaient sous le choc, réalisaient qu’ils ne connaissaient le mort que par des surnoms, le côtoyaient sans savoir quoi que ce soit de sa vie, rien d’autre que son pays d’origine, l’Afghanistan, qu’il était très solitaire et très discret. Enfin, quelqu’un a a∞rmé que son vrai nom était Habib ou Habibi. On lui donne entre 21 et 27 ans. Le matin même, au lever du jour, il a été aperçu par une joggeuse, lui, faisait les cent pas le long du canal.
On prévient un autre collectif qui se rend fréquemment sur le campement, ainsi que des associations qui militent en faveur des sans-abri en Alsace. Des journalistes sont appelé·es et passent sur le campement. L’adjointe au maire à la solidarité aussi. Pendant ce temps circule l’info du rassemblement, prévu à dix-sept heures à la gare. On fabrique des banderoles sur les berges : « Kobi Habib for ever », « La rue en deuil/États criminels », « Open the borders, stop Dublin », « Les assassinats cachés du 115/1 non = 1 mort ». Les soutiens et les personnes du camp qui souhaitent se joindre au rassemblement se mettent en route. On est plus d’une vingtaine, d’autres arriveront plus tard. C’est samedi, il fait enfin incroyablement beau, les Strasbourgeois·es sont de sortie. Les prises de parole d’habitants du camp, en français et en anglais, interpellent les passant·es. Spontanément, une quarantaine de personnes décide d’aller en ville jusqu’à la place Kléber, la place centrale. Les slogans fusent, « Justice pour Habibi » revient souvent. La manif est super vivante, elle surgit dans les rues, inattendue. Au niveau de la jonction des quatre lignes de trams, à la station Homme de fer, on bloque complètement le trafic pendant quelques instants. Les chauffeurs sont vénères, c’est drôle. On est peu nombreux·ses mais on fait bloc. Les flics sont là, derrière nous depuis le début, mais ils restent tranquilles. C’est ce soir qu’il va y avoir du sport.
On décide de rentrer ensemble. La petite manif perd en unité et en vigilance. Le groupe se disloque de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Une rumeur sur une interpellation circule, mais personne n’a rien vu. Les flics nient avoir arrêté quiconque, « pour l’instant ». C’est pourtant vrai, on l’apprendra plus tard : un jeune homme qui s’était écarté de la manif a été violemment interpellé, quelques mètres plus haut. La tension monte d’un cran devant un premier lieu d’hébergement du 115, quartier Gare, alors qu’on s’approche de la rue du rempart. Le slogan du moment : « Bayard ! On arrive ! » se répand dans le cortège, est repris de plus en plus furieusement. Un agent de sécurité ferme la grille du centre derrière lui. Elle cède quelques minutes plus tard, forcée à mains nues par quelques-uns. Certain·es rentrent à l’intérieur pendant que d’autres installent les banderoles sur les grilles qui entourent la cour. À l’intérieur, des chaises et des tables volent, la directrice quitte les lieux, paniquée, cherche refuge dans l’atelier voisin, puis monte dans une voiture de police. C’est la confusion. Très vite, tout le monde sort pour reprendre la rue du rempart en direction du camp.
Les flics nous rabattent sur le trottoir, contre la clôture. Plusieurs fourgons, voitures banalisées, la BAC, deux membres de la brigade cynophile, des flics avec toutes les protections possibles nous encerclent. Un des deux chiens policiers est déchaîné. C’est inquiétant. On se sent très loin de la ville tout d’un coup, et personne ne nous entendra crier. D’ailleurs, on se tait. On appelle les copains et copines de l’atelier d’à côté, qui viennent regarder la scène, tenu·es à distance par le dispositif policier. Deux personnes sont d’emblée ciblées par des baqueux et mises à l’écart dans un fourgon. Toutes deux ont beaucoup parlé au mégaphone et sont connues du personnel de Bayard. Nous autres restons nassé·es, sous pression, un bon moment, avant que les flics nous contrôlent. Les policiers laissent sortir au compte-gouttes toutes celles et ceux qui présentent leurs papiers, six sont embarqué·es pour contrôle d’identité. Ils et elles seront relâché·es une heure plus tard. Mais une autre arrestation a lieu plus ou moins au même moment, devant Bayard. Une autre aurait eu lieu après. Six personnes au total passent la nuit ou plus en garde à vue, pour avoir participé à une manifestation au cours de laquelle des dégradations auraient été commises 1.
Une personne sort du commissariat central blessée avec cinq jours d’Incapacité temporaire de travail. Un Nigérian de 21 ans, arrêté avant les dégradations, est envoyé en centre de rétention après quarante-huit heures en garde à vue. Il est « dubliné », c’est-à-dire qu’en vertu des accords de Dublin, il doit demander l’asile dans le premier pays dans lequel il est arrivé sur le territoire européen, en l’occurrence l’Italie. C’est là que la France s’apprête à le renvoyer. Contre toute attente, pendant son audience au tribunal de grande instance, le jeudi 30 mai, le juge des libertés et de la détention (JLD) le fait libérer 2 – à la grande joie des soutiens rassemblés devant le palais de justice. En attendant d’être jugé en octobre pour « outrage » et « résistance violente » à sa violente arrestation, il peut retourner dans sa tente, à Strasbourg.

Entre parenthèses
Au campement, justement, depuis quelques jours, l’ambiance est électrique. Les habitants cherchent des coupables pour la mort de celui dont on sait désormais qu’il s’appelait Soroush Habib. Sa famille, contactée par un autre Afghan du camp, est en route depuis le Canada et l’Allemagne. Le choc et le deuil produisent leurs effets délétères. Un groupe de jeunes hommes est notamment pointé du doigt. Ils seraient à l’origine de plusieurs vols de téléphone parmi les habitant·es des tentes et usager·es de Bayard, peut-être sur Soroush lui-même. Je ne sais pas qui a fait quoi et, à vrai dire, je ne cherche pas à le savoir. Ce que je sais, c’est que les jeunes hommes en question ont en commun de trouver indésirable l’attention policière et médiatique dont le campement fait l’objet depuis la mort de Soroush. Contrairement à d’autres habitants du camp, ils disent ne rien attendre de la mairie ou de l’État, que ce soit un toit ou des papiers. Il faut dire que depuis toute cette histoire, des flics dans de grotesques costumes de joggeurs d’où dépassent leurs talkies font des rondes, d’autres sont venu·es un matin en déguisement civil faire le tour des tentes, regardant à l’intérieur de celles qui étaient ouvertes. De leur côté, les autorités municipales ont réagi à la hauteur des événements : depuis la mort de Soroush, elles ont installé un cabinet de toilettes sèches sur le campement.
Les prises de tête sont de plus en plus nombreuses, et en viennent parfois aux mains. Un gilet jaune, ami d’un occupant du camp, se fait casser le nez en essayant de s’interposer entre son ami et un membre de ce groupe. Cet occupant et un autre, menacés, ne s’y sentent plus en sécurité et décident de poser leurs tentes ailleurs, dans un lieu beaucoup plus loin du centre-ville, mais tout aussi joli. Il y a autant de moustiques et pas non plus de point d’eau. Cinq habitants projettent d’y créer une sorte de village autonome, sur le modèle d’une ZAD. Les deux personnes à l’initiative de ce nouveau campement voient le précédent comme le résultat d’une agrégation de personnes, arrivées là jour après jour, sans réflexion commune sur ce que pourrait impliquer le fait de vivre côte à côte, sans temps de discussion collective formalisés. Ils se sont accordés sur une série de règles : la propreté des lieux et l’interdiction des vols et des violences physiques. Ils ont envie d’installer, avec l’aide de camarades bricoleur·ses, une cuisine de plein air sous abri et un panneau solaire pour recharger leurs appareils électroniques. D’autres ont prévu de les rejoindre, mais le cap est di∞cile à franchir. Le déménagement implique de s’éloigner des lieux qui distribuent gratuitement de la nourriture et du café, et des points de contact avec l’administration.
Un soir, un peu découragé, le copain de La roue tourne et du nouveau campement m’a confié qu’il avait envie de « faire comme vous », vous, nous, les gens qui viennent aider ponctuellement, par exemple à la cuisine et aux distributions, et qui continuent à avoir leurs occupations en dehors : « aider le camp, mais de l’extérieur ». Moi, avec mes différents engagements, dont un travail salarié et ceux que je garde malgré tout vis-à-vis de la revue, je m’échappe quand c’est trop, je reviens tous les soirs dans une maison où je peux laver ma vaisselle et mes mains, où il y a des toilettes dans une pièce séparée, où je peux faire chauffer des aliments et charger mon téléphone. Le soir dans mon lit, je lis le livre de Claire Richard sur les Young Lords de New York et j’apprends que les membres actifs de cette organisation politique devaient s’engager « 25 heures par jour ». Aucune activité, aucun travail, aucune relation amoureuse à l’extérieur du groupe n’était tolérée. Moyennant quoi, ils et elles ont littéralement nettoyé, semaine après semaine, le quartier portoricain des monceaux de déchets qui s’y accumulaient, servi des quantités de petits-déjeuners gratuits, occupé une église, fait de la propagande, mené des actions e∞caces contre le sexisme au sein de leur groupe, détourné un camion de dépistage de la tuberculose, ouvert un centre de désintoxication, etc. En éliminant tout interstice étranger à la lutte.
L’espace Bayard dans la rue du rempart rouvrira peut-être un jour. Puis il sera fermé et le camp évacué. Ou l’inverse. Le tram circulera à partir de l’été 2020 dans la rue perpendiculaire à la rue du rempart, en direction de Koenigshoffen. Les ateliers devraient survivre, au moins un temps, à la transformation du quartier, mais pas la Grenze, cette « véritable utopie urbaine, un espace sans frontières accessible à tous et à toutes ». La violente parenthèse que nous traversons aujourd’hui sera close, d’autres lieux plus pérennes s’installeront et ils se diront, eux aussi, « ouverts sur la ville ». Les caravanes des Rroms, les tentes des zonard·es et des sans-papiers auront disparu de cette petite ceinture de Strasbourg, jolie et un peu sauvage.

- Pour les dégradations, aucune poursuite ne sera engagée. Des tables et des chaises semblent avoir été les seules victimes de cette intrusion dans Bayard. En revanche, le centre est fermé depuis trois semaines maintenant (juin 2019). ↩
- Au bout de quarante-huit heures de privation de liberté, le JLD doit statuer sur la situation et confirmer le placement en centre de rétention pour que celui-ci soit légal. ↩