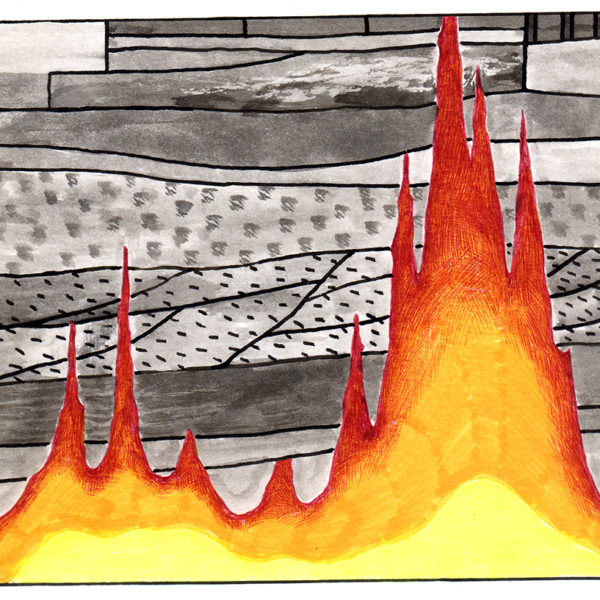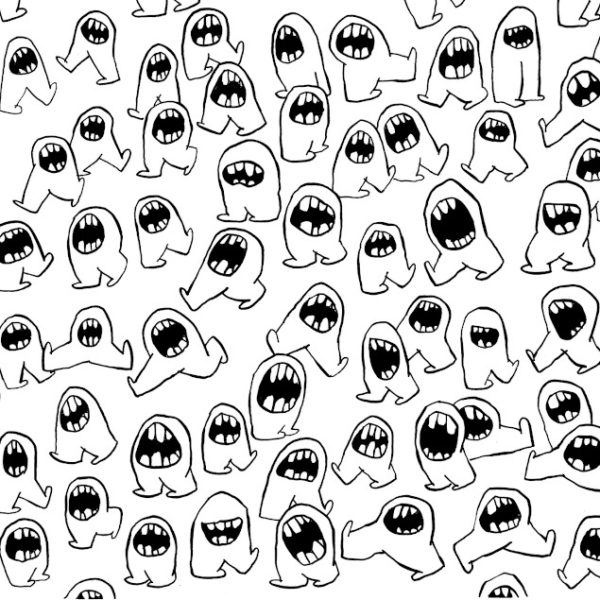Crédits photos : Yann Lévy / Hans Lucas
Du 16 au 18 mai 2018 aura lieu le procès en appel de trois policiers condamnés pour avoir blessé six personnes à Montreuil le 8 juillet 2009, et mutilé l’une d’entre elles. Le collectif 8 juillet travaille depuis neuf ans à porter la vérité des violences subies sur la place publique. Surtout, il s’agit de montrer le fonctionnement devenu banal des forces de l’ordre dans les banlieues, les ZAD, les manifestations, les camps de réfugié·es ou le simple quotidien : entre brutalité froide et impunité systémique. Pour un rappel des faits et de la procédure qui a permis de faire passer en justice la police, on pourra lire sur le site de Jef Klak un long entretien avec les membres de ce collectif, composé de personnes blessé·es par la police et de soutiens. Aujourd’hui, avant le procès en appel, Jef Klak publie par paire les témoignages de la première instance et donne la parole au collectif 8 juillet.
*
« Le 16 décembre 2016 au TGI de Bobigny, trois policiers ont été condamnés pour s’être adonné à une partie de Flash-Ball le soir du 8 juillet 2009 à Montreuil, et avoir blessé six personnes, mutilant l’un d’entre nous. Non contents des peines pour le moins symboliques dont ils ont écopé 1, les policiers ont fait appel, prolongeant encore une procédure sans fin.
Les sept années qui ont précédé ce premier procès, nous avons rencontré de nombreux collectifs constitués suite à une blessure, à un mort. Partageant nos histoires, nous avons acquis une connaissance précise des mécanismes de la violence policière. Nous avons les pleurs, mais aussi l’expérience, nous avons la rage, mais aussi le savoir. Nos vécus, nos luttes ont fait de nous des expert·es.
Le mercredi 24 et le jeudi 25 novembre 2016, c’est cette expertise sensible que nous avons convoquée à l’intérieur du tribunal. Il n’était plus question pour nous de demander la vérité, mais de la faire surgir depuis le réel de nos histoires, et de l’imposer là où elle est continuellement effacée et déniée. Treize personnes directement touchées par la violence policière sont venues témoigner à la barre, et voici deux de ces prises de parole… »
Collectif 8 juillet
*
Le procès aura lieu à la Cour d’appel de Paris, métro Cité, pôle 2 chambre 7, les après-midi du 16, 17, 18 Mai 2018.
Contact : huitjuillet (at) riseup.net
Télécharger le dossier de presse complet en PDF.
Télécharger l’article en PDF.

« Ce sont des armes de guerre »
IanB, Stop aux violences policières
et Désarmons-les !
J’interviens au nom du collectif Stop aux violences policières, qui s’est constitué en avril 2016, à partir d’autres groupes comme celui de « défense collective » et des « street-médics ».
Ces deux entités ont été créées au début du mouvement social de 2016 contre la loi Travail. La « défense collective » a pour but d’apporter une aide juridique aux personnes qui pourraient être confrontées à la justice dans le cadre du mouvement social. Les « street-médics » sont des groupes de soin autonomes, qui répondent aux besoins des blessé·es. S’il se constituent de tels groupes, c’est qu’il existe un besoin de venir en aide à des blessé·es. C’est une réalité des manifestations. S’il n’y avait pas de blessé·es, il n’y aurait pas de médics.
Le 20 juillet 2016, nous avons déposé un dossier au Défenseur des droits 2 rapportant un certain nombre d’abus survenus au cours du printemps 2016, durant une quinzaine de manifestations nationales, ainsi qu’en marge de manifestations. Nous avons pu réunir 104 témoignages, dont 68 saisines individuelles auprès du Défenseur des droits, auxquelles s’ajoute une douzaine de témoignages de victimes anonymes et une vingtaine de témoins directs de faits. Parmi ces victimes, 18 personnes ont été blessées pas des tirs de Flash-Ball et de lanceurs de balles de défense (LBD) et 25 par des grenades de désencerclement.
Ce dossier révèle l’ampleur et le systématisme des violences policières dans le cadre des manifestations ainsi qu’un nombre extrêmement important de blessures. Ce ne sont pas des blessures superficielles. Il y a des plaies ouvertes, des fractures, des hématomes profonds, des œdèmes ainsi que des crises d’angoisse et d’asthme dues aux gaz lacrymogènes. Nous avons relevé des centaines de cas sur toute la France qui mettent en cause le comportement de la police vis-à-vis des manifestant·es.
Parmi ces blessé·es, trois ont été gravement mutilés. Jean-François Martin a été énucléé par un tir de Flash-Ball ou de grenade à Rennes le 28 avril 2016. L’enquête a prouvé qu’il s’agissait bien d’un projectile provenant des forces de l’ordre. Romain Duisseau a subi un traumatisme crânien grave suite au jet d’une grenade de désencerclement le 26 mai 2016 à la porte de Vincennes à Paris. Le policier a jeté cette grenade sans regarder où il la lançait. Laurent Théron a été énucléé par un tir de LBD le 15 septembre 2016, place de la République à Paris.
Nous parlons de Flash-Ball, de LBD et de grenades de désencerclement. Ce sont toutes des armes similaires. Ce sont toutes des armes à feu. Les grenades de désencerclement lancent 18 plots de caoutchouc durs et rigides qui occasionnent les mêmes blessures que celles du Flash-Ball ou du LBD.
Ces blessures, ces constats, ces dossiers et ces saisines révèlent que nous avons face à nous des policier·es qui ont pris l’habitude, dans le cadre du maintien de l’ordre, de passer systématiquement à l’usage d’armes à feu. Ce sont des armes de guerre.
Nous avons aussi constaté d’autres blessures : des fractures des os du visage au niveau des joues ou des arcades sourcilières, des plaies ouvertes à l’arrière de la tête. Des tirs sont commis au niveau des épaules, du torse, des parties génitales.
On nous répondra sans doute que face à la violence des manifestant·es, il est justifié de tirer sur la foule. Je voudrais opposer à cela l’argument de la vulnérabilité. Nous ne sommes pas en guerre, que ce soit dans les manifestations ou dans les opérations de police effectuées dans les quartiers populaires. Les policier·es n’ont pas face à eux des combattant·es, ni des gens armés. Nous ne sommes pas dans la situation d’avoir deux forces armées en présence. Il y a d’un côté une force armée et de l’autre, la population.
La communication officielle, que ce soit directement celle du ministère de l’Intérieur, celle de la police ou celle énoncée par le biais des avocat·es qui les défendent est toujours la même. Les policier·es seraient en danger et assaillis. Une dichotomie est créée entre d’un côté les forces de police et de l’autre la population. En justifiant le fait que la police tire sur la population, nous avons passé un cap qui est extrêmement grave. Cette affaire, dont on fait le procès aujourd’hui, remonte à 2009. On a l’impression que rien ne change. Aujourd’hui, les constats sont les mêmes.
Nous avons rencontré des personnes qui, aujourd’hui, ont peur de venir en manifestation. Chose complètement assumée par les forces de police car, avec la doctrine du maintien de l’ordre, elles sont dotées d’armes à effet psychologique (tel le LBD). Des armes dont l’objectif est de faire peur, de créer de la terreur. Beaucoup de personnes qui s’investissent pour la première fois dans un mouvement social ont peur, parce qu’elles savent qu’elles ont en face d’eux des policier·es qui tirent dans le tas. Nous avons rencontré des gens qui garderont des traumatismes à vie.
Une quantité impressionnante de personnes a peur de la police. Un des slogans les plus repris dans le mouvement social est « Tout le monde déteste la police ». Pourquoi tout le monde déteste la police ? Cela fait écho à une réalité, celle d’avoir la sensation que la police déteste tout le monde. Ce qui expliquerait qu’elle tire sur les gens.
Il existe une quantité d’attitudes adoptées par les policier·es face aux manifestant·es et aux habitant·es des quartiers populaires : le mépris, le racisme, des tutoiements, des attaques gratuites… Il y a aussi énormément de policier·es en civil. On est aussi attaqué·es dans les mouvements sociaux par des gens qu’on ne peut pas, dans les premiers instants, identifier comme étant des policier·es. On doit deviner que ce sont des policier·es parce qu’ils ont des armes de policiers. C’est-à-dire des matraques, des LBD, des Flash-Ball et des tasers. Mais on n’en a aucune certitude. C’est aussi un glissement dangereux.
Nous avons face à nous des avocat·es qui, tout en défendant des policier·es, sont des prosélytes. Des personnes qui sont prêtes à mettre le Flash-Ball au placard en arguant que c’est une arme dangereuse mise entre les mains de policier·es mal formés, et qui veulent le remplacer par les lanceurs LBD. Et l’efficacité du LBD est là : en 10 ans, il a mutilé autant de personnes que le Flash-Ball en 20 ans. On mutile plus et c’est au regard de ces blessures qu’on juge l’efficacité d’une arme.
On a aussi constaté, lors du mouvement social, des comportements policiers que leur hiérarchie et le ministre de l’Intérieur justifiaient par le nombre de policiers blessés. Comme s’ils mettaient en concurrence les policier·es et la population. Pendant le mouvement contre la loi Travail, il y aurait eu 600 blessé·es du côté des forces de l’ordre. Les types de blessures sont majoritairement des ITT psychologiques, des ITT pour des hématomes et une infime minorité de plaies ouvertes. Mais on ne compte jamais les blessé·es parmi les manifestant·es et la population. Alors que les manifestant·es ne sont pas armé·es, n’ont pas de cuirasse ni de casques sur la tête. La population n’est pas protégée comme les policier·es.
Le 26 mai 2015, un policier a brandi son arme de service pour menacer des manifestant·es. C’était une façon de dire : un jour ce sera possible. Nous venons témoigner parce que nous sentons ce glissement du Flash-Ball vers le LBD, puis vers l’arme à feu. Ainsi, à Beaumont-sur-Oise, dans un cadre de maintien de l’ordre classique, face à des gens non armés, les gendarmes ont sorti des HK-G-36. Ce sont des fusils d’assaut de fabrication allemande. Les mêmes que l’on voit entre les mains des gendarmes devant ce tribunal. Pourquoi ?
Quel usage peut-il être fait de ces armes face à des personnes qui manifestent leurs idées ? Doit-on s’attendre à leur banalisation dans le cadre du maintien de l’ordre ? En tous cas, M. Lienard ici présent, l’avocat d’un des policiers jugés aujourd’hui, fait partie des personnes qui font la promotion de l’usage généralisé des armes à feu, y compris contre la population.

*
« Nous n’étions pas révolté·es, nous le sommes devenu·es »
Nathalie Torselli, mère de Quentin Torselli,
blessé au LBD 40 à Nantes le 22 février 2014,
lors d’une manifestation pour la ZAD
de Notre-Dame-Des-Landes
À Nantes, le 22 février 2014, à la fin d’une énorme manifestation réunissant des milliers de personnes venues dire non au projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un jeune homme a perdu un œil.
Il a été éborgné, marqué à vie, atteint dans son intégrité par un policier qui, armé d’un Flash-Ball ou d’une grenade, l’a visé alors qu’il ne présentait aucun danger pour personne et certainement pas pour des policier·es suréquipé·es et surarmé·es qui tirent au hasard dans la foule pour créer la panique, instaurer la peur et museler toute contestation.
Ils sont plus de quarante aujourd’hui en France à avoir traversé cette épreuve, dont quatre Nantais, faisant de Nantes la capitale européenne des jeunes mutilé·es par la police, dont les armes ne se contentent pas de blesser physiquement un seul individu. Elles éborgnent et mutilent également familles et entourage.
À la douleur de voir son enfant démoli s’ajoutent l’incompréhension (comment cela peut-il se produire dans un pays qui se dit civilisé ?) et la rage (on ne peut pas, on ne doit pas se taire, ceci doit être dénoncé avec force).
Une blessure reçue dans de telles circonstances n’a rien à voir avec un accident de bricolage ou un malencontreux hasard.
Les parents, les frères et sœurs, les proches, sont touché·es au plus profond d’elles et eux-mêmes. Elles et eux aussi sont abîmé·es, enveloppé·es par une sensation glauque, poisseuse, collante qui ne les lâche plus et les transforme irrémédiablement. Pour elles et eux aussi, il y a désormais un « avant » et un « après » la mutilation.
Tous·tes vont devoir vivre avec le ressenti très net que leur fils, leur frère, leur ami·e, est désormais perçu·e comme un individu dangereux, selon l’idée largement répandue et entretenue par la police, les responsables politiques, et les grands médias, que « s’il a été blessé par la police, c’est qu’il l’a bien cherché et qu’il l’a mérité ».
Les blessé·es vont devoir entamer un marathon judiciaire aboutissant généralement à un non-lieu ou à la relaxe du policier tireur. La lenteur étudiée de la procédure suspend le temps, empêche la réparation, ralentit la reconstruction et pérennise l’impunité policière.
La plainte de notre fils a été classée sans suite par la procureure de Nantes, Brigitte Lamy, pour le motif suivant : « Les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plaint n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’affaire soit jugée par un tribunal ».
L’enquête menée par l’IGPN a pourtant clairement établi qu’il a été blessé par un tir policier, alors qu’il n’avait pris part à aucun affrontement pendant toute la manifestation. Les agents des forces de l’ordre présents au moment du tir sont connus. Il aurait donc été possible d’identifier le tireur. Il n’en a rien été, et c’est une nouvelle violence infligée à notre fils.
Avant ce drame, nous ignorions tout des violences policières en manifestation. Nous avons appris. Nous étions naïf·ves et confiant·es envers la justice de notre pays, nous avions tort. Nous n’étions pas révolté·es, nous le sommes devenu·es.
- Condamnations pour violence par personne dépositaire de l’autorité publique : 15 mois de prison avec sursis et 18 mois d’interdiction de port d’arme pour le gardien de la paix Le Gall, 10 mois avec sursis et 12 mois d’interdiction de port d’arme pour le brigadier Gallet et 7 mois avec sursis et 12 mois d’interdiction de port d’arme pour le gardien de la paix Vanderbergh. Aucune interdiction d’exercer n’a été retenue malgré les réquisitions du procureur. Quant aux indemnisations, le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la décision au tribunal administratif. ↩
- Le Défenseur des droits, nommé par le président de la République pour un mandat de six ans, est une autorité administrative indépendante, à laquelle on peut avoir recours face aux administrations. Il dispose de prérogatives particulières en matière de droits de l’enfant, de lutte contre les discriminations, et de respect de la déontologie des activités de police et de sécurité. ↩