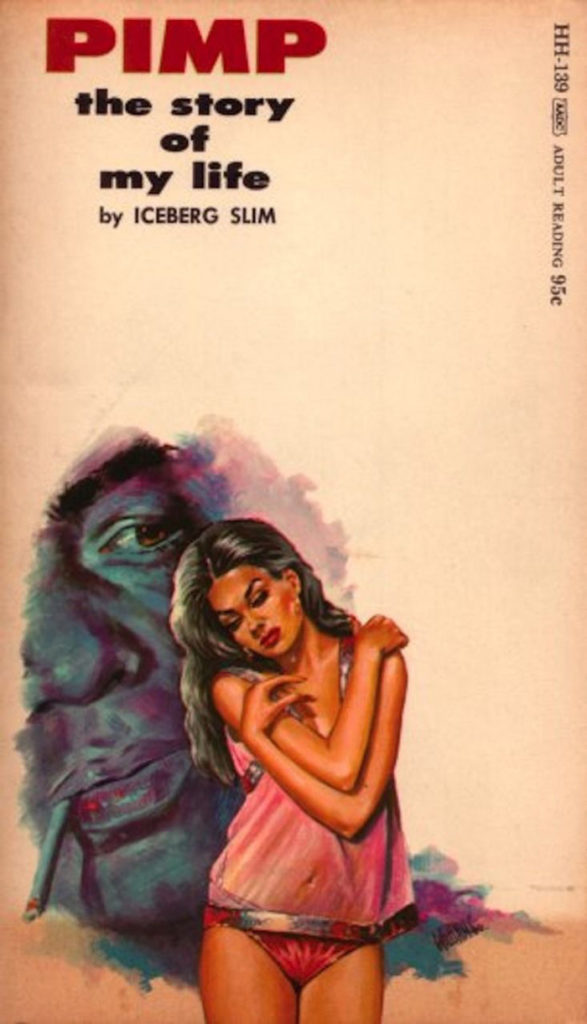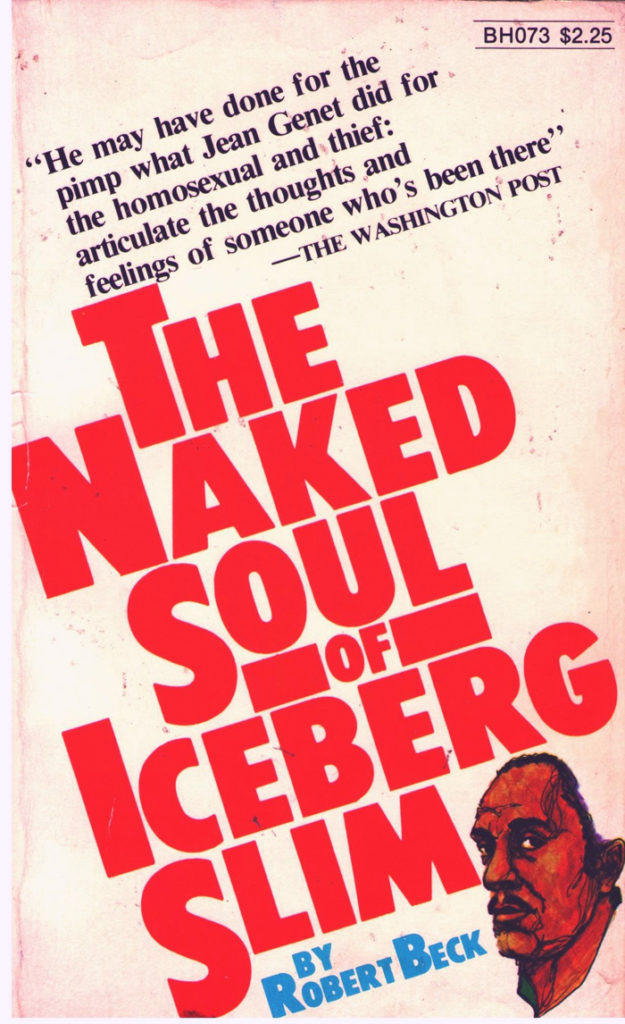Traduit par Samuel Lamontagne et Elvina Le Poul
Connu pour ses récits autobiographiques de maquereau, Robert Beck alias Iceberg Slim (1918-1992) est un personnage aussi paradoxal que populaire dans la culture US. Ses écrits ont marqué l’imaginaire du rap, notamment gansta, ainsi que la culture visuelle représentant la vie des Africain·es-Américain·es. Alors que son œuvre critique a abordé avec finesse les politiques raciales, son héritage dans la culture pop a rapidement nourri un regard voyeuriste porté sur le ghetto. Et la figure du maquereau, à laquelle il a pourtant donné de la substance, a pu contribuer à stéréotyper les masculinités noires. Les tumultes de ce personnage haut en couleurs nous emportent des rues du Milwaukee à la vie dorée hollywoodienne, en passant par la prison et les banlieues du South Los Angeles. Tout en contradiction, l’œuvre littéraire d’Iceberg Slim transcrit sans fioritures les expériences des Africain·es-Américain·es au sein d’une société raciste et sans merci.
Texte original : « The Fires That Forged Iceberg Slim », The New Yorker, 19 août 2015.
Je suis toujours étonné quand je rencontre des gens cultivés qui ne connaissent pas Iceberg Slim. L’idée selon laquelle ses livres ne circulent que dans l’underground littéraire du ghetto est ridicule.
Iceberg Slim, de son vrai nom Robert Beck, fait son entrée dans le monde littéraire il y a de cela cinquante ans, en publiant ses mémoires intitulées Pimp: The Story of my Life 1 (1967), suivies de son livre Trick Baby 2 (1967), qui sera plus tard adapté à l’écran par Universal Studios. Au cours des années 1970, Beck publie trois autres romans ainsi qu’un recueil d’essais politiques, il enregistre un album de spoken-word, attire l’attention des médias, et devient une véritable célébrité à Los Angeles.
Aux côtés de feu Donal Goines, son protégé le plus connu, il est à l’origine d’une nouvelle forme de polar. Avant sa mort survenue en 1992, Beck s’est affirmé comme une inspiration importante pour le gangsta rap. Au moment de sa première parution, Pimp: The Story of my Life est crédité d’une certaine autorité ethnographique par les sociologues, anthropologues et linguistes s’intéressant au ghetto. Après que le hip-hop est devenu un objet d’étude académique, l’œuvre de Beck a été mise sur un piédestal, elle est désormais inscrite dans les programmes de cultural-studies et apparaît dans les revues littéraires (ainsi que dans le livre de Peter Muckley, Iceberg Slim: The Life as Art, paru en 2003).
En 2012, le rappeur Ice-T et Jorge Hinojosa produisent Iceberg Slim: Portrait of a Pimp, un documentaire divertissant et instructif qui à la fois célèbre son sujet et l’humanise. Alors que j’écris ce texte, Pimp est numéro un des ventes Amazon dans la catégorie « Philosophie du Bien et du Mal », devançant de loin The End of Faith, de l’auteur ô combien plus pâle Sam Harris.
Le livre Street Poison: The Biography of Iceberg Slim écrit par Justin Gifford se veut un exercice de démystification. On peut y apprendre que l’allégation répandue selon laquelle Beck avait un QI de 175 est fausse, et que « Iceberg » n’était qu’un nom de plume que Beck inventa au cours de la rédaction de Pimp (son vrai nom de rue était en fait Cavanaugh Slim). Ayant fait lui-même usage de l’arnaque, de la flatterie et de la violence pour tracer sa route à travers les marges de la société, Beck a ironiquement été la bonne poire d’Holloway House, sa maison d’édition de longue date, dont les minuscules royalties n’ont jamais été à la hauteur des chiffres de vente astronomiques.
La grande histoire de Street Poison n’est pas celle de la fabrique d’un maquereau mais celle d’un écrivain et d’un prophète politique autoproclamé. Robert Moppins Jr. naît à Chicago en 1918, fils de Mary Brown et de Robert Moppins. Au cours des années 1930, il renaît dans les rues du Milwaukee sous le nom de Cavanaugh Slim, puis renaît encore, à Los Angeles en 1963 sous celui de Robert Beck, lorsqu’il choisit de rendre hommage à sa mère en portant le nom de famille de son regretté mari. Mais « Iceberg Slim » naît aux alentours de 1965, à la suite de l’assassinat de Malcolm X et des émeutes de Watts. En se réinventant comme un ex-criminel vieillissant devenu révolutionnaire, il écrit Pimp comme un acte de rédemption. Dans la préface, il déclare : « Perhaps my remorse for my ghastly life will diminish to the degree that within this one book I have been allowed to purge myself. Perhaps one day I can win respect as a constructive human being. » , ce qui a été traduit par « Mais ce que j’aurai livré de moi-même dans ce seul livre me permettra peut-être d’atténuer le remords que suscite en moi cette existence abominable. Peut-être même réussirai-je un jour à gagner le respect d’autrui en apparaissant comme un être humain plus constructif 3 ».
Bien que ce soit la misère qui ait motivé Beck et sa compagne, Betty, à transformer ses sombres souvenirs en un livre, Pimp était aussi censé être une contribution au mouvement des droits civiques. Au lieu de cela, il catapulta la figure du maquereau au panthéon des héros et bandits du cinéma de la culture populaire américaine.
À dire vrai, Pimp n’est pas responsable de la glorification des maquereaux. La figure du mac est exaltée et décriée dans la culture afro-américaine depuis plus d’un siècle, souvent à travers des fables, les « toasts » (forme de littérature orale grivoise) et de nombreuses chansons. Beck se saisit de l’image cartoonesque représentée dans les rimes urbaines du proxénète se pavanant dans les rues, et lui donne de la chair, de l’histoire et de la portée, exposant la brutalité déshumanisante du « game ». Il le fait alors que les ghettos sont en révolte et que les noirs américains sont devenus un objet de fascination mondiale.
Si Beck a entrepris de poser sur le proxénétisme un regard critique, comment se fait-il que des jeunes gens aient pu recourir à ses livres pour essayer de devenir de meilleurs maquereaux ? Comment un auteur dont le nombre des ventes a dépassé les 2 millions en à peine quelques années, a-t-il pu être aussi radicalement incompris ? Et pourquoi ses autres livres, en particulier ses essais politiques, n’ont-ils pas reçu autant d’attention ? Gifford ne répond pas à ces questions, mais les révélations qu’il nous livre sur la vie politique de Beck et sur ses démons personnels offrent quelques pistes. Son livre aide à comprendre pourquoi Beck ne pouvait pas tuer le maquereau en lui sans tuer une partie de lui-même, et pourquoi, quand les feux des luttes politiques commencèrent à perdre en vigueur, c’est le voyeurisme qui l’emporta.
Lorsque Beck décide d’écrire son histoire, il travaille comme dératiseur et vit dans la région noire de South Los Angeles avec une jeune femme blanche nommée Betty Mae Shue, son fils, et leur fille. C’est Betty qui a l’idée de coucher par écrit les histoires de Beck. C’est aussi Betty qui trouve un éditeur et qui transcrit et tape les manuscrits de Beck. Et c’est à peu près à ce moment-là que les émeutes de Watts d’août 1965 secouent profondément Beck. Ses inquiétudes initiales pour la sécurité de sa famille ont laissé place à de la gratitude pour le nouvel état d’esprit de la communauté noire. D’anciens membres de gangs rejoignent des organisations politiques comme les Sons of Watts, et plus tard le Black Panther Party. Des jeunes du quartier transforment un magasin de meubles en faillite en un lieu de rencontre pour aspirant·es militant·es, artistes et intellectuel·les, le Watts Happening Coffee House. Le scénariste juif Budd Schulberg lance le Watts Writers Workshop, que Beck viendra plus tard soutenir. C’est en plein milieu d’une révolution culturelle que The Autobiography of Malcolm X est publiée, quelques mois seulement après le meurtre de ce dernier. Beck dit qu’il modela ses mémoires sur « l’autobiographie », lorsque des années plus tard, il raconta à un journaliste : « Malcolm X defined the atrocity that pimpin’ is », « C’est Malcolm X qui a défini l’atrocité qu’est le proxénétisme ».
Beck a aussi pu s’être identifié à Malcolm, dans la mesure où tous deux avaient des conflits irrésolus avec leurs mères (celle de Malcolm fut internée quand il avait 13 ans). Beck trace sa trajectoire personnelle à partir de deux événements tragiques : avoir été abusé sexuellement par sa nourrice, et avoir été arraché à un beau-père stable et affectueux. Selon lui, ces deux événements se produisirent en raison des choix de sa mère. Beck en conçut une haine profonde à son égard, qui se transformera en haine de toutes les femmes. D’après le psychiatre d’une prison où il a été incarcéré, c’est cette haine qui conduisit Beck au proxénétisme. Alors qu’il est détenu à Leavenworth dans les années 1940, Beck est tourmenté par des cauchemars récurrents dans lesquels il fouette sa mère comme si elle était une esclave. Il passe la plupart de son temps en prison à lire Freud, Jung, et Karl Menninger. Après sa libération, il met ses connaissances à profit, non pas pour surmonter ses ressentiments, mais pour mieux subjuguer ses prostituées. En 1962, écroué dans la prison Cook County de Chicago, au bord de la folie, il prend conscience que, pour s’affranchir du proxénétisme, il doit se réconcilier avec sa mère. Dès sa libération, il court à Los Angeles pour passer le restant de ses jours à ses côtés.
Les conséquences politiques de la révélation de Beck sont cependant atténuées par le virilisme du milieu militant de l’époque – alimenté par les confrontations directes avec la violence d’État – et le rapport du sociologue Daniel Patrick Moynihan The Negro Family: A Case For National Action, publié en 1965. Ce rapport controversé accusait les femmes noires – ou plus précisément une culture matriarcale enracinée – de la promiscuité sexuelle, du crime et de la pauvreté qui gangrenaient les communautés noires. Même le lectorat attentif de Pimp, comme le comédien Chris Rock, attribue la déchéance de Beck à sa mère. Pourtant, Beck reconnaît avoir nourri à son égard une haine déplacée, et reconnaît que son chemin vers la rédemption fut tracé par l’amour de sa mère.
Il n’est sans doute pas fortuit que le livre le plus populaire de Beck, Pimp, soit aussi le moins politique. Un autre de ses ouvrages, Trick Baby – qui porte sur un maquereau métis dont la peau claire lui permet de parcourir aussi bien les ghettos noirs que la haute société blanche – est un exposé adroit sur la race et la classe aux États-Unis. Le personnage principal, appelé « White Folks » par ses ami·es, assiste à un dîner où un commissaire de police raciste et un capitaliste envisagent des solutions au « problème nègre ». Pour anéantir le mouvement des droits civiques, le policier opte pour la violence d’État et l’emprisonnement, alors que le projet du capitaliste vise à diviser les élites noires éduquées et la classe ouvrière.
À la fin des années 1960, Beck s’impose comme un intellectuel public, quand bien même sa situation financière demeure précaire. Conférencier populaire, il s’exprime aussi bien sur le commerce sexuel qu’au sujet de l’histoire des Puritains, si bien qu’il a plus l’air d’un jeune militant noir que d’un ancien proxénète vieillissant. Lors d’une lecture au Collège Malcom X de Chicago, Beck dit aux étudiants : « En exploitant vos pairs, vous êtes bel et bien contre-révolutionnaires… » Sans surprise, il applaudit les Black Panthers, en dépit du mépris que lui témoignaient ses membres locaux. Selon lui, ils étaient les « champions authentiques, les héros de la race noire… radicalement supérieurs à cette vieille génération de lâches dont je fais partie ».
Dans son livre le plus énigmatique et le plus méconnu The Naked Soul of Iceberg Slim (1971), Beck décrit les réunions des Black Panthers. Sous-titré Robert Beck’s Real Story, cette mince somme d’essais est son manifeste. Inspirés par The Fire Next Time (La prochaine fois, le feu) de James Baldwin, dans le sillage des Revolutionary Notes (Notes révolutionnaires) de Julius Lester, ces essais ne se veulent pas une répudiation de Pimp. Ils se comprennent davantage comme une sorte de synthèse hégélienne produite par l’unité des opposés : Cavanaugh Slim (thèse) et Robert Beck (antithèse). C’est pourquoi il dédicace le livre à Malcolm X, Angela Davis, Huey Newton et George Jackson, ainsi qu’à « tous les street niggers et tous ceux qui en bavent en tôle et en dehors ».
Les essais couvrent un grand nombre de sujets, de l’histoire psychosexuelle du lynchage ou de la bourgeoisie noire, jusqu’aux violences policières et au proxénétisme. Mélangeant réflexions personnelles et commentaires politiques, les essais démontrent que la suprématie blanche et le système de classes aux États-Unis sont fragiles. « Un État policier créé ostensiblement pour écraser les Noirs et la nouvelle gauche ne manquera pas d’être un état atroce pour tout le monde », annonce Beck dans un passage particulièrement clairvoyant. Pour lui, la révolution n’était pas seulement nécessaire, elle était inévitable. « L’Amérique est mise à mort par des racistes accros au pouvoir, en roue libre vers une destination stupide : le fantasme fatal selon lequel les militaires et les policiers peuvent détruire avec des matraques et des armes à feu une force indestructible : l’appétit de l’âme humaine pour la dignité, la justice et la liberté. »
Peu à peu, Beck radoucit ses positions concernant les proxénètes et les travailleurs et travailleuses du sexe et muscle sa critique de l’élite noire. Il se plaignait des éditorialistes noirs qui « traitent les proxénètes noirs et les prostituées noires comme des criminels, tandis que les atrocités commises par les flics dans le ghetto noir demeurent invisibles et impunies ». Lui et son vieil ami arnaqueur dénoncent dans un style socratique les élites noires et les politiques de respectabilité. Beck se demande si elles sont « si empoisonnées par les préjugés et l’intolérance pour les personnes noires d’autres classes sociales, que leur image publique soit une imposture et leur vie un mensonge ? Est-ce qu’un homme noir peut vraiment être un leader, un humaniste, un défenseur de l’épanouissement des noir·es s’il n’essaye de comprendre et d’aider que les noir·es qu’il imagine peut-être devenir des répliques sociales de lui-même ? »
La défense de Beck des personnes noires appartenant aux classes subalternes est particulièrement visible dans Mama Black Widow (1969), sans doute son meilleur roman : un portrait compatissant des tribulations d’Otis Tilson, drag queen noire dont la famille déménage du Sud des États-Unis pour s’installer Chicago en quête d’opportunités. Mais ce ne sont que misère, violence et pauvreté implacable qu’ils trouvent sur leur chemin. Otis est harcelé par la police, battu par d’autres hommes noirs et violé à répétition, mais il trouve une communauté et un semblant de protection auprès des groupes de gays de Bronzeville : « Il y avait en quelque sorte une douce et belle atmosphère d’égalité et de fraternité parmi les queers. J’en déduis qu’ils et elles étaient à ce point méprisé·es et discriminé·es dans le monde hétéro que, partageant souffrance et anxiété, les queers ont constitué entre eux un refuge émotionnel ».
En 1971, on rapporte que Beck était l’un des auteurs noirs le plus vendu du pays, mais selon la biographie écrite par Gifford, sa maison d’édition, Holloway House, s’arrangeait pour ne pas lui verser grand-chose. Son foyer comptait alors trois filles et un fils, il avait donc besoin d’argent. Sa fortune tourna l’année suivante, lorsque Universal Pictures acheta les droits de Trick Baby pour 25 000 dollars. Si, selon la plupart des critiques, le film fut un désastre en termes artistiques, grâce à lui la famille put quitter South Los Angeles pour rejoindre les Hollywood Hills, et il accorda à Beck suffisamment de stabilité pour qu’il puisse se consacrer à l’écriture de scénarios. C’est ainsi qu’il connaîtra une sorte de gloire qui, petit à petit, l’aimantera et l’éloignera de sa famille pour lui faire adopter un style de vie hollywoodien – s’apparentant occasionnellement à celui des maquereaux qu’il avait laissé derrière lui. Betty, lassée de ses absences, de ses badinages et de son manque de productivité, mit les voiles en embarquant les enfants avec elle.
En dépit des rumeurs, Beck n’a jamais repris du métier, mais ses interviews dans les années 1970 suggèrent une nostalgie latente pour le proxénétisme, tout particulièrement après que le cinéma de Blaxploitation 4 a décollé. À l’époque, il se mit à jouer à l’arnaqueur, en distribuant des conseils de maquereau et en tirant habilement profit de son aura. Ses photos publicitaires de l’époque évoquent l’ancien Iceberg Slim, étendu sur son lit, ou encore allongé sur un canapé rembourré, arborant un foulard ou un costume fantasque et posant devant sa Lincoln, les cheveux défrisés et ondulés. Sur la couverture d’un numéro du magazine Women’s Wear Daily de 1973, il se remémore « l’époque dorée du proxénétisme, c’était un art qui requérait de la ruse, de l’agilité, et de la vitesse ». Et pourtant, dans la même interview, il célèbre les femmes noires pour leur force, leur persévérance face aux abus incessants.
Peut-être est-ce la synthèse d’Iceberg Slim. Les proxénètes ne sont pas seulement capables de rédemption, ils manifestent un pouvoir et une masculinité qui manque aux militants. Leur défiance ouverte vis-à-vis des « contraintes de la moralité et des bonnes mœurs » font des proxénètes des « héros émancipés, dans un contexte étriqué, aux burnes (psychologiques) intactes », comme il a pu l’expliquer à un journaliste. Le roman de Beck Death Wish publié en 1977, sur la mafia à Chicago, va même jusqu’à envisager des façons de canaliser la masculinité gangsta vers des finalités socialement productives. Dans une intrigue secondaire qui rappelle celle du roman de Sam Greenlee The Spook Who Sat by the Door, publié en 1969, un couple de gansters anti-mafia organise une unité paramilitaire souterraine pour voler les trafiquants de drogue et ceux qui montent des paris truqués, pour financer un centre de désintoxication.
Beck comprenait que l’écriture était une forme de divertissement, un gagne-pain en même temps qu’un acte politique. Même lorsqu’il flirtait avec les Panthers et qu’il troquait ses cauchemars pour des rêves révolutionnaires, il savait que sa meilleure marchandise était sa street cred, sa crédibilité de gangster – qu’il a vendu, quand bien même il la désavouait. Cette ambivalence l’empêcha de bondir la tête la première dans le mouvement, mais elle reflète aussi la relation amour-haine d’un prolétariat urbain avec un capitalisme du type libéral qui récompense et célèbre ceux qui obtiennent la prospérité par tous les moyens nécessaires. Pas facile d’écouter les leçons de morale de personnages qui exhibent des liasses de billets et des dents serties de diamant.
Pourtant, Iceberg Slim a été forgé dans les feux de Watts, de la même façon que les critiques les plus acérées contenues dans les paroles de ses héritiers du gansta-rap, Ice-T et Ice Cube, ont été façonnées par l’émeute de Los Angeles en 1992 et par la lente brûlure de la désindustrialisation et les guerres contre la drogue qui les ont précédées. Le récent film Straight Outta Compton 5 nous rappelle combien les histoires crues de crime, de violence et de contrôle relatées par N.W.A. résonnaient avec leurs temps. Mais ce que le film élude est la manière dont le proxénète, dans toute sa brutalité, a fait un retour dans l’ère du « reality rap ». Le dernier album de N.W.A., Niggaz4Life, enregistré sans Ice Cube, comprend des titres comme « Findum, Fuckum & Flee » et « One Less Bitch », dans lequel Dr. Dre joue le rôle d’un proxénète qui assassine « sa » prostituée parce qu’elle a empoché quelques dollars. Sorti quelques mois après que le Los Angeles Police Department a tabassé Rodney King et qu’un commerçant de South Los Angeles a tué Latasha Harlins, âgée de 15 ans, soupçonné de lui avoir volé une bouteille de jus d’orange, Niggaz4Life s’est hissé en haut des ventes de disques, en écoulant plus de 2 millions d’albums aux seuls États Unis. Un an plus tard, la ville de Los Angeles explosait.
Peut-être que le vieil adage qui veut que « les proxénètes ne meurent jamais, ils se multiplient » est vrai, mais il l’est seulement à condition que la violence prédomine, que le patriarcat se maintienne, que les femmes soient économiquement vulnérables, et que la misogynie ne cesse de nourrir une masculinité fragile. Ou bien, comme Beck aurait pu le dire, le destin du proxénète demeure à la merci du prochain embrasement 6.
***
Robin D.G. Kelley, l’auteur de cette balade dans les vies d’Iceberg Slim, est professeur d’histoire de l’université de Californie (UCLA). Il a écrit de nombreux ouvrages dont The Freedom Dreams: The Black Radical Imagination (Beacon Press, 2002) et Thelonious Monk: The Life and Times of an American Original (The Free Press, 2009).
Pour aller plus loin
• Les livres d’Iceberg Slim traduits en français par Jean-François Ménard et Gérard Henri, aux éditions de l’Olivier.
• L’article d’Eithne Quinn « Who’s the Mack’: The Performativity and Politics of the Pimp Figure in Gangsta Rap », dans Journal of American Studies, 34, no 1, 2000.
• Iceberg Slim: Portrait of a Pimp, le docu produit par Ice-T :
• Who’s the Mack, chanson hommage d’Ice-T :
• Le film entier Trick Baby de la Blaxploitation, inspiré de son second roman :
• Reflexions, l’album Slam Jazz Groovy d’Iceberg Slim :
• La bande originale de The Mack, par Willie Hutch des studios Motown (1973), du bon funk des familles :
• Des titres de Pimp C ou Snoop Dog directement inspirés de l’univers d’Iceberg Slim :
- Publié en français sous le titre Pimp : mémoires d’un maquereau, traduit par Jean-François Ménard, Paris, Éditions de l’Olivier, coll. « Soul Fiction », 1998. ↩
- Publié en français sous le titre Trick Baby, traduit par Gérard Henri, Paris, Éditions de l’Olivier, coll. « Soul Fiction », 1999. ↩
- Extrait de la traduction française par Jean-François Ménard parue dans le recueil Pimp + Trick Baby + Mama Black Widow, Éditions de l’Olivier, 2012. ↩
- Genre cinématographique populaire dans les années 1970 principalement orienté vers le public afro-américain. Le genre Blaxploitation met en avant des personnages noirs dominants et victorieux, contrastant fortement avec les représentations populaires des noir·es et en particulier de la masculinité noire. Le personnage du pimp est récurrent dans ces films. ↩
- Sorti en 2015 (NdT). ↩
- Référence au livre emblème des communautés noires aux États-Unis, La prochaine fois, le feu (1963) de James Baldwin, éd. Folio. ↩