La question de l’émancipation des femmes est loin d’être résolue. Mona Chollet est de celles qui s’attachent à décrypter les mécanismes persistants d’infériorisation des femmes. Dans Beauté fatale. Les nouveaux visages d’une aliénation féminine (Zones, 2012 ; La Découverte, « Poches/Essais », 2015), elle montre à quel point l’inégalité des droits s’est muée en censure mentale, et comment les contraintes ont été intériorisées à coup d’injonctions à respecter le modèle de féminité dominant. Son dernier ouvrage, Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique (Zones, 2015 ; La Découverte, « Poches/Essais », 2016), tente quant à lui de déconstruire l’image toute faite du foyer et d’en explorer les potentialités émancipatrices, prenant ainsi à contre-pied la vision du foyer comme structure reproductrice d’inégalités, garant de l’ordre social et entérinant le modèle familial. Comprendre et lutter contre la domination masculine passe par la nuance. Entretien.
Téléchargez l’entretien en PDF.
Comment s’articulent dans ton dernier livre les deux axes, en apparence contradictoires, entre l’utopie d’un foyer émancipateur et le foyer comme symptôme de l’esclavage domestique ?
Le foyer comme lieu d’esclavage et d’aliénation est une image aujourd’hui évidente pour tout le monde. Grâce à l’apport féministe, on est conscient des enjeux du travail ménager. Même si les choses bougent peu, c’est très présent dans les consciences, et les inégalités sont moins faciles à faire accepter qu’avant : pour qui veut les reproduire, il faut de nouvelles ruses. À côté de ça, le foyer renvoie à l’image négative du pantouflard qui aime le confort.
J’avais ces deux images en tête et l’envie de les dépasser, de montrer sous quelles conditions le foyer devient un lieu émancipateur – même s’il ne suffit pas de rentrer chez soi et de fermer la porte pour cela. J’avais aussi envie de défendre le travail domestique, la plupart du temps vécu par les femmes – à raison – comme une corvée, une oppression. Or, même si c’est rarement possible, dans l’absolu, il peut avoir beaucoup de vertus s’il est fait dans de bonnes conditions, s’il est égalitairement réparti, s’il s’inscrit dans un emploi du temps pas trop dément. Il permet une prise immédiate sur son environnement, il nous permet d’empoigner ce qui nous concerne directement.
C’était l’occasion également d’interroger les modèles communément admis, comme celui de la configuration familiale. L’injonction à se mettre en ménage n’est jamais remise en question, même quand les conditions financières permettraient une alternative. Tout le monde semble toujours admettre qu’au-delà d’un certain âge, la vie doit ressembler à ça ; tous les arrangements un peu différents (habiter seule ou avec des gens qui ne sont pas de sa famille) demeurent réservés aux années d’études. Après, les choses sérieuses commencent, et on doit rentrer dans le rang.
Les perspectives ont elles changées depuis les axiomes posés par Virginia Woolf dans son livre Une chambre à soi, où elle prône l’autonomie matérielle, à la fois un revenu indépendant et un espace tranquille pour écrire, comme nécessaire au développement d’une liberté intellectuelle ?
Le texte de Woolf demeure très important en ce qu’il montre l’envers de l’enfermement des femmes. À certaines conditions, le cadre domestique peut être pour elles un lieu de liberté et pas seulement d’oppression. Mais cela implique de faire un sort à la figure idéale de la femme au foyer, encore terriblement ancrée dans les mentalités, et présentée comme un idéal d’épanouissement : assurer le travail domestique pendant que le mari se consacre aux activités intellectuelles, artistiques ou scientifiques. Le monde du travail est tellement dur et inhospitalier – et d’autant plus ingrat pour les femmes, évidemment – qu’il est assez facile de ré-enchanter le foyer comme un lieu protecteur, que l’on façonne soi-même et où on est entouré uniquement de gens que l’on a choisis ou qui sont de son sang. C’est une image classique hyper rassurante, dès lors qu’on a besoin de se réfugier loin du monde du travail. Mais, dans une société où bien souvent les couples se séparent, diminuer ou arrêter son activité salariale implique une énorme mise en danger. Cela contribue aussi à enfermer les femmes dans des rôles très limités, et cela entretient les représentations stéréotypées – même quand c’est repeint et vendu sous les couleurs du lifestyle et de la bonne cuisine. Finalement, l’envers de cette image-là, la célébration des femmes douées pour rendre la maison idyllique, est une manière implicite de montrer celles qui ont une activité intellectuelle ou un travail épanouissant comme des femmes dénaturées. J’avais lu une étude sur la manière dont la presse du début du XXe siècle présentait une image merveilleuse des foyers d’écrivains où la femme servait à la fois de secrétaire et de boniche. À l’inverse, les couples qui partageaient une activité artistique, scientifique ou intellectuelle étaient présentés comme formant des foyers tristes, le sommet de la désolation – Pierre et Marie Curie, notamment. Aujourd’hui, cela n’a pas tant changé…

L’utopie d’un foyer émancipateur n’est-il pas de fait réservé à une élite de privilégiés ?
Oui, je consacre beaucoup de pages à montrer pourquoi, dans les faits, c’est rarement possible ! En particulier, le fait que le travail soit autant déstructuré aujourd’hui, que les femmes soient souvent employées à temps partiel avec des horaires flexibles, morcelle complètement les loisirs. Je cite l’exemple d’une ouvrière qui a l’impression que les chefs font exprès de fractionner son temps de congé et de loisir, de sorte qu’elle n’a jamais plusieurs jours de repos d’affilée. Dès lors, le peu de temps passé à la maison ne peut être que consacré à faire les vitres ou aux lessives en retard. C’est une course permanente qui ne laisse jamais de vrai temps à soi. J’ai lu dernièrement le témoignage d’une esthéticienne qui louait son appartement pour n’y passer que son temps de sommeil, tellement ses amplitudes horaires de travail étaient grandes. Comment développer un lien avec le lieu où l’on vit dans de telles conditions ?
Cela dit, penser le foyer comme émancipateur semble aussi difficile pour les classes moyennes ou supérieures. Dans pas mal de foyers riches, la maison n’est pas vraiment habitée. Au-delà de ça, le modèle dominant du travail à temps plein fait en sorte que tout le monde est crevé quand il rentre chez lui, a peu de temps de loisirs pour paresser sans regarder sa montre. C’est étonnant, puisqu’on a l’impression de vivre dans une société qui exalte le plaisir domestique… Mais c’est seulement dans le but de nous vendre des appareils électroménagers, des meubles design, plutôt que pour nous proposer un lieu bienfaisant en tant que tel. Le manque d’espace fait que les gens sont les uns sur les autres, ou qu’ils habitent très loin en banlieue et passent leur temps dans les transports. Finalement, on observe une sorte d’empêchement, d’arrachement pour tout le monde. Et puis, durant le peu de temps qui reste, il faut sortir, partir en voyage dès qu’on a trois jours de libres. Tout se conjugue pour empêcher le simple fait de profiter de ce lieu.
La domination masculine est moins visible et semble plus intériorisée. On observe encore un grand écart entre loi et réalité.
L’enfermement physique dans le cadre du foyer a été remplacé par un enfermement symbolique – c’était la thèse de Naomi Wolf dans Le Mythe de la beauté, mais aussi de Susan Faludi dans Backlash. Les femmes ont intégré des univers autrefois uniquement masculins, comme le travail salarié ou la politique. Mais elles doivent encore s’y faire accepter, et elles ont toujours tout faux ; c’est pratiquement mission impossible1.
Il faut être crédible, donc pas trop jolie pour ne pas donner l’impression qu’on est arrivée là grâce à son physique (cette idée qu’une femme belle est forcément bête), et en même temps rester féminine, sinon on est vue comme une femme dénaturée, trop masculine, etc.
Par exemple, le regard sur la minceur dans le milieu professionnel est assez intéressant : il s’agit à la fois d’effacer le corps maternel nourricier trop lié à l’univers du foyer et de composer avec le sentiment de culpabilité d’être là, donc faire en sorte de ne pas prendre trop de place avec son corps. Se faire toute petite, au sens littéral. Le diététicien Gérard Apfeldorfer dit qu’un corps de femme idéal, c’est un corps d’homme avec des seins. Et c’est vrai, pas trop de hanches ni de formes : l’idéal est de pouvoir être identifiée dans le monde du travail comme un corps efficace. Cette surveillance qui s’exerce sur le corps des femmes dans les milieux professionnels et politiques est toujours une manière de leur rappeler qu’elles ne sont pas légitimes dans ces univers. Les ramener à leur physique, c’est une manière de nier leur parole et leurs compétences. Une manière de les rejeter, de leur dénier le droit d’être là.
Le rapport à la parole est régi par les mêmes mécanismes. Même si les femmes parlent trop peu, on trouve qu’elles parlent toujours trop. La part de parole masculine en réunion demeure écrasante. C’est dur de se faire entendre. Aujourd’hui encore, les femmes ont plus tendance à bégayer, elles sont moins sûres d’elles. Les réunions non mixtes prennent alors tout leur sens : un lieu où l’on prend confiance en soi, pour ensuite prendre sa place dans les réunions mixtes2. Exercer son droit de parole, occuper pleinement sa place d’oratrice, c’est quelque chose qui ne vient pas spontanément : il faut se créer l’occasion de s’entraîner pour trouver un sentiment de légitimité.
L’idéal de féminité paraît construit par la classe dominante, mais les idées féministes sont-elles transclasses ?
Ce qui m’a frappée en travaillant sur la beauté, c’est qu’il y a tout un travail pour dissimuler le fait que ce qui est prôné, c’est une beauté de femme riche. C’est frappant dans les discours de stars qui donnent leurs secrets pour être toujours belle à 50 ans : en général, ce sont des femmes très fortunées, qui ont consacré leur vie à soigner leur corps et n’ont jamais fait de boulot pénible. On aura beau lire tous les secrets de beauté dans les magazines, il n’y a pourtant pas de miracle : tout le monde n’a pas accès aux meilleurs soins de santé, aux produits de beauté, éventuellement aux opérations chirurgicales, ou encore au sport. Toute une somme de moyens sont mis en œuvre, puis escamotés, pour faire culpabiliser les femmes qui ne ressemblent pas à ce modèle-là à 50 ans. Alors que c’est humainement impossible ! Enfin, socialement impossible, pour être plus juste.
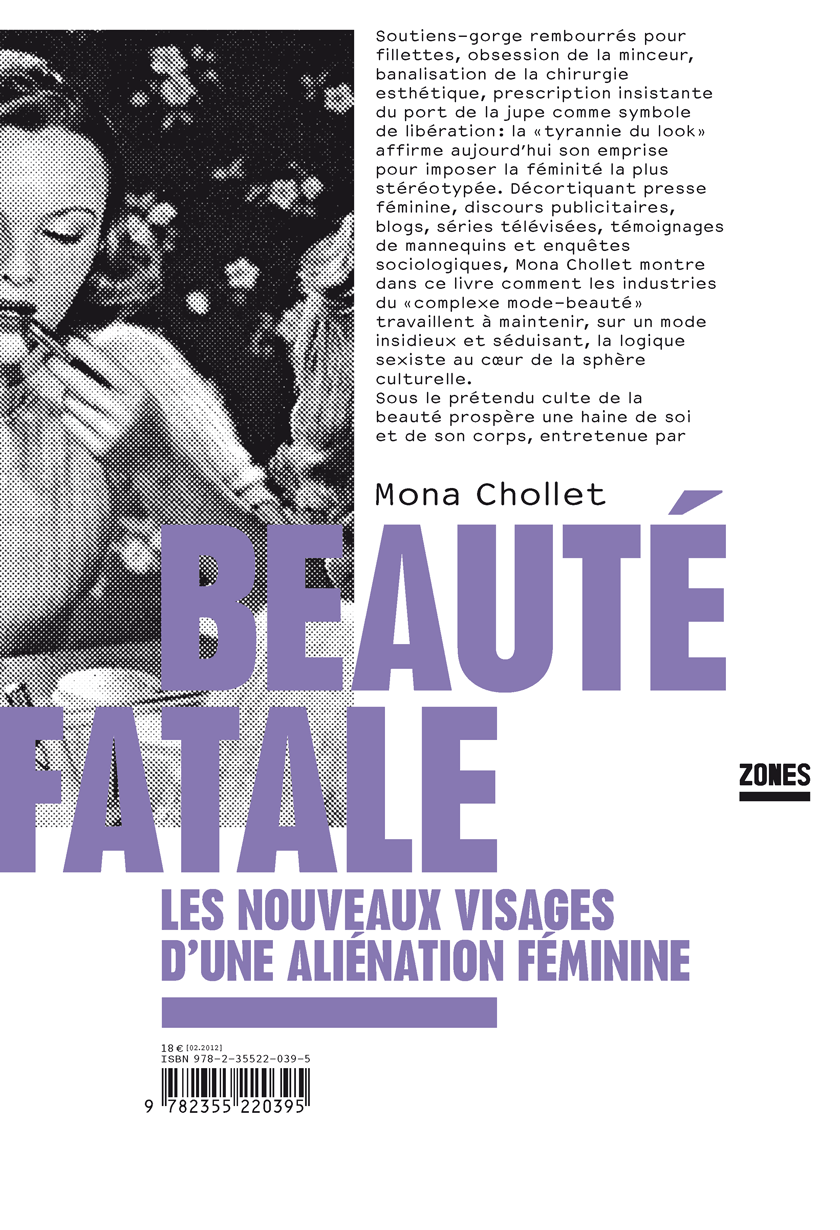
Il est parfois difficile d’adapter théorie féministe et pratique de vie. Sur le chemin de l’émancipation de la norme patriarcale, on se retrouve souvent à lutter contre nos propres désirs correspondant à l’imaginaire dominant.
Quand Beauté fatale est sorti, j’ai découvert une théorie selon laquelle dénoncer l’imposition de certains modèles revenait à exercer soi-même une tyrannie. On m’a reproché d’opprimer les femmes en leur interdisant de se faire refaire les seins. Ce discours me sidère, puisqu’il passe sous silence le fait que ce genre de désir n’est pas spontané, qu’il y a tout un climat qui le nourrit. Ces injonctions, on ne nous les adresse pas toujours directement, mais on les a intégrées de manière très profonde. Nos désirs sont façonnés par certaines normes. Derrière la mise en place de ces idéaux, il y a une machine de guerre énorme : la pub, la télé, les discours des magazines, les fausses évidences, les préjugés de l’entourage. Des forces puissantes se conjuguent pour imposer ces modèles-là. En face, la critique est toujours minoritaire, elle ne dispose pas des mêmes moyens, le rapport de force est trop inégal. Et tout cet appareil idéologique se défend quand on l’attaque : tous les stéréotypes négatifs sur les féministes sont autant de réactions venant du système qu’elles attaquent. Par ailleurs, loin de moi l’idée d’édicter une norme, ou de juger les femmes qui portent des talons, ou qui sont très maquillées, ou très minces ; mon propos n’est sûrement pas non plus de dénoncer comme frivoles ou superficielles les femmes attentives à leur apparence. De toute façon, je suis prise moi-même dans ces ambivalences, ces fascinations et ces injonctions, et je n’ai de leçons à donner à personne. Ce que je cherche, c’est à analyser tout cela, à y réfléchir, à le comprendre. Après, le comprendre ne veut pas dire qu’on s’en libère, ce serait trop beau, trop facile. Ce sont des forces puissantes face auxquelles on pèse bien peu. Je suis très attentive à la façon dont chaque femme se débrouille avec elles. Par exemple, sur Twitter, j’ai longtemps suivi une féministe qui lançait des tweets hyper vengeurs sur le patriarcat et qui enchaînait sur la dernière marque de fond de teint achetée. J’aimais bien ce côté décomplexé. Elle n’essayait pas de dissimuler le fait qu’elle était conditionnée comme tout le monde. De fait, il y a une énorme ambivalence chez toutes les femmes, entre une fascination pour tout ce qu’on a intégré comme normes et comme préoccupations, et un rejet aussi énorme, mêlé d’une exaspération totale. Tout cela cohabite. Cela m’intéresse de voir comment chacune négocie avec les injonctions sociales. Comment et pourquoi on ne se bat pas contre certaines normes tandis qu’on va en rejeter d’autres radicalement. Ça évolue au fil du temps, aussi : à telle époque, on est sensible à telle norme et pas à telle autre et puis ce sera l’inverse. On est condamnée à bricoler, en fait, mais comprendre les ressorts de l’aliénation n’est jamais peine perdue.
Dans Beauté fatale, je raconte comment moi-même je me suis fait reprogrammer le cerveau par une nutritionniste : je suis devenue très sensible aux variations de mon poids, alors que je n’y avais jamais fait attention avant. Je me suis mise à vivre avec cette norme-là, et aujourd’hui encore, je me rends compte que, quand au boulot quelqu’un apporte un gâteau, toutes les femmes, moi comprise, se disent « mince, je vais grossir » – alors que les mecs se jettent dessus. Mais au final, je suis contente d’avoir travaillé sur l’injonction à rester mince, puisque, au sens littéral, c’est l’injonction à ne pas prendre trop de place. Je pense que d’en avoir conscience me protège malgré tout. Comprendre les mécanismes cachés derrière aide à relativiser, à ne pas faire reposer l’essentiel de l’estime de soi-même là-dessus.
Les femmes parviennent-elles à se libérer de l’emprise du regard de l’homme et à prendre position comme sujets?
En tant que femme, on est toujours encouragée à se demander comment on est perçue, de quoi on a l’air, si on est désirée ou pas, et pas tellement ce qu’on désire soi-même, ce qu’on pense, comment on juge les autres… Ce déséquilibre-là est ravageur, il nous fragilise terriblement. On se laisse ballotter au gré du regard et du jugement des autres au lieu de se demander de quoi on a envie et de s’affirmer en tant que sujet. L’enjeu derrière la beauté est là : dans le déséquilibre entre la dimension d’objet et la dimension de sujet. Ce déséquilibre est évident dans la culture et dans l’art. Aux États-Unis, le groupe d’artistes féministes Guérilla Girls dénonce le sexisme à l’œuvre dans les musées en montrant le décalage entre la faible représentation de femmes artistes exposantes et à l’inverse la surreprésentation de femmes nues exposées. Les femmes ne sont pas incitées à développer leur vision du monde et à s’affirmer ou à développer leur personnalité, mais à se constituer comme des objets d’agrément, un peu décoratifs.
Je ne nie pas du tout que la dimension d’objet existe dans une certaine mesure pour tous les êtres humains, nous ne sommes jamais de purs sujets, mais c’est intéressant de voir comment la plupart des hommes privilégient leur dimension de sujet, souvent presque exclusivement : ils accordent de l’importance à leurs désirs, leurs jugements, leurs pensées. Ils ont tendance à voir les femmes comme des objets alors qu’ils s’objectifient eux-mêmes très peu – ils s’en foutent de la façon dont ils sont habillés ou coiffés, ou de leur poids. Les conséquences de ce déséquilibre sont flagrantes dans les cas de violences conjugales. Les femmes grandissent tellement avec l’idée qu’elles doivent plaire à tout prix que si quelque chose ne va pas dans leur couple, elles pensent que c’est forcément de leur faute. Elles ne sont pas poussées à s’affirmer, à faire confiance à ce qu’elles ressentent, à refuser ce qui ne leur va pas. C’est une éducation au masochisme encore assez présente. L’image de la femme dévouée, de l’abnégation féminine règne encore. On refoule sa colère parce qu’il faut rester la femme douce, agréable et ne pas faire de vagues.
Les garçons sont aussi élevés pour se conformer à un modèle, mais c’est un modèle de force – et ils souffrent quand ils ne correspondent pas à ce critère (lorsqu’ils sont chétifs ou vulnérables, par exemple). Ce qu’on apprend aux filles, c’est à être en position de faiblesse3. Les stéréotypes de beauté l’expriment très bien : porter des chaussures avec lesquelles on ne peut pas courir, des vêtements qui entravent le mouvement, cultiver un petit gabarit, en un mot être la faible créature qu’un homme doit avoir envie de protéger – mais qu’il peut aussi agresser. La reproduction d’inégalité et de domination se joue structurellement sur l’éducation des enfants.







