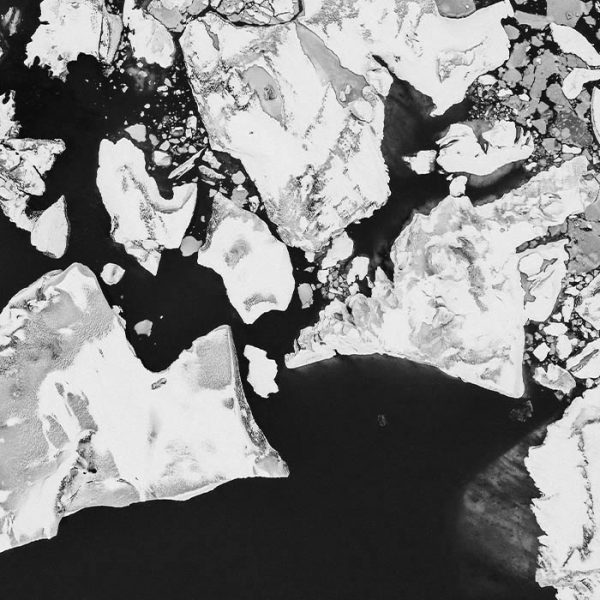Travail à la tâche sous-payé et sans protection sociale, enfants livrant illégalement pour Uber ou Deliveroo, subordination aux algorithmes qui imposent un rythme de travail toujours plus effréné… Sous couvert d’une soi-disant révolution numérique, les plateformes et les tenants de la « start-up nation » imposent des conditions de travail dignes du XIXe siècle. Comment font les plateformes pour contourner leurs obligations sociales ? Pourquoi leur offensive nous oblige à reconsidérer en profondeur le droit du travail ? En quoi la « loi Travail » de 2016 et le gouvernement Macron encouragent-ils ce modèle économique ? Comment livreur⋅ses et chauffeur⋅ses « uberisé⋅es » se mobilisent-iels ? Barbara Gomes, juriste et membre du collectif Pédale et tais-toi, tente de répondre à ces questions pour nous.
Quand les premières plateformes numériques ont-elles émergé ?
Elles sont apparues au début des années 2000 à l’initiative soit de militant·es associatif·ves qui recherchaient des bénévoles, soit d’ingénieur·es qui voulaient échanger autour de problématiques scientifiques. Au début de la décennie 2010, les plateformes numériques ont pris un tournant marchand 1. Les premiers achats en ligne étaient très peu sécurisés et il était considéré comme risqué de fournir ses données bancaires à un site internet. Mais la généralisation des smartphones a donné des ailes à la grande idée du marché consistant à produire des interfaces extrêmement simples d’usage qui permettent d’avoir directement accès à des services payants de façon sécurisée.
Ces applications ont depuis colonisé des secteurs qui étaient jusque-là préservés de tout rapport marchand et incarnent à merveille la marchandisation de nos gestes sociaux par des organisations productives capitalistes. Des plateformes comme Book-A-Friend et Diiing Dong proposent aujourd’hui de louer des « ami⋅es » ou quelqu’un⋅e pour rendre visite à une personne âgée…
En tant que juriste en droit du travail, quel regard portes-tu sur ces plateformes marchandes ?
D’une part, il existe les plateformes « de rente » : l’objet du contrat qui est passé entre la plateforme et la personne qui l’utilise pour se rémunérer est un bien, à l’instar d’Airbnb. D’autre part, il y a ce qu’on appelle les plateformes numériques « de travail » où l’objet du contrat est la location de la force de travail et où existe une valeur ajoutée due à la production d’un service. Sur ces plateformes « de travail », je considère que tous les contrats pourvus sont nécessairement des contrats de travail, car je ne vois pas comment une organisation productive peut réaliser une activité économique et commerciale identifiée, comme par exemple la livraison de repas, sans avoir besoin de travailleur·ses pour le faire.
On assiste par ailleurs à une forte polarisation des travailleur·ses. D’un côté, certaines plateformes de travail peuvent faire appel à une main-d’œuvre peu qualifiée pour des tâches très rudimentaires – identifier une image, renommer des fichiers en grande quantité, modérer des contenus de forums – et vont pratiquer le tâcheronnage à l’image d’Amazon Mechanical Turk 2. À l’opposé, d’autres font appel à des « profils à haute valeur ajoutée » comme des ingénieurs informatiques (Up Work), des traducteur·ices (Text Master) ou des architectes d’intérieurs (99 Designs).

Les plateformes numériques attirent aussi les travailleur·ses en leur promettant qu’ils ou elles pourront devenir leurs propres patron⋅nes…
Effectivement, elles jouent sur la volonté d’indépendance des travailleur·ses, et tout particulièrement celle des jeunes. Les plateformes ont contribué à imprégner l’imaginaire collectif du travail avec un discours très bien rodé qui met en avant l’autonomie des travailleur·ses et prétend que le contrat de travail et le salariat sont dépassés. Elles font croire que, grâce à la dématérialisation numérique, il existe un rapport triangulaire entre la structure qui offre le support numérique, l’individu qui veut travailler et la tierce personne qui a besoin d’un service.
En outre, nous traversons une prétendue crise du salariat qui, comme le démontre très bien la sociologue du travail Dominique Méda 3, est en réalité une crise de la pratique managériale. Les salarié·es vivent de moins en moins bien leurs mauvaises conditions de travail et le manque de reconnaissance sociale. Cette crise se traduit par une volonté chez certains individus de sortir du statut de salarié⋅e, dans l’idée que travailler en tant qu’indépendant⋅e sera plus émancipateur. Ce sont des discours qu’on entend beaucoup chez les travailleur·ses de Uber ou Deliveroo par exemple.
Il faut cependant distinguer ce que leur proposent les plateformes et ce qu’elles et ils veulent en réalité, c’est-à-dire plus d’autonomie et de responsabilisation, et pas forcément moins de protection sociale. Or, avec leur contrat d’autoentrepreneur·ses, ils et elles ne bénéficient d’aucune garantie en termes de droit du travail et leur protection sociale est beaucoup moins étendue que celle des salarié·es.
En revanche, en ce qui concerne la relation hiérarchique et le rapport aux client⋅es, il n’y a rien qui distingue une plateforme numérique d’une entreprise classique. Si j’ai besoin d’une table en bois pour chez moi, je vais passer un contrat avec un·e patron·ne-artisan·e qui demandera à un·e de ses employé·es de la fabriquer. C’est pourtant bien avec le ou la patron·ne que je passe le contrat. Avec la plateforme c’est la même chose, sauf que c’est dématérialisé. Je vais même être directement en relation avec la ou le travailleur·se qui va réaliser la prestation proposée par l’entreprise. C’est un simple changement dans la mise en relation : l’accès est facilité et plus direct. Pour autant, l’organisation productive est toujours là et des décisions de justice ont démontré que les plateformes de travail ne font justement pas de la simple mise en relation entre des travailleur·ses indépendant·es et des client·es…
Les plateformes numériques présentent les travailleur·ses comme indépendant·es afin de ne pas avoir à respecter les obligations sociales inhérentes au salariat. Mais celles et ceux-ci sont dépendant·es économiquement de la plateforme, car ils et elles ont besoin d’elle pour exister sur le marché et sont concrètement dans l’impossibilité de diriger leur activité commerciale.
Depuis 2015, on assiste à une vague de décisions de justice qui requalifient en contrat de travail salarié des contrats de prestation de service passés entre des travailleur·ses et une plateforme. Les décisions californienne (affaire « Berwick vs Uber » du 15 juin 2015) et britannique (affaire « Aslam & Farrar vs Uber » du 28 octobre 2016) ont à chaque fois fait tomber les masques sur cette prétendue activité de mise en relation. Elles démontrent que les plateformes créent un besoin de service et fournissent les travailleur·ses pour le réaliser, conservant la maîtrise totale de l’activité.
Les juges britanniques, très agacé·es face à Uber, ont affirmé que dès qu’une entreprise développe une activité commerciale, elle a forcément besoin de travailleur·ses pour l’exécuter. Ils et elles ont aussi insisté sur le fait qu’inciter un·e chauffeur·se à passer plus de temps derrière son volant, ce n’est pas vraiment du « développement d’activité entrepreneuriale », comme se targue de le faire Uber pour ses contractuel·les 4.
La meilleure décision concernant la nature des plateformes numériques de travail reste selon moi celle de la Cour de justice européenne du 20 décembre 2017 contre Uber. Les conclusions de l’avocat général sont limpides : la plateforme n’existerait pas si des individus n’étaient pas là pour rendre le service de transport. La mise en relation n’est qu’une partie de la modalité d’exécution de ce service.
En France, la Cour de cassation, la plus haute instance juridique du pays, a émis en novembre 2018 un arrêt qui fait désormais jurisprudence. Il insiste sur l’existence d’un lien de subordination juridique entre l’ancienne plateforme Take Eat Easy et un coursier, qui faisait bien de ce dernier un salarié, et non un travailleur indépendant.
Suite à cet arrêt, en janvier 2019, la Cour d’appel de Paris a requalifié en contrat de travail un contrat passé entre un chauffeur et la plateforme Uber. Elle pointe notamment le pouvoir de contrôle, qui s’exerce à travers la géolocalisation des chauffeur⋅ses, et le pouvoir de sanction, s’exprimant par exemple par la désactivation temporaire du compte d’un·e chauffeur·se de l’application. Cela relève d’un rapport de sujétion qui est dans la définition même du salariat en France.
Pourquoi, dans le Code du travail, est considérée comme salariée toute personne juridiquement subordonnée à un employeur ?
Depuis juillet 1931 et le fameux arrêt Bardou, les juges ont décidé que la subordination juridique était le critère distinctif du contrat de travail. Selon la loi, un·e travailleur·se salarié·e se distingue d’un·e travailleur·se indépendant·e par le fait qu’il ou elle obéisse à des ordres, qu’un pouvoir soit exercé sur lui ou elle.
C’est le résultat d’une longue bataille doctrinale entre les tenants de la subordination juridique et ceux de la dépendance économique. Pour ces dernier·es, le travailleur·se est dépendante économiquement d’un⋅e patron⋅ne pour survivre. Une dépendance créée de toute pièce par le système économique capitaliste et qui appelle donc une protection.
Au tournant du XXe siècle, certaines lois sociales ont clairement vocation à protéger les personnes en situation de dépendance économique, à l’instar de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, où apparaît la notion de travailleur « économiquement faible ».
Toutefois, on s’est également rendu compte que le travail nuisait à l’intégrité physique de la personne et on a alors décidé de protéger la ou le travailleur·se non pas parce qu’il ou elle était dépendant·e économiquement de son employeur, mais aussi parce que l’organisation tayloriste du travail pouvait conduire à faire des gestes dangereux pour sa santé et sa sécurité. C’est ce qui a donné lieu par exemple à la loi du 9 avril 1898, sur l’indemnisation des accidents du travail, une loi pionnière en matière de protection sociale.
Depuis l’arrêt Bardou, notre modèle social s’est construit autour de l’idée que l’on avait le droit de bénéficier des protections inhérentes au contrat de travail dès qu’on était soumis à une organisation hiérarchique.
Le contrat de travail est donc devenu le modèle type pour organiser la production. Il réglemente notre rapport individuel avec l’employeur⋅se et donne accès à des droits collectifs en tant que salarié·e – droit de représentation au sein de l’entreprise, les conventions collectives, etc. Des droits que les travailleur·ses des plateformes se voient malheureusement refuser aujourd’hui.
En parallèle a été mis en place la Septième partie du Code du travail qui recense toutes les professions « entre les deux », où le critère de subordination juridique ne fonctionne pas pleinement et où la situation de dépendance est cependant telle qu’il faut octroyer tout ou partie des protections du travail. Il s’agit par exemple des journalistes pigistes, des voyageur·ses représentant·es placier·es (VRP) ou encore des mannequins.
Le droit du travail français s’est ainsi toujours très bien accommodé de la subordination juridique. Et les mouvements protestataires pour le reconsidérer sous l’angle de la dépendance économique ont peu à peu disparus, cette question étant désormais cantonnée à des débats entre juristes. Mais face à l’offensive des plateformes, nous sommes obligés de construire un contrat de travail définitivement protecteur qui dépasse la subordination juridique.
Le Groupe de recherche pour un autre code du travail (GR-PACT 5) rassemble des universitaires qui ont décidé de s’attaquer à l’écriture complète d’un autre Code du travail, plus protecteur et qui prend en compte le critère de la dépendance économique dans la définition du contrat de travail. Cela peut être une superbe occasion de remettre les choses au clair et de définir enfin ce qu’est un·e salarié et un⋅e employeur⋅se, car ce n’est paradoxalement pas inscrit dans la loi.

Comment les plateformes font-elles concrètement pour masquer le fait qu’elles exercent un pouvoir sur les travailleur·ses ?
Au début, les plateformes appelaient directement les coursier·es ou les chauffeur·ses sur leur portable quand ils ou elles refusaient des courses, voire les convoquaient au siège. Mais cela ressemblait beaucoup trop à ce qui peut se passer dans une relation employeur⋅se-salarié·e et elles se sont depuis adaptées.
L’algorithme de l’application est devenu essentiel dans la dissimulation du pouvoir exercé par la plateforme. Il permet de prédéterminer à l’avance tout ce qui constitue les lignes directrices de l’organisation du travail, et ce de façon beaucoup plus masquée que lorsqu’un cadre de la boîte vient nous dire quoi faire. En un mot, le patron n’est plus sur ton dos mais dans ta poche 6.
Ainsi, chez les plateformes de transports privés, sous le prétexte « d’améliorer l’expérience des passager·es », les chauffeur·ses reçoivent de nombreuses « recommandations », « conseils » ou « retours ». Et l’algorithme privilégie non pas læ chauffeur·se læ plus proche, mais celle ou celui qui est læ mieux noté⋅e, qui a fait le plus d’horaires critiques, bref, celui ou celle qui se plie le mieux aux prescriptions dictées par l’algorithme. Plus l’attitude est zélée, plus la plateforme récompense. Sauf que la récompense permet à peine aux travailleur·ses de vivre dignement. S’ils ou elles ne se conforment pas aux exigences de l’algorithme, leurs revenus seront si bas qu’ils ou elles seront obligé·es de quitter la plateforme…
Quant au système de notation, certes læ client·e attribue la note, mais qui met en place cette notation ? Qui va en tirer les conséquences ? Qui est celui ou celle qui, suite à cette notation, prend des décisions qui auront des incidences sur le travail ? C’est bien la plateforme, et non læ client·e, et en droit c’est ça qui compte.
Toujours pour masquer la subordination, les plateformes préfèrent aux sanctions coercitives les mécanismes d’incitation et de récompense. Elles ne vont par exemple pas obliger à travailler de 19 h 30 à 21 h 30 au moins trois fois par semaine sous peine d’être exclu⋅e de l’application. Elles vont plutôt inciter à travailler régulièrement sur ses créneaux critiques en échange du droit à déterminer à l’avance ses créneaux de travail – qu’on appelle les shifts –, droit non négligeable quand on est aussi étudiant⋅e.
Autre exemple, la prime de pluie qui incite les coursier·es à livrer les jours de mauvais temps 7. C’est plus subtil que de leur dire explicitement: « Vous avez intérêt à bosser quand il pleut sinon on ne fera plus recours à vos services. »
L’enjeu futur des plateformes sera de développer de nouvelles stratégies encore plus diffuses pour masquer ces rapports de pouvoir qui s’exercent sur les travailleur·ses.
Tu affirmes aussi que les plateformes organisent leur propre marché du travail…
En droit du travail, nous sommes un certain nombre à être sensibles à l’idée que lorsqu’une personne entre dans une entreprise, elle est en partie extraite des logiques de marché. L’économiste Olivier Favereau va jusqu’à parler de l’entreprise comme d’un antimarché, parce que les logiques mercantiles pures – privilégier le facteur prix, favoriser la concurrence – sont effacées au profit d’autres : l’ancienneté, le fait de ne pas être sanctionné pour avoir fait grève, de pouvoir ne pas être licenciée sous prétexte qu’on est enceinte, etc.
Évidement, il existe des mécanismes qui permettent de réintroduire du marché, comme les primes au rendement. Mais les plateformes déjouent complètement cet effet antimarché. Elles organisent leur production en mettant tou⋅tes les travailleur·ses en concurrence les un·es par rapport aux autres. De plus, il y a un double effet concurrentiel, puisqu’existe aussi une concurrence sociale entre travailleur·ses. Celui ou celle qui sera le plus disposé⋅e à se brader, à remettre en cause ses conditions de travail ou à travailler durant les horaires les plus pénibles pour pouvoir avoir accès à l’activité sera favorisé⋅e par l’algorithme de la plateforme. Ce sont les algorithmes qui déterminent les conditions de travail, si bien que l’organisation massive de l’autoexploitation prend le pas aujourd’hui sur l’organisation du travail.
Tout pouvoir de résistance par rapport à la plateforme – comme le fait de refuser un créneau horaire ou de ne pas s’acheter tous les deux ans une voiture flambant neuve – est annihilé. Or c’est cela aussi le droit du travail : avoir un pouvoir de résistance face à la décision patronale.
Comment la « loi Travail » de 2016 a-t-elle pris en considération les travailleur·ses des plateformes ?
Dans le cadre de la « loi Travail », le gouvernement socialiste a créé un statut particulier pour accorder des droits aux travailleur·ses « des plateformes de mise en relation », ce qui exclut de facto les plateformes de travail (dont le rôle ne se limite pas à un simple rôle d’intermédiaire). Autre maladresse, les dispositions de la loi s’adressent aux « travailleur·ses indépendant·es des plateformes »… ce qui devrait exclure celles et ceux qui évoluent au sein de plateformes de travail, qui organisent, contrôlent et dirigent l’activité, telles que Uber et Deliveroo.
Depuis quelques années, beaucoup de personnes, y compris parmi les socialistes, pensent que le droit du travail est passéiste et qu’il faut protéger tous les travailleur·ses quel que soit leur degré de sujétion. En partie inspirées par les écrits d’Alain Supiot 8, il faudrait selon elles faire un droit de la personne avec des protections universelles. Le danger est que ce type de conception du droit social nie les divergences d’intérêts entre patron⋅nes et salarié⋅es. Cela s’entend bien quand on est libéral, mais c’est à mon sens d’une naïveté coupable quand on est socialiste.
La « loi Travail » octroie non pas des droits liés au salariat, mais des droits « mous » liés à la personne et à l’activité tels le compte personnel d’activité ou la validation des acquis d’expérience. On peut noter toutefois la reconnaissance du droit de grève, sauf que le législateur a tellement peur d’écrire le mot grève – car ça renvoie à des représentations mentales liées au salariat – qu’il a opéré un copier-coller de la définition du droit de grève !
Enfin, la « loi Travail » prévoit des dispositifs pour assurer les accidents du travail à un « niveau équivalent au régime général ». Chaque plateforme a donc négocié avec un assureur privé une convention d’assurance et, aux yeux d’une juriste, c’est brillant, car il n’y a rien de plus compliqué en droit du travail que de trouver des catégories similaires de protection équivalente. C’est une façon très bien pensée de contraindre les travailleur·ses à s’affilier au régime d’assurance négocié par, et donc pour, la plateforme.
Le problème, c’est que quand une convention d’assurance privée est négociée sans représentant·e du personnel, donc sans personne qui sache exactement comment s’effectue le travail, on arrive à des aberrations. Ainsi, en octobre 2017, Aziz Bajdi, un coursier Deliveroo, a été victime d’un grave accident de la route – il a subi deux opérations après avoir été littéralement éventré – qui l’a obligé à arrêter le travail. Aziz Bajdi, immobilisé pendant au moins quatre mois, apprend rapidement qu’il ne recevra pas l’indemnité prévue dans le cadre de la convention. Deliveroo avait prévu d’assurer les bras et les jambes des coursiers mais pas le buste et les viscères. Le moindre coursier vous dira pourtant que la blessure la plus fréquente, c’est de se prendre le guidon dans le ventre…

Depuis l’arrivée au pouvoir de Macron, le gouvernement encourage-t-il le modèle des plateformes numériques ?
Dans le cadre de la loi Avenir « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le député La République en Marche (LREM) Aurélien Taché a déposé en juin 2018 un amendement. Ce dernier prévoit que les plateformes éditent leur propre charte pour octroyer des droits et des devoirs aux travailleur·ses. Si Aurélien Taché et ses collaborateur·ices ont juré à l’époque la main sur le cœur qu’ils et elles voulaient protéger les travailleur·ses indépendants·e, l’objectif est clair : sécuriser les plateformes face aux risques de requalification en contrat de travail.
Chaque plateforme aurait dû ainsi rédiger sa « charte sociale » avec certaines mentions obligatoires, telles une rémunération minimum et des conditions de travail décentes. En contrepartie, les juges n’auraient pas pu se servir de ce qui était stipulé dans cette convention pour requalifier la relation en contrat de travail. Les plateformes auraient donc déterminé elles-mêmes l’organisation de la production, les conditions de travail, les salaires, l’accès à certains droits – et c’est pourtant justement ce qui prouve qu’il y a un pouvoir de subordination.
Heureusement, le Conseil constitutionnel a rejeté cet amendement en septembre 2018, car il a été considéré comme un cavalier législatif – un article de loi dont les mesures n’ont strictement rien à voir avec le projet de loi déposé.
En dépit de ce rejet, on a retrouvé un temps, au sein de l’article 20 de la loi d’orientation des mobilités en cours de discussion, le copier-coller à la virgule près de l’amendement Taché…
Pourquoi LREM tente-t-il de faire cela en douce ? Si jamais ils et elles décidaient de faire un texte sur cette question des travailleur·ses des plateformes, cela impliquerait un vrai débat public. Et ce serait compliqué d’expliquer la raison pour laquelle il faudrait retirer à des travailleur·ses précaires le statut de salarié⋅e, qui permet justement de compenser les inégalités, pour qu’une poignée d’actionnaires fassent du profit sur leur dos.
Qu’est-ce que le collectif Pédale et tais-toi (Pett) dont tu fais partie ?
Le collectif est né en juin 2018, du constat que les représentations nationales syndicales et politiques se désintéressaient des travailleur·ses des plateformes numériques. Souvent par ignorance du sujet. Nous organisons depuis un an un tour de France pour aller à la rencontre des travailleur·ses des plateformes, faire des réunions publiques, aller parler aux restaurateur·trices, aux élu·es des collectivités. L’objectif est de réaliser du travail syndical de base, de sensibiliser les personnes sur la cause des travailleur·ses des plateformes, de réfléchir collectivement à ce qu’il faudrait changer voire tenter à terme de rédaction d’une proposition de loi 9.
Existe-il des alternatives aux plateformes de travail actuelles ?
CoopCycle a produit un logiciel et une application de livraison pour ceux et celles qui voudraient développer des alternatives 10. Le logiciel, c’est le nerf de la guerre, le nouveau capital. Grâce à celui de CoopCycle se sont développés entre autres les Coursiers Bordelais, les Coursiers Nantais, Olvo à Paris, Feel à vélo à Lorient ou encore la Traboulotte à Lyon, des coopératives de livraison où les coursier⋅es sont salarié⋅es.
Avec le collectif Pett nous voulons vraiment couper le mal à la racine, car les plateformes de travail ont vocation à devenir hégémonique. On essaie de travailler à ce que ce type de plateformes coopératives et plus éthiques socialement soit privilégié à l’échelle des municipalités et des marchés publics.
Les travailleur·ses des plateformes ont-ils les moyens de se mobiliser contre leurs conditions de travail ?
Les travailleur·ses des plateformes, notamment chez Deliveroo, sont très jeunes : c’est souvent leur première expérience de travail rémunéré. Comme pour n’importe qui lors de son premier emploi, ce n’est pas évident de savoir ce qui est normal ou non, faute de repère. Sans compter qu’il y a un turn-over absolument incroyable au sein de ces plateformes, sachant que les militant·es estiment qu’il faut en moyenne cinq ans pour qu’un⋅e travailleur⋅se adhère à un syndicat. Des années sont nécessaires pour prendre conscience de sa condition, sans compter qu’on baigne dans un discours néolibéral qui dénigre depuis quarante ans le salariat.
Par ailleurs, il existe une vraie différence de sociologie avec les premier·es coursier·es. C’étaient pour la plupart des étudiant·es passionné·es de vélo. Ils et elles étaient payé⋅es entre 7 et 8 euros de l’heure, avec une majoration de 2 à 4 euros pour chaque course réalisée. Les plateformes leur ont cependant imposé une modification tarifaire parce qu’elles commençaient à avoir sous la main une réserve suffisante de travailleur·ses disponibles. Ainsi, en 2016, elles sont passées d’une tarification à la course à une rémunération au kilomètre qui s’applique d’abord pour les nouveaux et nouvelles entrant·es, avant de se généraliser ensuite à tou⋅tes les coursier·es dès 2017.
Les coursier·es protestataires, à l’instar de Jérôme Pimot du Collectif des livreurs autonomes de Paris ou d’Arthur Hay, à l’origine du premier syndicat CGT de coursier⋅es à vélo sur Bordeaux, ont été rapidement sanctionné⋅es en étant régulièrement désactivé⋅es par leur application. Quant aux coursier⋅es, ils et elles travaillent désormais 12 à 15 heures par jour et sont payé⋅es 3,50 euros à 1,4 euro par kilomètre parcouru…

On assiste pourtant à des mouvements de grève chez les coursier·es…
La grève se manifeste par une absence de connexion, c’est ce qu’ont fait du 8 au 15 juillet 2018, en pleine Coupe du monde de football, des coursier⋅es des plateformes Deliveroo, UberEats, Foodora, Glovo et Stuart. Mais déserter l’application est synonyme de déclassement. Un·e coursier·e gréviste ne paie pas uniquement son geste le jour où il ne travaille pas, mais aussi à plus long terme, car l’algorithme le défavorisera sur les livraisons à effectuer et sur ses shifts.
Qui plus est, les coursier·es, ne possédant pas de représentation syndicale, ne disposent pas de lieu où se retrouver. Avant, les livreur·ses parisien⋅nes se réunissaient place de la République pour attendre les courses au même endroit et échanger. Depuis peu, ils et elles ne peuvent plus rester ensemble trop longtemps, car l’algorithme favorise la circulation et l’atomisation des coursier·es. Cela détruit sciemment les espaces de discussion entre travailleur·ses. Et il ne peut y avoir de sentiment d’appartenance à une même communauté si tu ne peux pas échanger avec d’autres pair⋅es et développer ton esprit critique. Comment organiser une grève dans ces conditions-là ?
Les coursier·es britanniques de Deliveroo ont fait massivement grève l’année dernière, car leur rémunération kilométrique est encore pire que celle appliquée en France – ils et elles livraient pour 3 £ de l’heure. Contrairement aux chauffeur·ses Uber, les juges leur ont refusé la requalification, car ils et elles ont considéré que la possibilité de transmettre son compte à une tierce personne, ce qui est une pratique qui existe très à la marge chez les livreur⋅ses, est synonyme d’indépendance vis-à-vis de la plateforme. En Allemagne, le syndicat anarchiste FAU a créé une coordination, la Riders Union, forte de cinq cents membres. Certain·es livreur·ses sont parvenu·es à faire élire des comités d’entreprises au sein de Foodora ou de Deliveroo pour porter leurs intérêts. Enfin, en octobre dernier à Bruxelles, a été créée la Fédération transnationale des coursiers qui regroupe des livreur·ses issu·es de douze pays européens.
Tu fais souvent le parallèle entre les travailleur·ses des plateformes et les canut⋅ses, ces ouvrier⋅es-tisserand⋅es lyonnais⋅es du XIXe siècle…
Les canut⋅ses étaient en quelque sorte des autoentrepreneur⋅ses avant l’heure. Ils et elles étaient propriétaires de leur outil de travail, les métiers à tisser la soie, mais totalement dépendant⋅es des tarifs unilatéralement fixés par les négociant⋅es, les fabricant⋅es de matière première et les client⋅es. Une organisation de la production qui a donné lieu en 1831 à la première grande insurrection ouvrière.
Ces tisserand⋅es soumis⋅es à la dépendance économique se sont révolté⋅es pour obtenir des droits sociaux. On peut aujourd’hui se rendre compte de la régression terrible qui s’est opérée, dans la mesure où les travailleur·ses des plateformes sont obligés de se révolter pour avoir accès à ces mêmes droits acquis tout au long des deux derniers siècles.
Sous des airs de modernité, des conditions de travail dignes du XIXe siècle réapparaissent. Le 17 janvier dernier, Franck Page, un livreur de Uber Eats âgé de 18 ans, s’est fait écrasé par un camion à Pessac. Trois mois plus tard, un coursier de Yandex Food de 21 ans est mort d’épuisement à Saint-Pétersbourg. Depuis cette année, un⋅e livreur⋅se à vélo meurt sur la route chaque mois à travers le monde. On observe même le travail des enfants revenir. Certain·es prêtent leur compte à des collégien·nes – ou à des sans-papiers –, souvent habitant·es des banlieues parisiennes, qui vont ainsi travailler illégalement pour Uber ou Deliveroo tandis que le ou la détenteur·rice du compte peut empocher jusqu’à 40 % de la commission.
Le marchandage et le tâcheronnage sont des pratiques que le droit du travail était parvenu à réduire. Le droit du travail n’est certes pas révolutionnaire, dans le sens où il ne remet pas en cause le système capitalisme, mais il permet au moins de ne pas vendre sa dignité.
Le chant de révolte des canut⋅ses appelait à « tisser le linceul du vieux monde ». Souhaitons que les travailleur·ses des plateformes tissent le linceul du « nouveau monde » prôné par la Macronie.

- Lire à ce sujet Phillippe Vion- Dury, « De quoi l’“ubérisation” est-elle le nom ? Le partage des restes », Socialter, fév.-mars 2018, p. 22 ↩
- Le tâcheronnage est une méthode de rémunération où la personne est payée à la tâche effectuée. Voir Miranda Hall, « L’esprit du Turc mécanique. Moyen-Orient : les petites mains du capitalisme informatique » sur <jefklak.org>. ↩
- Dominique Meda, Travail : la révolution nécessaire, Éditions de l’aube, 2011. Dominique Meda, Patricia Vendramin, Réinventer le travail, Presses universitaires de France, coll. « Le Lien social », 2013. ↩
- Extrait de la décision « Aslam & Farrar vs Uber » du 28 octobre 2016 où les juges répondent à l’argumentation d’Uber : « The notion that Uber in London is a mosaic of 30,000 small businesses linked by a common ‘platform’ is to our minds faintly ridiculous. In each case, the ‘business’ consists of a man with a car seeking to make a living by driving it. Ms Bertram spoke of Uber assisting the drivers to ‘grow’ their businesses, but no driver is in a position to do anything of the kind, unless growing his business simply means spending more hours at the wheel. » ↩
- Voir <pct.parisnanterre.fr> et Emmanuel Dockès (dir.), Proposition de code du travail, GR-PACT, Dalloz, 2017. ↩
- Pour paraphraser le coursier Jérôme Pimot dans l’article « Comme d’autres livreurs à vélo, je n’étais pas salarié, je me suis fait virer » sur StreetPress en février 2017. ↩
- La masse de travailleur·ses précaires disponibles est aujourd’hui telle que nombre de plateformes se sont permises de supprimer cette prime de pluie. ↩
- Juriste français et professeur au Collège de France spécialiste du droit du travail et de la sécurité sociale. ↩
- Le 11 septembre dernier, une proposition de loi relative au statut des travailleur·ses des plateformes a été déposée par des sénateur·trices du groupe Communiste républicain citoyen et écologiste. Elle propose d’assimiler les travailleur·ses à des salarié·es, c’est-à-dire de leur faire bénéficier de la législation sociale tout en adaptant certaines dispositions aux particularités de leurs professions et en accompagnant leur volonté d’autonomie : contrôle de la rémunération, assurance chômage, interdiction des « désactivations » sans motif réel et sérieux, représentation et négociation collective, contrôle des algorithmes et des conditions de travail. ↩
- À ce sujet lire Benoît Borrits, « “Nous sommes une start-up anarcho-communiste” : Coopcycle auto-organise les coursiers à vélo », sur le site de Basta!. ↩