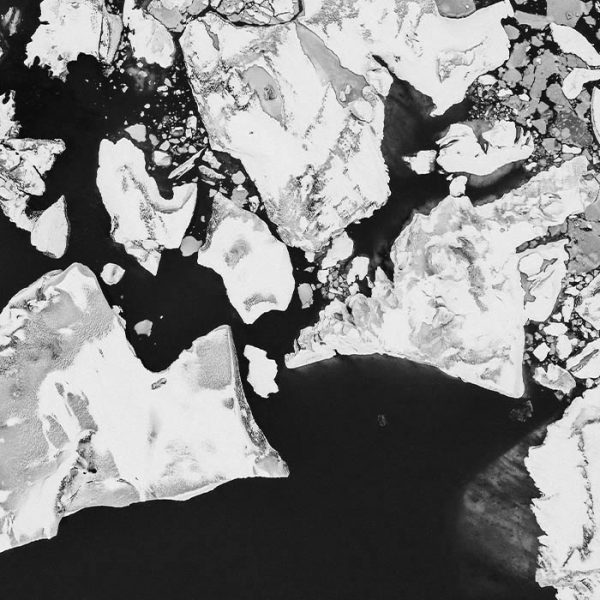J’ai creusé où on m’a dit de creuser. J’ai pris ma pelle et ma pioche. J’ai mis mon casque et mes œillères. J’ai vu quand même : le travail est un mensonge.
J’ai eu un emploi, on m’a donné un emploi du temps, je n’avais plus de temps pour moi. J’étais pillé, employé pour le temps que je représentais.
J’ai donné mon temps j’ai donné mon sang j’ai jeté mes gants j’ai mis la main à la pâte j’ai donné la patte à la main qui voulait me la prendre.
J’étais du temps on m’a découpé en tranches fines on m’a roulé dans la farine on m’a recouvert de papier je ne pouvais pas me périmer pas m’avarier j’étais salarié j’avais un sale air de pauvre.
Texte issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », toujours disponible en librairie.
Télécharger le texte en PDF…
J’ai écrit quelque chose autrefois, mais je ne m’en souviens plus. J’ai cherché dans les cartons qui peuplent mon appartement, je n’ai rien trouvé.
Parce que je ne me souviens plus de ce que j’ai écrit, et parce que je ne retrouve pas une preuve tangible de cette activité passée, j’écris de nouveau.
J’écris pour la deuxième fois de ma vie.
C’était peut-être un poème, mais rien ne le prouve.
C’était peut-être un poème parfait, le plus beau des poèmes. Je m’en suis aperçu, alors j’ai dit : « Passons à autre chose. » Si j’avais continué, j’aurais été déçu. Je devais envisager une vie sans écrire, pour ne pas courir après un idéal déjà atteint. J’étais poète, mais avant tout j’étais vivant, et je voulais vivre intensément, aussi pouvais-je devenir n’importe quoi, n’importe qui.
L’histoire est belle. C’était peut-être cette histoire que j’écrivais, si dans mon poème il y avait une histoire. Celle d’un homme qui écrit puis renonce. Un écrivain qui devient quelqu’un d’autre. Mais alors c’était peut-être une nouvelle. Ou bien c’était un poème qui est devenu une nouvelle. Car tout change tout le temps.
Je suis devenu fossoyeur. Cela, je m’en souviens. Les trous, les morts, la terre. La terre est la seule chose qui dans notre métier reste toujours au singulier. Les morts, par contre, sont visages et nombres tout à la fois. Présence et quantité. Sept aujourd’hui, douze demain. Autant de trous pour les recevoir.
Creuser, creuser – pour aller où ? J’ai souvent changé de cimetière. C’est toujours la même terre.
Ce n’est pas facile d’être aimé quand on est fossoyeur.
L’amour est comme au fond d’un trou : on donne de grands coups de pelle parce qu’on est pressé de le trouver, on touche un truc, ça ressemble à l’amour, pourtant c’est inerte – on l’a brisé.
Ou alors il y a celles que notre métier fascine. Des hystériques traquant l’odeur de la mort sur nos corps. Et toutes celles qui se sont trouvées tétanisées – « désolées » – à l’idée que peut-être je les enterrerai.
De toute façon c’est compliqué de passer ses journées avec les morts, puis, le soir, de retrouver une vivante qu’on aime.
Je pense à Nora – je me souviens d’elle, je ne l’ai jamais oubliée. Je l’oubliais chaque jour pourtant, en creusant. Puis je posais ma pelle et je pensais à elle. Et le soir nous étions ensemble, mais pas vraiment. C’était de ma faute. Je n’y arrivais pas. Dans ma tête il y avait des trous, des morts et toute cette terre. Je ne quittais jamais tout à fait le cimetière. La mort s’attache.
Dans mes cartons il y a mille fois son visage. Photographies, preuves accablantes des négligences passées. Quand une photographie est réussie, quand le visage de Nora dans l’un de mes cartons resplendit, je comprends que je ne l’ai pas assez bien regardée. L’appareil a été plus attentif. La machine savait, et j’ignorais.
J’ignorais que ce visage devrait tenir toute une vie.
J’ai peut-être arrêté d’écrire parce que j’ai trouvé du travail. On se laisse dévorer par le travail. Écrire après le travail, je ne voyais pas comment.
Aimer après le travail – Nora s’est épuisée à force d’essayer de me ramener à elle. Elle y arrivait parfois, mais le lendemain les trous, les morts, la terre, tout reprenait, tout était à refaire. L’emprise est telle.
Ce n’est pas seulement le problème du cimetière. Ce serait pareil dans n’importe quelle boutique, n’importe quelle usine. Le quotidien est la grande ruine. Les jours qui se répètent. Attendre les vacances pour retrouver l’étendue d’une journée, d’un sentiment qu’on tient, qu’on peut tenir enfin.
Je pouvais bien être poète, tout ce que je voulais, j’étais avant tout salarié.
C’était peut-être un poème, peut-être une nouvelle. En tout cas, je n’écrivais que des choses courtes. Pour atteindre plus rapidement l’essentiel.
C’était peut-être l’histoire d’un enfant, l’enfant que j’ai été, quelques souvenirs que l’écriture a changés en histoires.
Je ne me souviens plus de rien, j’émets des hypothèses, j’attends qu’elles sonnent juste.
Parfois la terre sonne juste. Vous savez que vous creuserez un beau trou.
Que le travail m’ait dévoré sonne juste. Toute la journée creuser – qu’écrire après cela, et que dire à Nora ? Un très beau trou.
Que cette nouvelle dont je ne me souviens plus ait été l’histoire d’un enfant sonne juste également. Car je ne me souviens plus de ce texte ni de mon enfance.
Les hystériques s’énervent parce que je ne leur parle pas assez de mes parents. Elles croient que je leur cache quelque chose. J’ai seulement oublié. Leurs visages et leurs noms, leurs voix, leurs tendresses et leurs colères.
Quand on vous confie votre premier cercueil de moins d’un mètre quarante, votre enfance s’écroule. Vous perdez le contact avec elle, c’est terminé. Si vous écriviez sur l’enfance, vous ne pouvez plus, vous ne savez même plus ce que c’est, vous croyez être né au cimetière avec une pelle à la main, déjà grand, déjà barbu, et c’est ainsi que vous observez vos collègues : des hommes sans enfance. Vous passez la journée à creuser en pleurant, vous creusez de travers parce que vous pleurez, alors vous décidez de ne plus pleurer et vous y parvenez : il faut bien creuser. Pour les enfants morts, il faut faire de beaux trous. Et les beaux trous se font les yeux secs.
La première fois, on m’en a confié deux d’un coup. Deux frères à placer côte à côte, 3 et 8 ans. J’ai creusé en pleurant dans la terre du cimetière de Pantin, puis je n’ai plus jamais pleuré, et je n’ai plus jamais eu de nouvelles de mon enfance.
Même quand j’ai vu les deux petits cercueils blancs sortir de la grosse voiture noire, je me suis retenu de pleurer. On aurait dit deux boîtes à chaussures. Je m’en voulais d’avoir creusé des trous trop grands. Les cercueils paraîtraient aux parents plus petits encore que leurs enfants ne l’étaient. J’ai pensé à mon métier et à ce que je devais faire pour l’exercer correctement. Des trous plus adaptés. Nora est partie quelques mois plus tard. Je suis allé peupler un appartement de cartons qui ne contenaient pas ce que j’écrivais. Des cartons qui ne contenaient que le reproche de n’avoir pas assez aimé.
Peut-être est-ce après avoir enterré ces deux frères que je n’ai plus écrit. L’enfance, qu’est-ce que vous voulez en dire quand vous l’avez enterrée ?
J’ai choisi un caillou, j’ai dit : « C’est mon enfance », et je l’ai jeté par-dessus la grille du cimetière. Pour la sauver peut-être. L’éloigner de la terre où l’enfance de Pantin finit.
Petit, j’ai quitté la maison où j’avais grandi. J’ai choisi un caillou et je lui ai dit : « Tu es mon enfance, je te dépose sous les marches de ce vieux perron, ne m’oublie pas, nous nous retrouverons. » Et puis j’ai déménagé.
Ce caillou se souvient de moi puisque je me souviens de lui.
Il y avait la mer aussi. Nous y allions.
Je serais bien en peine d’écrire qui formait ce nous. Mais le fait est que nous allions à la mer.
Je ne me souviens pas de la solitude. La solitude, c’est aujourd’hui. Avant, je n’étais jamais seul, et, quand je l’étais, avec mes mains, dans l’eau très claire, j’attrapais des poissons.
Ce sont là mes seuls souvenirs.
Il y a toujours un moment où, dans une conversation avec une inconnue, cette inconnue vous demande ce que vous faites pour gagner votre vie. Je n’ai jamais aimé mentir. J’ai rarement été aimé plus d’une nuit.
Je sais que je suis un homme avec lequel on passe une nuit pour voir ce que ça fait. Le lendemain, on est de toutes les conversations, de tous les SMS, de tous les statuts sur les réseaux sociaux : « Sucer un croque-mort : done ! » 42 likes, 19 commentaires, 3 nouvelles demandes d’amitié.
Mais peu importe.
On ne comprend pas vraiment l’oubli. On ne le comprend (et d’ailleurs il s’agirait plutôt de l’admettre ; mais comprend-on tout ce qu’on admet, ou comprend-on seulement qu’on a admis ces choses que nous ne comprenons pas ?) qu’à partir du moment où on n’essaie plus de savoir quand tout a commencé.
Le jour où j’ai commencé à oublier – comme s’il s’agissait d’une activité sportive, et que, à force de pratique et d’assiduité, on m’avait remis une ceinture noire d’oubli et un certificat.
Le jour où j’ai oublié ce que j’avais écrit – mais le jour où j’ai oublié est seulement le jour où je me suis aperçu que j’avais oublié et qu’il était trop tard.
L’oubli n’est pas un enfouissement – il me suffirait de creuser pour tout retrouver. L’oubli est une expulsion, un exil. Un morceau de ma vie passée a été, dans ma vie présente – pour que ma vie présente puisse continuer ? – condamné à l’exil.
J’ai quitté cette maison où j’avais grandi, puis je n’ai plus jamais grandi.
Vous dites : « J’ai oublié. » Comme si vous y étiez pour quelque chose. Comme si vous aviez participé activement à ce processus. Mais l’oubli se joue de vous, sans vous. En vérité, ce sont les choses dont vous ne vous souvenez plus qui vous ont oublié.
Oublierai-je un jour ces deux petits cercueils blancs ? M’oublieront-ils, ces petits anges ?
J’ai creusé pour eux deux trous trop grands.
Et pour Nora j’ai tout vu trop petit.
Le soir, seulement le soir.
La retrouver chaque soir.
Il existe des cartes pour se repérer dans les cimetières – des divisions et des allées, des cadastres pour ne pas creuser au mauvais endroit, enterrer quelqu’un sur quelqu’un d’autre, cela arrive quand on ne lit pas encore très bien les cartes. Existe-t-il des cartes pour l’amour ?
C’est peut-être cela que j’ai tenté d’écrire autrefois et que j’ai oublié depuis. Un plan pour nous, Nora et moi, quelques repères posés au gré des mots afin que nous nous retrouvions.
C’est parce que j’ai oublié ce que j’ai écrit autrefois que j’écris de nouveau. À présent, je suis libre de m’en souvenir – venir par en-dessous, ramper parmi les morts avec les mots.
Se souvenir et, peut-être, revenir.
Tout commence toujours à Pantin pour les fossoyeurs. C’est le premier cimetière qui vous embauche.
Un cimetière immense, sans relief, où sous la terre il y a une source. L’eau résurgente inonde les trous qu’on creuse. On les vide avec une casserole. On est couvert de boue. Après la douche, on en a encore dans les cheveux et derrière les oreilles. La terre ne vous oublie pas.
Oublierai-je un jour le caillou que j’ai laissé sous les marches du perron de la maison de mon enfance ? Était-ce une maison ? Je ne me souviens que du caillou. Et il y avait la mer et nous, mais nous n’est plus un ensemble de visages et de noms, nous est une sensation très vague, disparue depuis trop longtemps.
Un jour, un cercueil sort d’un corbillard, et personne n’assiste à la mise en terre. C’est alors qu’on comprend ce qu’est l’oubli.
Un jour, un homme arrive et vous offre à manger. Vous avez enterré sa femme l’année passée. Il se souvient de vous. Il vient vous remercier. Il revient chaque année avec une attention pour vous. Les hommes sont bons parfois, s’ils se souviennent.
Un jour, un cercueil ne veut pas descendre. C’est comme s’il s’accrochait. Le trou est assez large pourtant. Mais le cercueil résiste. Et les visages heureux, émerveillés de ceux qui observent cette résistance.
Ce jour-là, vous vous souvenez que vous écriviez autrefois. Mais vous vous rendez compte que vous avez oublié ce que vous écriviez.
La mémoire n’est pas se souvenir. La mémoire est un lieu, une propriété. Se souvenir est un retour.
Ce texte était peut-être une carte pour retrouver Nora chaque soir en sortant du cimetière. Car il n’y a rien, rien pour nous indiquer qui nous devons aimer et comment faire. Nos petits cœurs et nos petits sexes (auxquels une boîte à chaussures conviendrait pour un enterrement, si ce grand corps que nous traînons ne les accompagnait pas aussi résolument), nous les jetons dans l’obscurité la plus totale.
Ils sont sans flair ni pensée, ils ne savent rien, n’ont aucune conscience du danger et encore moins du bonheur.
Que savons-nous de l’amour ?
Nous avançons à l’aveugle au hasard des propositions et des proies. Rien n’est donné, mais nous prenons. Nous pouvons tout expérimenter sans jamais rien connaître. Sans que jamais la moindre chance de savoir nous effleure.
Oublier ce que nous avons entrevu au bout de ces expériences est bien plus probable.
Oublier, ou méconnaître.
Et méconnaître parce qu’on n’y reviendra pas.
Comme dans un champ de cendres, nous cherchons les formes des fleurs passées.
Nous cherchons les formes des fleurs passées – c’est peut-être une phrase que j’ai écrite autrefois.
Quand j’écris aujourd’hui, je traque ce qui ressemble à ce que je pouvais écrire avant.
Mes pensées me semblent étrangères quand elles ne sont peut-être que les réminiscences de cet homme que j’étais avant d’en être un autre, un qui a oublié.
Si j’écris aujourd’hui, c’est pour me souvenir de ce que j’écrivais. Il n’y a pas d’autres raisons.
Le motif de mon action est une fiction. Une fiction passée et oubliée. Les fictions sont aussi des raisons d’agir. Les fantômes nous donnent des indications.
J’aurais pu écrire parce que je suis fossoyeur. Mais je suis devenu fossoyeur et je n’ai plus écrit. Aujourd’hui si j’écris, c’est parce que j’écrivais.
Nora. Cette nouvelle que j’ai écrite autrefois – à présent je m’en souviens, je suis venu par en dessous, j’ai rampé parmi les morts, et je peux la cueillir (la recueillir ?) – était une carte m’indiquant comment te rejoindre.
Ou bien une carte t’indiquant comment me rejoindre.
C’était à toi de faire tous les efforts. Je voulais te prévenir des difficultés que tu rencontrerais. Aussi, j’écrivais.
Cette nouvelle avait pour titre – puisque c’est une pensée qui me traverse à présent, et puisque cette pensée me paraît étrangère, comme si celui que je suis ne pouvait pas penser ainsi, et comme si je ne pouvais penser une telle chose que parce que je l’ai pensée autrefois – L’Armure des journées de travail.
Le cimetière, les trous, les morts – creuser au plus juste. La terre si dure quand il gèle. Les machines se brisaient. Il fallait frapper fort. Ma nouvelle parlait de cela. Cette terre qui est toujours la même et qui gèle l’hiver pour nous briser le dos.
Enterrer au mieux, au plus profond. La joie d’un trou bien fait, quand tout le monde voit qu’il est bien fait, même ceux qui n’y connaissent rien, n’en ont jamais vu d’autres. Et puis écrire quand même entre deux trous.
J’écrivais parce que je pensais à toi. J’écrivais quelque chose pour toi, dans les allées, les divisions, avant d’enterrer d’autres morts. Je pensais pouvoir venir à ton secours avec cette nouvelle. Comme quand j’étais si seul que je mettais mes mains dans l’eau pour toucher l’écaille des poissons.
Il fallait trouver quelque chose, dans toute cette détresse. Quelque chose pour revenir. Parce que le bonheur n’était pas encore inaccessible. Il était lié aux circonstances. Il était encore temps. Le bonheur était temps.
Le désir de se frayer un chemin le soir, jusqu’à toi, à travers l’armure des journées de travail.
Je rentrais vite, je ne traînais pas.
Le quotidien nous écrasait d’ennui, mais nous en triomphions quotidiennement. Ou bien nous tentions d’en triompher. Et c’était l’essentiel, ces tentatives d’un triomphe incertain. Car à vrai dire nous succombions souvent.
L’ennui comme la terre s’accroche. Mais que nous succombions ou triomphions, c’était le même élan, le même effort.
Quoi qu’il arrive, quoi qu’il advienne de nos efforts, il y avait toujours quelque chose du monde qui restait, quelque chose du désir et de l’être, quelque chose d’amoureux ou de noir. C’étaient des particules en suspension dans l’air d’un grand gymnase rempli d’athlètes, que les rayons du soleil parfois révélaient.
Voilà ce qu’essayait de saisir cette nouvelle : des particules. Cette nouvelle était un soleil.
On voudrait qu’il y ait chaque jour du soleil, chaque jour voir les particules, se souvenir que nous sommes vivants, c’est impossible, ce n’est pas grave, la vie sans gravité, mais pas sans joie, pas sans hargne.
Ce n’était pas grave, nous retrouverions le soleil – voilà ce que disait cette nouvelle. C’était une mauvaise nouvelle. Il arrive que le soleil ne revienne pas. Cela, je ne l’ai pas écrit. Ce n’est pas possible autrement.
Je l’écris aujourd’hui. Il est trop tard. La mer est loin. La solitude est là. Plus rien n’est temps.
Je sortais du cimetière et en rentrant chez nous tes mains étaient là pour le palp, ce qu’entre nous nous nommions palp, ma queue, tes seins, mes fesses, ta chatte, tu passes la tranche de ta main entre mes fesses et tu t’agrippes, palp, tu presses mon gland dans ton poing, palp, et je caresse et presse tout ce qui vient de chair entre mes doigts, tout ce qui est saillant, ce qui s’enroule, un monde que le palp devine, et que les yeux ne voient jamais de cette façon. La précision et l’hyperbole au bout des doigts, révélation d’un monde, exploration tout en surface et tout en creux – chercherions-nous nos corps de la même façon si nous pouvions rester ensemble infiniment ? Aurions-nous le goût du palp ? Le palp est une procédure, nous procédons à la joie qui viendra, le plaisir nécessite de telles procédures, après les journées de travail qui nous séparent, après l’absence, se retrouver n’est une question ni de repos ni de présence, il faut encore que nous nous cherchions.
Entre le travail et toi il y avait sept stations de métro, mais je ne prenais pas le métro, je marchais, la rue est en pente et je la dévalais bien qu’elle monte, j’avais besoin de marcher pour te retrouver, j’avais besoin de quitter la terre du cimetière et de m’appuyer sur le béton des boulevards pour me hisser jusqu’à notre septième étage. Mais entre toi et le travail je préférais prendre le métro pour te quitter le plus tard possible, et j’observais toutes les stations, les quais, les visages saisis par la lumière de l’aube, je serrais dans mon poing une pelle imaginaire, j’effleurais dans ma mémoire la nuit passée, je pensais à ce qui dans ton corps avait différé des nuits précédentes, je croyais te connaître, mais les variations m’étonnaient, et j’étais inquiet quand je ne te voyais pas varier, j’étais peut-être passé à côté de quelque chose, car tu n’étais pas la femme la plus stable du monde, il y avait tant à savoir de toi que je voulais parfois m’en préserver – puis j’enterrais des corps que je ne toucherais pas.
Le travail est un mensonge. Qui rêve enfant de devenir fossoyeur ? Qui rêve de creuser six bons trous avant de poser sa pelle dans un local vert pomme et de retrouver celle qu’il aime ?
Enfant, j’avais rêvé de te trouver puis de te retrouver chaque jour, j’avais rêvé de cette rue en pente menant vers nous, et je la dévalais déjà en rêve. Il y avait dans mon rêve un orchestre qui jouait quelque chose tandis que je dévalais la rue, ce n’était pas Beethoven car je ne connaissais pas Beethoven, mais ça lui ressemblait, et à vrai dire je ne te connaissais pas non plus pourtant cela ne m’empêchait pas de te rêver, aussi pouvais-je rêver de Beethoven sans le connaître. On rêve de ce qu’on aime avant de le connaître, c’est que l’amour est là, comme une donnée au fond de notre enfance, et l’existence presse notre enfance pour que l’amour en sorte, certains le goûtent d’autres l’abandonnent, j’ai goûté au rêve de toi, qu’y a-t-il de plus beau que de venir vers toi ?
Du cimetière jusqu’à toi en dévalant la rue, chaque soir poser la pelle et puis presser le pas, poser la pelle s’est incrusté comme une donnée réelle dans le rêve de l’amour réalisé, c’est un amas de terre dure à partir duquel le mouvement s’initie, et c’est parce que j’ai posé ma pelle que je peux te retrouver, c’est parce que j’ai retourné toute cette terre, parce que j’ai enterré tous ces morts que je ne connais pas que je cours à présent vers toi pour te connaître à fond – je ne peux plus dire à fond sans penser à la terre, à ce creux où nos corps échouent, aussi ne te connaîtrai-je jamais à fond, je crois, mais bien plutôt en long en large et en travers, c’est l’expression qui va, c’est l’expression qui va le mieux à l’encontre des jours, et je sors du cimetière en courant, mais je ne fuis rien, je te désire, c’est différent, seulement je m’aperçois que sur mes épaules quelque chose freine, quelque chose dans l’air de la ville résiste, une lourdeur, un épuisement, un bruit de machine, mais c’est moi qui l’émet, j’ai oublié d’ôter l’armure des journées de travail, je cours avec maladroitement, je manque de trébucher, de m’écrouler, de renoncer à courir, cette armure est si lourde, j’ai oublié de m’en dévêtir, je cours quand même.
Entre le travail et toi il y a le rêve, la juste distance d’un rêve, l’exacte distance qui me permet de te retrouver, un rêve gardé depuis l’enfance. Aujourd’hui j’ai enterré deux enfants, je ne sais plus où je suis né, les paysages dans lesquels j’ai grandi se sont tous effondrés, je ne sais pas si je vais pouvoir m’appuyer sur quoi que ce soit, je ne sais pas si je vais pouvoir te retrouver ni enlever l’armure des journées de travail, il y a des soirs où on ne peut pas, pardonne-moi.
Si j’écrivais, c’était pour te demander pardon. Et je crois que j’écrivais de longues phrases quand j’écrivais. Mais je trichais. Au lieu de points, je traçais des virgules. Parce que rien ne devait s’arrêter.
Les virgules sont des armes fragiles. Aussi ai-je arrêté d’écrire.
Aujourd’hui je ne creuse plus seul. Mon collègue s’appelle Casper comme le fantôme et je pense qu’il s’agit d’un fantôme. Nous nous adressons des phrases courtes qui semblent sans destinataire, des humeurs et des impressions qui n’invitent à aucune forme d’échange.
Nous creusons ensemble, chacun d’un côté du trou. La compagnie est nécessaire. Même si elle n’est d’aucun secours.
Aux poissons que j’attrapais dans l’eau claire de la mer d’où je viens, aux poissons que je laissais mourir sur le sable, j’offrais la feuille d’un palmier pour que leur tête ne se recouvre pas de sable. Cela n’était d’aucun secours. Mais cela me semblait nécessaire. Casper est cette feuille de palmier, tandis que j’étouffe.
Et quand je rentre le soir je ne marche plus, je prends le train.
Casper et moi dans le Francilien, nous venons d’une île et nous rejoignons la France. Nous avons commencé à creuser à Pantin, c’est là qu’on nous envoie d’abord, avant de nous faire faire le tour de l’île (de France), le tour de la terre.
Le cimetière de Pantin et sa source secrète. Nous écopions puis nous prenions le train.
J’ai creusé où on m’a dit de creuser. J’ai pris ma pelle et ma pioche. J’ai mis mon casque et mes œillères. J’ai vu quand même : le travail est un mensonge.
J’ai eu un emploi, on m’a donné un emploi du temps, je n’avais plus de temps pour moi. J’étais pillé, employé pour le temps que je représentais.
J’ai donné mon temps j’ai donné mon sang j’ai jeté mes gants j’ai mis la main à la pâte j’ai donné la patte à la main qui voulait me la prendre.
J’étais du temps on m’a découpé en tranches fines on m’a roulé dans la farine on m’a recouvert de papier je ne pouvais pas me périmer pas m’avarier j’étais salarié j’avais un sale air de pauvre.
Il fallait sourire il fallait s’ouvrir il fallait s’écarter laisser de la place pour que tout puisse rentrer dans l’employé du temps ça rentrait c’était le bon temps.
J’ai travaillé au corps. J’ai œuvré puisqu’il fallait œuvrer. J’ai cherché du travail – j’en ai trouvé. J’ai cherché une histoire. Les histoires sont partout. Les histoires courent les rues. J’en ai pioché une au hasard. Mauvaise pioche.
La question est celle de l’échange.
Je veux dire : l’échange existe-t-il vraiment ?
Je veux dire l’échange autre que celui d’un corps contre une vie. Ou bien est-ce la même chose ? Un corps contre un corps. Une vie contre une vie. Deux centimes contre un centime.
J’ai gagné de l’argent, j’ai donné du temps. J’ai jeté mon temps dans le poulailler. J’ai donné du grain à moudre.
Je veux dire l’échange même le plus banal. Existe-t-il ? Sans attente d’autre chose que ce qu’il est. L’échange en soi, qui ne vaut pas pour ce qu’il pourrait être, mais qui vaut seulement pour ce qu’il est. Pour le petit corps qu’il est. Pour la petite vie. Pour le petit centime.
Je veux dire : est-ce qu’on peut se contenter du monde ? Se contenter de cette vie ? Se contenter de soi ? De l’autre ?
Ce n’est pas la question du bonheur ; c’est la question de l’inespéré.
Je me souviens de la mer.
Le pire est que la mer est loin.
Au fond des trous que nous creusions à Pantin, nous la voyions sourdre.
Nous avons été d’autres hommes, me dis-je quand je rentre chez moi.
C’est peut-être une phrase que j’ai écrite autrefois. Nous avons été d’autres hommes. Mais à présent nous sommes ces hommes dans le Francilien. Et il n’est pas certain que nous nous souviendrons de ce que nous sommes.