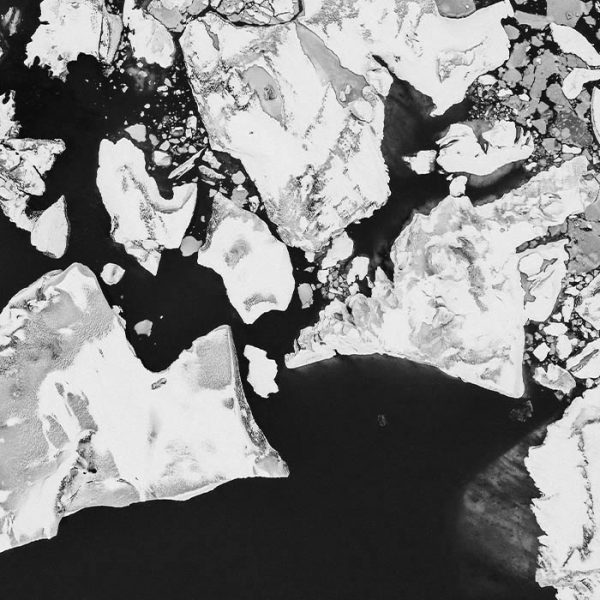Dans les secteurs du management et du marketing, mais aussi à l’école ou sur nos écrans, le nombre d’applications utilisant les mécanismes du jeu va croissant. Game designer et professeur à l’université de Lorraine, Sébastien Genvo s’attache à mettre en lumière le fondement béhavioriste de ce phénomène de « gamification ». À cette capture capitaliste et néolibérale du game, il oppose une conception libératrice de play, fondée sur les notions d’expérimentation et de réappropriation.
Cet article est issu du quatrième numéro de la revue papier Jef Klak, « Ch’val de course », qui traite du jeu et du risque, et toujours disponible en librairie.

Quels phénomènes le terme de « gamification » tente-t-il de recouvrir ?
Le mot vient initialement du marketing et a été employé à partir de la fin des années 2000 pour désigner l’utilisation de mécanismes et de technologies issus du domaine du jeu, en vue de les implanter dans des situations qui ne sont habituellement pas reconnues comme ludiques. C’est le cas par exemple des applications qui emploient des systèmes de points, de classement, de compétition et de récompenses dans le domaine de la formation professionnelle. Aujourd’hui, de plus en plus de grandes sociétés utilisent la gamification : suite à votre recrutement, on vous incite ainsi à vous connecter depuis chez vous à un jeu ressemblant un peu aux Sims, pour que vous puissiez découvrir l’univers de l’entreprise. Cela revient à faire de la formation hors du cadre du travail, à observer et surveiller chaque employé pour connaître son temps de connexion, mesurer sa connaissance de la marque et son degré de progression. BNP-Paribas, par exemple, a développé une application ludique afin de permettre à ses nouveaux employés de connaître le fonctionnement de ses différents départements. Dans un certain sens, on utilise clé en main des méthodes issues du monde du jeu avec l’idée qu’elles permettront d’« engager » l’utilisateur.

Qu’est-ce que cet engagement, pourquoi le rechercher ?
Dans le lexique du marketing, l’engagement signifie avant tout l’adhésion d’un consommateur à une marque, un produit ou un service. On pourrait d’emblée se demander quelle est la différence avec les programmes de fidélisation classiques. Dans ces derniers, on va au supermarché, on achète des produits, et la carte de fidélité permet d’accumuler des points, avec l’objectif de faire revenir le client en lui offrant des avantages. La gamification repose sur un autre principe : il s’agit de rendre un produit ludique, divertissant et sympa pour renforcer son attrait, pour inciter à son utilisation plus fréquente, donc à la consommation. Comme Nike, qui a développé un ensemble d’applications gratuites pour l’entraînement sportif en se fondant sur des principes de gamification, avec l’intention de rendre sa marque encore plus attractive.
Cette définition a été vivement critiquée, par le monde académique notamment, puisqu’elle relève d’une perspective béhavioriste, et considère que le simple aspect ludique suffit à ce que l’utilisateur se prenne au jeu et voie le produit sous un jour favorable. Néanmoins, ce n’est pas forcément parce que c’est un jeu que cela va être considéré comme fun et engageant.
En fait, ce qui fait l’intérêt d’un jeu, ce n’est pas simplement sa nature, mais sa conception même. Cela nous pousse à nous interroger sur ce qui fait qu’un jeu est bien construit pour un individu. Qu’est-ce qui fait jeu, après tout ? Est-ce que le simple fait de mettre un système de points, de classements et de récompenses dans une situation donnée est suffisant pour l’utilisateur ? Non, bien sûr, mais cette conception béhavioriste était complètement assumée par les premiers promoteurs de la gamification, qui jugeaient que le cerveau associe systématiquement jeu et plaisir, ce qui entraînerait l’engagement. Avec plus de six ans de recul, on se rend bien compte désormais que c’est plus complexe que ça.
Le jeu en général, et même les jeux vidéo, ne se résument pas à ces systèmes de compétition et de récompenses. D’autres aspects, comme la fantaisie, l’imagination, la métaphore, ne sont-ils pas aussi employés dans ces applications ?
Pour les tenants de la gamification, peu importe le thème, ce sont les mécanismes qui vont créer l’engagement. C’est un des points sur lesquels je suis particulièrement critique, car la thématique du jeu, son aspect fictionnel sont intimement liés à ce qui va nous donner envie de jouer. Tous les individus n’ont pas les mêmes envies selon la thématique du jeu. Eux pensent que si vous trouvez un travail répétitif, ennuyeux et peu engageant, il suffit de le gamifier pour le rendre plus plaisant.
Ces applications comportent beaucoup de mécanismes fondés sur la conflictualité, la compétition, ainsi que la contrainte. On parle d’ailleurs de « gamification », et pas de « playification ». L’anglais a deux termes pour désigner le jeu : « game » et « play ». Le play s’apparente à une activité libre de découverte, d’exploration, d’expérimentation et de réappropriation. Le game renvoie, quant à lui, à la structure et aux contraintes du jeu, avec ses règles et ses objectifs définis. La gamification fonctionne ainsi par ajout de systèmes de points, de quantification des usages, à tel point que certains critiques de ce concept préfèrent l’appeler « pointification ».
Cette quantification de l’expérience est fortement liée aux origines du marketing : si on mesure les usages, on peut voir pendant combien de temps vous avez utilisé tel service, sur lesquels vous avez passé le plus de temps – et les impératifs de réussite quantifiés peuvent motiver à devenir l’utilisateur le plus assidu d’un service.
La gamification est née dans le cadre de supports numériques, fonctionnant avec des nombres ; c’est plus facile de rajouter du quantitatif là où il y en a déjà. Mais le phénomène déborde sur d’autres domaines. L’usage des jeux dans les salles de cours n’est ainsi pas nouveau, mais aujourd’hui, on tente de plus en plus de quantifier l’enseignement en s’inspirant des mécaniques du jeu vidéo. On peut par exemple mentionner le cas du jeu Classcraft, qui attribue à chaque apprenant un personnage inspiré du jeu de rôle (magicien, guerrier, etc.), et repose sur l’attribution à chacun de compétences sanctionnées par des points d’expérience. Ici l’orientation est clairement de penser l’enseignement avant tout en termes de compétences quantifiables – ce que facilite la gamification – davantage qu’en termes de connaissances et de construction de savoir.

Quel est le lien entre la gamification et le phénomène plus général d’introduction d’éléments ludiques dans tous les secteurs de nos vies ?
C’est un processus ancien (l’historien Johan Huizinga faisait déjà ce constat en 1938 dans Homo Ludens) et relativement profond, qui s’explique en partie par la réduction du temps de travail et le développement d’une industrie dédiée aux loisirs. L’évolution de la porosité entre jeu et travail appuie donc un phénomène de fond de ludification, davantage que de gamification. Beaucoup d’activités et d’objets deviennent simplement plus ludiques : il suffit de comparer l’iPad avec un système informatique du début des années 1980 – l’interface se veut plus malléable, réactive, facilitant l’appropriation et l’exploration. En somme, le système est plus jouable, même si l’objet en soi n’est pas nécessairement un jeu. La gamification part de ce constat-là, elle essaye de le rationaliser et d’en tirer profit. Cette rationalisation passe par la création de méthodes, d’indicateurs d’efficacité et de mise en concurrence. On a longtemps opposé jeu et travail, jeu et sérieux, ce qui est une distinction purement culturelle, mais on voit bien que le rapprochement entre jeu et travail se fait également via la contagion du jeu par des logiques capitalistes et néolibérales. La gamification est une rationalisation du jeu à des fins capitalistes.
Cette contagion du jeu atteint-elle tout le monde de la même manière ? On imagine aisément certaines personnes rester réfractaires à l’idée que leur travail, en l’occurrence très sérieux, puisse être assimilé à du jeu…
Il s’agit ici de savoir si cette contagion ne va pas remettre en cause certaines représentations que nous avons de ce qui relève du jeu et non du travail. Évidemment, cela peut créer des frictions, tout comme quand le jeu vidéo s’est propagé auprès du grand public. Il y a alors eu de nombreuses résistances relatives à l’idée que certains publics se faisaient de ce qu’était un jeu, et le jeu vidéo a participé à transformer les attentes et les représentations sociales du ludique. C’est très important, parce que le jeu se définit avant tout par l’idée que chacun s’en fabrique. C’est un fait culturel en perpétuel mouvement.
Ces changements ne se font néanmoins pas spontanément, il y a des conflits, comme dans le cas de l’utilisation des jeux dans l’entreprise, qui ne va pas de soi. Et pour cause : l’attitude ludique relève habituellement d’une posture volontaire, il est donc difficile de jouer en étant contraint. Or, quand la gamification est mise en place, elle est imposée aux acteurs : on ne demande pas à l’employé s’il veut faire un jeu pour se former, on lui dit simplement : « Tiens, un outil a été développé et on te le “propose” pour te former. »

Puisque cet objet nommé « jeu » évolue sans cesse, ne doit-on pas craindre que les secteurs mercantiles et managériaux prennent trop en charge cette évolution ?
La gamification est une conception capitaliste et néolibérale de ce qu’est le jeu, où la quantification de l’expérience par accumulation est centrale. C’est un outil servant à étendre ces mêmes logiques de productivité et de concurrence à l’ensemble des sphères du quotidien ; jusque dans les loisirs, ou les recherches d’affinités amoureuses. Si on regarde les sites de rencontres aujourd’hui, il est évident qu’ils se sont inspirés de mécanismes de gamification pour favoriser l’utilisation de leur plateforme, les profils mis en avant sont ceux qui gagnent le plus de points, on donne des médailles ou trophées pour certaines actions (tant de messages envoyés ou reçus, etc.). C’est une façon parmi d’autres de favoriser des logiques de surveillance et de contrôle jusque dans le lien social.
Sous un angle moins pessimiste, il faut se souvenir qu’à l’origine de l’industrie du jeu vidéo, il y a également des logiques de play très fortes, favorisant les idées de libération, d’expérimentation et de détournement des systèmes. Tout cela fait aussi partie de cette culture, et l’industrie s’est développée à partir de frictions entre, d’un côté, l’imposition de normes très strictes, qui entraînent une rationalisation maximale du jeu 1 et, de l’autre, des résistances, des réappropriations, détournements ou expérimentations qui renvoient à une idée du jeu beaucoup plus libre. Un cas très célèbre est celui de l’incident du « sang corrompu » dans World of Warcraft, où un joueur a réussi à propager une épidémie dans le monde du jeu en exploitant un bug qui a mis à mal le serveur pendant plusieurs jours après l’événement.
Qu’en est-il du côté des utilisateurs ? S’amusent-ils vraiment, et adhèrent-ils autant à ces vrais-faux games qu’ils en viendraient à oublier qu’ils sont en train de consommer ou de travailler ?
Les individus ne sont pas naïfs par rapport à ces procédés. Et nous n’avons pas attendu la gamification pour le savoir. La chercheuse Catherine Kellner, par exemple, a mené une étude sur les CD-ROM ludo-éducatifs destinés aux enfants, et a pu constater que ces derniers n’étaient pas dupes quant aux tâches qu’on leur donnait à faire. Même si on leur présentait ça comme du jeu, ils voyaient bien que l’objectif était de leur faire suivre un programme contraint d’apprentissage, et que la vraie part de jeu était restreinte.
Mais les concepteurs travaillent dur de leur côté. Facebook, par exemple, puise abondamment dans les logiques ludiques pour donner de la confiance à ses utilisateurs. Il s’agit vraiment d’euphémiser les conflits, de faciliter la quantification de l’ensemble des expériences des utilisateurs, tout en favorisant des logiques de compétition : quantité d’amis ou de likes, mise en avant des posts plébiscités, etc. Il y a une réelle malléabilité de la plateforme qui favorise une logique ludique, mais cette logique est réglée pour faire oublier à l’utilisateur que l’objectif reste la traçabilité de l’ensemble de ses actions et la revente de ses données.
Pour autant, la part de jeu d’un dispositif peut correspondre aux envies de l’utilisateur et à la représentation qu’il se fait du jeu, telle qu’elle s’impose de nos jours dans le monde social. On peut dès lors se demander comment développer l’esprit critique, le recul et l’analyse de ces phénomènes.

Dans cet esprit critique, certains concepteurs font de leurs jeux mêmes des arguments contre la gamification…
Il y a aujourd’hui sur la scène du jeu vidéo indépendant des auteurs très critiques vis-à-vis des logiques capitalistes, comme par exemple l’artiste animant Molle-industria, qui crée des jeux très revendicatifs sur le plan politique. Ainsi, McDonald’s video game critique l’industrie agro-alimentaire en reprenant les codes du jeu vidéo pour faire passer le message. Bien que ces jeux concernent un public très minoritaire, ils permettent de développer une réflexion. Le jeu Progress Wars, quant à lui, comporte seulement une barre de progression que l’on remplit en cliquant sur un bouton, et une fois que la barre est pleine, on passe au niveau suivant, où le mécanisme reste exactement le même : c’est une critique par l’absurde du principe même de la gamification.

Certaines applications de la gamification sont présentées comme pouvant aider à la résolution de problèmes de manière collaborative, comme ce déchiffrage des structures d’une protéine annoncée par le journal Nature…
Les joueurs collaborent ensemble très naturellement sur tout un tas de problèmes, il suffit de voir toute l’énergie mise en œuvre dans World of Warcraft ou d’autres MMOG 2 pour résoudre des quêtes. Mais l’utilisation de ces ressources humaines pour exécuter des tâches extérieures au monde du jeu pose la question de nos envies en termes de jeux (l’exemple le plus connu est celui du jeu Foldit que vous évoquez, où les joueurs ont participé à la résolution de problèmes liés au repliement des protéines). A-t-on envie, en jouant, d’aider à résoudre des problèmes de recherche, et si oui pour quels profits ? On peut aussi voir cela comme une logique d’exploitation, et c’est en ce sens que le chercheur Ian Bogost parle d’« exploitationware ». Cette tendance – exploiter le joueur comme producteur de contenu non rémunéré – est en effet présente dans l’industrie du jeu vidéo. Toute la vogue des mods 3 pousse ainsi les joueurs à produire des contenus qui bénéficient avant tout au producteur ou au développeur du jeu original, sans aucune rétribution pour le joueur. Alors oui, c’est très bien si la recherche peut mettre à profit des centaines de milliers de joueurs pour résoudre un problème, mais il faudrait examiner les moyens de redistribuer équitablement les profits, matériels ou non, de l’implication des utilisateurs.

Cela rappelle le concept plus général de digital labor, où les utilisateurs de services internet produisent des données, de la connaissance, de l’optimisation logicielle sans que jamais cela soit pensé comme un travail…
Exactement. Vous vous retrouvez de fait employé, à consacrer du temps et de l’énergie à la production de savoirs, à la résolution de problèmes, sauf que vous n’êtes pas payé pour ça. On vous incite plutôt à le faire dans le cadre de vos loisirs, en vous promettant du fun et en vous promettant que c’est pour le bien commun. Sauf que ces recherches pourraient très bien profiter à une industrie pharmaceutique ou à une quelconque entreprise qui n’est pas dans une optique de redistribution pour l’intérêt général. Encore une fois, une réflexion sur l’éthique et la critique de la gamification est nécessaire, et le monde académique doit jouer son rôle, en favorisant la prise de recul et en questionnant ces logiques. Ceux qui font commerce de la gamification ont déjà suffisamment de puissance de communication pour la plébisciter. Il faut bien qu’il y ait un contrepoids, et la recherche, quand elle arrive à se dégager de certaines logiques néolibérales qui ont tendance à la traverser de nos jours, est là pour apporter ce regard critique.
Vous avez été vous-même game designer chez Ubisoft avant de devenir chercheur…
J’ai une expérience dans l’industrie des jeux vidéo, et à l’époque déjà, je percevais dans ce secteur des enjeux qui échappaient au discours dominant. Aujourd’hui, j’essaye de lier mes préoccupations de recherche à mon expérience de développement de jeux. Je continue à faire du jeu expérimental, j’ai créé un jeu gratuit que je qualifie d’« expressif », c’est-à-dire en lien avec des problématiques sociales et psychologiques, ancré dans la « réalité ordinaire ». Le jeu parle de maltraitance de l’enfance et du rapport entre un enfant devenu adulte et son père, où le joueur doit faire des choix entre le pardon, la condamnation, l’explication qu’il donne de ses actes, etc. Je crois vraiment que le jeu vidéo est une forme d’expression à part entière, comme le cinéma ou la bande dessinée. Aujourd’hui, les jeux les plus pratiqués par le grand public, les blockbusters, parlent très peu de la réalité quotidienne. Il faut pour cela aller chercher dans la sphère des jeux indépendants, qui demeurent minoritaires.

Ce qui m’intéresse à présent, c’est de pouvoir parler dans le jeu de sujets aussi graves et sensibles que la misère sociale ou l’atteinte à l’enfance. Je cherche à aborder dans une perspective ludique des sujets qui risquent de faire sortir le joueur de l’attitude ludique, et c’est pour cela que je préfère parler de « playfication » ou « ludicisation » plutôt que de gamification. Jouer permet de prendre une décision parmi un champ de possibles. Mais comment permettre au joueur d’avoir une posture réflexive sur les conséquences de ses actions avec des sujets qui risquent le faire sortir du cadre ludique ? On se pose alors les mêmes questions que dans la gamification, mais ici, il n’est pas question d’attribuer simplement des points au joueur. Le jeu expressif ne cherche pas à imposer une réponse toute faite à une situation problématique, mais à faire découvrir l’ensemble des possibles que comporte cette situation pour qu’il puisse y réfléchir et apporter ses propres solutions. Tout un ensemble de jeux issus de la scène indépendante me semble aujourd’hui répondre à cette qualification. On peut par exemple prendre le cas d’un jeu comme Cart Life, qui présente le quotidien d’un immigré aux États-Unis et qui nous permet de faire face à ses choix de tous les jours pour survivre, se nourrir, se loger, etc. Ou encore plus récemment That Dragon Cancer, où le joueur prend la place d’un père qui s’occupe de son nouveau-né malade. Tout en s’ancrant dans des thématiques qui sont habituellement extérieures au domaine ludique, ces productions me semblent montrer toutes les promesses du jeu comme forme d’expression.
Pour aller plus loin :
La chaîne Youtube de Sébastien Genvo.
- Il suffit de voir comment fonctionnent les consoles de dernière génération pour s’en rendre compte, avec par exemple des obligations de connectivité en ligne très forte pour mieux contrôler les accès et analyser les usages. ↩
- Le jeu en ligne massivement multi-joueur (MMOG, de l’anglais Massively Multiplayer Online Game, parfois encore abrégé en MMO) est un genre de jeu vidéo faisant participer un très grand nombre de joueurs simultanément par le biais d’un réseau informatique ayant accès à internet. ↩
- Modifications et ajouts apportés par les utilisateurs au jeu d’origine. ↩