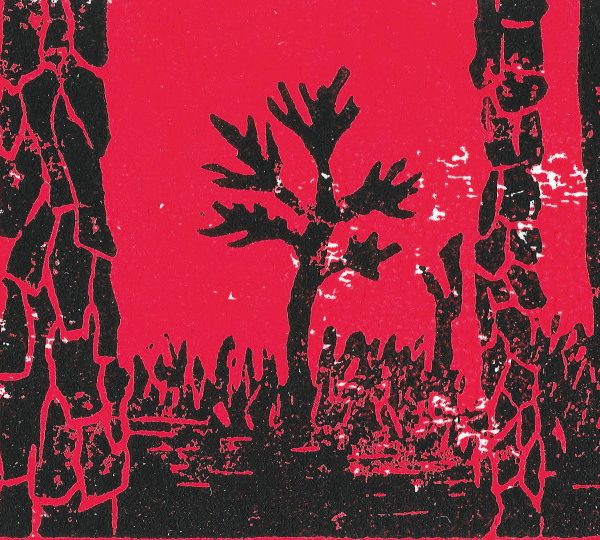Photographies : L. Dumont et M. Pastor.
Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 agit comme un puissant révélateur des inégalités sociales. Aux États-Unis elle s’articule notamment à la crise du logement que connaît le pays depuis de nombreuses années: la spéculation immobilière, la gentrification et la flambée des loyers ont conduit à une explosion du nombre de sans-abri ces dernières années. La crise sanitaire et les pertes d’emploi qu’elle a entraîné a mis de très nombreux⋅ses locataires dans l’impossibilité de payer leur loyer. Face à des mesures insuffisantes de la part des pouvoirs publics, les appels à la grève des loyers se sont multipliés, et les mobilisations autour des questions de logement ont nourri la dynamique existante des syndicats de locataires dans plusieurs grandes villes.
Entretien avec Lexie Cook, de l’université Columbia à New York, et avec Lenora Hanson, de l’université de New York (NYU).
Que s’est-il passé sur les campus universitaires quand la pandémie a démarré ?
Lexie Cook : Lorsque la pandémie a commencé à New York, le campus de Columbia a fermé, et les activités pédagogiques ont été transférées en ligne. L’université a alors envoyé une série de messages délibérément ambigus pour encourager les étudiant⋅es à quitter leur logement universitaire, au nom du risque sanitaire et de la densité de population sur le campus – il est aussi très étendu, Columbia est quasiment une ville dans la ville. Aucun ordre d’expulsion n’a été donné explicitement, mais la plupart des étudiant·es sont parti·es en interprétant les signaux de l’université comme une évacuation ou comme une expulsion, selon les points de vue. L’université est partie du principe que tou·tes avaient un endroit où aller, alors que ce n’est pas le cas : environ un·e étudiant·e sur six est sans logement propre aux États-Unis 1.
Ce premier moment a effrayé tout le monde, car l’université mettait tout simplement ses étudiant⋅es à la porte au beau milieu d’une crise sanitaire et d’un confinement général de la population. Cela nous a mis la puce à l’oreille sur une chose que nous aurions probablement dû anticiper mais à laquelle nous ne nous attendions pas dans ces proportions : Columbia se préparait à tirer avantage de la crise. L’université a agi comme n’importe quel mauvais propriétaire, et a profité du contexte pour imposer ou renforcer des mesures d’austérité. Elle a justifié ces mesures par les « difficultés financières » qu’elle rencontrerait, la perte de revenus liée à la crise, et la potentielle réduction du fonds de dotation.
Après avoir incité les étudiant·es à quitter leur logement, l’université s’en est prise aux doctorant·es, qui sont en grande partie aussi chargé·es de cours. Dans le département auquel je suis rattachée, les doctorant·es savaient déjà qu’iels ne pourraient pas payer leur loyer pendant l’été, pas seulement à cause de la pandémie, mais aussi parce que leur salaire estival ne couvre pas les frais de loyer – ou de justesse, quand il ne disparaît pas tout simplement après cinq ans de thèse. C’est un problème qui ne date pas d’hier, qui n’est pas propre à Columbia, et sur lequel nous avons tenté de négocier à plusieurs reprises par l’intermédiaire des syndicats professionnels. Cette situation est malheureusement normalisée, à tel point que tous les étés les doctorant·es sous-louent leur appartement pour aller dans des endroits où les loyers sont moins chers, ou trouvent un second emploi. Cet été, c’est encore plus compliqué, puisque nous ne savons pas dans quelle mesure il sera possible de sous-louer son logement, de se déplacer, ou de trouver du travail.
Lenora Hanson : Il s’est passé une chose similaire à NYU. Certain·es doctorant·es bénéficient de logements universitaires, et de nombreux⋅ses étudiant⋅es habitent dans des appartements partagés ou des dortoirs. Au début de la pandémie, l’université leur a demandé de quitter ces logements sans réelle explication – personne ne comprenait vraiment qui devait partir et qui était autorisé à rester. Une des raisons qui a été donnée était la nécessité de libérer les dortoirs pour le personnel médical qui venait en renfort dans les hôpitaux, mais au final cela n’a fait que mettre en lumière la gouvernance très verticale de l’université et renforcer des problèmes qui existaient déjà de longue date.

Quelle était la situation sur les campus pendant la suite de la pandémie ?
Lexie : La plupart des étudiant·es a quitté le campus. Certain·es ont fait une pétition et ont obtenu l’autorisation de rester. Nous avons recueilli beaucoup de témoignages d’étudiant·es parti⋅es en catastrophe, qui dorment sur les divans de connaissances, qui n’ont pas d’endroits pour rentrer « chez eux » ou qui ne peuvent pas revenir dans leur famille, parce que leurs proches sont âgé⋅es ou immuno-déficient⋅es.
La situation est un peu différente pour les doctorant·es. La plupart d’entre nous vit en appartement individuel. Nous avons rapidement alerté l’administration de l’université pour demander des aménagements du paiement des loyers. Columbia a d’abord refusé de discuter avec nous collectivement, et exigé que nous témoignions individuellement de nos difficultés financières auprès de nos professeur·es et directeur·ices de recherche, en disant que l’université allait ensuite traiter ces problèmes au cas par cas. Des demandes de prolongement de bail jusqu’au mois de juin sont restées sans réponse. La personne à qui j’ai sous-loué mon appartement est restée coincée au Pérou parce que les frontières ont été fermées, entre-temps j’avais quitté New York et j’ai maintenant deux loyers à payer. Il y a énormément de situations différentes, beaucoup de doctorant·es ont un·e conjoint·e qui a perdu son emploi.
L’université a finalement proposé une exonération des frais de fin anticipée du bail, et une aide pour quitter notre logement qui se traduit par le financement d’une toute petite partie du déménagement et la mise en contact avec des déménageurs ou des garde-meubles. En d’autres termes, la réponse a été : partez. Aucun effort n’a été fait pour nous permettre de rester chez nous, alors que c’était le problème principal de la crise sanitaire, et le but du confinement. C’est une sorte d’expulsion en douceur. Et par-dessus le marché, leur proposition consistait à reporter le risque sanitaire que nous encourions en déménageant sur d’autres personnes.
Lenora : À NYU, des groupes d’étudiant·es se sont mobilisés et ont rencontré l’administration de l’université. Iels ont demandé un remboursement des frais de scolarité et des frais associés au logement. La plupart d’entre elleux sont parti⋅es, et l’université a laissé deux dortoirs disponibles pour les étudiant·es resté⋅es sur le campus. Après leur départ, NYU les a contacté·es pour leur dire qu’iels devaient revenir sur le campus et reprendre leurs affaires, ce qui était à la fois ridicule et dangereux sur le plan sanitaire. Les étudiant⋅es ont immédiatement répondu et fait reculer l’université là-dessus. Elle a finalement annoncé qu’elle mettait en place un système de stockage des affaires des étudiant·es.
Rapidement, l’administration a pris des décisions pour faire en sorte que les profits que retire l’université des frais de scolarité et de logement perdurent. NYU ne bénéficie pas d’un fonds de dotation aussi important que celui de Columbia, l’université est donc beaucoup plus dépendante financièrement de ces rentrées d’argent. C’est là qu’elle puise l’essentiel de ses revenus et c’est ce qui l’autorise à accumuler de la dette et à étendre ses opérations financières, tant en termes de recrutement du personnel qu’en termes d’extension de son patrimoine immobilier.
Pourquoi la question du logement est-elle un enjeu si important pour ces universités ?
Lexie : Le fait que certaines universités américaines, dont Columbia et NYU à New York, soient de très gros propriétaires terriens, et qu’elles possèdent énormément d’immeubles est une composante essentielle de ce qui est en train de se passer sur plusieurs campus. C’est même plus que ça : pour ce que l’on appelle les landlord universities 2, c’est-à-dire les universités dont la richesse est en grande partie fondée sur l’immobilier, les enjeux principaux de leur organisation à long terme comme de leur gestion de la crise causée par la pandémie sont liés à la spéculation immobilière.
Lenora : Avant d’être une institution d’enseignement, NYU est surtout un très gros propriétaire immobilier, l’un des plus importants de la ville de New York. Tou·tes les locataires de NYU ne font pas partie de l’université : certain·es ne sont pas étudiant⋅es et ne font pas partie du personnel universitaire. Lorsque l’université a acheté une partie du quartier de Washington Square il y a une trentaine d’années, il y a eu beaucoup de mécontentement parmi les habitant·es. Certain·es d’entre elleux sont resté⋅es dans leurs appartements, qui appartiennent maintenant à NYU. Le parc immobilier de l’université est donc assez divers : il comprend aussi des commerces, les bâtiments d’enseignement, des résidences, universitaires ou non…
De manière générale, NYU utilise son offre immobilière pour attirer les enseignant·es et les étudiant⋅es, c’est un de leurs arguments commerciaux. D’abord parce que faire partie de l’université donne la possibilité de vivre à New York, ce qui est très convoité. Ensuite parce que l’université est située dans un quartier d’ordinaire totalement inaccessible parce que le coût du logement y est extrêmement élevé.
Avant la crise financière de 2008, NYU finançait une grande partie du logement des enseignant·es. Mais après l’écroulement des marchés immobiliers, l’université a réduit sa participation. Ce sont donc les enseignant⋅es qui ont dû prendre en charge une part plus importante des loyers, et le fait de vivre près de l’université. Or il est de moins en moins possible de payer les frais de logement avec un salaire de « simple » enseignant·e. Mon immeuble, par exemple, doit être évalué à 9,8 millions de dollars. Nous demander de prendre en charge une partie toujours plus importante des logements sur le campus en diminuant l’investissement de l’université est un moyen pour celle-ci de maintenir la rentabilité de l’opération immobilière.
La mobilisation autour du logement est un gros enjeu parce que la richesse immobilière de NYU et Columbia est gigantesque, ce qui n’est pas si fréquent même parmi les universités les plus riches. Le modèle capitaliste de ces universités fait qu’elles se sont énormément endettées pour gagner toujours plus d’argent : sur les frais de scolarité, sur leurs nouveaux investissements immobiliers, etc. Le cas de NYU est aussi très particulier parce que l’université s’étend maintenant à un niveau international en ouvrant des campus un peu partout dans le monde 3. Ce modèle est très inquiétant car cela ne fait qu’accentuer la financiarisation de l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, beaucoup de personnes craignent que des universités ferment leurs portes parce qu’elles ne seront pas en mesure de payer les intérêts sur les dettes qu’elles ont contractées pendant les dernières années, du fait du nombre réduit d’inscriptions universitaires pour l’année prochaine. Aux États-Unis, il pourrait tout à fait y avoir une vague de fermeture d’universités et de départements de recherche, qui va épargner seulement les établissements les plus riches et les disciplines déjà privilégiées.

Quelles actions politiques avez-vous envisagées pour faire face à cette situation ?
Lexie : Avec un groupe de doctorant·es, nous avons tout de suite envisagé de faire une grève de loyers. Plusieurs d’entre nous sommes aussi militant·es syndicaux⋅ales, mais les syndicats ne nous sont pas apparus comme le meilleur moyen de porter cette lutte. D’une part nous tenions à impliquer l’ensemble des locataires de Columbia – pas seulement les étudiant⋅es, les enseignant⋅es ou le personnel administratif syndiqué⋅es, mais aussi des locataires disséminé⋅es dans la ville – et d’autre part, nous voulions que cette action s’inscrive dans la vague d’appels à la grève de loyers qui était en train de se lancer à New York. Dans le même temps, nous ne voulions pas avoir affaire aux problèmes juridiques que rencontrent les syndicats, parce qu’ils sont limités dans les moyens d’action qu’ils peuvent officiellement soutenir.
L’idée initiale, c’était de rassembler nos revendications pour régler ce problème de loyers, mais aussi pour combattre les manières dont la crise financière est utilisée comme argument pour protéger les propriétaires, mettre en place ou prolonger des politiques d’austérité et s’en tenir à des mesures comme les moratoires contre les expulsions, qui ne font que repousser le problème. Le fait d’allier ces combats, c’est aussi une manière de pousser Columbia à redistribuer son immense richesse, à arrêter de gentrifier le quartier de l’université et à rendre des comptes à ses travailleur·euses et à ses étudiant·es. Le projet politique de la grève est donc relativement large, et ceci notamment parce que Columbia fait partie des dix plus gros propriétaires de la ville de New York – c’est même le deuxième propriétaire en termes de nombre d’adresses, après la ville elle-même 4…
En plus de cette centralité de la question du logement, l’université a menacé, dès le début de la pandémie, de mettre fin aux contrats d’enseignement de doctorant·es précaires. Cela signifie qu’iels peuvent perdre leur emploi et leur assurance maladie, et qu’iels devront en plus payer des frais d’inscription exorbitants pour terminer leur thèse. Donc nous avons décidé d’ajouter à la grève des loyers une grève des enseignements.
La situation des étudiant·es et des doctorant·es étranger⋅es, qui sont très nombreux⋅ses, est particulière dans ce paysage : iels sont très exposé⋅es, mobilisé⋅es et souvent dans des situations précaires. Une grande partie d’entre elleux n’est pas à l’aise avec l’idée de ne pas payer son loyer, car cela pourrait les mettre dans une situation très délicate vis-à-vis de leur statut d’immigration.
Lenora : À NYU, nous nous sommes organisé·es entre enseignant·es pour faire une grève de loyers. Certain·es d’entre nous étaient déjà impliqué·es dans des réseaux d’entraide, dans lesquels nous discutions de la possibilité de se coordonner avec des personnes vivant à Brooklyn ou dans le Queens. Nous avons donc réfléchi à des manières de soutenir les appels à la grève des loyers qui circulaient à New York, pour faire en sorte que cette grève se fasse à l’échelle de la ville et qu’elle ne concerne pas uniquement les personnes les plus vulnérables. Cela implique de mobiliser les personnes en capacité de payer par solidarité avec celles qui ne le peuvent pas. La clé de cette grève de loyers est de l’étendre à des endroits où on ne l’attend pas.
La croyance généralement répandue est que les enseignant·es de l’université sont riches et que par conséquent le paiement du loyer ne leur pose aucun problème, mais ce n’est pas vrai. D’abord parce que la plupart des enseignant⋅es commencent leur carrière avec d’énormes prêts étudiants à rembourser. Ensuite parce que beaucoup d’entre nous ont un·e partenaire qui a un emploi parfois précaire et/ou des enfants qu’il faut faire garder, ce qui est très cher à New York.
Notre grève est donc une grève en solidarité avec les étudiant⋅es, les doctorant·es et les enseignant·es contractuel·les qui ne peuvent pas payer leur loyer dans les mois à venir. Nous avons également mis en place un réseau d’entraide avec l’argent récolté par la grève, afin de constituer une caisse de solidarité pour les étudiant⋅es et les doctorant⋅es, pour l’assurance santé ou tout ce dont iels auraient besoin.
Comment avez-vous organisé ces grèves de loyers ?
Lexie : Nous avons créé récemment une association nationale, UWUFF (University Workers for a Fair Future), sur laquelle nous nous appuyons actuellement. Elle accueille tous les statuts universitaires (des enseignant⋅es titulaires et non titulaires, des étudiant⋅es américain⋅es et étranger⋅es…). Avec cette association, nous essayons de combattre toutes les mesures d’austérité qui sont imposées actuellement dans les universités. Cela concerne les universités publiques en premier lieu, parce que ce sont elles qui souffrent le plus directement de la crise, via les coupes budgétaires. Pour les universités privées comme Columbia, ce déficit est totalement artificiel.
Pendant la pandémie, à Columbia, nous avons formé un collectif, CU People Covid Response. Ce dernier rassemble beaucoup de militant·es syndicaux⋅ales et des étudiant·es qui viennent principalement des filières du travail social et de médecine. Avec ce collectif, nous avons deux objectifs : organiser une grève de loyers qui ait de l’ampleur et porter les revendications liées à l’emploi universitaire et aux droits des étudiant⋅es.
Nous discutons avec beaucoup de militant·es autour du logement et des mobilisations de locataires. Nous sommes également en lien avec le groupe des Démocrates Socialistes (DSA) qui se situe à la gauche du parti démocrate et qui est très présent sur les appels à la grève des loyers en ce moment. Aucun·e d’entre nous n’avait vraiment d’expérience sur les questions de logement. Mais en ce moment, il y a une tonne de formations en ligne, de brochures proposées par les organisations, de groupes de discussion. On essaie de suivre tout cela du mieux qu’on peut, et cela nous permet de nous coordonner avec les autres collectifs.
Nous avons commencé par faire passer un questionnaire, parce que nous ne savions pas vraiment combien de personnes étaient restées dans les logements de la fac, quelle était leur situation par rapport au paiement des loyers, s’iels étaient en capacité de payer ou non, etc. En recueillant ces informations, nous avons ouvert la discussion sur la possibilité de mettre en place une grève de loyers, pour essayer de comprendre qui serait intéressé pour y participer. Nous savons maintenant qu’une grande partie des étudiant·es et doctorant·es ne pourra pas payer son loyer. Entre vingt et trente doctorant·es sont impliqué·es à plein temps dans l’organisation de cette grève. Le groupe de personnes mobilisées s’est élargi à différents statuts et différents groupes qui s’occupent de tâches spécifiques – lien avec les médias, réseaux sociaux, recherche dans les finances de l’université, organisation avec les locataires…
Lenora : Beaucoup d’étudiant·es et de doctorant·es se sont organisés très rapidement, en particulier à travers ce qui s’appelle à présent la « Covid coalition ». Iels ont rapidement souligné qu’iels n’avaient aucun pouvoir sur leur situation résidentielle à NYU, aucune information, et demandé à récupérer l’argent de leur loyer pour ce semestre, dans la mesure où on leur avait demandé de quitter leur logement. La lutte porte maintenant sur le fait de savoir si, comment et quand NYU va leur rendre cet argent. Bien évidemment, l’université ne veut rien lâcher.
Du côté des enseignant·es, nous avons également réalisé une petite enquête pour essayer de comprendre quelle place occupait le logement dans leur budget. Nous avons immédiatement reçu plus d’une soixantaine de réponses, accompagnées de récits sur les difficultés financières rencontrées par chacun·e. La plupart a du mal à payer son loyer, généralement à cause de crédits contractés plus tôt ou des frais pour les gardes d’enfants, ou parce que le ou la conjoint·e a perdu son emploi. Même si nous ne faisons pas partie des plus vulnérables, nous rencontrons les mêmes problèmes que l’ensemble de la population dans le contexte de la pandémie.
Au total, il y a environ 2 000 logements d’enseignant·es qui pourraient être concernés, mais seule une quarantaine de personnes est active dans cette mobilisation pour le moment. Nous voulions démarrer la grève au 1er mai, mais nous avons été pris·es de court par les prélèvements automatiques. La première étape a donc été de stopper ces prélèvements.
Une des barrières les plus importantes que nous rencontrons est qu’une grande partie des enseignant·es estime ne pas être dans une difficulté matérielle assez grande pour justifier cette grève de loyer. Nous essayons donc de les convaincre que l’enjeu de cette mobilisation est d’être un plus grand nombre possible. C’est beaucoup de travail d’argumentation : il faut faire comprendre que la réussite de la grève ne tient pas uniquement aux difficultés matérielles ou financières des individus mais qu’elle doit être un mouvement de masse en faveur de la justice sociale. La difficulté est d’amener les gens à se mobiliser autour d’un sujet par lequel ils ne se sentent pas immédiatement concernés.
C’est un problème structurel, qui est aussi lié à un ethos professionnel et individuel bourgeois : même si nous travaillons au même endroit et vivons à proximité les un·es des autres, tout notre travail est très individualisé et nous avons peu d’échanges avec nos collègues et voisin·es. Il nous faut donc construire ces relations et les séparer au maximum de nos positions professionnelles.
Nous sommes en contact avec plusieurs associations, comme le syndicat de locataires de Crown Heights qui se mobilise sur ces questions à grande échelle. Sur le plan juridique c’est assez informel, nous utilisons les réseaux proches de nous, les brochures en ligne, etc.

Quelles ont été les réponses des universités jusqu’à présent ? Comment justifient-elles leur position ?
Lexie : Le statut fiscal de Columbia lui permet de ne pas payer d’impôts sur le patrimoine sur l’ensemble de ses immeubles. Or l’université avance que ses propriétés lui coûtent cher pour justifier le refus de toutes nos demandes.
L’un des arguments de Columbia est de dire que les questions de logement sont indépendantes de la gestion de l’université, et qu’il est impossible pour elle de négocier avec qui que ce soit à ce sujet. Il y a un discours totalement fictionnel sur la séparation du logement et de l’université comme institution pédagogique.
Il faudrait que Columbia puisse justifier de son incapacité à exercer une pression sur ses financeurs. Or grâce à nos recherches dans l’historique des finances de l’université, nous savons que ses finances sont solides. Les seules restrictions dont l’université fait l’objet pour utiliser cet argent, ce sont celles des Trustees 5.
Les stratégies et les arguments sont toujours les mêmes : l’université soutient que les départements disposent de leurs propres finances et que personne dans le haut de la hiérarchie ne peut intervenir.
Nous avons longtemps cru à tout cela, mais plus nous avançons dans nos recherches et plus nous comprenons à quel point c’est faux. Le type de restructuration financière que nous réclamons ne peut venir que des hautes sphères de la gestion de l’université. Le problème, c’est que les Trustees sont un peu comme le Magicien d’Oz : iels prennent des décisions mais ne sont jamais tenu·es de nous rendre des comptes, on ne les voit pas, on n’a aucun moyen de communiquer avec elleux, c’est la présidence qui contrôle les informations qui leur arrivent… et une grande partie d’entre elleux sont des gros poissons de Wall Street. Iels ne sont donc pas vraiment réceptif⋅ves aux arguments liés à la redistribution des richesses, aux discussions sur les inégalités sociales et économiques ou à la responsabilité de l’université envers ses étudiant⋅es et ses travailleur⋅ses.
Sur la question du logement, ce que l’université propose, c’est de mettre fin au paiement des loyers… sous réserve que l’on quitte les logements. Cela revient à nous mettre dehors. Une certaine pression est mise sur les doctorant⋅es et les personnels, qui consiste à dire : en tant qu’employeurs, nous connaissons votre niveau de vie donc nous savons que vous pourriez payer votre loyer et pour cette raison on ne fera aucune exception, quelles que soient les conséquences de la crise.
Lenora : Les problèmes que nous rencontrons et que nous abordons aujourd’hui sont des problèmes structuraux, et les arguments mobilisés par l’université face à cela sont toujours financiers. À NYU, les doctorant·es ne sont pas payé⋅es pendant l’été, leur bourse s’étend seulement sur neuf mois, donc iels ont du mal à payer leur loyer durant cette période – qu’iels soient logés par l’université ou non. Une grande partie d’entre elleux quitte la ville pendant l’été pour échapper à cette situation. Cette question, et de manière générale la précarité financière dans laquelle se trouvent les doctorant·es de l’université font partie des revendications du syndicat de doctorant·es. Cette année, les enseignant·es en voie de titularisation (tenure track) ont obtenu une extension d’un an pour soumettre leur dossier, mais rien de tel n’a été fait pour les doctorant·es, qui doivent finir leurs examens ou leur thèse avec le même calendrier que d’habitude. Iels demandent donc à ce que leur financement puisse également être étendu d’un an. L’université leur a répondu que ce n’était pas possible, qu’elle ne peut pas payer un prolongement des contrats doctoraux ni rembourser les frais de scolarité, parce que cela lui coûterait trop cher.
Pour changer cela, il faudrait aussi revenir sur toute la politique de l’université contre la syndicalisation des doctorant⋅es. NYU pousse pour que tou·tes soient considéré·es comme des chargé·es de recherche (fellows) plutôt que des chargé·es de cours (teaching assistants), ce qui les rattache à la recherche et non à l’enseignement, et leur interdit de se syndicaliser. Cela complique la mobilisation à long terme, et le choix de l’université de se tourner vers un modèle de recherche plutôt que d’enseignement est un facteur important.
Le logement à NYU est également une problématique de fond. Les doctorant·es ne peuvent pas payer leur loyer sur la base de leur financement de thèse, ce qui est absurde. Comme pour d’autres problèmes de long terme, la pandémie n’a fait que les rendre encore plus visibles.
Est-ce que la mise en place d’une grève de loyers est risquée pour les enseignant⋅es ou les doctorant⋅es ?
Lenora : D’après les avocat·es que nous avons consulté⋅es, il n’y a pas vraiment de précédent à cette situation, ce qui signifie que l’on s’expose à des représailles de la part de notre employeur parce que nous sommes aussi ses locataires. Nous ne savons donc pas exactement ce qui pourrait se passer, mais a priori il semblerait plus probable que NYU agisse qu’en tant que propriétaire et non en tant qu’employeur.
Nous ne faisons pas face à des dangers immédiats, parce qu’il y a un moratoire en cours à New York qui nous protège pendant trois mois 6, et parce qu’en nous appuyant sur la caisse de solidarité, nous avons de quoi payer. C’est aussi une des raisons pour lesquelles il est difficile de comprendre qu’il y ait si peu de personnes impliquées dans la grève.
En tant qu’enseignant·es, on peut nous refuser des postes ou une titularisation sans nous donner d’explication, et nous ne pourrons que spéculer sur le fait que c’est lié à cette mobilisation. Le problème qui peut se poser porte plutôt sur ce que nous souhaitons faire de l’argent mis de côté pendant la grève : le donner à des réseaux d’entraide, le réserver pour les doctorant⋅es, le partager avec celleux d’entre nous qui ne pourront vraiment plus payer leur loyer ? Ce sont des discussions à avoir.
La différence avec une grève des loyers « traditionnelle » est que nous voudrions aussi que NYU annule les loyers et l’augmentation de loyers qui a lieu tous les ans au début de l’été.
L’enjeu de cette mobilisation, c’est aussi de requalifier les loyers comme une lutte contre la reproduction sociale. Donc de ne pas se limiter à savoir si l’on est ou non en capacité de régler son loyer, mais plutôt de se demander ce que cela signifie de le payer quand on est endetté⋅e et qu’on a peine à élever ses enfants. J’ai bon espoir que cette grève puisse déplacer la question de la capacité individuelle à payer vers une reconnaissance plus grande du rôle joué par les locataires dans un monde capitaliste entièrement construit sur la dette.
- Voir par exemple Patrick Sisson, « Coronavirus College Closures Leave Students Unsure About Housing », Curbed, mars 2020, disponible sur <curbed.com>. ↩
- Voir « Time To Evict The Landlord University », The File, mars 2020, disponible sur <thefilemag.org>. ↩
- L’université de New York possède une douzaine d’antennes dans le monde et a ouvert des sites à Paris, Abu Dhabi et à Shangai ↩
- Aleksey Bilogur, « Who Are the Biggest Landowners in New York City? », <residentmar.io>, mai 2016. ↩
- Les Trustees, qui sont présent·es dans les plus hautes instances de la gestion des universités, sont les représentant·es des sociétés fiduciaires responsables de la gestion du patrimoine de l’université. ↩
- Le moratoire sur les loyers à New York se termine le 20 août 2020. ↩