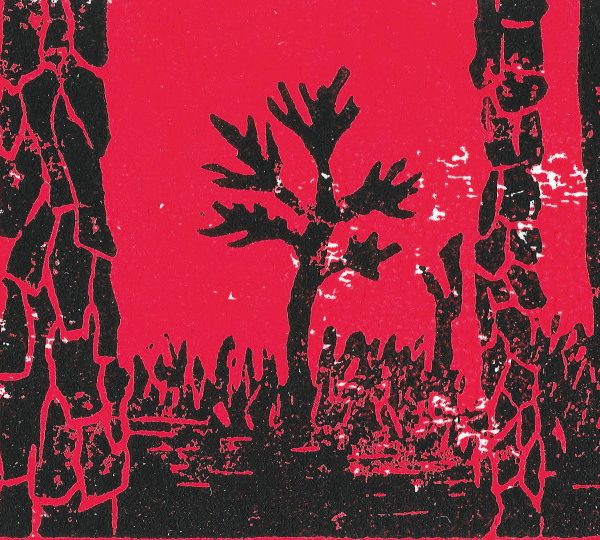Photographies par Ahmad Ebrahimi
Ouvert en 2013 sur l’île de Lesbos en Grèce sur le site d’une ancienne base militaire, le camp de Moria accueille et retient les réfugié·es qui cherchent à rejoindre l’Europe. L’un des cinq centres d’enregistrement et de contrôle situés en mer Egée, il se double d’un centre de détention, témoignant d’une gestion sécuritaire et d’une criminalisation de ces migrations. Coercition, détention arbitraire, expulsions, refoulements massifs et violations des droits fondamentaux sont au rendez-vous. Prévu pour loger 3 000 personnes, on dénombre en janvier 2020 plus de 20 000 personnes vivant à l’intérieur du camp et à ses abords.
En septembre 2018, Clément Aadli, Adrien Chevrier et Amélie Perrot mettent en place des ateliers de radio hébergés dans un accueil de jour situé en marge du camp. Emportant des enregistreurs avec elles et eux, les participant·es des ateliers racontent, interviewent d’autres habitant·es, captent la vie du camp et inventent leur radio (voir à ce sujet la première partie de cette publication, « Une radio face au camp de réfugié⋅es de Lesbos »). À l’heure où la crise du coronavirus et le défaut de protection sanitaire les vulnérabilisent encore davantage, retour sur le parcours de quatre réfugiés de Moria, partis d’Iran, du Cameroun ou d’Afghanistan. Portraits.
Note des auteur·ices :
Au moment des ateliers de radio et dans les mois qui ont suivi, certaines des personnes que nous avons rencontrées à Lesbos nous ont livré des témoignages sur leurs vies et leurs parcours. Ces témoignages ont été enregistrés, puis retranscrits et traduits. Nous les partageons ici, bruts dans leurs mots et leurs contenus, car nous pensons qu’ils disent une part de l’insupportable multiplicité des drames qui se lancent à la mer. Ces témoignages ne prétendent pas être représentatifs, ce serait d’ailleurs impossible. Il n’y a malheureusement pas de femme parmi ces quatre voix mais elles sont très nombreuses à Lesbos. Assurément ce travail est à poursuivre. L’identité de ces témoins n’est due qu’au hasard de nos rencontres. Nous remercions très chaleureusement Mehdad, Alain Serge Soh, Ahmad Ebrahimi et Anoosh Ariamehr.
Mehdad
Je m’appelle Mehdad. Je suis né en 1978, dans le centre de l’Iran, près de la ville d’Isfahan, à 500 kilomètres au sud de Téhéran. C’est là que j’ai grandi. J’aimais cet endroit, mais comme j’ai aimé d’autres endroits à travers le monde. Je suis né six mois avant cette révolution idiote. Peut-être la révolution la plus idiote qui ne se soit jamais produite dans le monde. Mon enfance s’est déroulée durant les années de la guerre entre l’Iran et l’Irak. Cette guerre m’a rendu malheureux… La dictature, la censure, les exécutions. Le régime exécutait toutes les personnes qui s’opposaient à lui. Les exécutions étaient très nombreuses. Beaucoup de gens sont morts, ont perdu leur famille, ont perdu leur maison, leurs affaires. C’est une période très douloureuse. Isfahan possédait les plus grandes raffineries du pays et les avions de guerre les visaient. Ma maison était proche de ces installations. Quand nous entendions les sirènes des bombardements, nous ne savions jamais où nous réfugier. Nous n’avions pas d’abri pour les bombardements. Les explosions nous réveillaient la nuit. Tous les jours, des gens mourraient. Plus de 100 000 civils sont morts pendant la guerre et plus encore de soldats. Je me souviens des cercueils que l’on voyait partout. Le régime avait besoin de ces morts car il les appelait des « martyrs » (encore une chose idiote). Le régime, autant dire la dictature, était extrêmement violent. Enfant j’ai été très affecté par cette violence.
Les soldats du régime patrouillaient dans des pickups. Et puis il y avait les Gardiens de la Révolution qui réprimaient partout dans les rues. Si quelqu’un était surpris avec un blue-jean dans la rue, il était immédiatement arrêté. Le comité de la révolution islamique arrêtait, emprisonnait, torturait. Beaucoup de personnes sont mortes dans ces conditions.
Toutes les femmes qui portaient du maquillage, du rouge à lèvres ou du fard à paupières avaient des problèmes. À Isfahan, un homme était devenu célèbre parce qu’il torturait les femmes avec des punaises métalliques. On l’appelait Akbar-punaise… Si une femme était surprise avec ses cheveux découverts, même très peu, il lui plantait une punaise métallique dans le front. Si une femme portait du maquillage, en particulier du rouge à lèvres, il lui arrachait le maquillage avec une lame de rasoir et lui découpait les lèvres. J’ai grandi dans le contexte d’une propagande omniprésente. Les gens se battaient les uns contre les autres, ils étaient devenus extrêmement violents. La moindre objection pouvait être violemment réprimée.
Un jour, en 1993 ou 1994, mon frère portait un collier en or et à cause de ça des gens sont venus saccager la boulangerie de mon père, détruire les fenêtres, jeter les employés dehors. Nous sommes allés porter plainte au commissariat. L’officier de police ne s’est pas déplacé pour venir voir les dégâts ; il a battu mon frère pour le punir d’avoir porté ce collier. Dans l’islam, un collier en or est paraît-il arham (impur)… Il y a trop de problèmes et trop d’inégalités dans ce pays. Les inégalités dont souffrent les femmes sont insupportables et nous perdons la moitié de notre société. J’ai deux sœurs, une fille… Elles sont comme toutes les femmes du monde, en France, en Amérique, en Afrique, en Syrie, en Israël, en Palestine. J’aime ma fille et mes sœurs. Et puis, mon pays finance le terrorisme partout sur la planète. J’ai vu les images de cet homme qui a foncé sur la foule dans le Sud de la France il y a quelques années. J’ai vu les images sur YouTube et elles m’ont complètement dégoûté. Je ne proteste pas au nom d’une supposée positivité, mais parce que je considère que c’est mon devoir. C’est notre devoir de nous battre contre la violence, l’opportunisme, le despotisme et toutes les choses idiotes qui se passent sur la planète.
Pendant la guerre, mon père était vieux, il avait perdu la quasi-intégralité de son œil droit, il était devenu presque aveugle. Je l’aidais en m’occupant parfois de la boulangerie à sa place. La religion baha’ie n’a cessé d’être persécutée depuis 1978-1979. J’avais lu sur Telegram que le gouvernement était en train de fermer les boulangeries tenues par des adeptes baha’ie. Je suis allé au siège du syndicat des boulangers. Ils m’ont confirmé que la police était en train de fermer les magasins. Alors, je me suis rendu au poste de police. Ils m’ont dit qu’ils exécutaient un ordre de la Cour de justice. Je suis allé à la Cour de justice. Le premier jour, je n’ai pas pu voir le juge. Le jour suivant, après avoir attendu très, très longtemps, j’ai finalement pu le rencontrer. Je lui ai dit que j’étais boulanger. Je lui ai dit qu’il fallait absolument ordonner la réouverture de ces magasins, que ces gens souffraient, qu’ils étaient extrêmement pauvres. « Ça n’est pas votre affaire » m’a-t-il répondu. « Ils sont baha’ie. Ils sont impurs » a-t-il ajouté. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu’ils étaient impurs et je lui ai demandé à nouveau d’ordonner la réouverture des boutiques. J’ai ajouté que même en temps normal, ils ne gagnaient que peu d’argent, car ils n’avaient souvent pas pu rénover leurs boutiques, la municipalité le leur interdisant. « Ce n’est pas votre affaire. Dégagez » m’a-t-il répondu avec brutalité. Je lui ai répondu que je ne partirais pas, que je resterais jusqu’à ce qu’ils ordonnent cette réouverture. Il m’a insulté. C’était injuste à mon avis. Certaines personnes deviennent juges mais se comportent comme des gangsters. Il a appelé des gardes pour me jeter dehors. Alors, à mon tour, je l’ai insulté, lui et le régime. Et j’ai insulté l’islam et le Coran. Quatre ou cinq personnes sont arrivées, m’ont arrêté et jeté en prison. Je ne me suis pas arrêté. J’ai continué à crier, à les insulter. Je sais que c’était très grossier, mais c’était l’unique moyen que j’avais de répondre à leur violence. Il faut insulter la violence, les dictateurs. Il faut le dire et le crier.

Le soir-même, ils m’ont amené dans une prison spéciale. En réalité, ce n’est pas une prison. C’est le centre de l’Organisation de sécurité du Sepah (le corps des Gardiens de la révolution islamique). Plus tard dans la soirée, un agent est arrivé et a commencé à me battre. Il me frappait et je me suis dit que j’allais sans doute mourir dans cette cellule. Et puis je me suis dit aussi que j’aurais tout aussi bien pu mourir ailleurs, dans un accident de voiture ; des dizaines de milliers de gens meurent, chaque année, dans des accidents de la route. J’ai décidé… J’ai décidé en quelque sorte de me suicider : j’étais seul, personne ne me connaissait dans la prison, personne ne savait que j’avais été arrêté ; personne ne savait où je me trouvais, alors j’ai dit à cet agent : « Frappe-moi, frappe-moi bâtard. Ce sera la fin de tout ce que tu fais. » Il me frappait avec sa chaussure, me frappait au visage… J’avais le visage plein de sang… Je ne pouvais pas contrôler mon urine, je me suis uriné et chié dessus. Je pleurais. J’avais très, très peur et j’ai décidé de mourir. J’allais mourir, comme beaucoup d’autres gens meurent. Quelle est la différence entre quelqu’un qui meurt comme moi sous les coups et un homme qui, au même moment, meurt en Syrie ? Laisse-moi mourir. Je l’ai insulté : « Bâtard, c’est ce que que tu fais de mieux… C’est vraiment ce que tu peux faire de mieux ? Tu peux faire mieux ! Frappe-moi, frappe-moi plus fort ! » Je le regardais dans les yeux en l’insultant. Les gens ont peur quand on les regarde dans les yeux. Il me frappait et m’insultait. Je ne me souviens plus de la suite, j’ai probablement perdu connaissance. Je crois que je suis resté dans le coma plusieurs jours.
Après quatre ou cinq mois, personne ne savait où j’étais. J’étais dans les geôles du Sepah, dans le département de sécurité et personne n’avait été prévenu. On me battait tous les jours. Une fois, un soldat m’a ordonné de me déshabiller. J’ai refusé. J’ai répondu que je ne me déshabillerais pas. « Enlève ton caleçon » a-t-il ordonné. J’ai refusé une seconde fois. Il m’a mis la tête dans la cuvette à deux ou trois reprises, me tenant la tête immergé dans l’eau et les excréments. Ils ne m’ont pas autorisé à me laver le visage pendant dix jours.Vous savez, durant tous ces jours, je n’ai pas cessé de penser à la liberté… Je pensais à l’Histoire. Je pensais aux révolutionnaires français qui avait mêlé leur sang à l’eau de la Seine. Beaucoup de gens sont morts. Et durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens sont morts. Mais maintenant les Français peuvent crier dans les rues, ils peuvent s’embrasser dans les rues. Ce sont leurs droits et beaucoup d’innocents ont perdu la vie pour les faire respecter. Ces mois ont été très durs, mais je suis fier.
Mehdad s’est brutalement arrêté de parler. Il a posé la tête dans ses mains puis s’est levé, manifestement très ému. Nous avons arrêté l’enregistrement. Quelques secondes plus tard, il s’est rassi et a continué son récit au point où cette parenthèse sur la liberté l’avait en quelque sorte laissé.
Après quatre ou cinq mois, menotté, dont vingt jours dans une cellule sans fenêtre… Je ne savais même pas quel jour nous étions et depuis combien de temps je me trouvais enfermé… j’ai finalement été déplacé dans une autre cellule. J’ai demandé au soldat qui m’escortait : « Quel jour sommes-nous ? » Quand il m’a répondu, je n’ai pas pu le croire. J’étais là depuis cinq mois. Je pensais que cela faisait au moins deux ans. Ça a été tellement long… Parfois, il me réveillait en pleine nuit pour me poser des questions et me battre. Je ne voyais pas le lever du soleil. Tout était noir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Parfois, j’essayais de deviner l’heure en me fiant aux horaires auxquels ils m’emmenaient aux toilettes. Mais j’ai compris que les horaires n’étaient pas réguliers et changeaient sans arrêt : parfois huit heures du matin, parfois huit heures et demie, parfois onze heures… J’étais autorisé d’aller aux toilettes une ou deux fois par jour mais ils refusaient toujours de répondre à mes questions : quel jour sommes-nous ? quelle heure est-il ?
Je crois qu’on ne meurt qu’une fois. Si vous cédez à la peur, votre monde meurt avec vous. Je n’aime pas être déshonoré comme je l’ai été ; ça a été très dur, mais c’était le droit au futur. Si l’on voit de plus en plus de gens descendre dans les rues pour manifester, c’est parce que d’autres gens se sont entêtés. Notre peuple doit se réveiller.

Après cela, ils m’ont déplacé dans une prison régulière, la prison centrale d’Isfahan. Au total, j’ai passé un an et demi en prison. J’étais heureux parce qu’ils ne pouvaient plus me torturer comme ils le faisaient avant, mais, à l’isolement, j’ai été souvent battu. L’officier venait et me frappait. On ne me donnait pas le droit d’aller aux toilettes trois fois par jour. La plupart du temps, je souffrais de diarrhée et je devais déféquer dans le bol que j’utilisais pour manger. Puis, je le nettoyais pour manger. C’était très dur de manger et chier dans le même récipient. Je suis sorti très longtemps après. Au départ, ma famille n’en avait aucune idée. Ils ne savaient même pas que j’étais en vie. Ils pensaient que j’étais mort. Très vite, de nombreuses personnes avaient appris mon arrestation. Ils sont donc allés devant la Cour et un employé a dit à ma famille que j’étais mort. Et puisqu’ils n’étaient pas autorisés à récupérer mon corps ou à connaître l’endroit où j’avais été supposément enterré, ils ont organisé une cérémonie. Ils sont allés au cimetière et ont payé pour organiser une cérémonie d’enterrement. A l’isolement, j’ai pu demander à quelqu’un que je savais sortir bientôt d’informer ma famille. Mon oncle a versé une grosse somme d’argent et j’ai été libéré. J’avais commis un crime assez léger finalement.
J’ai été libéré en 2013. Le jour de ma sortie, j’étais sous le choc. J’ai franchi les douze portes de la prison. Douze portes. Ce jour-là, à chaque fois que je passais une nouvelle porte, je doutais davantage. Jusqu’à la dernière, la porte principale de la prison. Elle est plus grande que les autres. J’ai franchi cette dernière porte, sans rien. Je n’avais rien. Je n’avais pas d’argent. Je portais un pyjama, une paire de tongs et un t-shirt. À côté de la prison se trouvait un arrêt de bus. J’ai dit au chauffeur : « Je viens d’être libéré. Je n’ai pas d’argent. » J’étais intimidé, honteux. J’avais toujours été propre et élégant et je me retrouvais sans domicile, avec seulement un vieux pyjama et une paire de tongs. Mais j’avais cette chance d’être en vie, de voir le soleil, de voir des gens… Certains n’ont pas eu cette chance.
Ce n’est pas à ce moment-là que j’ai quitté l’Iran. Durant les quatre années qui ont suivi, j’étais très actif sur Telegram. Fin décembre 2017 des manifestations ont commencé et je téléchargeais sur Internet des documents expliquant comment combattre la police, comment combattre les sociétés de sécurité, puis je les partageais avec les manifestants. J’ai aussi préparé des bombes artisanales célèbres en Iran, les cocktails Molotov, et j’utilisais de l’essence de moteur pour faire déraper les voitures de police. Pendant quatre ou cinq jours, j’ai participé aux manifestations. Un jour, pendant une manifestation, j’ai été interpellé dans la rue, mais les personnes qui m’ont arrêté ne savaient pas qui j’étais, ni que j’étais déjà allé en prison. Elles m’ont contrôlé. J’étais terrifié. J’ai réussi à les duper et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé devant la boulangerie, j’ai croisé un de mes amis. Il m’a demandé où j’étais passé. Je lui ai expliqué que j’avais été arrêté et que j’avais eu tellement peur que je m’étais uriné dessus. Il s’est moqué de moi, il a ri. Et il m’a dit : « Tu es vraiment stupide. Qu’est-ce que tu cherches ? Tu veux retourner en prison ? » J’ai été si déçu que j’ai décidé, à ce moment-là, de quitter ce pays où les gens n’ont aucune considération pour ceux qui ont été en prison pour défendre leurs valeurs.
En raison des contrôles de police, je savais que je ne pouvais pas aller au terminal de bus acheter un billet, je me suis rendu directement au bus – je savais à quelle heure il devait partir – et j’ai payé mon billet au chauffeur. On ne m’a pas demandé mes papiers. Je suis allé à Tabriz, où j’ai passé deux jours, puis à Maku, à la frontière. Là-bas j’ai trouvé un facilitateur et je suis allé en Turquie. J’ai traversé la frontière à pieds. Mon passeur était bon (Il rit). Certaines personnes qui veulent rejoindre la Turquie doivent marcher pendant vingt-quatre heures, parfois plus. En ce qui me concerne, on m’a mis dans un camion et on m’a amené à une rivière. J’ai marché environ deux heures et je suis arrivé sur le territoire turc. Je suis resté quelques jours à Dogubayazit. Je ne voulais pas rester vivre en Turquie. J’ai payé mille euros pour aller à Istanbul où j’ai passé une semaine, puis à nouveau mille euros pour aller d’Istanbul à Lesbos.
Je suis arrivé à Lesbos dans la nuit. Il était minuit, il pleuvait. La mer n’était pas bonne. Nous avons passé quatre heures dans un bateau gonflable, un dinghy, puis nous sommes arrivés. Bien sûr que sur le bateau, j’avais peur. Mais j’ai lu cette phrase quelque part : être courageux, ce n’est pas ne pas avoir peur, c’est avoir peur et braver cette peur. Quand je suis arrivé sur l’île, l’avenir n’était pas clair, mais j’étais prêt et je ne m’attendais pas à ce que la vie ici soit si dure. Le passeur m’avait dit qu’au bout d’une semaine, je serais en Allemagne. Après treize mois, je suis encore ici, je ne peux rien faire pour changer cela. J’imagine que je devrai rester ici pendant encore une année, peut-être plusieurs. J’ai eu des problèmes mais aujourd’hui, je suis en vie et c’est l’important.

Alain Serge Soh
J’écris toujours des textes de rap, en permanence. Par exemple, je suis en train d’écrire un texte qui va parler de mon parcours, de mon voyage. Il y a ce refrain, qui revient sans cesse dans ma tête : « Je ressens l’envie de raconter mon parcours. Et partout. À notre tour de rôle. Il y a rien de si drôle. D’où je viens, rien de bien. On vient tous du sol. Parti de rien j’ai pris le cap avec une boussole. Né pour briller : appelle-moi luciole. » Je peux raconter certaines étapes de mon parcours, mais d’autres non. Il y a certaines questions auxquelles je ne veux pas répondre. D’ailleurs, je dis dans un couplet : « Moria m’a donné des céphalées mais tant qu’il y a l’instinct il y a la survie, je sais ça va aller. J’ai pris le taureau par les cornes et la confiance s’est installée. Tu veux savoir pourquoi j’ai quitté mon pays ? Demande à ma vie. »
Je suis né au Cameroun en 1990 à Baré, une petite ville dans la région qu’on appelle la « région du littoral ». Aujourd’hui, la population vieillit. Les jeunes s’en vont à Douala pour l’université, pour les activités. Mais j’ai beaucoup de souvenirs là-bas. J’ai des amis d’enfance qui sont presque comme mes frères. Dans ma famille, on était quatre : deux petits frères, une petite sœur, et moi, je suis le grand. Et aujourd’hui, on n’est plus que trois. Nous avons perdu notre plus petit frère en 2009, l’année de mon bac. Je vivais à Yaoundé. Vous savez, en Afrique, ça n’est pas comme en Europe. Quand mon petit frère et moi avons eu le bac, deux personnes la même année, dans la même maison, ça n’a pas plu à certaines personnes. Mon plus petit frère de 3 ans et ma petite sœur ont été empoisonnées. Seule ma petite sœur a survécu. On a demandé à mon frère et moi de ne pas venir aux obsèques, parce que c’était trop dangereux. Alors on est restés à Yaoundé. Ce n’est que deux ans après que nous avons pu aller voir où il a été enterré.
C’est plus tard que j’ai décidé de partir du Cameroun. En janvier 2018. Je travaillais déjà. Je suis parti brutalement, seul. Je ne dirai pas pourquoi. Je ne me suis pas demandé ce qui m’attendait, je n’en ai pas parlé avec des gens qui avaient déjà fait la route. J’avais un problème, je n’ai pas eu le temps de me poser de question. Je n’ai même pas fait de valise. D’abord, j’ai pris un avion pour la Turquie. C’est la destination qu’un client m’a suggéré de choisir, avec l’aide de ses relations. J’ai donc pris un avion de Yaoundé à Istanbul. Cette personne avait informé des gens de mon arrivée. J’ai été reçu, même si ça n’était pas le genre d’accueil auquel je m’attendais. Disons que tu pars parce que tu as un problème. La personne qui te reçoit le sait et elle va abuser de ça. Elle va te demander de l’argent, de l’argent pour ceci, pour cela. Je n’étais pas au courant. En arrivant à Istanbul, j’avais 27 ans. Je ne connaissais personne. J’étais malade, je souffrais beaucoup. J’ai commencé à chercher comment faire pour partir de Turquie. Je ne suis resté qu’un mois. Il fallait absolument que je quitte cet endroit. Il y avait du passage chez cet homme chez qui je vivais. Parmi ces visites, d’autres Camerounais. Je leur ai demandé comment faire pour quitter Istanbul. Ce sont eux qui m’ont expliqué que ça ne pourrait pas aller pour moi à Istanbul, dans un pays musulman, étant donné mes problèmes. Je suis allé chez quelqu’un d’autre, et de là je suis allé à Izmir. J’y suis resté un mois.
À Izmir, tout le monde est là, dans des hôtels. On m’avait fait plusieurs propositions. Soit tu arrives et tu te loges toi-même, tu ne payes que pour la traversée. Soit tu payes tout à l’avance et on te loge jusqu’à ce que tu traverses. Il y a un risque de se faire avoir dans tous les cas, mais quand tu es dans une position désespérée tu fais confiance à ton instinct. J’ai payé quelqu’un pour l’hébergement et la traversée. J’avais préféré faire ainsi. J’étais déjà dans le pétrin, alors je pouvais bien continuer comme ça. J’ai payé le passeur huit cents euros, et ensuite j’ai attendu. Il y a beaucoup de monde. Les hôtels sont alignés sur la côte. Toutes les personnes sont dans le même cas que toi. Bien sûr les passeurs peuvent en abuser certains… Mais tout le monde a l’envie d’en finir vite avec ses problèmes. Parfois, vous ne vous posez même plus la question de savoir si ça va aller ou pas. Quand ça va, ça va, et si ça ne va pas… Les passeurs ne te disent rien pour la traversée. La seule chose que tu sais, c’est qu’on va t’appeler pour que tu traverses. Parce que si on t’explique réellement les conditions, je pense que tu ne pourras pas vouloir le faire.

À Izmir, le jour où l’on vous dit de partir, vous partez. Certains sont arrêtés en route, d’autres dans l’eau. J’ai failli perdre la vie. J’ai fait deux tentatives. La première fois a été la plus difficile. On nous a dit qu’on partait, et on nous a entassés dans un véhicule, debout, et c’était tellement serré… On ne pouvait même pas respirer. Certains gamins criaient et pleuraient parce qu’ils étaient étouffés. Cette fois-là, moi aussi, j’avais de la peine à respirer jusqu’à l’arrivée. Des enfants pleuraient. Il y a des choses comme ça dont j’essaye de ne pas me rappeler. Et dans l’eau… On voyait une île. Le mec qui conduisait a changé de main à cause de sa cigarette. Et le moteur s’est arrêté. On voyait l’île, nous étions là, on ne bougeait pas, et la corde du moteur qu’on essayait de rallumer s’est cassée. Nous avons appelé l’île. Ils nous ont répondu qu’ils nous voyaient mais qu’ils ne pouvaient pas venir nous chercher car nous étions toujours de l’autre côté. Nous sommes restés et nous avons finalement appelé la police turque qui est venue nous chercher.
La deuxième fois, on a réussi à passer, mais avec beaucoup de peine. À l’hôtel, les lieux étaient saturés. Cela faisait longtemps que les gens n’étaient pas passés parce que l’eau n’était pas bonne, et que la police arrêtait beaucoup de gens. C’est comme ça là-bas. C’est comme un cycle. Parfois, tu es découragé, mais tu n’as pas le choix. Il faut y aller, tu as déjà donné l’argent aux passeurs. Notre traversée a duré quatre heures. Si, à un moment, on n’avait pas eu l’idée de jeter tout ce qu’on avait, tous nos sacs, tout, aujourd’hui je ne serais pas là pour parler. Nous sommes tous arrivés à Lesbos seulement avec les vêtements que nous portions car nous avions tout jeté. Certains avaient leur téléphone dans leur sac, tout. Parce que non seulement le bateau était trop chargé, mais il y avait une fuite. On essayait d’écoper avec ce qu’on pouvait, avec nos chaussures… Mais l’eau rentrait toujours. On a tout jeté, tous nos sacs. Certains ont même retiré leurs chaussures pour les jeter. Je dis « bateau », mais j’abuse du mot. C’est un objet dans lequel on met de l’air. Je l’appelle bateau pour que cela sonne bien aux oreilles. Tous ceux qui en passent par là appellent ça un « dinghy ».
Je suis arrivé en mars. Je me souviens de mon arrivée. Il y a des étapes que tu veux effacer, mais ce moment-là, je ne peux pas l’oublier. Cette satisfaction a été de très courte durée. Nous sommes arrivés le 25 mars et le 26, on nous a mis en prison. Mais pas tout le monde. On était 40 dans ce bateau, et 18 d’entre nous ont été mis en prison. Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi. Soi-disant parce que nous étions entrés illégalement sur le territoire. Mais pour moi, ce sont des bobards. Quand on a un visa, on n’entre pas par là. On ne nous dit même pas qu’il s’agit d’une « prison », d’ailleurs. J’ai su qu’on m’amenait en prison parce qu’on m’a mis dans une voiture menotté et qu’on a fermé les portes. On ne te met pas des menottes pour aller faire la fête. À ce moment-là, je me suis dit que tout ce qu’on pense, ou bien tout ce qu’on se dit par rapport à l’Europe, c’est pas ça.
Cette prison, elle est à l’intérieur de Moria. Ce sont des cellules collectives. Je ne sais pas si vous voyez les containers de Moria : à l’intérieur de la prison, c’est comme ça aussi. Mais complètement fermé, vous ne pouvez pas sortir. Pourquoi nous? Le seul constat que j’ai pu faire, c’est que ce sont des Noirs qu’on met en prison. Il y avait aussi des Arabes et des Afghans en prison, mais eux étaient là parce qu’ils étaient punis pour une chose précise J’ai vu que ce sont juste des noirs qui sont mis directement en prison à leur arrivée.
Dans la prison, il y a deux côtés. Un côté qui appartient à l’OIM 1, l’agence des déportations : on y trouve ceux qui ont signé la déportation, un papier disant qu’ils voulaient bien rentrer dans leur pays. Avant d’être renvoyés, ils font aussi trois mois de prison. De l’autre côté où on met les gens qui ont fait « du désordre ». Quand nous sommes arrivés, on nous a mis du côté de ceux qu’on allait déporter, on l’a appris par des gens dans la file. À l’intérieur, on ne dormait pas, on ne mangeait pas… Je n’ai jamais autant réfléchi de toute ma vie. Si j’avais pu mettre toutes ces réflexions dans un exercice de maths ou de programmation, je pense qu’il serait long aujourd’hui. C’était terrible. Dans ce genre de situation, tout te passe par la tête, tout, tout, tout. Tout, complètement. C’est un peu comme quelqu’un qui est en train de mourir ou qui pense qu’il va mourir. Toute sa vie lui défile devant la tête, vous voyez ? C’est un peu ça. Je suis sorti après trois mois, comme tout le monde. Et j’ai rejoint le camp. J’étais nouveau. Je ne savais rien, je ne connaissais rien des démarches, j’essayais d’avoir toutes les informations possibles.

À Moria, au début, je dormais dans une tente, au niveau d’Olive Grove. Nous étions parmi les premiers dont on a installé les tentes là-bas. C’est un espace qui est à côté du camp, installé là à cause du sureffectif. Peut être trois ou quatre jours après, le vent a tout emporté. On a essayé d’aller se réfugier, de demander de l’aide, et on s’est retrouvés dans les containers. Dans un container, au moins on ne ressent pas le vent. Même si, quand il pleut, l’eau entre par les fissures. Nous étions dix. Il y a des lits superposés de deux. Il n’y a presque rien d’autre que des lits tellement c’est serré. On s’est quand même cotisés pour acheter une plaque électrique pour se faire à manger. On se cotisait pour manger mais moi, je ne mangeais pas. En sortant de prison j’avais des problèmes de nutrition. Jusqu’à aujourd’hui même, il y a des trucs que je ne peux pas manger. La nourriture qu’on sert à Moria, vraiment, parfois rien que le fait de regarder, ça te dégoûte de manger, catégoriquement. Moria ne mélange pas les Africains avec les Afghans ou les Arabes pour limiter les tensions. Dans le container, les gens avec qui je vivais venaient tous d’Afrique de l’Ouest, mais pas du Cameroun. Ça me plaisait, parce que j’avais souvent envie de rester un peu dans mon coin, seul.
À Moria et à l’accueil de jour d’OHF 2, j’ai quand même rencontré beaucoup de monde. Quand vous êtes quelqu’un d’ouvert, vous rencontrez aussi des gens ouverts. Le contact passe. Vous apprenez beaucoup de choses des différentes personnes, des différentes cultures, des différents pays. Ça vous permet de vous enrichir, c’est très bien.
Je crois que c’est là la force du parcours. La force du chemin. Parce que face à la difficulté, parfois on oublie que nous ne sommes pas du même pays. Face à la difficulté, parfois on oublie certaines différences, on oublie la religion… Vous avez un même objectif : survivre. Par exemple, dans le bateau, nous n’étions pas tous du même pays, mais nous nous sommes serrés les coudes.
Aujourd’hui, ce que j’aimerais d’abord, personnellement, c’est avoir une position stable dans ma tête. Ce qui me pèse, c’est que tout est confus, ce qui fait que des fois on ne croit plus en soi. Ne pas connaître mon avenir me dérange. Est-ce que j’aurai les papiers ? Est-ce que ma demande va être acceptée ? Est-ce que, est-ce que… Il y a tant de questions que je me pose sans même avoir le centième de la réponse. Ça me fragilise beaucoup. J’essaye de cacher ça, je souris, je dis « ça va ». Plus vous avez les éléments de réponse aux questions que vous vous posez, plus vous avancez.

Ahmad Ebrahimi
Mon nom est Ahmad Ebrahimi. Je viens d’Afghanistan. Je suis né à Kaboul, ville très peuplée d’environ huit millions d’habitants. Après le départ des Talibans en 2001, beaucoup d’Afghans sont rentrés, de partout dans le monde. Ils ont lancé des nouvelles entreprises. Maintenant nous avons beaucoup de chaînes de télévision, plus de cent à Kaboul, beaucoup de chaînes de radios, de journaux. J’étais réalisateur et producteur à Kaboul. Je travaillais sur plusieurs émissions télévisées : des émissions pour les enfants, des matinales, des émissions musicales. Et j’ai aussi réalisé cinq ou six court-métrages, ainsi que des ateliers de réalisation pour les enfants.
J’ai quitté Kaboul en juin 2016, tout seul. Je ne veux pas raconter pourquoi je suis parti.
Je suis d’abord allé en Iran avec mon visa. Ensuite, je suis allé en Turquie en avion, depuis Téhéran. Puis j’ai passé deux ans en Turquie. Là-bas, ça a été très difficile de trouver un travail. Pendant longtemps, j’ai fait des boulots très simples, très mal payés, juste pour gagner un peu d’argent. C’est comme ça que j’ai appris à poser du parquet. J’ai dit à un ami que je cherchais du travail. Un de ses amis cherchait quelqu’un pour l’aider, j’ai dit oui. J’ai travaillé avec lui pendant un mois et j’ai appris le métier. Ensuite, j’ai acheté mon propre matériel et j’ai commencé à travailler tout seul. Et j’ai aussi trouvé un travail en lien avec la photographie, dans un magasin de photo à Istanbul. J’ai travaillé pour eux pendant un mois, mais ils payaient très mal et j’ai arrêté. J’ai travaillé dans une autre boutique de photo à Azram pendant environ deux mois.
Je suis arrivé à Lesbos en juin ou juillet 2018. Je suis parti parce que je venais de passer environ deux ans en Turquie et je me rendais compte que rien de nouveau n’allait se passer, que ce soit du côté de l’UNHCR 3 ou du gouvernement turc. Je n’avais pas d’entretien prévu. J’ai connu beaucoup de gens en Turquie qui y avaient passé neuf ou dix ans… après quoi, le gouvernement turc les a renvoyés dans leur pays. On peut être déportés après neuf ans en Afghanistan ou en Iran. Rien ne se passait, alors j’ai décidé de venir en Europe. À Istanbul j’ai trouvé un passeur. Après deux ou trois nuits, mon passeur m’a dit : « Nous partons ce soir. » À onze heures du soir, on nous a emmenés dans un petit van. J’imagine qu’ils nous ont amenés à Izmir. Je ne suis pas très sûr d’où j’étais. Et ensuite nous avons traversé la mer. Ça nous a pris douze heures pour arriver ici. On a réparé le bateau, on l’a gonflé, on a soufflé dedans. Il devait être cinq heures de l’après midi quand on a traversé la frontière. C’était une après-midi ensoleillée. J’ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de gens passent quatre ou cinq jours dans les bois sans pouvoir traverser. Et j’ai pu traverser du premier coup.
Je ne savais pas sur quoi j’allais tomber sur cette île. Je suis stupide, je n’ai même pas regardé sur Internet et je n’avais aucune idée d’où j’allais. Mon passeur m’a dit : « Tu quitteras l’île dans un mois et je pourrai t’amener dans un autre pays d’Europe. » Je l’ai cru. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit : « Merde, je crois que je vais devoir rester longtemps… » En Turquie, je n’avais aucun contact. Je parlais avec certains de mes amis, mais eux non plus ne m’ont rien dit du temps que j’allais passer ici par exemple. Maintenant, quand quelqu’un m’appelle pour me demander, je peux tout expliquer : « D’accord, si tu veux venir, je ne te dis pas de venir, mais si tu viens, voilà ce qui se passera. » Je leur dis : « Tu vas rester sur cette île pendant longtemps. Tu ne pourras pas la quitter, car tu n’as aucun papier. Tu vivras dans une tente, tu attendras des heures dans la file d’attente pour avoir à manger. » Juste la vérité… « Maintenant, c’est ton choix si tu veux venir. Simplement fais attention avec la mer. C’est ton choix, je ne te dirai pas de venir ou de ne pas venir. C’est ta vie. »

Anoosh Ariahmehr
Je suis né en 1984 dans une petite ville de la province de Badakhshan dans le nord-est de l’Afghanistan. C’est une petite ville de montagne. La plupart des gens sont des fermiers. Au printemps, en été et en automne, ça ressemble au paradis. Tout y est naturel et pur. J’ai grandi au milieu de ces gens calmes et doux. J’ai un frère et trois sœurs. Mon père est fermier et ma mère, mère au foyer. Quand j’ai ouvert les yeux un jour, autour de moi il y avait les soldats de l’Armée rouge (l’armée Russe), en guerre contre le groupe terroriste moudjahidin en Afghanistan. Mon enfance et mon adolescence ont oscillé entre la peur et l’espoir. Je passais la moitié de mes journées à l’école et à étudier certains livres, et l’autre moitié à l’agriculture et à la ferme, avec mes parents.
Il y a deux périodes dans ma vie. Avant et après le lycée. Après avoir fini le lycée, j’ai déménagé à Kaboul pour continuer mes études à l’université de Kaboul. J’ai étudié la littérature persane et la linguistique. J’ai travaillé à différents postes dans plusieurs organisations. Et puis j’ai travaillé comme journaliste, parfois seul, parfois avec une équipe. La plupart du temps, je travaillais comme journaliste freelance. J’ai enquêté sur des sujets historiques, sociaux, politiques, culturels, sur des assassinats politiques, sur des impostures, sur l’apartheid afghan et sur le pillage des mines d’Afghanistan. Quand j’ai enquêté sur des assassinats politiques, sur des vols de mines ou sur des falsifications historiques, j’ai travaillé dans des conditions difficiles. Plusieurs fois j’ai été menacé par des inconnus. Un jour, on a essayé de me tuer avec une voiture. Heureusement, j’ai eu la chance de survivre.
J’ai traversé les frontières pakistanaises, iraniennes et turques avant d’arriver en Grèce et cela m’a pris un mois et huit jours. J’ai vécu deux ans en Turquie et je travaillais tous les jours pour rester en vie. Les conditions étaient très mauvaises. Le gouvernement turc et les Nations unies n’acceptaient aucune responsabilité concernant les réfugiés. Ils ne regardaient pas nos dossiers. J’ai vu et su que des personnes avaient attendu pendant huit à dix ans en Turquie que les Nations unies fassent quelque chose, mais ils ne leur ont jamais répondu. Je n’avais aucun droit en Turquie, pas d’éducation, pas de protection, aucune aide. Je ne pouvais pas retourner dans mon pays, je devais aller en Grèce.
Avant de venir à Lesbos, j’ai étudié la situation sur chacune des îles. Quand je suis arrivé, les conditions de vie n’ont pas été une surprise pour moi. Je n’attendais rien, je savais ce qu’il se passait ici. Quand je suis arrivé au camp de Moria, la première chose qui a attiré mon attention a été une phrase intéressante écrite sur le mur du camp : « Bienvenue à la prison de Moria. » Les conditions à l’intérieur du camp sont tellement dures. Il y avait 9 700 personnes quand je suis arrivé. Nous devions faire la queue pendant des heures pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner, pour l’eau, pour voir un docteur, pour aller aux toilettes. C’était une sorte de tâche quotidienne. Tous les jours à cause de l’eau ou du pain, il y avait de violentes disputes qui se terminaient souvent en affrontements aux implications ethniques ou linguistiques. Des parties du camp étaient brûlées et des dizaines de personnes blessées. Après ce qui s’est passé à Cologne 4 la situation était hors de contrôle. Il y a beaucoup d’immigrants et de réfugiés qui attendent ici de savoir s’ils auront l’asile. J’ai fait une enquête auprès d’eux et j’ai trouvé deux grandes raisons qui rendaient problématiques la possibilité d’avoir l’asile :
-
1. La plupart n’ont pas une raison suffisamment reconnue de quitter leur pays. L’Afghanistan, par exemple, est un pays plein de troubles, mais pas considéré comme un pays en guerre.
-
2. Une partie d’entre eux n’ont aucun papier d’identité prouvant qui ils sont, ou aucune information concernant leur pays ou l’endroit où ils sont nés. Le service d’asile ne peut pas traiter leurs cas.
Malgré cette situation si difficile, au bout d’une semaine, j’ai trouvé une école, j’ai commencé à enseigner : le persan et les mathématiques pour des enfants réfugiés parlant persan. Il y avait aussi un cours de guitare auquel je participais. Je remplissais mon temps libre en étudiant des livres sur mon téléphone. Dans cette école, j’ai pu améliorer mon anglais jour après jour. Au bout de cinq mois à attendre mon entretien, des personnes m’ont agressé. Ils étaient sept ou huit. Ils m’ont blessé aux cuisses, à l’abdomen et à l’épaule avec un couteau. Les blessures aux cuisses et à l’abdomen étaient très dangereuses, et possiblement mortelles. Si une voiture n’était pas passée, ils m’auraient tué. Ils ont aussi volé mon téléphone et mon argent. Après ça, j’ai tout arrêté. Je ne pouvais plus retourner enseigner à l’école ni aller à mon cours de guitare ou aux cours de yoga. L’UNHCR m’a déplacé à un autre endroit qui était un peu plus sûr que le camp. J’y ai trouvé quelques livres de physique et je les ai étudiés.

Après cette agression, le service d’asile m’a reconnu comme une personne sérieusement vulnérable et j’ai eu la permission de quitter Lesbos. J’ai mis mon nom sur la liste d’attente pour Athènes. Mais à ce moment, j’ai aussi reçu une décision du service d’asile m’accordant l’asile en tant que réfugié. J’ai préféré rester à Lesbos attendre ma carte de résident et mon passeport. Pendant ce temps, j’ai trouvé un cours de photographie et des ateliers de radio. Le premier était donné par un producteur américain et le second par de jeunes français. J’ai appris dans les deux. Deux jours après avoir terminé mon cours de photographie, j’ai reçu ma carte de résident et l’UNHCR m’a transféré à Athènes. Quand je suis arrivé, Athènes m’a paru très étrange, mais j’y ai très vite trouvé ma place. Maintenant, j’apprécie ma situation et je me sens très bien dans cet environnement Tout va bien, je suis très occupé par un petit projet d’entreprise, par le travail et par les études. Je veux faire ma vie à Athènes, la ville de la philosophie. J’aimerais y poursuivre mes études. Je m’apprête à aller à l’université. Je suis heureux d’être à nouveau étudiant. J’ai beaucoup de projets pour ma nouvelle vie dans ce nouveau pays.
Pour aller plus loin
-
« Les Hotspots, véritables camps de la honte », Migreurop, vidéo disponible sur <migreurop.org>.
-
« Nouvelles Formes de confinement aux portes de l’Union européenne », Migreurop, actes de conférence disponibles sur <migreurop.org>.
- Organisation internationale pour les migrations, liée aux Nations unies depuis 2016. ↩
- One Happy Family. Le centre est actuellement fermé ; le 7 mars dernier, il a été partiellement détruit par un incendie criminel, vraisemblablement déclenché par des militants liés à des groupes d’extrême droite. Une enquête est en cours. ↩
- Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. ↩
- Des médias ont rapporté une explosion d’agressions sexuelles supposément commises par des réfugiés le soir du 31 décembre 2015 à Cologne, en Allemagne. L’affaire dite de Cologne, alimentant le mythe du réfugié violeur, a entraîné une vague de discours et d’actes xénophobes en Europe. L’enquête concernant les plaintes déposées au sujet des faits commis ce soir-là a depuis remis en cause cette version. Elles signalent un ensemble d’agression de nature diverse – vols, coups et blessures, agressions sexuelles, etc. – qui ne sont pas imputables aux réfugiés mais qui représentent plutôt un problème systémique se posant en présence d’une foule festive et alcoolisée. Voir Von Florian Flade, Marcel Pauly et Kristian Frigelj, « 1054 Strafanzeigen nach Übergriffen von Köln », Welt, dispnible sur <welt.de>, et Patric Jean, « Agressions sexuelles de Cologne : un renversement révélateur », disponible sur <blogs.mediapart.fr/patricjean>. ↩