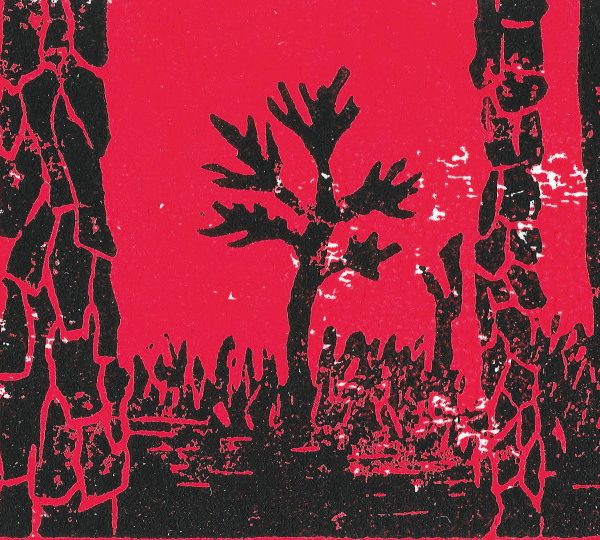Les ateliers de l’Antémonde ont entrepris d’écrire la vie quotidienne d’un monde révolutionné, anti-autoritaire et anti-capitaliste, dix ans après un soulèvement mondial, l’Haraka. Leurs séances d’écriture collective ont donné naissance au recueil de nouvelles Bâtir aussi, que leurs auteur·es qualifient elles et eux-mêmes d’« utopie ambiguë ». Car si on peut y entrevoir des futurs enthousiasmants, tout est à réinventer collectivement dans ce monde d’après. Le livre, publié en mai 2018 par les éditions Cambourakis, n’a pas clôturé l’exercice : il est devenu le point de départ d’ateliers de réflexion et d’imagination itinérants, les « labo-fictions ». Quand la (science-)fiction devient un levier pour penser la dimension concrète et vivante de possibles processus révolutionnaires.
Télécharger la lecture musicale de l’atelier de la Parole errante

Pouvez-vous nous raconter comment est né le projet Bâtir aussi ?
H : L’écriture, d’emblée collective, a commencée en 2011. Sous l’impulsion de R., qui faisait partie de la maison d’édition Tahin Party, nous nous sommes réuni·es autour de la réédition d’un article de 1965 intitulé « Vers une technologie libératrice ? », de l’anarchiste et écologiste américain Murray Bookchin. Nous voulions écrire des textes complémentaires aux perspectives ouvertes par ce texte, renouveler nos réflexions autour de la critique du capitalisme industriel, du rapport à la technique et à la technologie. Une abondante littérature critique existait déjà sur le sujet, mais nous avions des problèmes avec la manière dont était abordée cette critique de la technologie industrielle, qui ne prenait pas toujours en compte des terrains politiques importants pour nous, tels que les féminismes et d’autres luttes contre les dominations croisées.
R : Pour revisiter cet article, je trouvais intéressant de l’accompagner de textes actuels proposant des regards féministes, mais aussi des points de vue d’informaticien·nes ou de geeks, passionné·es par des techniques liées aux ordinateurs, ainsi que des perspectives plutôt reliées aux questions de travail et de rapports de classe.
H : L’impulsion donnée par le texte de Bookchin venait de son imagination d’une société anarchiste, anti-autoritaire, communautaire, écolo, avec un rapport enthousiaste aux solutions techniques. Il prend le temps de décrire pendant trois pages une unité de production métallurgique, partageant une passion pour le bidouillage et la technicité dans les solutions matérielles : comment marchent les rouages d’une chaîne de production, quelles machines, comment s’organisent les gens ? Ça nous a fait du bien de sortir des textes anti-indus assez théoriques et surplombants, qui s’attaquent en bloc à « la société industrielle ». On y a trouvé quelque chose qui nous manquait, nous interrogeait : comment faire une critique du capitalisme industriel sans être technophobe ? Comment retrouver un rapport de plaisir dans les savoirs complexes, les dispositifs techniques, sans tomber dans les pièges de la société capitaliste, qui nous aliène notamment à travers ces objets techniques ? On voulait aussi être fidèles à une certaine réalité de nos vies collectives, à ces moments d’apprentissage de savoir-faire techniques – le réel plaisir à reprendre prise sur la réparation d’une bagnole, la construction d’une maison, la technique dans un studio radio, etc.
K : François Jarrige a aussi été une référence, notamment sa distinction entre système technicien et trajectoires technologiques 1 – les trajectoires technologiques, présentes dans toute société, dépendent du monde dans lequel elles s’inscrivent. Le dire ne revient pas à affirmer : « La technique est neutre, il y a des bons et des mauvais usages. » On parle plutôt de l’imbrication entre un développement technique et le monde qui va avec. Par exemple, la trajectoire technologique du zeppelin a mené à un abandon de cette invention, en partie à cause de sa très grande fragilité, qui ne lui permettait pas d’être utilisé pour la guerre. Le capitalisme n’implique pas forcément le développement de toutes les possibilités technologiques – d’où l’importance de sortir des logiques évolutionnistes selon lesquelles seules les technologies valables se développent, alors que celles qui ne sont pas utiles seraient abandonnées. Il faut penser l’interdépendance entre une trajectoire technologique et les manières de vivre ensemble, le monde social, les dispositifs de pouvoir…

Pourriez-vous expliciter la critique que vous portez contre les approches anti-indus les plus courantes ?
H : Des pans entiers de ces approches considèrent la lutte contre le capitalisme industriel comme lutte principale et tous les autres combats comme secondaires, voire contreproductifs. « La Nef des fous » de Ted Kaczynski 2 est une parfaite allégorie de ce biais de la « lutte prioritaire ». L’auteur imagine un bateau avec plein de gens aux revendications différentes : le cuisinier râle parce qu’il fait à bouffer tout seul, qu’il n’a pas de bonnes conditions de travail ; les femmes disent ne pas être bien prises en compte ; il fait état de tout un tas de revendications secondaires… Et seul le petit mousse surveille la mer, et avertit : « Regardez, il y a un iceberg, on va se planter ! » Personne ne l’entend, et le navire chavire. La critique anti-indus est aussi fortement liée à un certain catastrophisme – insistant sur l’horreur nucléaire, les seuils de non-retour 3, etc. Il faut d’abord lutter contre ça, et tout le reste, on verra après – voire : le reste nous détourne, nous divise, et est donc contrerévolutionnaire. Nous nous opposons à cette idée, et adoptons une approche intersectionnelle : il faut croiser les luttes et considérer les différents systèmes d’oppression, d’aliénation. Les luttes ne doivent pas être uniquement des terrains accessibles à des personnes suffisamment libérées, émancipées – et donc, en réalité, dominantes par rapport à d’autres – pour pouvoir se payer le luxe de penser le monde dans sa globalité, en se targuant de ne pas avoir de problème personnel avec les dominations. Il y a une dimension hautaine et non matérialiste dans cette manière de considérer telle lutte comme prioritaire, au dépens de toutes les autres problématiques.
K : Il y a ensuite une tension entre aliénation et domination. La notion d’aliénation apparaît dans une pensée d’un système extérieur à nous, qui nous aliénerait, modifiant nos structures mentales et corporelles, et dont il faudrait qu’on se défasse pour se libérer. C’est un postulat qui sous-entend que nous serions doté⋅es d’une sorte d’identité profonde, contrainte par la société, la structure sociale, les conditions matérielles… L’approche des dominations permet plutôt d’envisager qu’on n’est rien d’autre que le résultat d’une construction sociale. On porte en nous les structures de domination et on peut les détricoter, se décaler, changer des choses en nous, mais on fait partie du système. Il n’y a pas un être authentique à libérer, il y a des manières plus ou moins émancipatrices de fonctionner ensemble, qui produisent des rapports sociaux plus ou moins injustes ou dégoûtants. C’est une autre manière de concevoir le rapport entre individu et construction sociale. Je ne rejette pas intégralement le concept d’aliénation, mais il est problématique entre autres car il permet de se positionner comme si on n’était pas partie prenante du système, d’éviter les questionnements sur la manière dont on participe à le reproduire ou dont on le subit. L’approche des dominations vient complexifier le rapport au social.
R : On retrouve également la question de la « nature profonde », éminemment essentialiste, dans beaucoup de discours et écrits anti-indus.
H : On pourrait même parler de pensée conservatrice – notamment dans ce rapport à l’authenticité, au mythe d’une harmonie originelle entre « l’homme » et « la nature ». Des lieux communs selon lesquels vivre en zone rurale, proche de pratiques agricoles, serait se rapprocher de la nature par opposition à l’artificialité de la ville – comme si l’agriculture n’était pas tout aussi artificielle et construite socialement que les pratiques urbaines. Cette division entre nature et culture nous semble produire, dans ce qu’on appelle primitivisme 4, des pensées assez réactionnaires sur l’ordre établi, ce qui existe « de tout temps ». Il en est par exemple ainsi de l’évidence pour certain·es de la répartition des tâches genrées.

À quel moment avez-vous décidé d’écrire de la fiction ?
H : Assez vite, à partir de ces critiques théoriques, on s’est mis à parler de livres de science-fiction qui nous avaient inspiré·es, à y faire référence de manière récurrente. Il y a eu ce moment un peu fou où on a décidé d’écrire de l’anticipation. Le présupposé étant qu’on ne pouvait pas critiquer les rapports aux dispositifs techniques sans critiquer la société qui va avec, sans imaginer un autre monde. La projection fictionnelle est une manière de le faire : si on imagine un monde un peu différent, est-ce que cela renouvelle notre rapport à ces questions ? À partir de là, on est parti·es sur des ateliers d’écriture à trois.
R : Dès le début, on a discuté de l’ambivalence d’une science-fiction qui joue sur le design des technologies du futur, particulièrement dans les dystopies cinématographiques. Typiquement les films Minority Report et Bienvenue à Gattaca ou la série Black Mirror sont des histoires glaçantes qui proposent, en même temps, des designs ultra contemporains et séduisants du type Apple, Sony et compagnie, où les flics utilisent des écrans qui se projettent en 3D dans l’espace, avec des petits gants pour les manipuler… Comme la science-fiction parle toujours du présent, ces dystopies ne cessent de nous renvoyer à l’horreur de la situation actuelle, tout en promouvant un univers chatoyant, attirant, qui épouse souvent une esthétique de pub, et alimente la fascination pour les objets technologiques complexes. Alors à force d’évoquer des ouvrages de science-fiction dans nos discussions, nous avons fini par avoir envie d’en construire une qui nous plaise, peuplée de personnages qui nous soient familiers.
Comment avez-vous envisagé, dans Bâtir aussi, le rapport entre ces deux formes de la science-fiction que sont l’utopie et la dystopie ?
R : Ce n’est pas de la dystopie, c’est sûr. Mais on ne s’est pas dit non plus : « Tiens ! on va écrire de l’utopie. » Même si on quittait la théorie pour aller vers la fiction, on voulait plutôt dessiner une utopie un peu merdique. On définit le bouquin comme une « utopie ambiguë 5 ». C’était un pas de côté intéressant à faire : en s’emparant de la fiction, on voulait qu’elle soit à l’image du monde pour lequel on lutte – une image à définir et en perpétuel mouvement. On souhaitait réfléchir à un monde qui nous ferait du bien, dont on aurait envie, qui pourrait nous émanciper, où on puisse se projeter. Un livre de Christiane Rochefort a été fondamental pour moi : Archaos 6. L’auteure y élabore une utopie anarchiste, ce qui est plutôt rare. C’est fulgurant, poétique et radical, effectivement très empreint des années 1970, et ce roman amène de l’air.
K : Contrairement à Bookchin, qui imaginait une société idéale mais pas très reliée au réel, on est parti·es sur une fiction qui se passe dans un futur proche, avec des allers-retours entre le réel et ce qui pourrait mieux se passer d’ici quelques années.
R : Pour pouvoir imaginer une transformation sociale radicale, il nous fallait penser, même de manière partielle, le déclencheur de ces révoltes, ce par quoi elles passeraient, ce qui viendrait transformer le monde. On ne voulait pas simplement se projeter en l’an 3000. Situer le récit dix ans après la révolution nous a obligé·es à concevoir au moins un bout de la transformation sociale qui avait eu lieu.
H : On voulait dessiner un processus révolutionnaire, pas une alternative. On ne voulait pas produire une réalité parallèle qui arriverait doucement par glissement, sans que quelque chose qui soit de l’ordre d’un processus révolutionnaire ait lieu, et se prolonge dix ans plus tard. Notre conception de la révolution repose sur l’idée d’une société perpétuellement en mouvement, en questionnement, en rupture aussi… D’où le titre Bâtir aussi, où « aussi » sous-entend cette idée de rupture.

Et pourquoi avez-vous décidé de signer « Ateliers de l’Antémonde » ?
R : On voulait une signature collective, et on a beaucoup cherché. La notion d’atelier était très importante pour nous, car même si l’écriture était une activité sérieuse – on y passait beaucoup de temps –, on avait surtout l’impression de chercher, de bricoler… Ça nous permettait d’insister sur le côté fabrique, qui correspond aussi à l’intention du livre : travailler sur les aspects techniques des choses.
H : Et « l’Antémonde », parce que c’est la manière dont on désigne dans le livre la période d’avant le basculement. C’était donc assez logique de nous situer, en tant que groupe de travail, encore dans l’Antémonde. Par ailleurs, un nom collectif est réappropriable, à l’exemple du collectif italien Wu ming ou du projet Luther Blissett 7 – qui ont écrit collectivement de la fiction, permettant à différentes personnes d’endosser ensemble ces noms. Nous avons l’espoir que d’autres personnes rejoignent les ateliers de l’Antémonde, pour écrire la suite de la vie des personnages, prolonger de différentes manières cet univers en se fondant dans cette signature.
K : C’est aussi parce qu’on a vraiment écrit tous les textes à plusieurs mains, ce qui est une pratique un peu rare. Ce n’est pas une compilation de nouvelles qui auraient chacune un·e auteur·e différent·e. Le fait d’avoir un auteur collectif avec un nom bizarre a aussi fait que les maisons d’édition ont eu du mal à appréhender le livre. D’autant qu’en général il n’y a pas un grand imaginaire de l’écriture à plusieurs – alors même que la plupart des auteur·es le font, même si iels signent de leurs noms seulement, et que toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte pour les soutenir dans l’écriture n’apparaissent que subrepticement dans les remerciements.
À quel moment du processus d’écriture est venue la forme du recueil de nouvelles ? Pourquoi l’avez-vous choisie ?
R : D’emblée, on ne voulait pas écrire un roman, on ne voulait pas être obligé·es d’anticiper le point où le livre allait se terminer. On avait envie de poser les bases de la révolution qui amène à l’Haraka 8 puis, dix ans après, montrer quelques morceaux de vie, imaginer comment chaque collectif viendrait construire dans le quartier où il habite, les problèmes que cela poserait. On ne voulait surtout pas faire quelque chose de programmatique, un monde clos dès le départ, avec des positions entérinées. C’est ce qui nous a donné la vitalité d’écrire : le fait de ne pas forcément savoir comment ça allait se terminer quand on commençait une nouvelle.
H : L’ellipse est un bon soutien : ça nous permet d’avancer dans des histoires sans tout savoir nous-mêmes, sans être forcément cohérent·es. Ça permet aussi d’imaginer la vie dans ce monde sans en avoir une vision totalisante. Au moment de la finalisation des nouvelles et de leur relecture par des ami·es, on s’est dit qu’il y avait de la place pour que d’autres gens écrivent des choses qu’on ignore. La forme nouvelle aide à travailler le côté multiple.
K : L’Haraka, c’est une révolution qui a eu lieu pour des milliards de gens dans plein d’endroits de la planète, et le penser totalement, ça reviendrait à le penser depuis notre prisme occidental. Ça ne nous intéressait pas. On voulait plutôt écrire quelques situations. On a imaginé un monde autogéré, où le pouvoir et la capacité de reconstruire reviennent au peuple. Mais on est sûr·es que ça se construirait de manière différente à d’autres endroits.
H : Il y aurait pu y avoir un roman du point de vue de la trame narrative, si les personnages qu’on développe se rencontraient, se connaissaient et partageaient des expériences communes. Mais, d’une part, on venait avec une intention d’abord théorique, sans expérience d’écriture de fiction. D’autre part, on s’est dit que ça pouvait donner goût à d’autres personnes de prolonger les personnages, de les faire vivre et se rencontrer. Le recueil de nouvelles a été pensé comme un appel à ça, comme une pelote de fils à tirer. En plus de toutes les questions sociales de fond qui sont à prolonger, on peut s’appuyer sur des personnages existants pour ramifier leurs vies. Et pourquoi pas constituer quelque chose qu’un jour on appellera un « roman mosaïque », dans le sens où la narration pourrait comporter des entremêlements.
Avec ces formes courtes, il y a beaucoup de photographies de personnes à un temps T, ce qui les constitue souvent en figures plutôt qu’en personnages. La forme roman n’aurait-elle pas été plus à même de faire évoluer un personnage, de décrire un processus d’émancipation ? Il se dégage de Bâtir aussi une impression presque d’assemblée générale, avec des débats où s’expriment davantage des archétypes politiques et moins les processus intimes à l’échelle subjective. Par exemple, dans le cas du personnage qui se fait virer de sa communauté parce qu’il a installé un réseau internet contre la volonté de ses voisin·es, on ne sait pas comment il a vécu cet épisode intimement 9…
H : C’est une des limites de cette forme. Et la pirouette qu’on peut faire, qui n’est pas qu’une pirouette, c’est insister sur la dimension d’appel des textes. Vous avez envie de ça ? Faites-le, ou continuons à le faire. En tout cas, dans le projet Bâtir aussi, qui n’est pas uniquement un livre, mais aussi des ateliers 10, des rencontres avec des gens autour de pratiques, l’envie était d’inviter d’autres personnes à tirer des fils, à écrire d’autres histoires et à les publier ensemble sur le site. Ainsi, alors que toutes les nouvelles s’achèvent sur une forme de chute, la dernière raconte un projet de construction qui débute à peine et s’arrête en plein milieu : iels partent faire des récup’ et ça finit sur des points de suspensions. On assume qu’on en est là, et qu’on ne sait pas ce qui va se passer ensuite… Ce qu’on a fabriqué, ce que ça a généré en nous – et qu’on espère que ça produise chez d’autres –, c’est l’ouverture de portes dans nos imaginaires, au-delà du livre. L’idée est d’inviter chacun·e à se poser cette question : « Si l’Haraka avait lieu, qu’est-ce que je ferais chez moi ? »

Dans quelle mesure une personne peu familière des débats militants peut-elle se projeter dans ces histoires ? Au moment de l’élaboration des nouvelles, pensiez-vous les adresser à des personnes en particulier ?
R : J’avais envie de l’adresser à des gens qui se situent dans des sphères autonomes, radicales, féministes, anti-indus… Je ne projetais pas des lecteurs ou lectrices que je ne connaissais pas, mais une grande variété de personnes avec qui je suis en interaction dans le monde, dont je connais le positionnement. La question de l’adresse s’est surtout posée pendant la finalisation, avec des interrogations sur l’entre-soi, sur nos réseaux, qui sont certes larges – trans-pédé-gouine, autonomes, hackers… Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on s’est demandé si l’histoire était suffisamment prenante pour embarquer des lecteurs et lectrices qui ne maitriseraient pas les mots et les codes des milieux militants.
H : Moi, quand je termine un texte, je me demande toujours si ma mère va réussir à le lire, ou si des gens qui n’ont pas de pratiques collectives et militantes seront trop rebutés par des questionnements qui leur sont étrangers, et se diront que ça ne les concerne pas. Par ailleurs, on part déjà d’un entre-deux, on se positionne un peu comme des intermédiaires, à cheval sur différents réseaux, postures, perspectives, qui ne s’entendent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se connaissent pas forcément. Ce n’est qu’un exemple, mais dans le champ des militances et politisations féministes, on avance rarement les critiques anti-indus, et inversement. Ces univers ne sont pas forcément très poreux les uns aux autres. On n’a pas fait de choix entre les deux, on a tenté de créer des ponts entre ces questions.
K : Dans les nouvelles que nous avons écrites, nous avons aussi cherché à nous faire du bien en réconciliant des gens de notre entourage qui n’arrivent pas à se côtoyer aujourd’hui. Ce qui nous rassemble tou⋅tes les trois, c’est d’être impliqué·es dans des luttes différentes, de vouloir en permanence créer des ponts entre elles. C’était passionnant de se dire : « Là, dans l’Haraka, ces personnes n’auront pas d’autre choix que de faire des trucs ensemble ! »
Il y a aussi la contrainte de proposer un monde désirable – certes très stimulante, comme on peut l’éprouver dans les ateliers. Dans quelle mesure cette contrainte ne vous a-t-elle pas parfois empêché·es d’imaginer des situations vraiment problématiques ? Comment avez-vous abordé les éventuels problèmes de l’Haraka ?
R : Je trouve que ça n’empêche pas d’imaginer ces situations. Simplement, le focus n’est pas le même que le focus militant : au lieu de se demander comment faire chier le plus possible les institutions de l’État, entraver les rouages du capitalisme, on se demande comment on veut arriver au monde qu’on désire. Ce qui n’empêche pas les problèmes de surgir comme des montagnes.
H : Après, il y a des montagnes qui sont tellement grosses qu’on en a fait des ellipses. Les questions pour lesquelles on n’avait pas de réponse, on a choisi de ne pas les traiter. On en revient à l’avantage des nouvelles, ce pari qu’il y a bien quelqu’un⋅e qui nous écrira une nouvelle sur le démantèlement nucléaire, parce que nous, on n’a pas suffisamment d’imaginaire pour réussir à fabriquer cette étape. Ce serait aussi super que d’autres réfléchissent à la question de la défense militaire extérieure, parce que s’il y a des capitalistes de l’autre côté de la frontière, à un moment ils voudront revenir. Faut-il un dispositif de défense ? Un bouclier anti-missiles ? Face à de telles questions, nous nous disons : « Nous allons lancer ça dans des ateliers… »
K : On a eu la confirmation que notre démarche touchait juste avec l’exemple du nucléaire. Dans les dix premiers ateliers faits à l’automne, des participant·es avec des compétences et des connaissances sur le fonctionnement des centrales nucléaires ont commencé à construire un imaginaire rassurant, qui rendait possible d’envisager pratiquement le démantèlement. Les hypothèses qu’on nous assène sans cesse, selon lesquelles on est dans la société nucléaire jusqu’à la fin du monde, ont explosé face à cet autre imaginaire, avec de vraies perspectives : les réacteurs mettent vingt ans à refroidir, que mettra-t-on donc en place pendant vingt ans pour permettre ce refroidissement ? Et après ? Imaginer tout ça m’a libérée de quelque chose. Je peux enfin arrêter de penser qu’on est foutu⋅es sur les questions du nucléaire.
Notre question concernait moins les problèmes techniques que vous n’avez pas abordés, que les problème politiques abordés de façon plutôt douce. Par exemple, il y a les récalcitrant·es, c’est-à-dire ces personnes qui n’ont pas accepté la fin du capitalisme et l’Haraka. Celui dont vous racontez le désarmement est plutôt un vieux gâteux gentil. Il aurait pu être beaucoup plus dur ; il y aurait pu y avoir des morts à ce moment-là, il aurait pu y avoir une communauté fasciste… D’ailleurs, très vite, au cours de la lecture, on se pose la question de l’importance des fascistes. Le livre y répond un peu au fur et à mesure, mais on sent bien la contrainte du désirable, parce que ça aurait pu, voire ça aurait dû être bien pire…
H : Lors d’un atelier à Saint-Étienne, en s’inspirant de son village d’origine où ses parents vivent toujours, et où elle reviendrait après la révolution, une personne a projeté un regroupement très réactionnaire à tendance fasciste et communautaire. Tout en se rapprochant d’autres personnes sur des positions autogestionnaires plus ouvertes, elle se questionnait et restait à proximité de ce groupe, se demandant ce qui pouvait se travailler dans le quotidien avec ces gens-là. Son imaginaire s’appuyait sur ce qu’elle connaissait réellement de cette campagne, de ses habitant·es, de ses voisin·es. Nous, on n’a pas tout exploré. Sur de nombreux aspects, on n’avait pas de matière pour réussir à nous projeter… Mais cette tournée me donne confiance : sur plein de sujets épineux, quand on commence à creuser, on trouve des chemins, des idées qui passeront par des histoires plus ou moins dures ou glauques. Personnellement, j’ai envie par exemple d’une nouvelle autour d’un accident du travail, sur tous ces gens qui se réapproprient avec enthousiasme plein d’outils, ont des pratiques hyper dangereuses, et se tuent plus souvent au travail qu’à l’époque du salariat. Qu’est-ce que ça produit ? Comment les gens font face à une telle situation ? Puis, ce serait super que des gens racontent, par exemple, le point de vue des personnes hors de l’Haraka. Que perçoivent-elles de l’extérieur ? Est-ce qu’il y a eu un mouvement social réprimé ? En étaient-elles ou pas ? Y a-t-il du soutien, nous passent-elles du matos ? Quel est l’état de la propagande ?

La question des échanges avec les États-libres 11 est très enthousiasmante : imaginer une nouvelle où des ados né·es après le basculement voudraient regarder des films hollywoodiens, par exemple…
R : Ou des personnes qui raconteraient l’expérience d’habiter sur la frontière, de n’être ni d’un côté ni de l’autre… Qu’est-ce que le lieu de la frontière ?
H : Et aussi, des hypothèses plus fantasmagoriques ou oniriques, avec des personnages développant des pratiques magiques. Comme une personne dans un atelier qui a dit : « Une des premières choses qui se passe, c’est qu’on abolit la Méditerranée : il n’y a plus de mer donc on ne peut plus se noyer dedans. » Nous, on était très peu là-dedans, on avait un niveau assez faible de magie dans nos imaginaires, mais ça émerge de temps en temps de l’esprit de participant·es aux ateliers. C’est enthousiasmant de voir comment ça ouvre des possibilités très différentes.
L’idée de la tournée d’ateliers vient-elle de là ? De ce désir de prolonger le livre de multiples manières ?
R : Avant de trouver un éditeur, on avait déjà imaginé l’atelier qu’on propose durant cette tournée, parce qu’on avait tou·tes les trois une très forte envie de partager cet enthousiasme à se faire prendre par un monde révolutionné victorieux, à se demander ce qu’on foutrait dedans. Dès le début, on partait du principe que même si on ne trouvait pas d’éditeur, on ferait une tournée avec ces ateliers, soit sans livre, soit en auto-éditant. On souhaitait que ça continue, et qu’on embarque des gens là-dedans au passage.
C’est une tournée énorme…
H : Oui, elle s’étale sur plusieurs mois, avec un atelier soit de 2 h 30, soit de 4 h. Ce sont des ateliers d’imagination qui passent uniquement par la discussion, même si, quand on dit « atelier », tout le monde pense directement « atelier d’écriture ». C’est une forme qu’on voulait vraiment abordable, accessible à des publics très différents, pour faire éprouver ce que c’est de se mettre dans la projection imaginaire, avant d’être dans la technicité de l’écriture, qui est une autre étape. Mais, à mi-parcours, on commence à avoir envie de proposer des ateliers d’écriture en plus, comme celui qui s’est déroulé à la Parole errante 12.
R : On a essayé de l’appeler « labo-fiction », qui est un très joli nom, mais ça ne marche pas. Même quand on leur dit plusieurs fois, les gens croient quand même que c’est un atelier d’écriture.
K : On pourrait dire que c’est une sorte de jeu de rôles. Peut-être que ça marquerait plus les esprits.
R : Quant aux lieux qui nous accueillent, ce sont des librairies, des salles des fêtes, des bibliothèques municipales, des centres ou écoles d’art, des cafés associatifs, des squats, des espaces autogérés… Et chaque atelier est très différent. Il y a des couleurs, des ambiances qui varient selon plusieurs facteurs : si les gens se connaissent beaucoup, ou sont très impliqués dans la même zone géographique, ou sont sur des corps de métiers ou des classes sociales similaires, etc. Mais le dispositif reste assez semblable. On l’ajuste au fur et à mesure, on débriefe entre deux ateliers. Sur un groupe, tu peux parfois sentir que des gens se sont braqués parce qu’ils ont surinterprété ce qu’on proposait dans un sens, au lieu de se laisser embarquer dans l’exercice d’une manière fluide. Si les questions posées produisent toujours le même genre de réponse, on décale un peu la manière de poser la question – pour ne pas induire aussi fortement tel type de réponse, ou donner d’autres pistes.
K : Que tu prononces un mot ou pas pendant l’introduction, ça peut changer du tout au tout. C’est assez effrayant.
Pour y avoir participé, nous avons eu l’impression que quand on commence à imaginer comment serait ce monde, ce sont les contraintes, les empêchements qui viennent en premier…
K : C’est un mouvement récurrent, on le vit sur tous les ateliers. L’automatisme dystopique nous pousse vers l’impossible plutôt que vers le possible. Par exemple, beaucoup de gens se disent : « On ne pourra plus voyager. » ou « Il n’y aura plus d’électricité. » Or, notre proposition, c’est de partir d’un autre endroit : si on a envie de pouvoir voyager, on cherche à imaginer les conditions qui rendraient possibles les voyages dans ce monde-là. Cet exercice de construction d’imaginaires désirables est super utile, et ce n’est qu’en l’éprouvant qu’on en prend conscience : il nous oblige à changer notre manière de nous projeter – sans commencer par : « Non, c’est pas possible » – et permet de réouvrir des possibles imaginaires qui nous aident ensuite dans le quotidien, dans nos vies réelles, qui nous redonnent une forme d’énergie.
H : Cette tournée est assez exaltante, très addictive. Elle nous fait entendre des dizaines d’histoires et d’idées incroyables, que les gens puisent en eux et dans leurs propres expertises – expertises au sens technique, mais aussi au sens de vécus, d’expériences. C’est très stimulant, et émouvant, de voir comment des gens se mettent en jeu en peu de temps, se demandant ce qu’iels fabriqueraient là-dedans. On sort de la plupart des ateliers hyper excité·es… Je dis « on » pour parler de ma sensation avec les participant·es, pas spécialement en tant qu’animatrice.
Avez-vous eu des retours sur une possible fatigue liée à la vie dans l’Haraka, qui viendrait de la nécessité de tout régler collectivement, de se sentir concerné·e par des aspects de la vie matérielle auxquels on réfléchit peu, aujourd’hui, mais aussi due au rapport à la parole, aux réunions permanentes, aux AG interminables ?
H : C’était un truc que personnellement j’avais en tête, peut-être parce que je vis ça quotidiennement. Mais on a beaucoup moins eu ce retour que ce à quoi je m’attendais.
K : Dans les grosses entreprises, les gens passent aussi leurs vies dans les réunions. Seulement, elles sont encore pires que les nôtres : tu es avec vingt personnes que tu ne connais pas, tu dois passer deux heures à écouter un powerpoint chiant de la fatigue que j’ai pu ressentir, au bout d’un moment, en habitant en squat : tu te lèves le matin en programmant ce que tu vas faire de ta journée puis, le soir, tu as fait complètement autre chose – à cause d’imprévus, du manque de matériel ou parce qu’il fallait réparer le siphon, puis les gens ont débarqué pour faire à manger… J’aurais bien aimé mettre cette fatigue en scène.
R : Lors d’un atelier, on essayait de penser les difficultés des personnes isolées, et on se disait qu’effectivement un monde comme ça décloisonnerait très fort et que ça pourrait être très angoissant pour certaines personnes. Quelles sont la place et la possibilité de la solitude dans ce monde sans que ça soit jugé moralement ?

La question du jugement moral traverse le livre en filigrane : une fois qu’il n’y a plus de travail salarié, quels rapports de force peuvent se développer entre des personnes qui, par exemple, écrivent, font de la musique, sont fatiguées ou ont envie de vivre seules ? En somme qui ne veulent pas ou pas trop participer à la survie collective ? Le fait que cette question apparaisse en creux, est-ce un accident ?
H : Pour moi, ce n’est pas un accident, ça se pose forcément et de manière récurrente. Qu’est-ce qui fait norme ? Qu’est-ce qui fait société ? Comment les gens se foutent la pression ? Où s’exerce le contrôle social ? Par quelles voies ? On ne se départit pas de la question des effets normatifs de la vie à plusieurs. De chaque histoire, et selon la personnalité de chacun des personnages, se dégagent différentes manières de traverser ces questions, de se positionner, de s’en protéger ou de jouer en plein dedans. J’aurais du mal à le voir comme un sujet qu’on traiterait seulement dans une nouvelle en particulier, c’est sous-jacent à toutes.
K : Quand on a fait le labo-fiction à Lyon, il y avait cet imaginaire étonnant, où une communauté de « maniaques » – c’est comme ça qu’iels se définissaient –, complètement obsédé·es par l’efficacité, avaient fini par se retrouver ensemble tellement les gens les trouvaient insupportables. Iels arrivaient à fonctionner ensemble grâce à ces valeurs communes – ce qui les amenait par exemple à des considérations telles que : « Tant pis si on bouffe des patates à tous les repas si ça nous demande moins de boulot. » La personne qui l’avait imaginé s’inspirait de sa lecture de Bolo’ Bolo 13. C’est une des références que j’avais moi aussi souvent en tête lors de l’écriture : cette idée de communautés de 100 à 500 personnes qui se regroupent autour d’une certaine manière d’être.
R : Une autre grande inspiration commune, c’est Ursula Le Guin et le féminisme de ses textes de science-fiction et de fantasy. L’aspect moral, par exemple dans Les Dépossédés 14, est très présent. La planète Anarres, qui abrite une société émancipée de l’État et du capitalisme, est un monde aride et pauvre, les gens sont obligés de s’entraider ; alors, les comportements dépensiers en ressources sont perçus comme antisociaux. L’histoire s’achève sur un groupe de personnes qui décident d’imprimer une pièce de théâtre dont personne ne veut, alors qu’il n’y a pas beaucoup de papier… Elles jouent les anarchistes chez les anarchistes ! Cette image est assez juste : dans les collectifs, il y a des codes moraux qui se créent, puis des personnes les trouvent trop étouffants et décident de les exploser. Cela fait bouger et reconfigure le monde.
H : En tous cas, la puissance de la fiction est de pouvoir créer des personnages moralistes, qui en font chier d’autres, et dont on rend visibles les contradictions, les limites. De faire figurer toute la complexité de la vie, avec nous tou·tes qui sommes tordu·es, de mauvaise foi à des moments, cherchant à faire du mieux qu’on peut, et des fois pas. Sortir des pensées totalisantes, argumentaires, cohérentes, pour travailler le réel avec ses limites et ses contradictions, me pousse à défendre l’idée de faire plus de fiction pour réfléchir le politique. Je ne dis pas qu’il n’y a que la fiction pour le faire, mais elle aide beaucoup, car c’est une forme qui se prête au travail des aspects rugueux et forcément imparfaits de l’humain.

Montreuil 2022
Les ateliers de l’Antémonde accompagnent la sortie de Bâtir aussi d’une série d’ateliers d’imagination dénommés « labo-fiction », où les participant·es sont invité·es à se projeter dans l’Haraka. Ces ateliers reposent uniquement sur des conversations en groupes à partir de consignes prodiguées par les animateur·es. En novembre 2018, le lendemain d’un labo-fiction à la Parole Errante, celleux-ci ont proposé un atelier d’écriture à tou·tes les participant·es d’Île-de-France. Ces textes ont ensuite donné lieu à une performance musicale lors de l’émission radio en direct « Radio cheval », concoctée par la Parole errante demain, la Quincaillerie, le quartier libre des Lentillères et la médiathèque NGHE en clôture des trois semaines de résidence de la compagnie Les Endimanchés et leur spectacle Modules DADA. À lire et écouter.
Montreuil, Commune du 9.3, 2022
Nous sommes en 2022, après la guerre civile entre la Commune du 9.3 et L’État libre Versailles-Neuilly, quand Paris n’était plus qu’une zone de guerre.
Après la Grande Récupération des denrées non périssables des supermarchés, de tonnes de matos électronique, des livres sauvés de la BNF incendiée, du métal de la Tour Eiffel déboulonnée, des disques durs de la Banque de France…
Après la Grande Disette, quand la population des villes bataillait avec les autres animaux, en concurrence pour la nourriture.
Après l’exode urbain massif, qui laissa tant de bâtiments abandonnés.
En 2022, à Montreuil, quartier de la Commune du 9.3, les Chantiers-écoles ont réintroduit l’élevage (troupeaux mixtes chèvres et moutons) et les cultures en terrasse aux parcs des Guillands et des Beaumont.
Beaucoup de terrains sont encore en dépollution et les zones toxiques impossibles à dépolluer sont entourées de rues-balises. « Ne pas habiter, ne pas cultiver. »
Toutes sortes de vélos, tricycles et triporteurs circulent dans la ville.
La plupart des toits ont été terrassés et mis en culture, il y a des champignonnières dans les parkings, et des brasseries dans les caves.
Les anciens centres de santé fonctionnent toujours et se sont multipliés dans la ville, comme lieux de médecine préventive. À l’Hôpital Communal de Laboissière André Grégoire, on se concentre sur les maladies graves, et un collectif réunissant ingénieur⋅es, usager⋅es de médocs et teufeur⋅ses expert⋅es en MDMA, cherche à mettre en place un laboratoire de production locale de molécules.
En 2022, la Parole errante s’est étendue à de nombreux bâtiments de la rue piétonne désertée de ses commerces et de la plupart de ses habitant⋅es. Le lieu n’est plus seulement une grande zone de stockage et d’inventaire du matériel accumulé lors de la Grande Récupération. Elle foisonne d’une multitude d’activités publiques, de la ferme-école aux cantines de rue midi et soir, en passant par le ciné-club de l’Antémonde ou l’atelier permanent Radio Michto, qui émet désormais en FM dans toute la Commune du 9.3 sur la fréquence 105.8.
12 février 2022, la Parole errante, Commune du 9.3 :
C’est la 90ème réunion du groupe mémoire, à raison d’une réunion par semaine. Les plus jeunes ont insisté pour qu’on fasse quelques réunions sur l’Antémonde, alors qu’il avait jusque-là été décidé de se concentrer sur la période du soulèvement, sur les dix dernières années de l’Haraka. Les jeunes en avaient un peu marre des faits d’armes, des récits de la guerre civile, des bouts d’histoire qu’iels avaient plus ou moins vécus. « Ça va, ça on le sait, ça ne nous apprend rien. » « On veut savoir de l’avant, on veut savoir ce qu’on ne connaît pas. » Ç’a été de longues discussions pour savoir si on allait faire ça, revenir sur cet Antémonde dont on avait mis tant de temps à se débarrasser. Et puis c’est les plus vieux, les vraiment plus vieilles qui ont insisté pour qu’on parle de ça aux réunions, ceux et celles qui ont vécu la guerre de 39-45, les restrictions, les rationnements, et ont déjà constitué, sept ans auparavant, des groupes de transmissions de savoir sur l’Antémonde, à propos des techniques de débrouille inventées au quotidien pendant cette guerre.
« Bien, la parole est à tous et toutes, évoquez des souvenirs, posez des questions, approfondissez des problématiques, trouvez des résonnances avec aujourd’hui. Et surtout, à l’aise, Blaise. »
Iggy ose. « Bon voilà, j’ai jamais trop osé poser la question et à chaque fois j’oublie, mais c’était quoi un syndicat, c’était quoi le travail ? Du peu que j’ai discuté avec les autres et tout, j’arrive pas bien à comprendre et… hum… j’ose pas trop mais je me lance : est-ce que le travail a totalement disparu ? Par exemple, est-ce que quand je vais pendant une semaine à la champignonnière des anciens parkings et que, pour tout dire, ça me fait chier, est ce que c’est du travail ou pas ? Parce que, de ce que j’ai compris, un peu, ça a l’air de ressembler. Est-ce que quand on se résout à aller traire les chèvres au parc des Beaumonts parce que les autres groupes nous font la misère pour qu’on prenne notre part, c’est du travail ? Heu, voilà, c’était ma question. »
Billy lui sourit et lui donne un petit coup de coude genre cool, Raoul, et ceux et celles qui ont vécu l’époque du salariat, des syndicats – Confédération générale du travail, Confédération nationale du travail et tout le toutim – font toutes sortes de mimiques, bouche pincées, yeux en l’air, grands soupirs…
La suite de la réunion risque de ne pas être une mince affaire.

22 mars 2022, la Parole errante, Commune du 9.3 :
« L’arme décisive du guérillero est le mot. » Voilà, je me suis souvenu que je suis entré dans ce lieu, à la Parole errante, par ces mots peints sur une énorme banderole qui mangeait tout l’espace du Hangar. C’était encore l’Antémonde. Ça me fait bizarre de m’en souvenir aujourd’hui, en pleine réunion hebdo du groupe mémoire, alors qu’il est question de renommer les différents espaces du lieu. Les renommer pour faire voir à tous et toutes le chemin que nous avons parcouru ensemble.
En moins de deux réunions – un exploit – on est arrivé⋅es à tomber d’accord sur la plupart des noms à attribuer aux différents espaces : l’Arche Armand Gatti pour la grande salle, évidemment, la cafétéria-médiathèque Michèle Firk, le centre social Jenny Marx, la ferme-école Jérôme Laronze, le jardin d’enfants Christiane Rochefort, le magasin général Jacques Rancière, l’atelier d’anti-production Gaston Lagaffe, le cinéma en plein air Hélène Chatelain – qu’elle inaugurera elle-même le mois prochain ; on s’est mis⋅e d’accord pour utiliser aussi des noms de belles personnes vivantes.
MAIS on doit maintenant décider de la couleur de la peinture qu’on utilisera pour dessiner ces noms, et là, ça se complique.
Rouge ? Trop sanglant pour les unes, stal pour d’autres.
Noir ? Trop triste, ou trop anar.
Jaune ? C’est la couleur des Neuilléens-versaillais et Neuilléennes-versaillaises.
Verts ? C’est l’unique couleur acceptée par les primotiv’s qui pourrissent toutes nos AG.
Moi, je vais défendre le bleu – maintenant qu’aucune force hostile ne la revendique – mais vu la teneur des débats, je pense que je prendrai la parole la prochaine fois…
Un soir du printemps 2022, à la Parole errante, Commune du 9.3 :
Je voudrais tenir le bar, faire les entrées, donner un coup de main pour la sono ou montrer aux invité·es le chemin du dortoir pour la fin de la nuit. Mais ce n’est pas une de nos fêtes, les autres ont tout bien prévu, à leur manière. Je ne suis pas dans l’organisation. Je devrais boire une bière, aller danser. Je ne sais plus faire la fête. Trouvez-moi une fonction sociale claire dans ce beau bazar. Oui, c’est vrai, c’est beau de voir toutes ces personnes s’amuser. Il faut que j’apprenne à faire la fête.
Je m’arrête dans la salle, tout bouge autour de moi, je vois le sol se disperser sur les chaussures de toutes. Danser, prendre une bière, mettre du PQ dans les toilettes, refermer la porte bleue derrière qui donne sur un trou béant, s’enlacer devant la porte du local électrique, escalader l’échafaudage, tomber d’une marche, tituber, virer un gars, se recoiffer dans un miroir couvert de tags. Sans bouger, je vois ou devine tous ces gestes, toutes ces mains, tous ces doigts, ces ongles, prendre les portes, saisir les peaux. Danser, se prendre par le cou, faire un croche-pied, cracher un bout de tabac, régler les lumières qui aveugleront, renverser la nuit. Faire la fête. Seuls nos yeux dansent, des yeux fous. Et derrière une image fixe, la boîte de nuit de…
Je cligne des yeux, j’ai mal aux paupières, l’automatisme des gestes continue, pris dans les frasques de la boule à facettes. L’image fixe derrière. L’alcool m’éclate les tympans à chaque gorgée, je suis sûre qu’on va finir sourd, aveugle, ou mort à force d’en boire. Mais j’en bois, on en boit. Très peu. En mettre un peu sous la langue et le garder quelques secondes avant d’avaler.
La Parole errante est toujours là, même odeur, même trou béant derrière laissé par les assauts de 2015. On a dû apprendre à nouveau à jouer, après tout ça, parce que « tout ça » n’était pas un jeu : « tout ça » nous a enlevé de nos corps des morceaux de plaisirs, de joies, des envies de rencontres ou de flirts. « Tout ça », on doit le dépasser et jouer, faire la fête, se regarder dans les yeux sans penser à rien. Danser ? On a traversé une guerre, pourrait-on dire, un soulèvement, une révolution, dans tout ce que cela raconte d’oppressions, d’horreurs. On voulait ça, on le voulait mais en même temps on se l’est bien pris dans la gueule.
Ce ne sont plus seulement des oiseaux qui viennent picorer là. Maintenant il y a des renards.
Gatti serait heureux – enfin j’imagine, même s’il parlait surtout des rossignols.
J’ai triché pour les attirer. J’ai même un peu menti pour prendre une portion supplémentaire dans les réserves, en disant que c’était pour la voisine. Mais la viande attire plus sûrement un renard que les restes de salades. Je l’ai peinte en gris pour qu’elle ne se voit pas au milieu des graviers. C’est tout au fond dans un coin mais on ne sait jamais. Étienne avait retrouvé des réserves de colorant alimentaire dans l’ancienne pizzeria. Je ne sais pas ce qu’ils en faisaient mais ça a bien marché. Ça fait trois jours qu’il vient, presque toujours à la même heure, à l’aube, quand tout le monde dort encore. Certain⋅es fument en terrasse mais ils n’y voient rien. Ils et elles n’entendent pas non plus. J’aime beaucoup Montreuil à l’aube, quand il n’y a personne sauf les fouines et les renards. C’est compliqué d’ailleurs, l’autre jour, un renard a attrapé une fouine, certain⋅es en étaient tristes, il ne faut pas qu’ils ou elles apprennent que je les attire exprès.
Ça va encore faire des débats monstres entre les végan⋅es radicaux et radicales et la cantine carniste spécialisée dans les kebabs de rats. Et tout simplement avec toutes celles et ceux qui en ont marre de batailler avec les animaux chaque fois qu’iels bougent d’un lieu à l’autre. C’est vrai que se sentir suivi par une vingtaine de chiens errants dans la rue, ça fait pédaler plus vite. Mais après tout, s’il y a des fouines et des renards ici, c’est parce qu’ils peuvent encore se planquer, même si je ne vois pas comment ils tiennent face aux animaux qui vivent encore dans les ruines.

- Voir par exemple, Technocritiques. Du refus des machines à la contestation des techno-sciences, La Découverte, 2014. ↩
- Surnommé « Unabomber » par le FBI, le mathématicien Theodore Kaczynski a été pendant quinze ans l’ennemi public numéro un aux États-Unis. De 1978 à 1996, il a envoyé seize colis piégés artisanaux à diverses personnes construisant ou défendant la société technologique, qui firent trois morts et vingt-trois blessé⋅es. Il a pendant ce temps écrit un manifeste, faisant aujourd’hui référence dans la critique de la technologie (disponible en français sous le titre La Société industrielle et son avenir, L’Encyclopédie des nuisances, 1998). Voir aussi l’entretien avec le cinéaste James Benning, qui lui a consacré un film, « 3×3,65 mètres », paru dans la premier numéro de Jef Klak. ↩
- En écologie, désigne un point de bascule climatique : par exemple des températures critiques au-delà desquelles la fonte des glaces s’accélérera, modifiant inexorablement les conditions de vie sur la planète. ↩
- Le primitivisme, ou anarcho-primitivisme, est un courant politique qui considère la révolution industrielle comme la source principale des différentes formes d’aliénation qui pèsent sur la liberté humaine. Essentiellement théorisée aux États-Unis, cette doctrine prône l’abandon du mythe du progrès et l’avènement d’une société sans État qui s’inspirerait des sociétés pré-industrielles, considérées comme des sociétés naturellement anarchistes. ↩
- C’est aussi la manière dont Ursula Le Guin sous-titre son roman Les Dépossédés (Robert Laffont, 1983), qui met en scène le face à face entre deux mondes sans contact depuis deux siècles : Urras, planète luxuriante mais réputée liberticide, violente et corrompue, et sa lune jumelle Anarres, peuplée deux cents ans plus tôt par des dissidents de la planète mère, désireux de créer une société égalitaire, mais sur une planète à l’environnement bien plus hostile. ↩
- Archaos ou le jardin étincelant, Grasset, 1972. ↩
- Wu Ming est un collectif d’écrivain·es italien·nes fondé en 2000 à Bologne, qui a publié plusieurs romans, dont Manituana (Métailié, 2009). Ses membres avaient fait partie du projet Luther Blissett, pseudonyme emprunté à un footballer du Milan AC et adopté par de nombreux⋅ses militant·es en Europe et en Amérique latine pour dénoncer l’industrie culturelle et médiatique, à travers un plan quinquennal d’actions, performances et canulars. Leurs actions allaient de la médiatisation de rituels sataniques en Italie centrale, à la publication de faux textes inédits d’Hakim Bey, auteur de l’essai à succès TAZ (Temporary Autonomous Zone, Zone d’autonomie temporaire en français). Le projet prit fin avec la sortie du roman Q, traduit en français sous le titre L’Œil de la Carafa (Seuil, 2001). ↩
- Dans Bâtir aussi, l’Haraka (mouvement, en arabe) désigne le monde révolutionné d’après le soulèvement initié par les printemps arabes qui, dans la fiction, ont essaimé sur toute la planète. ↩
- Dans la dernière nouvelle, « Ressorcelées ». ↩
- Les prochaines dates des ateliers sont à retrouver sur le site antemonde.org. ↩
- Dans Bâtir aussi, les États-libres sont ceux qui ont réussi à empêcher la révolution et continuent de vivre dans un système capitaliste. ↩
- Voir l’encadré ci-dessous. ↩
- Bolo’bolo (P.M., L’Éclat, 1983) est un essai d’écologie politique-fiction, qui imagine la fin de la Machine-Travail planétaire (MTP) – parabole du système capitaliste – et son remplacement par de nouvelles formes d’organisation sociale, sans salariat, argent ni État, qui abandonnent l’unité classique du ménage biparental pour une structure en bolo. Un bolo est une communauté autonome formée celles et ceux qui choisissent librement d’y participer, et qui peut avoir la taille d’une grande maison, d’un village ou d’un quartier – plusieurs bolos pouvant s’associer pour former des unités de coopération de la taille d’une commune ou d’une grande ville. ↩
- Ouvr. cité. ↩