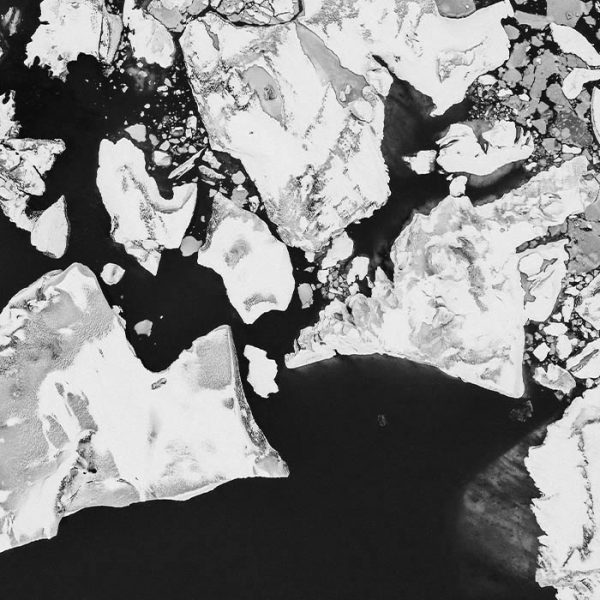Contrairement à sa dépolitisante condamnation médiatique et policière, la joyeuse mise à feu et à sac de « la plus belle avenue du monde » par une rue jaune de rage samedi dernier a été un message clair aux maîtres (de la fin) du monde. Pas simplement adressé gouvernement actuel de l’entreprise-France, mais aussi aux multinationales, ces gouvernements privés qui tentent encore de faire croire que leurs décisions répondent à une raison économique par delà le bien et le mal, par delà le politique. Dans La Société ingouvernable. Une généalogie du libéralisme autoritaire (La Fabrique, 2018), Grégoire Chamayou décrypte cette soi-disant raison économique en relisant les écrits et controverses des théoriciens du management et autres militants de l’économie ; il propose à ses lecteurs et lectrices une boîte à outil pour mieux appréhender les formes contemporaines du pouvoir. Mathieu Triclot nous en livre une recension placée sous le signe de l’amitié philosophique : pas de regard expert, mais une lecture critique d’un ouvrage qui cogne et enrage.
Photographies : Olivier Saint-Hilaire, oliviersainthilaire.com.

Grand Est/Meuse – “Grand débat, bla bla”. Assemblée des assemblées de Gilets jaunes organisée à l’appel des gilets jaunes de Commercy à Sorcy Saint Martin le 26 janvier 2019.
Fausses pistes
La couverture de La Société ingouvernable m’a d’abord entraîné sur de fausses pistes. Les ouvrages précédents de Grégoire Chamayou, Théorie du drone, Les Chasses à l’homme et Les Corps vils, mettaient en avant des objets énigmatiques aux titres intrigants. À l’inverse, le programme d’une « généalogie du libéralisme autoritaire » semble renvoyer à du trop bien connu. Qu’est-ce que le livre pourrait bien nous dire que ne nous dit déjà cette photo de Bolsonaro à Davos, attablé avec les patrons de Microsoft et d’Apple, ce dernier arborant sa petite pancarte « Brazil, country of opportunities » ? Pas mal de choses, puisque ce n’est pas (seulement) de cela qu’il s’agit.
Et puis, là-dessus vient se greffer, évidemment, une immense surchauffe sémantique, servie par l’actualité : surdétermination totale du livre par l’événement. La Société Ingouvernable paraît pile un jour après la pétition contre la hausse des prix des carburants, un mois avant l’Acte I des Gilets jaunes. Et au surgissement de l’ingouvernable – « contre-disposition rétive, esprit d’insubordination, refus d’être gouverné, du moins “pas comme ça, pas pour ça, pas pour eux”. » (p. 8) – répondent les tactiques du libéralisme autoritaire : loi « anti-casseurs », « flashballs » LBD40, grenades de désencerclement, et corps mutilés à vie. Titre et sous-titre tournent en boucle sous nos yeux : qu’est-ce qu’un livre pourrait nous apprendre que la rue ne nous montre déjà ? Des effets d’écho permanents accompagnent le lecteur : à son discours de la galette des rois, Macron blâme « la perte du sens de l’effort des Français 1 », ânonnant la vieille litanie de « l’affaiblissement général de la tolérance à la frustration » dont souffrent les travailleur⋅ses (p. 25), disséquée dans le chapitre 3. Le 28 janvier, il rassure une journaliste allemande : « Non, la France n’est pas devenue ingouvernable 2 ».
Mais l’ouvrage décolle de l’actualité immédiate par deux mouvements. D’abord parce que la « société ingouvernable » dont il est question ne désigne pas seulement la rue, mais aussi la firme, l’entreprise. L’ingouvernable « peut avoir deux grandes polarités, en bas, chez les gouvernés, en haut, chez les gouvernants » (p. 8). L’originalité de l’ouvrage est d’aller voir ce qui se passe « en haut ». Par conséquent, ce que le livre met au centre – le pouvoir privé de la firme, le marché comme dispositif disciplinaire – est aussi ce qui est le plus largement occulté dans le mouvement des gilets jaunes qui, dans sa forme actuelle, ne s’adresse pas directement à ces gouvernements privés que sont les entreprises.

Grand Est/Meuse – “Tout pouvoir à la base”. Assemblée des assemblées organisée à l’appel des gilets jaunes de Commercy à Sorcy Saint Martin le 26 janvier 2019.
Philosophie politique de l’entreprise
J’ai commencé par dire ce que l’ouvrage n’était pas, ou ce que j’ai d’abord cru qu’il était. En quoi donc consiste-t-il ? La Société ingouvernable, c’est une manœuvre théorique : refuser de lire la littérature des économistes et gestionnaires dans ses propres termes ; mais la relire en tant que philosophie politique. Un renversement : vous mettez un économiste sur un tapis, vous tirez brutalement le tapis, le sol se dérobe sous ses pieds, il chute. Sous le tapis, depuis toujours, se dissimulait la politique : pouvoir, violence, institutions, technologie, tactiques. Cette manœuvre de renversement reproduit en théorie la stratégie pratique des activistes qui vise à « politiser l’entreprise » (p. 80), la rendre comptable de ses actes en tant que gouvernement privé. L’enjeu n’est rien moins qu’une mise à niveau de la philosophie politique pour décrypter les formes contemporaines de la puissance : « Alors même que la grande entreprise est l’une des institutions dominantes du monde contemporain, la philosophie demeure sous-équipée pour la penser. De son corpus traditionnel, elle a surtout hérité de théories du pouvoir d’État et de la souveraineté qui remontent au XVIIe siècle » (p. 10).
Cette relecture politique des théories de l’entreprise prend d’abord appui sur l’existence de théories qui, elles-mêmes, abordent l’entreprise comme entité politique ou « gouvernement privé ». C’est le cas des théories du managérialisme éthique, étudiées au chapitre 6, qui réinventent le despotisme éclairé face à la crise de légitimité des multinationales. C’est encore le cas des théories policières de la firme (ch. 13), qui conçoivent la genèse du pouvoir managérial à la manière de Hobbes, désignant un garde-chiourme pour que les autres se tiennent à carreau. C’est à nouveau le cas de la théorie des parties prenantes (ch. 17) qui « rhabille les vieux thèmes managérialistes » (p. 144) dans le langage du partenariat. Des philosophies politiques de la firme, il y en a donc déjà, subsumées sous la notion de « managérialité » – c’est-à-dire, « un art d’exercer le pouvoir économique dans la forme d’une certaine politique, d’une politique privée » (p. 49).
Quel besoin y a-t-il, dès lors, de relire ce corpus sous l’angle de la philosophie politique ? L’objet principal de l’ouvrage consiste en réalité à rendre compte de la dénégation qu’opèrent les théories économiques dominantes de cette stratégie de politisation. Ainsi, les « théories de la firme » dissolvent les rapports de pouvoir dans l’entreprise en les ramenant à des nœuds de contrats (ch. 12). C’est encore ce que fait, à une échelle supérieure, le programme de Friedrich Hayek 3, considéré comme le père du néolibéralisme, qui vise à « détrôner la politique » et à placer les choix économiques hors de la décision démocratique (p. 236).
Ces mouvements de politisation, dépolitisation, repolitisation de l’entreprise forment un pas de danse complexe, d’autant qu’ils se reproduisent à divers étages de la régulation économique : au niveau de la firme – dans la relation entre travailleur⋅ses et managers, managers et actionnaires, managers et groupes de pression –, mais aussi au niveau des États qui, conformément au programme néolibéral, se dessaisissent de leur propre puissance d’agir sur le terrain économique, sauf précisément quand il s’agit d’encourager le marché. La philosophie politique de l’entreprise que propose La Société ingouvernable s’entend donc comme la dénégation d’une dénégation : renverser la dépolitisation de l’entreprise qui s’opère dans les théories de la firme au détriment des anciennes théories managérialistes. Mais Chamayou ne s’arrête pas là. À travers le concept de catallarchie, formé à partir de la lecture critique de Hayek, il s’agit de saisir cette forme de politique – « pouvoir destituant » (p. 236), « intervention dépolitisante » (p. 237) – qui passe son temps à se nier en tant que telle. Si la catallaxie désignait chez Hayek l’ordre spontané des marchés, la catallarchie désigne chez Chamayou ce « nouveau régime de gouvernement à concevoir comme un gouvernement des gouvernants par les marchés », un pouvoir qui s’exerce de manière « impersonnelle », « indirecte », « automatique », sous la sanction des indicateurs boursiers. Ainsi, « les marchés en même temps qu’ils remplissent sans relâche leur fonction spéculative, exercent, sans même que ses agents aient besoin de le vouloir, une fonction de police » (p. 242).

Une manifestante montre a des gardes mobiles une pancarte dénonçant les violences policières lors de la manifestation de femmes Gilets jaunes le 6 janvier 2019 à Paris.
Écrire et mordre
Comment caractériser la méthode employée pour cette généalogie du gouvernement néolibéral ? Le livre nous plonge dans un flux de discours empruntés à l’adversaire. Par un côté, La Société ingouvernable rejoue la stratégie idéale-typique du sociologue Max Weber dans L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme : « Laisser parler le document dans sa pureté presque classique » (p. 25). Par un autre, la multiplicité des citations et des sources, leur hétérogénéité, nous renvoie à une méthode à la Walter Benjamin : construire par accumulation des « images dialectiques », qui font apparaître les contradictions inhérentes à des discours ou des situations. Cette méthode est sans doute plus conforme à la destination pratique de l’ouvrage : réarmer la théorie critique, lui donner les moyens de lire dans les situations du capitalisme contemporain, ou dans sa propre théorisation, les points de tension et les lieux de crise potentielle.
Mais, dans les chapitres écrits par Chamayou, le document ne parle jamais tout à fait seul. Il est assorti d’une écriture qui relève moins du commentaire ou de l’exégèse que du contrepoint, souvent ironique, mordant. Un peu comme le fait d’ailleurs Karl Marx dans Le Capital, qui se moque régulièrement des économistes bourgeois qu’il cite. Ce caractère percussif du texte – qui cogne celles et ceux qu’il cite autant qu’il laisse son lecteur ou sa lectrice parfois KO – est encore renforcé par le rythme de l’ouvrage : chapitres courts et coups de poing, dans la veine de la formule littéraire déjà perfectionnée de Théorie du drone. L’expérience de lecture emprunte au grotesque. Il y a de quoi osciller entre le dégoût – on pense à la tendresse toute hayékienne pour les régimes autoritaires et les gouvernements kamikazes – et le rire, lorsqu’un Friedmann apeuré discerne l’ombre des chars russes derrière la doctrine de la responsabilité sociale des entreprises, ou que les théoriciens du capital en détresse se lamentent de sa perte de légitimité : « Comment voulez-vous que des hommes d’affaires qui ne sont même plus capables aujourd’hui de convaincre leurs propres enfants que les entreprises sont moralement légitimes réussissent par eux-mêmes à en persuader le monde entier ? » (p. 86) Au milieu de ce flux discursif, à la polarité émotionnelle changeante, le texte de Chamayou boxe à tout va, entre incises mordantes et fulgurances conceptuelles.

Grand Est/Meuse – “L’État blesse, l’État tue, l’État dément”. Assemblée des assemblées de Gilets jaunes organisée a l’appel des gilets jaunes de Commercy à Sorcy Saint Martin le 26 janvier 2019.
L’absence de vue d’ensemble ou de cartographie du domaine peut rendre la lecture de l’ouvrage difficile. Si on rencontre quelques grands noms connus, d’autres sont beaucoup plus obscurs pour le ou la non-spécialiste. Il n’est pas aisé d’évaluer l’importance respective des textes à l’intérieur du champ économique, dans la mesure où l’ouvrage n’en propose pas de critique épistémologique. Ce qui a pour effet, assumé, de mettre au même niveau les extraits cités et de produire par endroits un flux sans attaches saillantes.
Si l’auteur caractérise d’abord l’entreprise philosophique comme une « généalogie des concepts et des modes de problématisation » (p. 10), les stratégies argumentatives qu’il emploie empruntent à plusieurs registres : à la lecture serrée de certains textes, notamment ceux des théories de la firme, et au démontage des sophismes qui s’y déploient (ch. 13) ; mais également au renvoi à des mobiles externes pour expliciter les enjeux de la production des discours ; enfin et surtout, l’entreprise philosophique de l’ouvrage repose sur la contre-lecture politique de la littérature des économistes. Toutes ces stratégies alimentent un travail d’innovation conceptuelle, qui s’effectue dans la bagarre avec les discours passés en revue.
L’ouvrage se construit selon une structure en « étages », métaphore qui revient à plusieurs reprises. Si l’arbre de la philosophie s’est transformé en immeuble de bureau, ses racines, tout en bas, sont l’indocilité et la résistance incompressibles des travailleur⋅ses. D’étage en étage, de branche en branche, on peut remonter l’ordre du pouvoir en passant par les managers, puis les actionnaires, pour finalement atteindre l’État. Mais les ascenseurs ne se contentent pas de monter, ils vont et viennent, dans un ballet cybernétique. Le dessaisissement du politique qui se joue au niveau de la firme, en organisant « l’insécurité sociale » ou en déléguant le contrôle des managers au marché, se rejoue à l’étage de l’État : « Autre genre de “théorie du ruissellement”, différente de l’officielle : tandis que les profits remontent, ce qui retombe en pluie, ce sont les coups de pression » (p. 68). Dans le même temps, la contestation se déplace, tactiques et contre-feux migrent d’un étage à l’autre, pour se renforcer ou se contrecarrer.

Mobilisation des Gilets Jaunes sur l’avenue des Champs Élysées a Paris le 24 novembre 2018.
Dilemme de la théorie critique
Par de nombreux aspects, La Société ingouvernable poursuit le travail entamé dans Les Corps vils, Les Chasses à l’homme ou dans Théorie du drone. On y retrouve à la fois pouvoir, technologie, violence ; et l’avertissement du philosophe Friedrich Nietzsche est pris au pied de la lettre : « Cette échoppe où l’on fabrique l’idéal, il me semble qu’elle pue le mensonge à plein nez » (cité p. 128). Les théories les plus tièdes se muent en technologies de pouvoir : « Sous les fausses représentations, il y a de vraies technologies » (p. 151). La sainte horreur de l’éthique, déjà nourrie par les corps vils et les drones, trouve ici de nouveaux aliments. « Il y aura toujours un éthicien de service pour justifier l’injustifiable » est un axiome que chaque traité renouvelle. L’ouvrage ne se laisse jamais attirer par les faux-semblants de la réconciliation, ici rhabillés d’éthique managérialiste.
Il est difficile d’ignorer l’accablement qui saisit le lecteur ou la lectrice à la fin de l’ouvrage. La Société ingouvernable me paraît négocier le dilemme de la théorie critique un peu différemment de ses prédécesseurs : comment armer l’action sans la désarmer du même mouvement ? Sachant que pour l’armer, pour que la critique soit valide autant qu’audible, celle-ci doit faire démonstration que le programme de l’adversaire fonctionne, au moins jusqu’à un certain point, et qu’il produit des dégâts.
D’où les armes rhétoriques usuelles de la dystopie et de la catastrophe : fonctionnement total, dégât absolu. Les textes paniqués que cite Chamayou, au moment où les théoriciens de l’entreprise ont l’impression de perdre pied devant l’ampleur des contestations sociales et de la vitalité démocratique, usent eux-mêmes de cette stratégie inflationniste. Il n’y a pas de sens à critiquer quelque chose qui ne marche pas et ne produit pas d’effet. Mais si cela marche et produit ses effets, quelle place pour des alternatives et à quel coût ? La stratégie de la critique inflationniste a sans doute ce défaut qu’elle marche avec des catégories qui pointent en gros le problème autant qu’elles désarment en pratique l’action, faute d’offrir, littéralement, des prises sur les processus en cours.

Manifestation des Gilets jaunes, acte 9 à Paris le 12 janvier 2019.
Le texte de La Société ingouvernable fonctionne évidemment de manière tout autre, il tente de résoudre le dilemme de la critique par deux voies. Il s’agit dans un premier temps de déplier les processus et de saisir dans les discours adverses des points d’appui pour nourrir la contradiction, sur le plan des concepts comme des processus sociaux qui les accompagnent. « Dénoncer la duplicité ne suffit pas ; la question cruciale, dans chaque situation, serait plutôt de savoir comment attiser la contradiction » (p. 201). C’est la métaphore du bricolage. Certes, ça – le système, la grande tour cybernétique du néolibéralisme avec ses ascenseurs qui dupliquent les régimes de pouvoir d’un étage à l’autre – tout ça fonctionne, mais non sans contradictions, engorgements et faux pas. Et regardez, eux-mêmes, les théoriciens du pouvoir d’entreprise, ne sont pas d’accord entre eux (p. 137). Par en haut, ça tiraille, ça se dispute, ça ne comprend rien à rien. Par en haut, la gouvernementalité ne se conçoit que comme effort continué contre l’ingouvernable.
La seconde voie part du constat suivant : il n’y a de technologies de pouvoir que parce qu’il y a résistance. La puissance de la technologie est d’autant plus importante que les craintes qu’elle conjure sont grandes. C’était la conclusion de Théorie du drone, citant les activistes de Science for the people en 1973 : « Nous ne partageons pas l’hypothèse suivant laquelle ceux qui maîtrisent la technologie la plus avancée auraient fatalement la suprématie. […] Le développement de cette technologie vient de la faiblesse et non de la force du capitalisme américain. […] La guerre aérienne a été développée parce que l’armée américaine n’était plus digne de confiance. […] La technologie n’est pas invincible. C’est un mythe qui conduit à la passivité. […] Le réel pouvoir de transformation sociale réside ailleurs, dans les vastes segments opprimés de la société 4. »
Les deux ingouvernables se rejoignent dans cette formulation : pas de pouvoir sans contre-pression venue d’en bas – maxime : « Partout, ça se rebiffait » (p. 7) –, mais aussi bricolages et contradictions dans les modes de gouvernement qu’il faut toujours aménager par en haut – maxime : « Ce cosmos ne tient que grâce aux démiurges qui le rafistolent tant bien que mal en permanence » (p. 69). Tout se passe comme si la machinerie politique était enserrée entre deux physiques qui la sapent en permanence autant qu’elles entraînent sa perpétuelle réinstanciation : inertie – frotter, traîner, vivre – par en bas ; entropie – désordre, information incomplète, points aveugles – en haut.

Grand Est/Meuse – Des Gilets jaunes devant une carte représentant les villes d’où sont venus les groupes de Gilets jaunes présents a l’Assemblée des assemblées organisée à l’appel des gilets jaunes de Commercy à Sorcy Saint Martin le 26 janvier 2019.
La leçon d’agir critique de Théorie du drone a son analogue dans La Société ingouvernable : « Le néolibéralisme repose moins sur un naturalisme que sur une ingénierie politique : construire par architecture institutionnelle des mondes artificiels. Non seulement cet univers présenté comme automatique, nomothétique, impersonnel, est activement construit mais, plus encore, il requiert, en ce qu’il est immanquablement contesté en ses effets, d’être inlassablement réimposé par des stratégies conscientes. […] Sans cela, il ne tiendrait pas très longtemps » (p. 68).
Cependant, ce qui fournissait l’argument conclusif de Théorie du drone est ici encapsulé dans le chapitre central sur la catallarchie. Un dispositif dont le dernier chapitre du livre, « Micropolitique de la privatisation », donne à voir des effets si fins et si puissants, qu’il accable et conduirait bien plutôt à douter de la réémergence de la critique. Certes, l’appel à revenir aux stratégies autogestionnaires, comme moyen de repolitisation démocratique de la production, est compris dans la ligne d’ensemble de l’ouvrage. Mais quand on lit, en conclusion de ce chapitre : « Altérer radicalement les capacités et les manières d’agir, ceci à un niveau anthropologique. Telle est la radicalité de ce à quoi nous sommes confrontés » (p. 261), cet appel paraît bien désarmé face à l’étendue du mouvement de privatisation – des communs comme des existences singulières – et à l’efficacité des tactiques sur lesquelles ce mouvement repose.
Sans doute faut-il faire droit à deux temps de la réception. L’accablement de qui ferme l’ouvrage laisse place à deux contre-effets théoriques. L’ouvrage tisse d’abord quelque chose de l’ordre de la lucidité et de la colère. Il faut voir clair dans ce qui se passe, alors que les coups pleuvent. Il semble ici que la recherche produit son œuvre : elle offre un langage pour comprendre et décrypter les processus sous nos yeux. Mais La Société ingouvernable se lit en même temps comme un catalogue raisonné de tactiques, assorties de leur mode d’emploi, forces et faiblesses en situation : ce qui marche, comment ça se contre, par où anticiper les coups, partout où la légitimité démocratique vient saper le pouvoir privé.

Mobilisation des Gilets Jaunes sur l’avenue des Champs Élysées à Paris le 24 novembre 2018.
- Voir Libération, « Macron exhorte les Français “à l’effort” », 12 janvier 2019. ↩
- Pierre Haski, « Macron poursuivi par la crise des Gilets Jaunes jusqu’en Égypte », France Inter, 29 janvier 2019. ↩
- Lauréat du prix Nobel de l’économie avec Gunnar Myrdal en 1974, Hayek développe les théories économiques de la concurrence (notamment monétaire) contre le collectivisme. Il prône un ordre social « spontané », et critique la notion de « justice sociale ». ↩
- Théorie du drone, La Fabrique, 2013, p. 313-315. ↩