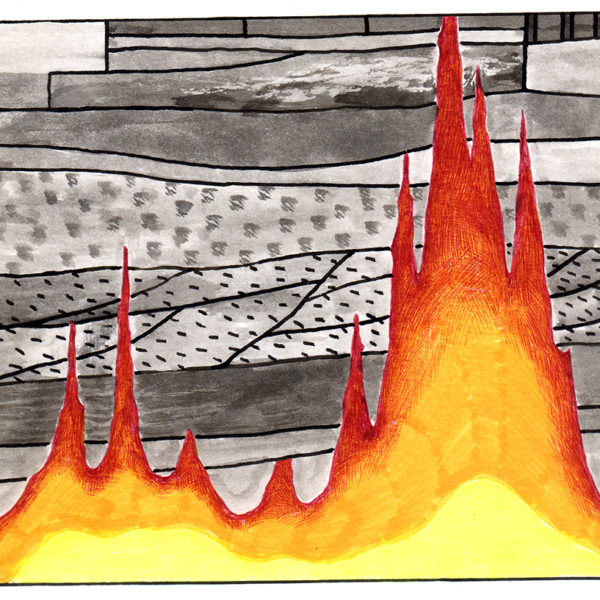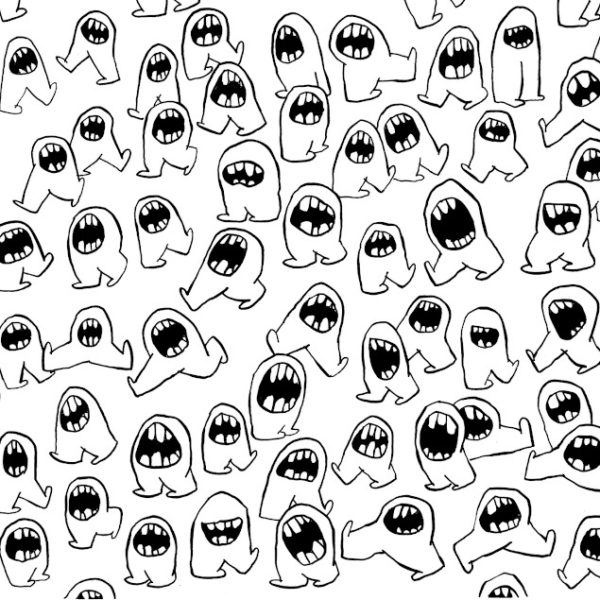Photos d’Alexis Berg
En novembre 2013, Bill de Blasio est élu maire de New York avec un programme axé sur la lutte contre l’arbitraire de la police. Une chose plutôt rare, en ces temps sécuritaires, et un comble, dans la capitale de la « tolérance zéro », politique ultra-répressive qui fait florès depuis les années 1980. C’est que, des coins de rues aux tribunaux, une riposte militante s’est organisée contre le « stop and frisk », ces arrestations et fouilles subies en permanence par les New-Yorkais des quartiers pauvres.
Cet article est issu du no8 de la revue Z, « Vénissieux, la rouge et la révolte » (2014), toujours disponible en librairie.
Télécharger l’article en PDF.
« I DO NOT CONSENT TO THIS ILLEGAL SEARCH ! » « Je ne consens pas à cette fouille illégale ! » Ils sont une douzaine à crier dans un petit parc du Bronx cet après-midi, bien qu’aucun policier ne s’en prenne à eux. « Plus fort ! Tout le quartier doit nous entendre ! » Les forces de l’ordre restent en contrebas, discutant tranquillement à côté de leurs voitures bleu et blanc. Il s’agit d’un atelier d’entraînement organisé le mardi 22 octobre 2013 à l’occasion de la 18e journée nationale contre les violences policières1. Avec une ample veste rouge tombant jusqu’aux genoux et une large casquette de base-ball vissée sur la tête, Majesty, New-Yorkais noir d’une trentaine d’années, affiche un style hip-hop qui claque. Au sein de l’organisation People’s Justice, il est chargé d’organiser ces ateliers qui permettent de connaître ses droits, bien utiles en cas de contrôle qui dérape. Ils sont aussi une expérience corporelle : oser crier dans la rue, où la police vise justement à discipliner les corps, n’est pas un acte anodin. Par l’occasion qu’ils offrent de discuter publiquement du problème des contrôles, les ateliers sont aussi un outil pour convaincre la population d’affirmer haut et fort que la police aujourd’hui est plus dangereuse que rassurante – même pour ceux qui n’ont « rien à se reprocher ».
La théorie de la vitre brisée
La police de New-York est réputée dans le monde entier pour son application exemplaire de la théorie de la vitre brisée. Cette doctrine postule que les actes de délinquance mineure préparent le terrain pour la grande délinquance et la criminalité : « Qui vole un œuf, vole un bœuf ». Pièce d’un puzzle idéologique qui prétend embrasser l’ensemble de la vie sociale, elle est née sous l’impulsion des premiers groupes de réflexion néolibéraux, au début des années 19802. En réprimant très sévèrement les petites dégradations ou le vol à l’étalage, on cherche donc à assécher la source des meurtres. L’entretien des rues et l’aménagement urbain sont pensés pour empêcher les délits, et la « tolérance zéro » devient la ligne de conduite de forces de l’ordre qui se doivent d’incarner le service public moderne. Un service public dont l’activité est façonnée par une batterie d’indicateurs statistiques sensés en « évaluer l’efficacité ».
Aux États-Unis, une grande partie des politiques publiques se décide à l’échelle des villes, ce qui a permis à Rudolph Giulani, élu maire de New-York City en 1994, puis à Michael Bloomberg, qui lui succède en 2002, de mettre en place la tolérance zéro. Au programme : augmentation des effectifs policiers pour arriver à quelques 40 000 agents au sein du New-York Police Department3 (NYPD), mise en place d’un lourd dispositif statistique informatisé (COMPSTAT)4, multiplication des contrôles préventifs et incarcération massive des délinquants. Les prisons se remplissant à vitesse grand V, il a fallu construire des établissements pénitentiaires dans tout l’État de New-York5.
L’arbitraire sous le masque
du bon sens
La doctrine de la tolérance zéro affiche la simplicité d’un raisonnement frappé du coin du bon sens. Qui voudrait que sa rue soit pleine de vitres brisées ? Qui ne veut pas vivre dans un cadre agréable ? Ces questions sont habilement décrochées du contexte social dans lequel elles prennent sens : où ai-je les moyens d’habiter ? Pourquoi dois-je aller chaque jour travailler dans les quartiers riches ? Quel pouvoir puis-je avoir sur mon quartier ? Qu’est-ce que je peux faire avec les autres gens qui vivent là ?
Cette « sécurité » vendue comme une valeur à défendre quelle que soit la société qui va avec est un cheval de Troie qui va légitimer l’arbitraire policier au sein de la démocratie représentative. Un processus dont Gilles Sainati et Ulrich Schalchli, membres du Syndicat général de la magistrature, décrivent l’impulsion par la rationalisation de l’activité policière : « L’État de droit nouvelle mode […] est devenu un ensemble de processus rythmés sur le tempo de l’urgence, du “temps réel”, disent les bureaucrates, auquel s’ajoute une organisation calquée sur les réseaux informatiques et dont les résultats s’expriment en tableaux de bord. On parlera du “flux d’évacuation des affaires civiles et pénales” pour signifier que la machine à punir tourne bien6. »
La protection de chacun contre l’arbitraire du pouvoir n’entre pas dans le cadre de ces procédures automatisées de production de l’ordre, dont la légitimité n’est jamais questionnée. C’est la peur de la sanction, que chacun doit ressentir, qui se présente comme le seul fondement permettant la production d’un ordre public. Alors que l’existence du désordre pourrait être vue comme le signe d’une démocratie toujours inachevée où nombreux sont ceux qui ne trouvent pas leur compte, il est considéré comme un kyste à éliminer à tout prix.
Le principe de proportionnalité des peines, qui affirme que le vol d’un œuf appelle une sanction différente que le vol d’un bœuf, devient alors un archaïsme gênant pour la production de l’ordre. Au contraire, les peines préventives tendent à devenir la règle. Il ne s’agit plus de sanctionner des actes déjà commis, mais de punir le voleur d’œuf au nom du bœuf qu’il risque de dérober le lendemain. Cette logique de sanction préventive à l’œuvre dans la tolérance zéro new-yorkaise se retrouvera par la suite dans l’antiterrorisme, des deux côtés de l’Atlantique…

De la critique des crimes policiers
à celle du harcèlement quotidien
La tolérance zéro est un mot d’ordre qui fait des victimes, et c’est par là qu’est d’abord arrivée la contestation. En 1999, suite à l’assassinat d’Amadou Diallo par la police new-yorkaise, une campagne d’envergure aboutit à la poursuite des agents responsables et au remplacement du chef de la police7. Près de quinze ans plus tard, la police continue toutefois de tuer. Le 22 octobre 2013, une exposition se tient autour de la fontaine centrale du parc où se déroule l’atelier de résistance aux contrôles de police. Sur de grands panneaux, une quarantaine de portraits peints en noir et blanc, assortis de noms et de dates : des victimes récentes dont la mémoire est honorée ce jour-là. Plus tard dans l’après-midi, une dame noire d’une cinquantaine d’années en impose lorsqu’elle se met à chanter en hommage aux victimes, entre les deux hauts-parleurs installés pour l’occasion de part et d’autre de la mini-scène plantée au milieu du parc. Elle-même « famille de victime », elle enjoint la centaine de personnes présentes à continuer le combat pour la vérité et la justice. La prochaine étape de ce combat est toute proche : brandissant les panneaux de l’exposition, la petite foule s’engage sur les trottoirs des rues du Bronx, direction le commissariat du coin. Très dynamique, le cortège enchaîne les slogans. « No Justice No Peace, Fuck the Police » (« Pas de justice pas de paix, nique la police ») est aussi bien repris par les parents de victimes que par des militants arborant les casquettes rouges de leur organisation politique. Moins familier pour des oreilles francophones, on entend aussi « Stop the Stop and Frisk ! » Cible emblématique des critiques de la tolérance zéro, la pratique du « Stop, question, and frisk » – « arrestation, interrogatoire et fouille » – symbolise la lutte du NYPD contre la petite délinquance.
La critique du stop and frisk a opéré un tournant dans le discours sur la police : le mouvement d’opposition n’est pas parti de cas exceptionnellement violents, mais des centaines de milliers de contrôles qui font le rapport quotidien de la population à la police. « La ville est bien plus sûre qu’avant, c’est un fait. À Wall Street les gens sont très contents des progrès de la sécurité », concède Shaun Lin, chargé de la défense des droits civiques au sein de l’association Picture the Homeless. « Et c’est vrai que les touristes ont accès à des endroits de la ville où ils n’allaient pas avant. Mais cinq millions de personnes ont été contrôlées depuis que Michael Bloomberg est maire8. Ça fait beaucoup de gens humiliés ! » Quelques jours de prison pour celui qui saute les tourniquets du métro, des contrôles à répétition pour les jeunes noirs et latinos, et le sentiment d’être en permanence à la merci de l’humiliation policière pour le reste des habitants des quartiers populaires.
Devant le commissariat, la manifestation s’arrête un moment pour dénoncer les violences régulièrement perpétrées sur la population du quartier. Au moment de partir, Majesty, l’animateur de l’atelier, s’emballe et interpelle directement les policiers postés devant le bâtiment : « Je ne dis pas que vous êtes tous des ordures, mais il se passe des choses terribles dans ce commissariat ! Vous n’avez pas à cautionner ça ! Vous devez parler, vous désolidariser ! C’est possible ! Soyez un peu dignes ! »
Un petit concert au milieu d’un carrefour animé du Bronx met fin à la journée de contestation. Parmi les nombreux passants qui rentrent du boulot, très rares sont ceux qui se joignent à l’assistance composée de militants. Ce moment est d’abord l’occasion pour chacun de se dire au revoir avant une dispersion en douceur. Les trente dernières personnes présentes se mettent en cercle, se prennent par la main et répètent solennellement des encouragements mutuels. Ce rituel étonnant, qui pourrait sonner un peu faux, semble en fait performatif : il fait vivre une communauté de lutte au-delà de l’appartenance à diverses organisations et in fine, redonne de la force jusqu’à la prochaine fois.
Le racisme sans racistes des contrôles de police
La sécurité vantée par la tolérance zéro est bâtie sur la mise au pas de toute une partie de la population. Cette discipline s’applique d’abord aux pauvres et à tous ceux pour qui la rue n’est pas qu’un simple sas entre une confortable maison et un boulot bien rémunéré. Mais à cette évidente question sociale s’ajoute une question raciale. En 2010, un Noir avait dix fois plus de chances de se faire contrôler qu’un Blanc9.
Bloomberg, maire de 2002 à fin 2013, assume cette différence de traitement. En août 2013, il rappelle que l’immense majorité des victimes de meurtres sont noires et latinos, et donc que la diminution de la criminalité profite d’abord à ces communautés. Puis il dénonce l’idée selon laquelle tous les citoyens devraient avoir les mêmes risques d’être contrôlés : « Selon cette logique erronée, nos policiers devraient arrêter aussi souvent les femmes que les hommes, et aussi souvent les personnes âgées que les jeunes. […] Le résultat absurde d’une telle stratégie serait que beaucoup plus de crimes seraient commis contre les Noirs et Latinos new-yorkais. Quand il s’agit de maintien de l’ordre, le politiquement correct est mortel10 . » Les jeunes noirs et latinos seraient donc plus contrôlés que les autres parce qu’ils habitent dans des quartiers plus dangereux et parce qu’ils adoptent plus souvent des comportements suspects. Les parents devraient se satisfaire de voir leurs enfants emprisonnés, puisqu’au moins ils ne sont pas morts dans un affrontement entre gangs…
Pourtant, une étude menée sur la police de Los Angeles montre qu’entre juillet 2003 et juin 2004, les contrôles effectués sur des Noirs s’avéraient bien plus souvent injustifiés – selon la raison policière elle-même – que ceux subis par des Blancs, qui se révélaient plus fréquemment en possession de drogues ou d’armes lors du contrôle11.
Les policiers américains seraient-ils alors particulièrement racistes ? Le maire balaye cette idée par un constat simple : « Une majorité de nos officiers de police sont noirs, hispaniques et issus d’autres minorités. […] Avec le chef de la police Ray Kelly, nous appliquons la tolérance zéro sur le profilage racial 12. » Pour montrer sa détermination, il a même signé un décret l’interdisant officiellement. Le jour de sa promulgation, Michael Bloomberg se faisait d’ailleurs lyrique en affirmant que « New-York est comme une maison où huit millions de personnes de toutes les races, ethnies et religions doivent pouvoir se sentir en sécurité pour réaliser leurs rêves13 ». Plus sobrement, les chercheurs en sciences sociales reconnaissent que chez les policiers comme dans l’ensemble de la population américaine, « le racisme conscient a sans aucun doute diminué par rapport aux générations précédentes14. » Qu’est-ce qui vient donc entraver les relations rêvées entre les policiers et les plus pauvres des jeunes noirs et latinos new-yorkais ? Si les consignes de la hiérarchie dissuadent officiellement de cibler en fonction de la race, si les policiers blancs sont une minorité et s’ils sont de moins en moins animés par des sentiments explicitement racistes, comment expliquer que les Noirs aient toujours dix fois plus de chances de se faire contrôler que les Blancs ?
« Le stéréotype implicite est que les Noirs, particulièrement les jeunes, seraient plus violents, hostiles, agressifs et dangereux », explique la chercheuse en droit L. Song Richardson. « Dans un contexte de maintien de l’ordre, ces stéréotypes implicites peuvent expliquer qu’un policier qui n’a aucune animosité raciale consciente et qui rejette toute grille de lecture raciale en vienne à traiter différemment des individus en fonction de leur seule apparence physique15. » Ces mécanismes inconscients pèsent surtout sur l’interprétation de situations ambiguës. Un Blanc qui s’attarde devant une voiture en stationnement sera supposé chercher ses clés là où, au contraire, un Noir sera soupçonné de chercher à voler le véhicule.
Ce questionnement de la dimension raciale du stop and frisk n’est pas purement théorique. Il offre aussi un point d’appui à la mobilisation en permettant d’attaquer la police en justice. Depuis 1999, plusieurs organisations ont en effet placé le combat sur ce terrain, notamment en s’associant à deux plaintes collectives pour discrimination raciale et contrôles abusifs. Ces plaintes ont par exemple permis l’émergence de nombreux témoignages de policiers attestant l’existence d’une politique du chiffre qui les incitait à contrôler à tour de bras. Cette mobilisation dans les tribunaux a connu une victoire importante lorsque la juge Schira Scheindlin a déclaré, le 12 août 2013, que le NYPD allait bel et bien à l’encontre de la constitution américaine par sa pratique du stop and frisk. Le jugement ne se contente pas de reconnaître qu’une discrimination a parfois eu lieu, mais reproche à la municipalité d’avoir « constamment fermé les yeux sur les preuves de stop and frisk anticonstitutionnels » et même d’avoir « maintenu et augmenté des politiques dont on pouvait prévoir qu’elles mèneraient à toujours plus de violations de la constitution »16. La mairie de New-York a fait appel de ce jugement qui lui imposait une réforme du NYPD. La Cour d’appel a ensuite dessaisi la juge, accusée d’avoir manqué à ses obligations d’impartialité, et remis en discussion l’évaluation juridique du stop and frisk. Les différentes étapes de ce feuilleton judiciaire ont en tout cas été autant d’occasions de porter publiquement le débat sur l’action de la police.

Convaincre,
de chaque coin de rue
jusqu’aux rangs
du Parti démocrate
Quelques jours après la manifestation dans le Bronx, Majesty anime une scène ouverte de rap au sud de Manhattan, dans l’un des derniers bars à ne pas encore être investi par la jeunesse dorée. L’occasion de revenir sur cette campagne contre le stop and frisk et sur le rôle des équipes de copwatching animées par son organisation, People’s Justice. Inspiré des premières actions des Black Panthers, à la fin des années 1960, le copwatching, ou surveillance de la police, consiste ici à créer des groupes déambulant dans les quartiers pour dissuader, et le cas échéant documenter le harcèlement policier. Majesty explique : « Une équipe se compose dans l’idéal de cinq personnes, dont deux munies de caméras : l’une filme les policiers tandis que l’autre filme la première caméra, au cas où elle serait elle-même prise pour cible. Le temps passé dans la rue quand la police n’est pas en action est loin d’être perdu : à l’image des ateliers d’entraînement aux contrôles, il s’agit avant tout de discuter avec les autres habitants du quartier du rôle de la police. » On construit ainsi petit à petit une politisation des inquiétudes que chacun peut ressentir face aux « forces de l’ordre » censées protéger la population. Nombre de parents s’inquiètent plus des contrôles à répétition subis par leurs enfants que de la menace hypothétique d’être agressés par un jeune délinquant. L’image de la victime de l’insécurité tend à s’effacer derrière la solidarité avec les victimes du harcèlement policier.
Un changement qui ne s’est pas fait sans difficultés, comme l’explique Kazembe Balagun, militant du Malcom X Grassroots Movement, et responsable du bureau new-yorkais du Rosa Luxembourg Stiftung (think tank du principal parti allemand d’opposition, Die Linke). « Au début, il a fallu répondre aux gens qui disaient “les rues sont plus sûres maintenant, et les gens que vous défendez sont des dealers” . » À 47 ans, après des années passées dans le milieu militant, il reçoit aujourd’hui en costume chic dans son grand bureau situé au cœur de Manhattan. C’est de là qu’il tente de décrypter les dynamiques à l’œuvre dans les mouvements sociaux pour construire une alternative radicale compatible avec des partis politiques institutionnels. « À qui appartient la ville ? C’est la question posée par cette politique de contrôles systématiques qui excluent toute une partie de la population des espaces publics. Si je ne peux pas me sentir à l’aise au coin de ma rue, où vais-je me sentir bien ? Il faut mettre ça en lien avec la politique du logement, qui elle aussi vise à trier les habitants de New-York et favorise les plus riches en laissant des centaines de milliers de logement inoccupés. Propriété, citoyenneté et droit à la ville sont liés. »
Une campagne ancrée à gauche
Le parvis de l’hôtel de ville est protégé de l’agitation du Financial District par de petits jardins et un poste de contrôle antiterroriste par lequel doivent passer tous ceux qui prétendent traverser l’esplanade. C’est le chemin qu’ont dû suivre la cinquantaine d’activistes réunis ce mercredi 6 novembre 2013 pour réclamer la fin du stop and frisk. Entre deux prises de parole, une promesse se faufile sur les marches de la mairie : « Nous ne choisirons pas entre la sécurité publique et le respect des communautés de notre ville. » Ainsi s’exprime le représentant de Bill De Blasio, l’homme qui vient, la veille, de remporter haut la main les élections municipales17. Comment le candidat du parti démocrate en est-il venu à placer la remise en cause de l’activité policière au cœur de sa campagne électorale ?
En trois mandats successifs, Michael Bloomberg avait su affirmer son style autoritaire et ouvertement hostile à tout ceux qui sortent du rang, développant ainsi un ras-le-bol généralisé. Même les plus déterminés à ne jamais faire confiance à un candidat issu du Parti démocrate, organisation peu réputée pour ses penchants révolutionnaires, ont éprouvé une certaine satisfaction à ce que quelqu’un dise enfin haut et fort que la ville n’a pas à être entièrement pensée pour les riches propres sur eux et les touristes.
C’est ce qu’a fait Bill De Blasio en choisissant pour slogan de campagne le titre d’un roman de Charles Dickens, Le Conte de deux villes (A Tale of Two Cities), signifiant par là que la ville des travailleurs pauvres et des minorités allait prendre sa revanche sur la brillante cité des traders. Parti d’une position minoritaire parmi les candidats démocrates, il s’est démarqué en mettant en avant des mesures symboliques ouvertement anti-Bloomberg, comme la taxation des hauts-revenus pour financer un meilleur accueil public de la petite enfance. La critique du stop and frisk entrait parfaitement dans le cadre de cette stratégie osant s’ancrer à gauche. Le marketing électoral a fait le reste, De Blasio multipliant les apparitions avec sa femme noire et leurs enfants métisses, érigés en symbole d’une ville réconciliée. Les républicains auront défendu leur politique sécuritaire jusqu’au bout, via les Unes spectaculaires des tabloïds promettant le chaos aux électeurs qui oseraient porter un De Blasio repeint en rouge et décrit comme un revenant de l’Union soviétique.
Quelques jours avant le triomphe électoral de Bill de Blasio, Nicholas Mirzoeff, professeur à la New York University et actif lors du mouvement Occupy Wall Street, résumait ainsi le sentiment de beaucoup de militants new-yorkais : « Il ne faut rien attendre de lui. Il ne va probablement pas changer les choses en profondeur, mais son élection est le signe de changements, d’un rapport de force nouveau dans New-York, ce dont on ne peut que se réjouir. » La première mesure prise par le nouveau maire peut avoir de quoi étonner : pour mettre fin au stop and frisk, il a rappelé aux affaires celui qui fut la cheville ouvrière de la tolérance zéro : William Bratton, chef de la police de New-York entre 1994 et 1996. L’idéologie de l’homme providentiel a encore frappé : celui qui a su affronter la criminalité saurait bien affronter les policiers et leurs pratiques discriminatoires…
Fin janvier 2014, De Blasio et Bratton ont annulé l’appel interjeté par l’administration Bloomberg dans le procès qui oppose la mairie de New-York aux victimes de contrôles discriminatoires. Un geste immédiatement dénoncé par les syndicats de police, outrés d’être ainsi lâchés par leur hiérarchie. Les rebondissements judiciaires sont donc loin d’être terminés. En attendant, William Bratton explique sa stratégie pour une future réforme du NYPD fondée sur la restauration d’une relation privilégiée avec les différentes communautés pour trier ensemble le bon grain de l’ivraie, poursuivre les criminels sans harceler la population. De là à renverser l’idéologie de la production de l’ordre par la peur, rien n’est encore gagné.

Occupy Wall Street
La police et la question raciale dans un mouvement de réappropriation de l’espace public
En occupant le petit parc Zuccotti pendant plusieurs semaines à l’automne 2011, à proximité d’une des premières places boursières du monde, quelques milliers de personnes ont incarné le pendant américain d’un moment de repolitisation des espaces publics à l’échelle mondiale, qui s’est appelé « mouvement des places » en Grèce, « 15-M » en Espagne, ou les Indignés dans les médias français. Nicholas Mirzoeff, professeur blanc à l’Université NYU qui affirme avoir « trouvé sa communauté » dans l’occupation, insiste sur son importance symbolique : « Occupy a posé publiquement la question de l’égalité d’une manière qui n’avait plus été possible depuis longtemps. » Le rôle d’Occupy aurait donc été central par la légitimité qu’il a fait gagner à un discours déjà porté par divers groupes politiques plutôt que dans la constitution de nouvelles forces prêtes à agir ensemble. « La campagne de De Blasio centrée sur l’égalité aurait été impossible avant Occupy, continue-t-il avant de dresser un bilan amer de cette expérience du point de vue de la question raciale. Ce qui est terrible, c’est qu’Occupy était davantage homogène et blanc à la fin qu’au début. Les mouvements noirs nous ont assez clairement signifié qu’Occupy était perçu comme un mouvement blanc. » Un bilan que modère Kazembe Balagun, militant noir du Malcom X Grassroots Movement : « La jonction entre les mouvements contemporains sur les droits civiques et Occupy n’a été que partielle, mais on a connu des moments importants. Des gens des quartiers Nord sont descendus jusqu’au Financial District pour parler des contrôles de police et ont été très écoutés par une assemblée de 200 personnes d’Occupy. La manifestation organisée après l’exécution de Troy Davis [le 21 septembre 2011, pour le meurtre d’un policier vingt ans auparavant, alors qu’un large mouvement de soutien défendait son innocence (Ndlr)] s’est terminée au Zuccotti Park, et un mouvement Occupy the Bronx est aussi né à ce moment-là. La question des droits n’était toutefois pas au cœur de ce mouvement centré sur la dénonciation de la finance et l’affirmation du pouvoir des 99 %, et on a évidemment connu des problèmes de racisme au cœur de l’occupation. En tout cas, l’espace politique qui s’est ouvert a été investi par la question raciale. »
Cet espace a été marqué par un vécu commun de la répression policière. Si les pratiques émeutières de dégradations et d’affrontement avec la police ont été marginales, les participants à Occupy ont massivement choisi de bousculer la tolérance zéro new-yorkaise, en descendant des trottoirs pour manifester directement sur la chaussée (ce qui n’arrive que rarement aujourd’hui aux États-Unis), en écrivant des slogans au sol et surtout en campant au milieu du Financial District. Le NYPD a répondu en multipliant les violences, les arrestations et l’usage des gaz lacrymogènes18. L’expérience de la répression a renforcé un sentiment commun de défiance envers le NYPD, y compris chez des étudiants ou des travailleurs blancs qui ne sont pas les plus exposés au harcèlement policier au coin de leur rue. Les militants engagés depuis des années dans la critique de la police à travers la Coalition du 22 octobre l’ont bien compris et s’en félicitent dans leur appel à la 16e journée nationale contre les violences policières en octobre 2011, non sans regretter que dans quelques villes, comme à Greensboro et Minneapolis, les assemblées générales d’Occupy aient pris des positions favorables au maintien de bonnes relations avec la police, empêchant ainsi l’alliance avec les communautés pour qui l’hostilité policière est une évidence quotidienne19.
- « National Day of Protest to Stop Police Brutality, Repression, and the Criminalization of a Generation », organisé par la October 22 Coalition
- Serge Halimi, Le grand bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, 2004, Fayard (épuisé puis réédité aux éditions Agone en 2012). Pour le rôle des différents acteurs dans la diffusion du versant sécuritaire de cette idéologie, voir Loïc Wacquant, Les prisons de la misère, 1999, Raisons d’Agir, p. 14 et suivantes
- Soit 1 agent pour 200 habitants, tandis que des villes comme Marseille ou Lyon ont 1 agent municipal pour 1 500 à 2 500 habitants, le maintien de l’ordre étant principalement assuré par la police nationale.
- Sur l’application d’un système similaire dans la ville de Baltimore, voir la série télévisée The Wire.
- Steven Donziger, « Fear, Politics, and the Prison-industrial Complex », The Real War on Crime, Basic Books, 1996, p. 63-98, cité par Loïc Wacquant, op. cit., p. 13.
- Gilles Sainati et Ulrich Schalchli, La décadence sécuritaire, La Fabrique, 2007, p. 100-101
- Loïc Wacquant, op. cit. p. 28-31.
- Chiffre confirmé par l’administration new-yorkaise pour la période de 2002 à 2013, publié par la New York Civil Liberties Union. <http://www.nyclu.org/content/stop-and-frisk-data>
- En croisant les données issues du recensement américain et celles du bilan des arrestations publié par le NYPD, on constate que les noirs représentent 25 % de la population new-yorkaise mais 54 % des personnes contrôlées, tandis que les blancs représentent 45 % de la population et seulement 9 % des personnes contrôlées.
- Michael Bloomberg, « “Stop and frisk” is not racial profiling », Washington Post, 19/08/2013
- « A Study of racially disparate outcomes in the Los Angeles Police Department », cité par Angela Onwuachi-Willig, « An officer and a gentleman », Mack and Charles (dir), The New Black, The New Press, 2013.
- Michael Bloomberg, art. cit.
- Michael Bloomberg, Communiqué de presse no 183-04 du 12 juillet 2004.
- Angela Onwuachi-Willig, art. cit., p. 146.
- L. Song Richardson, « Arrest efficiency and the fourth amendment », Minnesota Law Review, no 95, 2011, p. 2038-2039.
- Cité par le Center for Constitutionnal Rights. <http://ccrjustice.org/newsroom/press-releases/judge-rules-floyd-case>
- Il a recueilli environ 800 000 voix parmi les huit millions d’habitants de la ville, contre environ 250 000 au candidat républicain Joe Lhota.
- « NYPD et OWS : deux styles qui s’opposent », Alex Vitale, traduit par J. Strauser pour Collectif, Occupy Wall Street ! Textes, essais et témoignages des indignés, Les Arènes, 2012.
- « National Day of Protest 2011: New Connections and New Possibilites for Deepening Resistance », in October 22nd Coalition, Wear black ! <http://october22nationaldayofprotest.wordpress.com>