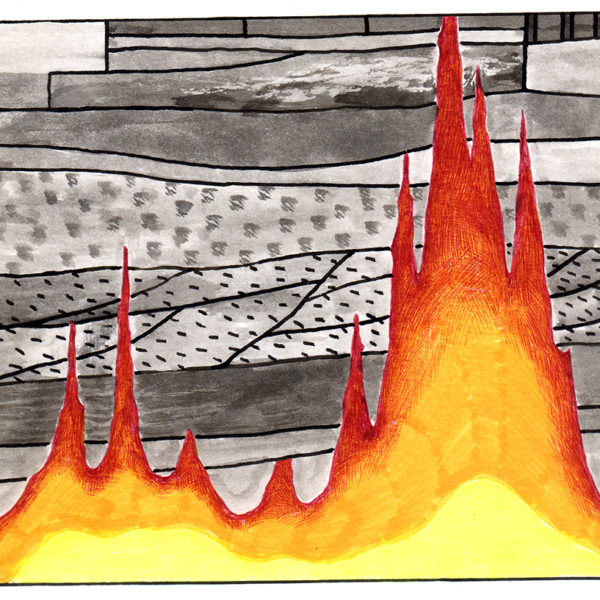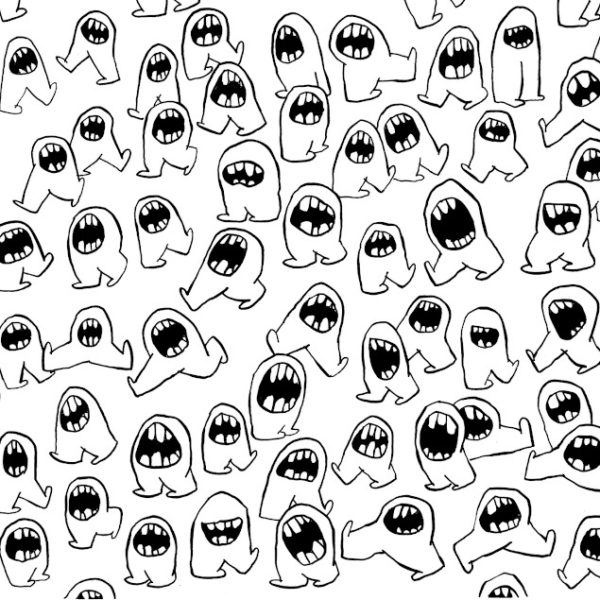Avec le concours de Claire Feasson et Alexane Brochard
Le 8 juillet 2009, à Montreuil (93), ville en pleine gentrification où perdurent des pratiques de solidarité (notamment avec les sans-papiers), les forces armées de la police expulsent au petit matin « la Clinique », un immeuble occupé en plein centre, qui accueille des activités collectives ouvertes sur la ville.
Le soir-même, des habitant.e.s et personnes solidaires descendent dans la rue pour dénoncer publiquement cette expulsion. Ils organisent un repas de rue qui se termine en déambulation jusqu’au bâtiment expulsé. La police réprime sauvagement ce sursaut de résistance en tirant au flash-ball dans la foule. Des tirs au-dessus des épaules, contrairement à l’obligation légale censée encadrer l’utilisation de cette arme. Bilan : six blessés, dont une personne éborgnée. Quatre des blessés portent plainte auprès de la police des polices.
Depuis, le collectif 8 juillet s’est créé pour préparer le procès qui aura lieu du 21 au 25 novembre 2016, soit sept ans plus tard, au Tribunal correctionnel de Bobigny. Fait rarissime, trois policiers seront dans le box des accusés. Pour comprendre les enjeux de cette affaire, Jef Klak revient sur le contexte qui a précédé les faits en demandant à cinq participant.e.s du collectif 8 juillet de raconter leur histoire commune et les perspectives de résistance à la police. En cinq actes.
*
1. Le contexte montreuillois :
chasse aux sans-papiers, rencontres et assemblées (2002-2008)
2. La Clinique, un lieu ouvert sur la ville (2009)
3. L’expulsion de la Clinique et la charge policière (8 juillet 2009)
4. La procédure au long cours et le collectif 8 juillet (2009-2016)
5. Le procès contre la police (21-25 novembre 2016)
Télécharger l’article en PDF.
1.
Le contexte montreuillois :
chasse aux sans-papiers, rencontres et assemblées (2002-2008)
Pourriez-vous faire le récit collectif de l’ambiance de lutte à Montreuil avant ce 8 juillet 2009 ?
Salma : Dans les années 2000, les résistances à la chasse aux sans-papiers avait réuni beaucoup de monde. L’importance de la communauté malienne et le grand nombre de foyers de travailleurs immigrés sur Montreuil avaient fait de la ville un terrain d’expérimentation pour les policiers. Leur question était : comment organiser le territoire pour en choper un maximum ? En face, les gens étaient assez bien organisés pour résister, sans forcément appartenir au même groupe ou à la même tendance politiques. Ils partageaient le même territoire, la même répression. Juste après que Sarkozy a été nommé ministre de l’Intérieur, en 2002-2003, les contrôles massifs ont commencé dans le métro, puis ça s’est intensifié. La multiplication des réquisitions du procureur, autorisant des contrôles massifs sur une zone sans raison particulière, a effectivement fait exploser le nombre de contrôles et d’arrestations.
À Montreuil, de telles rafles avaient lieu toutes les semaines, voire tous les jours, selon les périodes. Souvent, ça se passait le matin, vers 6 h 30. Ils fermaient quasiment un quartier et contrôlaient les gens sans raison. Au bout d’un moment, on était finalement toujours les mêmes personnes à se déplacer. Du coup, les flics nous connaissaient, on se côtoyait dans la rue, on se croisait régulièrement. Quand ils nous voyaient arriver, ça leur arrivait de nous appeler par nos prénoms, de nous désigner du doigt, ou de nous foutre la pression. Ils collaboraient beaucoup avec les agents municipaux, sous la mairie communiste de Jean-Pierre Brard puis sous les Verts avec Dominique Voynet, pour mettre en place une surveillance serrée.
Victor : Dans ces années-là, différents réseaux se mêlent sur Montreuil. Le collectif pour les droits des sans-papiers de Montreuil, qui existait déjà, mais aussi des gens venant du mouvement anti-CPE de 2006, avec une dynamique d’ouverture de squats dans la ville. Il y avait également des gens issus des luttes d’intermittents, de chômeurs, de précaires. Et puis un tissu ancien, avec des habitant.e.s qui se mobilisaient depuis des dizaines d’années. Toutes ces réalités se croisaient à Montreuil.
La tension montait avec la police, autour des arrestations de sans-papiers et les squats, et tout cela a abouti à l’« Assemblée contre les expulsions » qui s’est créée à côté, et non en marge, du collectif de sans-papiers de Montreuil. Avec cette hypothèse : s’organiser le plus concrètement possible autour des arrestations de sans-papiers et des expulsions de squats.
L’idée était simple : dès qu’on entend parler d’une arrestation, il faut intervenir le plus vite possible, et faire le plus de bordel possible. On en avait marre de l’occupation policière de la rue, en bas de chez nous. C’est sur la base des réseaux déjà existants que nous avons repris une idée déjà mise en pratique à Paris : le « numéro anti-rafle ». Nous, on l’avait appelé le « numéro d’urgence » : une chaîne de SMS pour se prévenir en cas d’arrestations ou de présence policière anormale, et pour pouvoir rameuter du monde.
En plus de cela, l’Assemblée s’est réunie une fois par mois pendant plus d’un an. Par rapport au contexte de réquisitions, aux alentours de 2008, les foyers étaient ostensiblement ciblés par les flics, pas seulement en banlieue, mais aussi à Paris. On a alors commencé à organiser des manifs de quartier, notamment autour des foyers, des espèces de rondes, pour informer et rencontrer les voisin.e.s de ces foyers, avec des distributions de tracts dans les cités environnantes.
Bref, entre 2002 et 2008, des gens se coordonnaient sur la ville, avec beaucoup de régularité. En 2008, on collait au bitume, jusqu’à créer une présence vraiment importante et bruyante dans la ville. Avec une certaine efficacité locale : la pression autour des foyers a fini par reculer – ou plutôt par se déplacer – grâce à la mobilisation et à ce qui est arrivé le 4 juin.
Salma : Le 4 juin 2008 au matin, un sans-papier s’est fait arrêter à quelques mètres du foyer de Rochebrune, où était prévu le jour même un départ pour une manifestation de quartier. Nous avons donc décidé de descendre nombreux jusqu’au commissariat pour pousser à la libération de la personne arrêtée. Là, à l’intérieur, il y avait un pot de départ, ils nous ont vu arriver, et je ne sais pas, ils ont dû croire qu’on allait rentrer. De l’extérieur, on ne les voyait pas, mais assez rapidement, ils ont mis leurs tenues anti-émeute et sont sortis. Ils ont chargé en frappant et tirant sur tout le monde. Un garçon s’est pris un coup de flash-ball dans les testicules, et certaines personnes se sont fait arrêter. Une chaîne téléphonique s’est constituée, et on s’est vite retrouvés trois cents devant le commissariat. Toute la nuit, il y a eu énormément de monde dans les rues de Montreuil. Ils ont ramené des cars anti-émeute, et une chasse à l’homme a commencé. Même les jeunes des tours qui habitaient juste en face se sont fait courser.
Serge : Ce jour-là, ils ont arrêté huit personnes, qu’ils ont placées tout de suite en garde à vue. Ils ont libéré le soir-même tous ceux qui avaient des papiers, et ont gardé les trois sans-papiers, dont celui qui était blessé. Ces derniers ont été jugés un an après le 12 juin 2009, et ont tous été relaxés des violences dont on les accusait. Suite à cette charge policière et à la nuit d’émeute, Voynet avait saisi la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS1), qui a conclu que la brutalité des policiers était disproportionnée, et qu’arrêter des sans-papiers aux abords des foyers créait une trop grosse pression sur les habitants des foyers, qu’ils aient ou non des papiers, ainsi que sur l’ensemble de la population de Montreuil2. Cela a conduit à l’abandon de cette méthode – et à passablement énerver les policiers locaux.
Dimitri : À cette époque, on avait rencontré des gens participant au collectif de sans-papiers de Montreuil et qui vivaient dans les foyers. Certains dormaient dans les couloirs du foyer Rochebrune, et ont ouvert un squat d’habitation qui a tenu très longtemps. C’était devenu des amis, et cela a reconfiguré les réseaux : c’était autre chose que de la simple solidarité. L’Assemblée contre les expulsions s’appelait comme ça, car elle était censée répondre aux expulsions de sans-papiers et aux expulsions de squats.
Victor : La question de l’ouverture des squats générait une tension régulière avec la police, et ça compte dans l’histoire qui amène aux tirs du 8 juillet.
2.
La Clinique, un lieu ouvert sur la ville (2009)
Comment décririez-vous ce lieu qu’était la Clinique ?
Dimitri : Le mot tournait depuis longtemps : « Il nous faut un grand lieu ». Il y avait des squats d’habitation, mais il manquait un espace assez grand pour qu’on puisse s’organiser à nombreux. La Clinique s’est ouverte avec plein de gens différents. C’était une ancienne clinique radiologique, un grand bâtiment en plein centre-ville, sur la place du marché, en face du métro Croix de Chavaux. Un lieu très visible, avec des banderoles donnant sur la rue.
Alice : Il y avait une radio de rue, un freeshop où l’on pouvait trouver des vêtements gratuits, un ciné-club, etc. Un journal mural hebdomadaire aussi, L’ordonnance, qui racontait ce qui se passait dans la ville. Le lieu était attentif aux questions quotidiennes et pragmatiques, et ça passait entre autres par l’autodéfense par rapport aux droits sociaux, avec par exemple un « cercle collectif de recherche de logements », où se rencontraient des gens en galère de logement et d’où certaines occupations sont sorties. Le collectif des CAFards de Montreuil3 a aussi organisé ses premières réunions et permanences à la Clinique.
Serge : On est dans un contexte où la ministre de l’Intérieur, Michèle Alliot-Marie, vient de créer de toutes pièces le concept d’« anarcho-autonomie » pour désigner un nouvel ennemi intérieur. Certains territoires, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Nantes, Grenoble, Rennes, Tarnac, sont décrits par la police comme des viviers de l’anarcho-autonomie. Montreuil en fait partie.
Salma : Une semaine ou deux avant l’expulsion, une banderole avait été déroulée sur la façade, très visible depuis le marché, où était écrit « Poulets grillés » avec quatre plaques d’immatriculation de voitures banalisées qui nous surveillaient et qu’on avait repérées. Le genre de choses que les flics n’apprécient pas du tout.
Dimitri : À l’été 2009, deux lieux occupés se retrouvent expulsables en même temps : la Clinique, et les Demi-Lunes4 dans le haut Montreuil. La Clinique est expulsée le matin du 8 juillet. Environ 150 policiers et le RAID pour 15 personnes à déloger, avec tout le quartier de Croix de Chavaux bouclé. L’opération ne dure qu’une heure. Ça se termine avec le RAID sur le toit, qui braque les gens au fusil d’assaut et enlève le drapeau pirate qui orne le bâtiment.
Dans la foulée, une assemblée générale est organisée, qui décide d’appeler à un repas de rue le soir, à l’entrée de la rue piétonne voisine. On se retrouve pour le préparer et cuisiner des gnocchis tout l’après-midi. L’idée était de rendre visible le délire de cette expulsion. On avait appelé cette assemblée, « l’Assemblée de la Clinique exilée ». Elle a continué les jours suivants à differ des tracts. Il fallait s’organiser. Sachant qu’en plus, les habitants se sont retrouvés à la rue, sans maison.
3.
L’expulsion de la Clinique et la charge policière (8 juillet 2009)
Avec plus de précision, comment s’est passée cette soirée du 8 juillet où la police a tiré dans le tas ?
Salma : Le soir, il y a donc des tables remplies de gnocchis à l’entrée de la rue piétonne. On est nombreux.ses. Un gros dispositif policier a été mis en place toute la journée, pour être levé à 22 h. Une vingtaine de minutes après, un feu d’artifice est tiré vers le ciel, depuis la place, annonçant qu’une déambulation va commencer. Nous marchons calmement vers la Clinique, à quelque 200 mètres de là. La porte est ouverte, gardée par un vigile et son chien, avec qui on se met à discuter, pas forcément poliment. Le mot tourne que les flics arrivent, donc on repart vers l’autre coté de la place. Des voitures de police sont arrivées, d’où ont surgi des flics en civil de la BAC (Brigade anti-criminalité) et des flics en uniformes (Unité mobile de sécurité), qui s’équipent très rapidement de boucliers, tonfas, flash-balls, lance-lacrymos. Une personne restée près du bâtiment est interpellée, puis les flics tirent dans le tas.
Dimitri : Une première personne est touchée au front, et le mot tourne très rapidement : « Ils tirent à la tête ! » Joachim est touché à l’œil et s’écroule, moi je me fais toucher à la clavicule. Ça se transforme en panique. On revient naturellement vers les gnocchis au pas de course, vers l’autre place, mais dans la confusion et la peur. Les flics continuent à poursuivre les gens dans la rue, alors que Joachim est grièvement blessé, au sol. Il va être pris en charge par les camarades et part avec les pompiers, vers un hôpital. Plus loin, les flics tirent à nouveau, trois fois, dans le dos. Une copine se fait toucher à la main, alors qu’elle était en train de se protéger la nuque en courant. Un autre se fait toucher à l’épaule, et une à la jambe. Six tirs au total dont cinq qui ont touché des personnes au-dessus du torse.
Serge : En tout, ça a duré une douzaine de minutes entre le feu d’artifice, c’est-à-dire le départ du rassemblement, et ce que les flics appellent la dispersion. Ça a été très rapide. Je me rappelle d’un mélange de stupéfaction, de panique, et de colère. Après la dispersion, les flics qui avaient tiré ont continué à patrouiller pour faire des arrestations, afin de justifier leur violence. Leur but, c’était d’essayer de transformer les choses en violence urbaine, de dire qu’ils se faisaient assaillir de centaines de projectiles, qu’ils n’avaient pas d’autre choix que tirer, que c’était de la légitime défense.
Salma : Nous n’avons pas envie de tomber dans un discours « innocentiste » qui dirait qu’ils ont tiré sur des personnes qui ne faisaient rien. On s’en moque au final de ce qu’il se passait à ce moment-là en face des policiers, puisque de toute façon, ils ne se sont pas posé la question. Ils avaient l’intention de tirer.
Comment vous êtes-vous organisé.e.s les jours suivants ?
Serge : Une fois qu’on s’est ressaisis, on fait le compte des copains arrêtés, et des blessé.e.s, avec Joachim à l’hosto. Le lendemain, les gens essaient de se remettre de la soirée, et tout le monde ressent le besoin de se voir pour parler de ce qu’il s’est passé. On est choqués par le communiqué mensonger de la préfecture repris par la presse, qui qualifie Joachim de « jeune squatteur », parle de « heurts » avec la police, et met en doute l’origine de sa blessure. Stéphane, le père de Joachim lance rapidement un contre-communiqué sur le fait que c’est la préfecture qui parle à travers l’AFP. Comme il a un petit réseau grâce au milieu du théâtre et d’Armand Gatti, l’affaire gagne en médiatisation.
Dimitri : De notre côté, on distribue des tracts qui racontent les faits. Un appel à manifester cinq jours après est lancé. Parallèlement, Joachim porte plainte, puis trois autres blessé.e.s. Des assemblées « Clinique en exil » s’enchaînent, pour décider quoi faire. Après l’expulsion, les tirs, et avec le pote à l’hôpital, tout le monde est tendu, traumatisé, triste ou énervé, donc c’est très compliqué : les assemblées sont un peu dures, mais on décide d’agir, de tenir la rue, en essayant d’éviter la victimisation. Comme avec le repas de gnocchis après l’expulsion, l’envie est de montrer qu’ils ne nous feront pas rentrer chez nous – d’autant plus que les habitant.e.s de la Clinique n’ont plus de chez eux –, même en nous tirant dessus comme des pigeons.
Salma : Pour la manif, on appelle publiquement les gens à venir avec des casques, des lunettes de protection. Des banderoles renforcées sont fabriquées pour protéger la manif devant et derrière. Pour le coup, il y a vraiment du monde qui répond à l’appel, venant d’horizons très différents. Un texte écrit par Joachim à l’hôpital est lu, et la manif va vers la mairie, en passant par la rue piétonne, puis revient jusqu’à Croix de Chavaux. Et là, au même endroit où ils ont tiré quelques jours avant, les flics chargent la queue de manif. Quarante mecs de la BAC, armés et cagoulés, pour la plupart sans brassard, cachés sous la halle du marché pour sauter sur nous par surprise en courant, avec le commissaire devant et le préfet présent derrière eux.
Du côté des manifestants, il y a une réponse – la banderole de tête arrive à résister à l’assaut policier –, parce que les gens ont décidé de ne plus se laisser faire. Celles et ceux qui sont le plus remonté.e.s protègent les gens qui ne sont pas casqués – et heureusement, parce que sinon, les flics auraient fait un carnage. Il n’y a pas eu de blessés graves dans cette manif, quelques arrestations, dont un journaliste du Monde, mais tout le monde a été libéré sans suite.
Alice : Certaines personnes présentes étaient choquées par de telles pratiques, elles n’en revenaient pas. On n’était plus la nuit comme le 8 juillet, mais en pleine journée, avec la vie de quartier de Montreuil et les gens autour qui hallucinaient. D’habitude, les violences policières, ça se passe dans certains quartiers, loin du centre, ça ne se voit pas. Dans cette manifestation, il n’y avait pas seulement les groupes de Montreuil qui s’organisent, et qui étaient devenus une cible banale pour les flics. Du coup, ça a créé un peu de scandale dans la presse : quand on tape sur les journalistes, ils s’intéressent un peu plus aux faits, et reprennent moins les communiqués de la préfecture. À tel point que le directeur de la sécurité départementale s’est fait muter quelques jours après pour mauvaise gestion de cette manif.
Salma : À l’époque, les flash-balls sont utilisés sur des cibles très précises, dans certains quartiers, dans les prisons, sur les migrants et sur certains types de manifestations radicales. Ce qui fait malheureusement scandale, c’est qu’ils n’ont pas touché un migrant, un Noir dans une cité, ou un squatteur anarchiste, mais un homme de 30 ans, cinéaste et petit-fils d’un poète reconnu. Ils n’ont pas touché la bonne personne – selon les catégories qu’ils ont fabriquées pour faire régner l’ordre.
Dimitri : Très rapidement, le commissaire lui-même demande à ce que l’Inspection générale de la Police nationale5 soit saisie, on est quatre à porter plainte pour s’être fait tirer dessus. On se fait entendre à l’IGS, et la procédure est lancée.
Comment s’est prise la décision de porter plainte et de se constituer en collectif ?
Salma : Il y a quelque chose de spécifique aux personnes blessées, mutilées, et aux proches de personnes tuées par la police, c’est qu’elles sont démunies. Ce n’est pas n’importe quelle violence. C’est une violence d’État. Sur le coup, il ne te reste que ça : porter plainte. Tu aurais plutôt envie d’attaquer un comissariat, mais tu ne le feras pas. Certaines personnes décident de ne pas porter plainte, c’est une décision qui appartient à chacun.e. Avec ces morts ou ces mutilations, on ne parle pas d’accident de voiture ou d’engueulades entre voisins, mais de morts et de blessures à vie infligées par la police, ce qui n’est pas dû au hasard ou à la mauvaise humeur : c’est structurel. Ainsi, quand Joachim a décidé de porter plainte et que d’autres ont suivi, ce qui était important, c’était que ce soit collectif, et que nous voulions faire autre chose de cette démarche. Nous voulions dire que ces personnes blessées, ça aurait pu être n’importe qui. Quand on essaie de s’organiser dans les quartiers ou dans les manifs face à la police, ce n’est pas nous en tant qu’individus qui sommes visés, c’est ce qu’on représente. Cette nuit-là, la police a tiré sur ce qu’on représentait.
Ce qui a été décidé assez vite, inconsciemment je pense, c’est que ça ne pouvait pas être individuel. Pour faire front face à la machine judiciaire et policière. Médicale aussi, parce que l’hôpital est une administration comme une autre dans ces cas-là, elle te culpabilise aussi. Lorsque tu arrives blessé.e par les flics à l’hosto, tu n’es pas reconnu comme personne qui a été mutilée, mais comme quelqu’un qui a sans doute fait une connerie, et donc qui aura un autre traitement.
Après les dépôts de plainte, nous avons fait une demande d’indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi), qui sert à recevoir un peu d’argent quand tu es dans l’incapacité d’en gagner après un accident ou une agression. Mais nous nous sommes heurté.e.s aux mêmes défiances : « Êtes-vous vraiment victimes ? Qu’est-ce que vous aviez bien pu faire pour mériter ça ? » Quand tu as été blessé par la police, la Civi bloque toute indemnisation avant le procès, au cas où la victime serait en fait… coupable.
4.
La procédure au long cours et le collectif 8 juillet (2009-2016)
Entre le dépôt des plaintes contre les policiers et le procès, sept ans ont passé. Comment avez-vous occupé ce temps ?
Alice : À partir de là, notre question a été : qu’est-ce qu’on fait du temps de la justice ? Que fait-on en attendant un procès qui aura lieu dans des plombes ? Et s’il arrive, comment utiliser le procès à d’autres fins que celles de l’institution judiciaire ?
Serge : Dès le tout début du collectif, on s’est dit qu’on allait en justice pour en faire aussi autre chose. Surtout qu’à l’intérieur même du collectif, il y a différentes visions de la justice. La plupart des comités Vérité et Justice qui se forment quand quelqu’un est tué ou mutilé par la police se heurtent à des classements sans suite de leurs affaires, ou perdent leurs procès. Parce que l’enquête a été foireuse, parce que des preuves ont disparu, des témoignages ont été tronqués, bref tout un tas de magouilles pour disculper les flics.
Sur l’histoire du 8 juillet, on a vite vu que l’enquête n’allait pas pouvoir escamoter tous les témoignages extérieurs qui contredisaient les mensonges des policiers. Pour une fois dans une histoire de violence policière, on avait des billes pour pousser à une condamnation devant les tribunaux. On bénéficiait d’une certaine focale médiatique, et on s’est aussi dit que ça devait être une occasion d’en faire profiter les autres histoires, celles qui sont généralement passées sous silence.
Contrairement à plein d’histoires qui pètent à la gueule de gens qui ne sont pas organisés, là, c’est arrivé dans un cadre où les gens avaient l’habitude d’agir ensemble dans des rapports de force politiques…
Victor : Oui, c’est arrivé en plein milieu d’un moment collectif, après l’expulsion d’un lieu occupé. D’où le nom du collectif « 8 juillet » : ce qui rassemble les gens, c’est à la fois une histoire et un événement partagés. Toute personne présente ce soir-là aurait pu être blessée par les tirs de flash-ball, ça aurait pu arriver à n’importe qui. Mais se réapproprier collectivement cet événement, c’était aussi aller au-delà de notre propre cas, la relier à d’autres histoires où la violence d’État s’exerce. D’où, dès le départ, l’idée d’enquêter sur divers moments et lieux où les flics avaient blessé et mutilé au flash-ball, et donc d’aller rencontrer des gens qui avaient vécu la même chose que nous, dans des contextes complètement différents. C’était une manière de ne pas nous laisser enfermer dans les catégories qui nous sont tombées dessus avec la médiatisation de l’affaire. Et cela a donné des rencontres extrêmement fortes, par exemple avec les proches d’Ayoub Bouthara, mutilé à Audincourt près de Montbéliard, ou la sœur de Lamine Dieng, tué dans un fourgon de police dans le xxe arrondissement de Paris – et tant d’autres..
Salma : On n’avait pas non plus attendu que ce genre de trucs nous arrive pour se pencher sur la question des violences policières. On savait déjà que la violence est inhérente à la police. Mais c’est vrai que quand tu perds un œil, tu rencontres différemment les gens qui ont vécu la même chose dans une banlieue anonyme.
En novembre 2014, on a donc organisé une rencontre de deux jours avec une quinzaine de personnes touchées par des tirs de flash-ball, dont certaines ont perdu un œil, et on a aussi invité des gens proches de personnes tuées par la police. Cela a permis de créer du réseau, de partager nos expériences, nos outils, les expertises, ce qu’on savait déjà de la justice, des avocats, des contacts de médias, comment garder l’œil sur son dossier pour qu’il ne disparaisse pas par magie comme c’est souvent le cas dans les affaires de violences policières…
Alice : C’était pile au moment des manifestations suite à la mort de Rémi Fraisse, qu’on a rejoint avec des pancartes fabriquées lors de cette première « assemblée des blessées, des familles, et des collectifs contre les violences policières ». On a pu aussi parler de ce que c’était d’être blessé dans sa chair par la police, de perdre un œil, avec des moments où les premier.e.s concerné.e.s pouvaient échanger entre eux seuls, comme une communauté des blessés, et d’autres moments pour s’organiser avec tout le monde.
Salma : Cette assemblée est un outil pour celles et ceux qui viendraient d’être blessé.e.s, mais aussi pour partager et rendre publiques l’expérience et la parole de ces blessés. En juin 2015, des blessés et proches de blessés participant à cette assemblée ont ainsi été entendus par une commission d’enquête parlementaire sur le « maintien de l’ordre », qui a eu lieu après la mort de Rémi Fraisse. Nous savions bien que cette commission n’était que de la poudre aux yeux. Elle a même aggravé les problèmes liés au « maintien de l’ordre », notamment en ouvrant la voie aux assignations à résidence préventives qui ont un peu plus détruit le droit de manifester lors de la COP21 ou du mouvement contre la loi Travail. Mais ce moment nous a permis d’élaborer un discours commun entre personnes touchées par les violences policières et de le rendre public6.
Serge : Au fil des rencontres avec d’autres blessés, on a pu vérifier que les armes dites non létales, au lieu de réduire les violences comme elles ont été vendues dans l’opinion publique, ont rajouté une strate supplémentaire à l’arsenal de répression et de terreur utilisé par les policiers, entre la matraque et l’arme de service. On s’est rendu compte en discutant avec des blessés à quel point le flash-ball n’est absolument pas une arme utilisée pour se défendre, mais plutôt pour punir et terroriser. Beaucoup de tirs de flash-ball ont lieu après les faits, pour punir un groupe, et non pour se défendre. C’est le cas par exemple avec Pierre Doulliard à Nantes, qui se fait tirer dessus après une expulsion, alors qu’il est séparé des policiers par une grille et sans arme. C’est une punition extrajudiciaire : les policiers s’érigent en juges, et décident de la culpabilité d’un groupe en mutilant certains de ses membres pour l’exemple. Malgré le fait que les prisons n’ont jamais été aussi pleines, les policiers prétendent que les juges ne condamnent pas assez, alors ils s’arrogent le droit de punir eux-mêmes.
Salma: Aujourd’hui les flics manifestent pour faire valoir leur droit à la « présomption de légitime défense », c’est-à-dire le droit de blesser ou tuer sans raison. Droit qu’ils ont déjà, au vu du nombre de personnes blessées, mutilées ou tuées par la police. Ils cherchent à obtenir un cadre légal pour des pratiques qui existent de fait, et sont couvertes par la justice. Beaucoup de gens en ont été témoins pendant le mouvement contre la loi Travail. L’utilisation massive d’armes dites non létales comme le flash-ball, les grenades de désencerclement, les gaz lacrymogènes, les grenades assourdissantes… a non seulement pour but d’en blesser un.e pour terroriser tout le monde, mais aussi de menacer celles et ceux qui veulent manifester qu’elles/ils risquent de perdre un œil ou d’être gravement blessé.e.s. Et cela dissuade effectivement beaucoup de gens.
5.
Le procès contre la police (21-25 novembre 2016)
Comment va se dérouler le procès et comment peut-on soutenir le collectif 8 juillet ?
Alice : Dans le collectif, on a toujours marché sur deux pieds, l’un politique, l’autre juridique. Travailler sur l’histoire et les effets du flash-ball et rencontrer les gens blessés par la police. On voudrait que le procès ressemble à toutes ces rencontres, en donnant la parole à différentes personnes croisées durant ces années, avec des gens de l’assemblée des blessés qui vont venir parler de leurs histoires, et du savoir commun qui s’est constitué depuis. Pourquoi ces armes sont utilisées, comment les policiers cherchent à nous terroriser, en quoi ce sont des armes punitives. On veut aussi parler de notre expérience commune face à la justice et à l’impunité policière, comment elle se fabrique, par exemple avec le premier communiqué de la préfecture qui retourne l’accusation en faisant de toute personne blessée ou tuée par la police un coupable.
Un des atouts de ce procès, c’est d’être parvenu à ce que trois policiers soient mis en accusation, et non un seul. Cela montre qu’on ne parle pas de bavure, ni de ce flic-là qui serait mal formé, ou qui aurait pété les plombs. Trois policiers doivent justifier leurs actes de ce soir-là, et cela va nous permettre de mettre en cause la police et son fonctionnement. Tuer et mutiler font partie des pratiques ordinaires de la police.
Serge : Il n’y a pas de solution miracle, pas un truc qui va tout changer à la situation actuelle. Dans ce genre d’événements, l’institution pousse à l’isolement, et ce qu’on peut faire, c’est se regrouper pour visibiliser l’ampleur de cette violence institutionnelle. Le procès va avoir lieu une semaine après la commémoration des attentats du 13 novembre 2015, et en plein mouvement de rue de certains policiers qui demandent à pouvoir tirer sur les gens plus librement encore. Malgré un énorme effort des flics, des politiques et des médias pour instrumentaliser des attentats suicidaires afin de construire une image de la police comme protectrice du peuple, l’adhésion populaire à un gouvernement par la police n’est pas totale. Avec le mouvement contre la loi Travail, les violences policières sont apparues aux yeux de beaucoup de monde, il y a de plus en plus d’affaires qui les mettent en cause. On a l’impression d’un mouvement schizophrénique dans les médias où d’un jour à l’autre, on saute de reportages qui disent : « Les policiers sont là pour nous sauver » à des sujets qui affirment : « Les policiers sont des fous qui nous tirent dessus et tapent nos enfants ». Sans que jamais les deux choses ne soient reliées.
Salma : Un autre enjeu du procès est de pouvoir habiter l’espace et le temps hors de la salle d’audience, en organisant des débats, des actions, des rassemblements pour réfléchir au rôle de la police.
Alice : Il y aura plusieurs événements en amont, pour informer et pour récolter de l’argent : une réunion publique à Montreuil, une discussion au Rémouleur, une autre avec Pierre Douillard sur son livre L’Arme à l’œil au café-librairie Michèle Firk, une cantine…7 On a vraiment besoin d’argent, entre autres parce qu’on fait venir plein de gens pour témoigner au tribunal, et que cela coûte cher en frais d’huissier. On appelle aussi à venir nombreux.ses lors du procès : ne nous laissez pas seul.e.s avec la police et la justice ! On organise également un rassemblement à Montreuil le mercredi 22 au soir, au milieu du procès, pour parler publiquement du 8 juillet, mais aussi des luttes locales actuelles comme celles des Rroms expulsés cet été du lieu où ils habitaient, ou le « collectif Baras », collectif de migrants occupant un immeuble de Bagnolet expulsable depuis septembre. Il y aura aussi beaucoup de moments de discussion avec les autres luttes en cours autour des violences policières, par exemple autour de la mort d’Adama Traoré. Le but, c’est de faire entrer le monde dans le tribunal, pour montrer que cette affaire, comme toutes les autres, n’est pas anecdotique : elle parle de la violence structurelle de la police.
Serge : Oui, il s’agira de parler de sur qui et sur quoi tire la police. Le soir du 8 juillet, ils savaient sur qui ils tiraient : sur une histoire et des pratiques politiques. Des pratiques locales, offensives, hétérogènes, auxquelles ils sont régulièrement confrontés dans la rue, et qu’ils estiment anormales. C’est ça que fait la police au quotidien : fabriquer la norme en s’attaquant à tout ce qui déborde.
Plus d’infos :
Le site du collectif 8 juillet .
- La Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) était une autorité administrative indépendante créée par le gouvernement Jospin. Depuis mai 2011, ses missions sont désormais dévolues au Défenseur des droits. ↩
- http://cnds.defenseurdesdroits.fr/rapports/ra_pdf/Police_nationale/Avis_2008-60.pdf ↩
- Collectif de précaires, chômeurs, et allocataires du RSA qui s’entraident face à l’administration de la CAF et Pôle Emploi, produisent des enquêtes, organisent des actions, et tiennent des permanences d’auto-défense social ; https://cafard93.wordpress.com/. ↩
- Les Demi-Lunes étaient deux maisons mitoyennes dans le quartier de La Boissière dans le Haut-Montreuil, où se sont installés à l’automne 2008 une trentaine de personnes, enfants et adultes. Expulsables le même jour que la Clinique, ces maisons seront expulsées par la police un matin d’octobre 2010. Dans la foulée, la police tire au flash-ball sur Geoffrey, un garçon de 16 ans, alors qu’il manifeste contre la réforme des retraites devant un lycée de Montreuil. Geoffrey perd un œil. L’histoire se répète. ↩
- En abrégé l’IGPN — couramment surnommée la « police des polices » — désigne le service d’inspection de la Police nationale française et de la préfecture de police de Paris. ↩
- Cette intervention collective est disponible en ligne : https://collectif8juillet.wordpress.com/2015/06/01/intervention-de-lassemblee-des-blesses-lors-de-la-mission-denquete-parlementaire-sur-le-maintien-de-lordre/ ↩
- L’agenda détaillé de la mobilisation avant le procès est en ligne ici : https://collectif8juillet.wordpress.com/2016/11/08/programme-de-la-mobilisation/ ↩