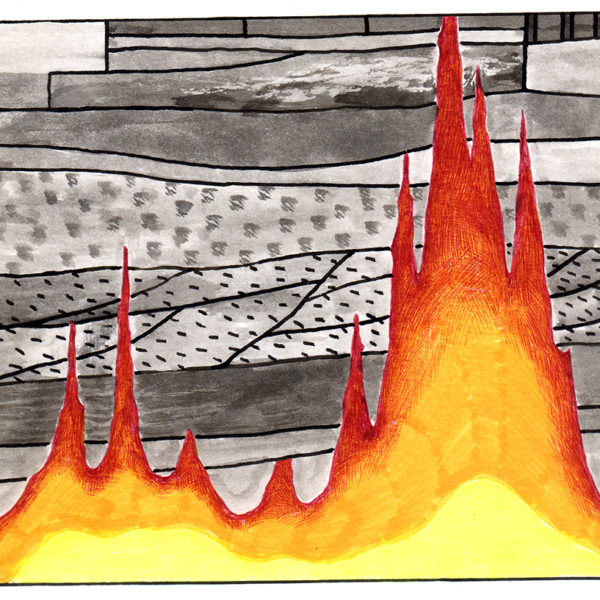Traduction par Émilien Bernard
Ce texte du journaliste irakien Ghaith Abdul-Ahad, connu notamment pour ses reportages sur Al Qaeda, a été publié le 8 octobre 2015 dans la London Review of Books, sous le titre « Some tips for the long-distance traveler ». Il y raconte le trajet « ordinaire » des migrant-e-s, comme lui, venu-e-s d’Irak, de Syrie, d’Érythrée ou d’ailleurs, passant par la Turquie ou la Grèce, en route vers l’Europe du Nord. Autant de voyages que d’existences, avec leurs étapes singulières, leurs espoirs trahis et leurs rencontres anodines ou presque.

Un ami kurde résidant à Souleymaniye, au Nord de l’Irak, a récemment posté sur sa page Facebook la reproduction d’un schéma tracé à la main. Orné de petites flèches, de silhouettes humaines en bâtons, de dessins de trains et de bateaux, il détaille la manière de se rendre de l’Est de la Turquie à la frontière allemande en vingt étapes.
Une fois que vous avez effectué le trajet d’environ 1 600 kilomètres jusqu’à l’ouest de la Turquie, le voyage tel que représenté sur le dessin commence réellement, avec un taxi qui vous mène d’Izmir à la côte. Une flèche indique la prochaine étape : un bateau allant de la mer Égée à « une île grecque ». Cela vous coûte entre 950 et 1 200 euros. Un autre bateau vous conduit ensuite jusqu’à Athènes. Puis c’est à bord d’un train ressemblant à une chenille mutilée que vous vous rendez à Thessalonique. La marche, des bus et deux autres trains aux allures de chenille vous font traverser la Macédoine jusqu’à Skopje, puis la Serbie jusqu’à Belgrade. Une silhouette en bâton traverse ensuite à pied la frontière de la Hongrie, près de la ville de Szeged. Vient enfin le trajet jusqu’à Budapest en taxi, et un autre taxi à travers toute l’Autriche. En bas du schéma, une petite silhouette-bâton bondit en agitant un drapeau. Arrivée en Allemagne, elle salue Munich. Son périple de quasiment 5 000 kilomètres lui a pris environ trois semaines, pour un coût total de 2 400 dollars.
La question de la migration est au centre de quasiment toutes les conversations dans les cafés de Bagdad et Damas – de même que dans ceux des petites et grandes villes de Syrie, d’Irak et des environs. Ces débats se focalisent notamment sur les avantages et inconvénients des pays en matière d’aides sociales accordées aux migrants. Tout le monde se tient au courant des trajets les plus adaptés du moment. Dès qu’il y a de nouvelles informations et conseils de route, ils se répandent sur les réseaux sociaux – Viber, WhatsApp et Facebook. Ces temps-ci, un peu plus de 2 000 dollars et un smartphone suffisent à atteindre l’Europe. La situation diffère donc largement de celle qui avait cours à la fin des années 1990, notamment en Irak, quand les sanctions de l’ONU combinées à la dictature de Saddam empêchaient d’envisager l’exil, la survie quotidienne dépendant d’allocations du gouvernement et de maigres salaires étatiques. Très rares étaient ceux disposant d’une somme d’argent suffisante pour rejoindre l’Europe. Des dizaines de milliers de personnes quittèrent l’Irak, mais la plupart atterrirent dans la morne Amman, en Jordanie. Si beaucoup de gens parmi mes proches voulaient partir, la plupart ne purent le faire – par manque de moyens, de volonté ou simplement de chance.
Je fus l’un de ceux qui n’y parvinrent pas. J’avais passé un diplôme d’architecture et rêvais de continuer mes études à Vienne ou Beyrouth. Ou bien d’au moins décrocher un job alimentaire à Amman ou Dubaï. J’étais déserteur et n’avais donc aucun espoir d’obtenir un passeport. Ma seule solution pour quitter l’Irak était de me procurer des faux documents ou de trouver un passeur. J’ai essayé pendant trois ans, dépensant environ 3 000 dollars – une fortune, alors – donnés à un passeur. On m’a menti, trahi, et j’ai perdu tout l’argent que j’avais emprunté. Pendant neuf mois, j’ai vécu avec mes bagages bouclés, prêt à décamper. Chaque nuit, j’appelais le passeur, qui continuait à me mentir et à me dire que le jour d’après serait le bon. Finalement, j’ai abandonné, rangé mes affaires, et j’ai attendu pendant cinq autres années.
Pendant des décennies, le chemin qui menait hors de la guerre, de la destruction et de la pauvreté pour aboutir à une existence européenne sécurisée était un secret jalousement gardé : la propriété des passeurs et des mafias qui contrôlaient les routes et avaient le monopole du savoir nécessaire. Ils conduisaient leurs affaires illicites dans les cafés miteux des ruelles d’Aksaray, à Istanbul. Les migrants qui avaient eu la chance d’atteindre la Grèce pouvaient aussi les croiser dans le quartier d’Omonia, à Athènes. Ceux qui étaient parvenus jusque là étaient baladés d’un réseau à un autre. De nouveau, on leur mentait, on les manipulait. Après tout, ils n’avaient pas d’autre choix que de tendre leur argent en échange d’une promesse et d’un espoir.
Il y a toujours eu une poignée de migrants optant pour la mer Égée, mais jusqu’ici, cette route était peu empruntée. Non pas en raison d’eaux dangereuses ou de bateaux peu fiables, mais parce que la police grecque avait la réputation d’être brutale et parce qu’il était très compliqué d’obtenir l’asile à Athènes. Cette année, tout a changé. La poignée s’est transformée en marée quand le nouveau gouvernement Syriza a réécrit les règles. « Jusqu’alors, notre politique avait été de repousser les bateaux même si nous mettions des vies en danger », m’a confié un homme travaillant dans l’administration des gardes-côtes de Lesbos. « Avec ce nouveau gouvernement, c’est plutôt : “Laissez-les venir, et aidez-les s’ils en ont besoin.” » La Turquie fermant elle aussi les yeux sur le passage de migrants, les vieux réseaux de passeurs et les frontières de l’Europe ont plié sous la pression de dizaines de milliers de personnes. Les Syriens qui auparavant étaient déplacés au sein de la Jordanie, du Liban et de la Turquie ont été rejoints par des Irakiens – pour la plupart de jeunes Sunnites fuyant l’État islamique et les milices chiites –, ainsi que par un petit nombre d’Afghans, d’Érythréens et de Pakistanais, lesquels fuyaient leurs propres conflits. Tous étaient en quête de nouvelles routes, guidés par l’espoir de vies meilleures.
Les techniques de mobilisation utilisées au cours des révolutions arabes, rassemblant des milliers de manifestants en un lieu donné, sont désormais utilisées pour organiser ces nouvelles vagues de migration. Cet exode n’est plus seulement composé des plus misérables et piétinés – même si beaucoup le sont encore. C’est devenu un pèlerinage où prédominent les classes jeunes, éduquées et moyennes. La disparition des frontières européennes a provoqué l’ire de deux groupes de personnes, luttant pour restaurer l’ordre ancien : les passeurs et les dirigeants de l’Union européenne.
* *
*
À l’aube sur l’île de Lesbos, un petit homme aux cheveux gris gare sa moto sous un pin et s’assoit sur le rivage d’une plage de galets recouverte de gilets de sauvetage abandonnés – oranges, rouges et bleus. Des carcasses d’embarcations en caoutchouc gisent dans les environs. À l’horizon, de l’autre côté du détroit, les montagnes turques sont ternes : la journée s’annonce couverte. L’homme vient tous les jours sur la plage. Il prend place et attend que les migrants arrivent. De temps en temps, il scanne l’horizon avec une paire de vieilles jumelles militaires pendues à son cou. Deux de ses amis boivent du café sur une table qu’ils ont installée un peu en retrait. Ce sont tous des pêcheurs, à l’origine. Comme beaucoup d’autres sur l’île, ils se sont transformés en charognards, dépouillant les moteurs des embarcations. La loi de la mer stipule que vous pouvez conserver ce qu’elle rejette.
« Parfois, ils leur refilent de mauvais moteurs chinois », explique l’homme, désappointé. Non pas qu’il s’inquiète pour la sécurité des migrants, mais la valeur à la revente de ces trouvailles est moindre. Pour ces trois hommes, les migrants sont des « pouilleux dégoûtants » venus de « l’autre côté », mais appâtés par un bon moteur hors-bord à 200 euros, ils seront ravis de former une sorte de comité d’accueil pour les nouveaux arrivants. Dans le sillage de ces exodes à répétition fleurissent en effet divers business. À Karaköy, vieille zone portuaire d’Istanbul, des échoppes en plein air qui jusqu’à récemment vivaient de la vente de quelques cannes à pêches se refont soudain une santé économique pétaradante en se livrant au trafic de gilets de sauvetage et de moteurs pour petits canots.
Alors que le soleil grimpe dans le ciel, quatre points apparaissent à l’horizon, en provenance de la côte turque. Ils sont disposés à intervalles réguliers et l’opération semble conduite avec une rigueur presque militaire. Les points finissent par se transformer en bateaux. Trois d’entre eux cinglent vers l’est, tandis que le dernier prend en droite ligne la direction du rivage où les trois pêcheurs sont positionnés. Même un seul moteur, ce n’est pas à négliger. La matinée vient seulement de commencer. Qui sait combien d’autres vont atterrir ici avant la fin de la journée ? Une heure plus tard le bateau semble ne pas avoir bougé. « Quelque chose déconne », dit l’homme à ses amis. Grâce à ses jumelles, il peut détecter des points bleus et rouges, ainsi que des bras désespérément agités. « Le moteur est foutu », lâche-t-il.
Les trois hommes sautent sur la moto et décampent en direction des bateaux qui ont mis le cap sur l’est. Le temps qu’ils y parviennent, une longue file de personnes – hommes ployant sous leurs sacs à dos, femmes portant et traînant des enfants – a escaladé les falaises et fait son entrée dans un village en surplomb. Ils sont une centaine, voire un peu plus – la cargaison de trois bateaux. Le quatrième est pour sa part escorté jusqu’au rivage par les gardes-côtes grecs. Les hommes, femmes et enfants remplissent les rues du village, prenant pied sur les trottoirs, se reposant dans l’herbe, détonant dans le paysage. Finalement, ils rassemblent leurs possessions et commencent à marcher vers Mytilène, principale ville de Lesbos, où les migrants doivent s’enregistrer avant d’être conduits à Athènes.
La longue marche vers l’Europe a commencé. La caravane est un véritable patchwork ethnique – Afghans, Arabes, Kurdes. Tous progressent le long de la piste. La disposition des groupes évolue, selon que certains décident de se reposer, ou bien au contraire de repartir. Par moments, les marcheurs s’étalent sur un kilomètre. À d’autres, ils avancent de front, regroupés, intimidant alors les touristes et les locaux.
En chemin, ils croisent un autre groupe de marcheurs, voyageant dans la direction opposée. Arrivant de la ville et se dirigeant vers la nature sauvage, ce groupe est composé de retraités européens – allemands et britanniques. Eux sont vêtus de vêtements de randonnée clinquants, de grosses chaussures et de t-shirts. Ils ont l’air anxieux. En face viennent les migrants, en route pour la ville, nombre d’entre eux quittant leur pays pour la première fois. Ils sont exténués suite à la longue traversée, mais également de bonne humeur. Ils évoquent leurs plans pour les jours à venir et n’ont pas le temps d’admirer le panorama. « Si j’étais un touriste, ç’aurait été un endroit parfait à visiter », lâche un homme qui voyage avec sa fille, alors qu’ils traversent un autre village pittoresque, entouré de champs de cerisiers. « Peut-être qu’un jour nous reviendrons avec ton frère et ta sœur. »
Il s’appelle Khaled. Il a des yeux tristes et ses cheveux trop tôt blanchis sont coupés courts. Il ne semble pas très rassuré concernant ce voyage et n’arrête pas de demander à sa fille si elle tient le coup. Cette dernière doit avoir 12 ans. Si elle répond rarement, elle ne semble pas aussi perdue que lui. Elle se contente juste d’avancer. Tous deux se sont joints à un groupe de Syriens, mais ils ne s’assoient pas avec eux et marchent quelques pas en retrait. Il explique qu’ils souhaitent rallier le Danemark, où vit son beau-frère. Il parle avec un accent irakien marqué, mais dit venir d’Al Mayadin, bourgade syrienne proche de la frontière irakienne. Lui et sa famille ont fui après que l’État islamique a pris le contrôle de sa ville natale plus tôt dans l’année, mais il est mal à l’aise quand il s’agit d’évoquer la situation là-bas. Sa femme, son fils et une autre fille sont toujours en Turquie.
Il est interdit de transporter les « illégaux » sur les îles grecques. Bus et taxis leur sont également interdits. Tout local les transportant est passible d’une amende. Ils doivent donc marcher quarante kilomètres pour rejoindre les centres d’enregistrement. Quand une Grecque, grande et blonde, s’arrête pour proposer de transporter Khaled et sa fille, il jette un œil penaud sur le groupe de Syriens et déclare : « On est arrivés ensemble, ce serait une honte de les abandonner. Nous continuons avec eux. » Après une nouvelle heure à progresser sous le soleil, la jeune fille semble encore plus fatiguée, si bien qu’il finit par accepter quand la femme grecque réitère sa proposition. Dans la voiture, il se montre plus volubile. Il demande à sa fille de sortir son Kindle, ce qu’elle fait avant de montrer à la femme quelques images du reste de la famille.
La police contrôle les entrées du port de Mytilène. L’après-midi commence et des centaines de migrants font la queue. Beaucoup sont là depuis la nuit précédente. Ceux qui ont débarqué ce matin avec Khaled n’arriveront pas avant la tombée du soleil. Les autres s’organisent. Ici, un Libyen et ses cinq enfants ont construit une maison entre deux voitures. Deux douzaines de Somaliens et d’Afghans sont installés près de l’eau. Chaque personne doit d’abord être enregistrée avant d’être convoyée dans un terrain de jeu désaffecté, où commence l’attente du transfert à Athènes.
La femme grecque fend la foule pour se frayer un passage jusqu’au barrage policier. Elle revient quelques minutes plus tard pour emmener Khaled et sa fille à l’intérieur, où une docteure de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), organisme affilié à l’ONU, inspecte l’enfant. Italienne d’une cinquantaine d’années, la soignante est habituée aux situations de crise, mais quelque chose dans la manière dont le père agrippe la main de sa fille la fait fondre en larmes. Elle demande le passeport du père, afin qu’elle puisse activer la procédure. Il se fige, avant de déclarer qu’ils n’ont pas de passeports.
« Vous êtes syrien, c’est bien ça ? »
« Oui. »
« Dans ce cas, ça ne prendra pas longtemps. »
La Grecque leur serre la main et les laisse à l’intérieur.
Peu après, Khaled ressort de nouveau et lui fait signe.
« Je suis désolé », lâche-t-il.
« Que s’est-il passé ? »
« Je vous ai menti. Je suis irakien, pas syrien. Ma fille m’a dit que c’était une mauvaise chose de mentir aux gens qui nous aident. J’étais terrifié. Nous sommes chiites, et les Syriens avec qui on voyageait étaient tous sunnites. Je suis désolé. »
Le mensonge du père est pourtant on ne peut plus logique. Les bagarres entre groupes ethniques différents ne sont pas rares. Et il y a une autre raison : les Syriens ont droit à un traitement préférentiel en de nombreux endroits. En Grèce, par exemple, ils peuvent rester plus longtemps dans le pays après avoir reçu leurs papiers – quatre mois, contre un mois pour un Afghan.
La femme blonde qui les a transportés appartient à un petit groupe de gens travaillant à contourner la bureaucratie européenne. Ils se rencontrent dans une pièce située au rez-de-chaussée d’un bâtiment en construction, dans un village des environs de Mytilène. Parmi eux, il y a une fleuriste dépensant son salaire en essence pour transporter femmes et enfants le long des collines jusqu’à la ville ; deux docteurs s’étant portés volontaires pour traiter les nouveaux arrivants le matin sur les plages et les transporter secrètement à Mytilène la nuit ; un fonctionnaire des gardes-côtes travaillant la journée au principal centre d’accueil. Le soir venu, quand il ne joue pas au volley mais quitte sa maison pour aider les migrants. Le leader du collectif est un prêtre imposant, doté d’une barbe blanche lui arrivant à la poitrine. Le Père Papastratis se déplace en traînant une bouteille d’oxygène et des tubes sortent de ses narines. Il a 58 ans mais en paraît 70. Ses poumons sont en piètre état et il a déjà eu deux attaques. Quand son fils n’est pas dans les environs, il en profite pour fumer une cigarette.
Bien avant que certains habitants de Budapest et Vienne ne commencent à faire des dons de nourriture et d’habits aux réfugiés, et tandis que les autorités locales cherchaient encore comment réagir, ce groupe de six faisait tourner un centre d’accueil non officiel, procurant de la nourriture, un toit et une assistance médicale aux nouveaux arrivants. La fleuriste m’explique que beaucoup d’habitants de l’île sont des descendants de réfugiés chassés de Turquie des décennies plus tôt. Elle me raconte ceci alors qu’elle est au volant de sa Renault et descend la route des collines en compagnie d’une autre famille. Sur le siège arrière, une mère ferme les yeux et s’endort, un enfant sur les genoux. À ses côtés, trois autres enfants, de 9 à 14 ans. Elle les conduit au centre d’accueil du Père Papastratis. Là, un homme décharge une voiture remplie de marmites, d’une cuisinière et de sacs de pâtes. Il installe une cuisine mobile tandis que la pièce se remplit. Costas est un anarchiste qui a nourri les sans-abris d’Athènes pendant deux ans. Drôle d’attelage : un anarchiste et un prêtre orthodoxe…
Contrairement au bâtiment du Père Papastratis, le centre d’accueil géré par le gouvernement sur le terrain de jeu abandonné est un endroit horrible. Il y a des ordures partout. Des bagarres éclatent entre Syriens, Afghans et Somaliens. Deux Érythréennes se plaignent de harcèlement sexuel. Le fonctionnaire des garde-côtes – par ailleurs fils aîné du prêtre – se tient au milieu d’une foule multipliant les demandes. Une famille syrienne dont la mère souffre du cancer, deux Afghans se plaignant du fait que des Syriens ne les laissent pas recharger leurs téléphones, une femme afghane expliquant que son enfant a besoin de médicaments contre la diarrhée… Tout le monde veut savoir quand il sera possible de quitter l’île. « Pourquoi est-ce que vous nous traitez comme ça ? », demande quelqu’un. « Qu’est-ce que je peux faire ? », m’explique l’homme plus tard. « Ils veulent que je sois leur mère, leur ami, leur psychologue, et je suis juste un garde-côte. C’est de la folie. Que l’Union européenne aille se faire foutre. »
* *
*
S’ils s’en tiennent à la route tracée par le schéma, la plupart des migrants s’arrêteront brièvement à Athènes, puis continueront leur voyage via Thessalonique. Là, ils feront six heures de marche entre la gare et la frontière macédonienne. Sur la route, à côté d’une station-service déserte (l’essence est moins chère de l’autre côté de la frontière), se trouve un motel. On peut s’y reposer, acheter des provisions et recharger les téléphones. Il est probable que les deux étages du bâtiment aient été par le passé aussi désertés que la station-service, mais c’est désormais un véritable caravansérail des temps modernes. Le hall déborde de piles de boîtes de conserve, de paires de baskets, de sacs à dos et de bouteilles d’eau, le tout à des prix prohibitifs. Deux vieux Grecs servent à la louche un plat de haricots et de riz – 10 euros l’assiette. Le moindre recoin est occupé – pas une chaise ni une table de libre. Un groupe de Syriens papote en fumant. À côté d’eux, une pleine table d’Érythréens boit de la bière en silence. Le patron du motel arpente les lieux en hurlant ses ordres d’une voix rageuse, se comportant comme s’il gérait un établissement haut-de-gamme, envahi non pas par des clients mais par de la vermine. Le business est si juteux que dans le voisinage les tavernes et lieux disposant de chambres à louer affichent tous des pancartes rédigées en arabe, dans l’espoir d’attirer une partie de la nouvelle clientèle. La plupart des migrants ont de l’argent à dépenser et font peu attention aux prix. Ils sont venus avec quelques milliers d’euros, du cash provenant de la vente de leur maison et de leur voiture. Se voir facturer cinq euros pour une canette de Coca leur semble une exploitation triviale comparée au millier d’euros environ que chacun d’eux a dû payer pour une traversée sur bateau pneumatique. Laquelle leur aurait coûté quinze euros en ferry.
Depuis le motel, les migrants suivent une piste serpentant dans les champs. Des milliers de personnes les ont précédés, si bien que la terre est très tassée. Des femmes portant voiles et jupes longues se déplacent avec précaution, guidant leurs enfants. Derrière elles, il y a un groupe de hipsters syriens arborant des panamas et des t-shirts. Des diplômés des universités de Homs et Damas. L’un d’eux est un ingénieur réseau ayant prévu de se rendre en Angleterre. Plus loin se trouve un Somalien affublé d’un chapeau de cow-boy, d’un pantalon de cuir et d’un collier. Il est complètement défoncé au haschisch et communique en anglais de rappeur gangsta.
Il y a également une famille syrienne : père, mère et trois petites filles. Le père, Bassem, porte la plus jeune d’entre elles sur ses épaules. Par le passé, c’était un marchand fortuné des environs de Damas. Sa famille possédait un grand nombre de terres agricoles. En 2011, quand la révolution a éclaté, il a utilisé son argent pour financer les insurgés et a été commandant dans la guerre civile qui a suivi. « J’ai dépensé 300 000 dollars en armes et munitions, dit-il, et j’ai perdu beaucoup d’amis. Je regrette de m’être ainsi impliqué. » Quand sa zone de combat a été encerclée, il s’est envolé pour la Vallée de Bekaa, au Liban. Il souhaitait y faire profil bas, mais a vite eu des ennuis avec le Hezbollah. Son frère a été jeté en prison, tandis que lui échappait de peu à la capture. Du Liban, il s’est rendu en Turquie, où un camarade révolutionnaire et passeur lui a promis de les mettre lui et sa famille dans un ferry pour l’Italie contre 10 000 euros. Le camarade a pris l’argent et a disparu. De toutes les sommes d’argent qu’il a perdues, dit-il, c’est celle-là qui lui fait le plus mal. Il parle calmement, sans amertume. En revanche, il se dit honteux d’avoir vendu les bijoux de sa femme pour échouer ici, où ses filles dorment dans des champs.
La police grecque a abandonné l’idée de faire barrage à la frontière, ayant appris qu’il convient de laisser s’écouler le flot de migrants aussi rapidement que possible. Après tout, personne ne souhaite rester en Grèce. Il faudra encore quelques semaines à la Macédoine pour en arriver au même constat. Si bien que pour ce groupe de migrants, la route est bloquée un peu plus loin par une Land Rover et cinq policiers macédoniens. Quelques centaines de personnes doivent donc sillonner les environs de la voie ferrée afin de trouver un endroit où passer la nuit. Certains installent leurs sacs de couchage sous un pont, d’autres improvisent des tentes faites de bâches en plastique et de bâtons. Au matin, alors qu’arrivent d’autres personnes (des femmes de Sierra Leone, un Yéménite en chaise roulante, beaucoup d’autres Syriens et Irakiens) et que le campement improvisé se fait village, quelques éclaireurs arpentent la frontière pour trouver un passage sûr. À droite de la police se trouve une rivière – infranchissable. À sa gauche, des collines réputées pleines de bandits réclamant à toute personne un droit de passage de 200 euros – ils auraient « acheté » la zone. Deux jeunes Kurdes qui ont combattu à Kobané s’en approchent pour trouver un passage. À un coude du chemin, juste avant un poste de police grecque abandonné, l’un d’eux repère un chemin menant à la Macédoine à travers les buissons. Le mot tourne : une voie a été trouvée.
Un heure plus tard, une colonne de migrants s’avance dans les champs de tournesols menant aux collines. La tristesse du matin a laissé place à l’exaltation. Les garçons kurdes aident tout le monde à progresser dans les buissons, puis grimpent sur la crête pour observer la police macédonienne en-dessous, tout en roulant et fumant des cigarettes. Deux équipes de police prennent la relève, tandis qu’un chien est amené sur place. L’un des garçons finit par faire une suggestion : « Pourquoi ne pas se disposer en ligne et courir jusqu’à la frontière ? » L’idée de prendre d’assaut une frontière internationale semble insensée à de nombreux réfugiés, notamment les plus âgés, mais il n’y a pas d’autre issue. Quand la nuit tombe, toute la troupe se rue au bas des collines jusqu’à la Macédoine.
Ensuite, il s’agit de descendre jusqu’à Gevgelija, ville la plus proche. Là, dans un absurde retournement de situation, la police macédonienne enregistre poliment chaque migrant et lui donne les papiers nécessaires pour se déplacer librement dans le pays. Plus loin, je tombe sur les hipsters syriens à la station de bus. Ils parlent avec excitation et consultent Google Maps sur leurs téléphones. « Prochain arrêt, Skopje », lance l’un d’eux. Ils ont prévu toute la route à venir : la Serbie, la Hongrie et l’Autriche. L’un d’eux pense se rendre au Danemark. Ils en sont convaincus : cela ne prendra pas beaucoup de temps.
* *
*
Plus tard, je rencontre des migrants à Lojane, village habité en grande partie par des Albanais, situé à la frontière Macédoine/Serbie. Ils se regroupent et tentent de trouver le moyen de traverser une autre frontière internationale. Un nouveau jeu du chat et de la souris avec la police. Cette fois, les conditions sont plus rudes. La rumeur dit qu’il est dangereux de flâner. La place du village est vide, à l’exception d’un fermier vendant melons et tomates sur un étal, ainsi que trois hommes âgés à caquettes noires assis sur un banc. Une famille fait ensuite son apparition sur la place, le père portant un enfant et la mère tenant la main de deux petits garçons. Ils marchent rapidement sur les pas d’un adolescent, un Arabe qui ouvre la voie. Ils empruntent une rue de traverse qui vire vite à la piste, et croisent une Audi rouge sombre sans plaques d’immatriculation stationnée en bordure de route. Les quatre hommes à l’intérieur les regardent passer. La famille s’engage dans les bois bordant la Serbie, avant de disparaître à un tournant de la piste. C’est seulement quand je vois une autre famille les suivre que je comprends : les nouveaux venus sont guidés par des migrants qui les ont précédés, des gens qui connaissent les astuces de la frontière et sont rémunérés pour la faire traverser en toute sécurité. Mais les vieux réseaux de passeurs sont encore à l’affût, prêts à ré-émerger au moindre signe de contrôles frontaliers plus serrés et à s’engraisser de nouveau sur le dos de ces migrants adeptes du do it yourself.
* *
*
Tous les passeurs ne se cantonnent pas aux pistes paumées traversant les frontières. Nabil est un Suédo-Irakien particulièrement doué pour le marketing. Son boulot est devenu plus difficile récemment : qui a besoin d’un passeur s’il est possible de tracer sa propre voie vers l’Europe ? Il a pris la décision de se focaliser pour des clients plus exigeants, ceux qui souhaitent éviter à leur famille les difficultés d’une longue marche à travers les Balkans.
Je le rencontre dans le hall d’un hôtel de Bagdad, feignant d’avoir besoin de ses services. Ses cheveux couverts de gel sont teints en noir de jais. Il porte une chemise bleue à pois blancs. Une paire de Ray-Ban à son cou. Il a un jour raconté à l’un de mes amis qu’il s’habille à l’européenne pour impressionner ses clients.
« Vous ne voulez pas vous humilier en traversant l’Europe à pied, c’est bien ça ? me lance-t-il, en vendeur expérimenté. Vous préférez sans doute une stratégie vous garantissant d’obtenir un passeport suédois dans les deux ans ? » Pour une somme de 40 000 dollars, il dit pouvoir arranger un mariage avec l’une de ses amies de Malmö. « Il faudra lui donner 10 000 dollars d’avance. » Le mariage serait organisé à Bagdad, des photographies immortalisant l’instant. « Une fois que vous obtenez votre visa, garanti par un contact à l’ambassade de Suède d’un pays voisin, vous payez 15 000 dollars. Une fois en Suède, vous vous installez et vous n’avez plus à vous inquiéter. Le gouvernement vous donnera une maison et un salaire. Vous vous posez et vous attendez, jusqu’à ce qu’il vous offrent un passeport, dans un an ou deux. »
« Qu’est-ce qu’il se passe si je vous donne l’argent et que je n’obtiens pas le passeport ? »
« Je vous garantis que vous l’aurez. Je l’ai déjà fait pour des tas de gens. »
« Et si je donne l’argent à votre amie et qu’elle ne se pointe pas au mariage ? »
« Je suis votre garant », m’assure-t-il.
Il ajoute qu’il existe une option moins onéreuse, qui peut être arrangée via un réseau d’agents corrompus dans les ambassades européennes de Bagdad. Apparemment, celles d’Italie et de Pologne sont les plus faciles à soudoyer. « On peut vous obtenir un visa Schengen de cette manière, mais on ne peut pas vous garantir que vous aurez le passeport par la suite. » Le visa louche me coûterait seulement 18 000 dollars.
Image de Une :
Doris Bittar, Secured States : The Arab World