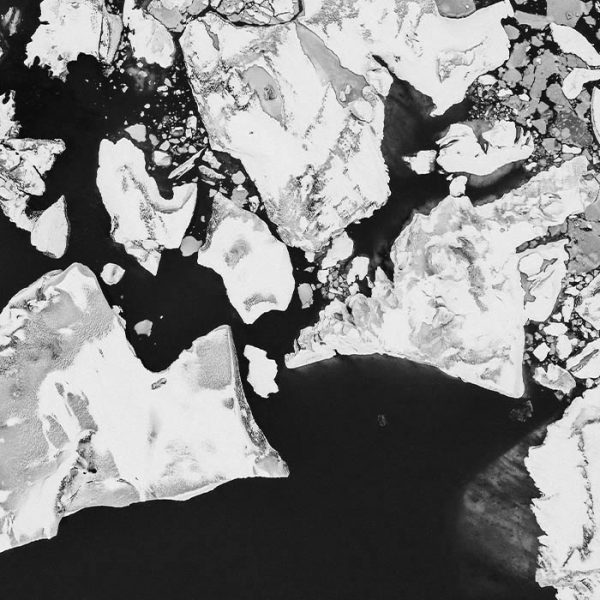À présent que sont terminées les commémorations en grandes et funestes pompes pour le centenaire de la boucherie de 14-18, on lira ici un autre souvenir, plus engageant. Car à la toute fin de cette guerre des puissances européennes commence une autre histoire, celle de la Novemberrevolution en Allemagne. Dès octobre 1918, les mutineries s’enchaînent, notamment chez les matelots qui refusent de continuer les massacres qu’on leur ordonne. Des soldats, paysan·nes et ouvrier·es se réunissent alors autour de structures de décision autonomes de tout pouvoir extérieur et s’auto-organisent en conseils – le tout en activant la grève générale. La monarchie et la bourgeoisie sont attaquées, la République socialiste de Bavière est proclamée… Mais laissons Paul Mattick Jr nous raconter cette histoire : sans en tirer de leçons définitives, et sans comparer l’incomparable, son éclairage donne un peu plus de prise et d’outils face aux crises politiques que nous vivons aujourd’hui.
Traduction de l’anglais (États-Unis) par Émilien Bernard
Texte original : « A Revolution to Remember », Commune, no 1 – Automne 2018.
Commune est un site web et un magazine papier semestriel qui vient de se créer, pour le plaisir de tout·es nos lecteurs et lectrices anglophones. Longue vie !
Paul Mattick Jr est auteur d’essais et responsable de « Field Notes », pages politiques du journal The Brooklyn Rail à New York.
Télécharger l’article en PDF.
Dans le numéro d’août 2018 de la London Review of Books, Susan Pederson listait les centenaires commémorés ces derniers temps, « s’entassant comme des avions en attente d’atterrissage dans le ciel d’Heathrow : 1914, l’insurrection de Pâques en Irlande (1916), la bataille de la Somme, la déclaration Balfour, la révolution bolchevique… Mais aussi l’Armistice, le Traité de Versailles et l’épidémie de grippe espagnole qui continue à planer au-dessus de nos têtes. » Un autre événement historique aux fortes résonances actuelles a malheureusement échappé à son attention : la Révolution allemande de novembre 1918.
Pederson est loin d’être la seule à avoir délaissé ce centenaire, auquel on n’a même pas accordé l’évocation lugubre réservée à la Révolution d’octobre russe en ces temps de foi déclinante envers les principes léninistes. Il y eut de rares contre-exemples : l’inestimable numérisation par la Bibliothèque nationale allemande de leur collection de publications révolutionnaires, ou bien cette conférence londonienne en octobre ayant pour thème « Living the German Revolution, 1918–1919 ». Mais on reste encore loin du déferlement de livres et d’articles qui aurait semblé approprié pour une telle occasion.
L’une des raisons de ce silence est à n’en pas douter la nature équivoque de l’événement. Alors que ce fut indéniablement un soulèvement social majeur, la république qui en découla périclita en une quinzaine d’années jusqu’à la fondation du Troisième Reich. Du point de vue de la gauche, la révolution elle-même a laissé un goût amer : ce fut le gouvernement social-démocratique installé par l’insurrection populaire qui pava la voie à Hitler en massacrant les révolutionnaires situés à sa gauche – celles et ceux qui s’étaient opposé·es à la guerre mondiale (appuyée par le SPD), et avaient exigé l’exercice direct du pouvoir politique et économique par la classe ouvrière. Et cela ne se traduisit pas uniquement par le meurtre de quelques leaders par les protofascistes en une alliance tactique avec les socialistes. Non, il y eut une participation indéniable à l’assassinat de dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses rebelles au cours des années de guerre civile. Rien de surprenant donc à ce que les « leçons » à tirer d’une telle période puissent sembler embrouillées.
Bien sûr, les leçons du passé sont généralement de peu d’utilité : les réalités évoluent, si bien que les schémas du passé se périment. Si le parti léniniste est mort, incapable de fournir la moindre proposition pratique pour aujourd’hui, ce n’est pas tant parce que les leçons du passé ont été tirées que parce qu’a disparu le contexte qui lui conférait une fonction : l’impulsion historique transformant une population pré-industrielle en classe travailleuse salariée dans des pays sous-développés manquant d’une classe dirigeante capable de s’en charger. Si la démocratie sociale ne peut pas être ravivée de nos jours, même sous la forme appauvrie qu’en propose Bernie Sanders aux États-Unis, c’est parce que la stagnation actuelle de l’économie globale freine l’accumulation du capital et la hausse des salaires réels qui donnaient à de tels mouvements une signification dans le passé.
D’un autre côté, il est des moments historiques qui révèlent des vérités structurelles sur le système social et ont néanmoins une signification durable, sans pour autant transmettre des « leçons » doctrinales. La Commune de Paris se situe certainement parmi les moins reproductibles des événements, façonnée qu’elle fut par l’histoire singulière de la classe ouvrière française au XIXe siècle. Marx le comprit très bien, lui qui se focalisa sur les spécificités historiques des réalités sociales. Et les actions de la population parisienne en 1871 lui permirent clarifier l’idée fondamentale selon laquelle la destruction du capitalisme requiert à la fois l’abolition de « cette propriété de classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques-uns », et « la destruction du pouvoir étatique » par le biais de délégué·es ouvriers et ouvrières révocables, pour prendre en charge directement les affaires sociales.
La révolution allemande constitua un autre moment révélateur. Avant même la Première Guerre mondiale, il apparut évident aux révolutionnaires que la destruction du capitalisme passait par la création d’organisations socialistes. Pour certain·es, cela devait être de petits groupes affairés à conspirer. Pour d’autres, des partis de masse visant les élections et des syndicats. Pour d’autres, encore, des unions syndicales qui pourraient un jour se transformer en organes du pouvoir social. Avant que la guerre eut démontré l’impuissance des partis et syndicats à empêcher que les travailleurs et travailleuses européen·nes (et, sur la fin, américain·es) ne soient envoyé·es se massacrer les un·es les autres, les vagues de grèves de masse qui s’étaient développées dans divers nations européennes au début des années 1900, indépendamment voire contre la volonté des organisations de travailleur·ses, avaient suggéré l’idée que la classe ouvrière elle-même – et pas des organisations minutieusement façonnées – pouvait former la base d’une lutte radicale.
Cette idée trouva un autre champ d’expression dans les manifestations d’usine qui éclatèrent en Allemagne à partir de 1916, coordonnées par un réseau de « délégué·es d’atelier révolutionnaires » (revolutionäre Obleute), qui étaient plusieurs milliers à la fin de la guerre. En mai 1916, par exemple, les « délégué·es d’atelier » appelèrent à une manifestation générale à Berlin, afin de protester contre l’arrestation du spartakiste (socialiste de gauche) Karl Liebknecht. L’appel mobilisa 55 000 ouvrier·es d’usine pendant deux jours. Une autre grève lancée un an plus tard, « rassembla entre 200 000 et 300 000 travailleurs de centaines d’usines et ateliers, avec des marches et des manifestations dans toute la ville [Berlin] et sur les lieux de travail. Les leaders syndicaux furent condamnés au silence ou ignorés. »
De telles évolutions servirent d’exemple, offrant des structures organisationnelles clandestines, au soulèvement général qui se déroula en novembre 1918, quand les marins sommés d’attaquer la flotte britannique dans un dernier effort voué à l’échec choisirent de se mutiner, arrêtant leurs officiers et disséminant leur mouvement dans les villes des environs. En quelques semaines, le pouvoir social, politique et économique fut pris en charge dans toute l’Allemagne par des conseils de travailleurs et de travailleuses et de soldats. Si beaucoup des personnes composant ces conseils étaient d’anciens fonctionnaires du SPD et des leaders de syndicats socialistes espérant contrôlant le mouvement, dans les grandes villes et les zones industrielles des conseils ouvriers firent élire des travailleur·ses en tant que représentant·es de leur lieu de travail, sur le modèle des comités de grève actifs pendant la guerre. Cela donna davantage de consistance à ce qui jusqu’ici était une idée vague : « le pouvoir des travailleurs et des travailleuses ».
Fondé sur la position de la classe ouvrière comme productrice de biens sociaux, ces conseils étaient structurés par les relations des travailleurs et travailleuses entre elles et eux. Ils prenaient la suite de l’organisation capitaliste de la production ; pour leurs propres intérêts. L’essence de l’organisation sur le lieu de travail fut ainsi résumée par l’un des principaux revolutionäre Obleute, Ernst Däumig : « Dans l’usine, tous les prolétaires, quelle soit leur affiliation partisane, tiennent une position commune. » Cela leur permettait de collectivement définir leurs intérêts en tant que groupe. Comme pour la Commune de Paris, l’action organisée et directe de la classe productrice, à l’échelle d’une société tout entière, soulevait la possibilité de l’abolition conjointe du salariat et de l’État.
Les principes essentiels de ces conseils étaient la révocabilité des délégué·es et le fait qu’ils et elles devaient remplacer l’administration étatique de « l’administration des choses » (pour user de la terminologie de Marx). Ne répondant pas à des impératifs théoriques, mais plutôt aux besoins pratiques de la lutte révolutionnaire, les formes spécifiques adoptées par le conseil de travail étaient déterminées par les conditions sous lesquelles il avait éclos. Ainsi que l’expliqua Däumig : « Sa formation ne suivra jamais un ensemble de règles bureaucratiques. Il accordera sa forme et ses tactiques aux besoins d’une situation révolutionnaire particulière. »
Pendant ce temps, les leaders du plus officiel SPD s’étaient emparés du pouvoir d’État, le gouvernement de guerre s’étant désagrégé et le Kaiser ayant abdiqué. Les membres du parti entreprirent de restaurer l’ordre social. Le nouveau chancellier Friedrich Ebert passa un accord avec le chef de l’armée, le général Groener : en échange de l’appui des militaires, le gouvernement socialiste leur laissait carte blanche pour écraser les conseils ouvriers. Il était clair pour tout le monde que les deux pouvoirs rivaux, le système des conseils et la république naissante, ne pouvaient plus coexister. La situation atteignit un point critique quand le SPD appela à l’élection d’une assemblée nationale, laquelle formerait un gouvernement, privant le réseau de conseil du pouvoir. Un congrès national des conseils ouvriers, dominé par le SPD, vota en faveur de l’élection d’une assemblée, signant son propre arrêt de mort. Début janvier 1919, alors que les socialistes au pouvoir œuvraient à solidifier le pouvoir d’État, des travailleurs et travailleuses de gauche tentèrent de défendre le système des conseils dans les rues et les usines. Ils et elles furent écrasé·es par les forces armées. Si le mouvement ne connut une véritable fin d’arrêt qu’en 1923, avec la faillite de la dernière insurrection, le sort des conseils était scellé dès le départ, la plupart des travailleurs et des travailleuses ayant refusé d’endosser le principe de leur auto-détermination.
Avec le recul, cela n’a rien d’étonnant. Les gens n’avaient aucune envie de subir une guerre civile après les souffrances du conflit mondial de 14-18. La fin de la guerre et la chute du gouvernement impérial semblaient déjà être de grands accomplissements, lesquels avaient demandé beaucoup de sacrifices. Et, après tout, la nouvelle république était aux mains des socialistes – les leaders du parti que les travailleurs et travailleuses avaient attendu pendant un demi-siècle, en pensant qu’il résoudrait tous leurs problèmes, dans la vie comme au travail. Mais le prix à payer pour avoir baissé la garde fut énorme : affermissement du capitalisme allemand, surgissement de nouvelles forces de la droite sociale et, en bout de course, une guerre qui coûta la vie à soixante-dix millions de personnes.
Quoi qu’il en soit, ainsi que le déclara plus tard un participant du mouvement : « La révolution, qui était si longtemps restée une théorie lointaine et un vague espoir, est apparue pendant un temps comme une possibilité pratique. » Nous vivons en 2018 un contexte très différent de celui qui donna naissance à la Révolution allemande. Nous avons notamment éprouvé la restructuration radicale des classes ouvrières désormais mondialisées et la disparition d’idées et d’organisations associées à la gauche telles qu’elles existaient à la fin du XIXe et au début du XXe. Les événements de 1919 montrèrent que cette gauche-là faisait partie intégrante du capitalisme en développement, puisqu’elle organisait le marché du travail et fournissait une structure pour contenir les rébellions de la classe ouvrière. La Révolution allemande démontra également l’obsolescence des vieilles idées et organisations de la gauche, de même que l’ampleur des conséquences à payer pour la classe laborieuse qui échoua à comprendre le changement. Dans le même temps, l’exemple qu’elle fournit de travailleurs et travailleuses reprenant prise sur la position que le capitalisme leur avait donnée – une soumission de fait, mais aussi une puissance possible – continue à mettre en valeur l’idée d’une révolution sociale comme une possibilité pratique.
*
Pour aller plus loin :
-
Un complément d’information sur cette période dans l’article « 1918 : Les conseils ouvriers en Allemagne », par Jules Hyénasse, CQFD no 126, nov. 2014.
-
On pourra lire des ouvrages de Paul Mattick, père de Paul Mattick Jr, ouvrier, militant et théoricien durant la Novemberrevolution, puis au sein des Industrial Workers of the World (IWW) aux États-Unis.
Marxisme, dernier refuge de la bourgeoisie ?, Entremonde, 2011.
La révolution fut une belle aventure, des rues de Berlin en révolte aux mouvements radicaux américains (1918-1934), L’échappée, 2013. Ainsi que la préface qu’il a écrite au livre d’Otto Rühle : La révolution n’est pas une affaire de parti, Entremonde, Genève, 2010. -
De manière plus générale sur les conseils ouvriers au XXe siècle : Ni parlement, ni syndicats : les Conseils ouvriers !, Denis Authier et Gilles Dauve, Les nuits rouges, 2003 ; Les Conseils ouvriers d’Anton Pannekoek aux éditions Spartacus, ou les Œuvres complètes de Rosa Luxemburg, aux éditions Smolny.