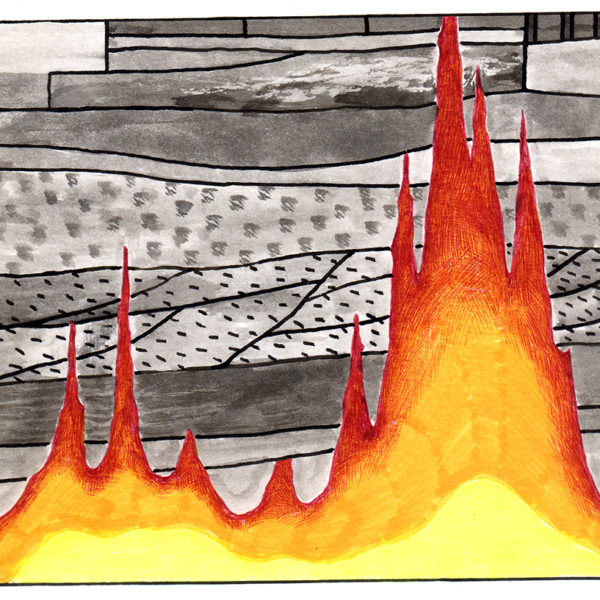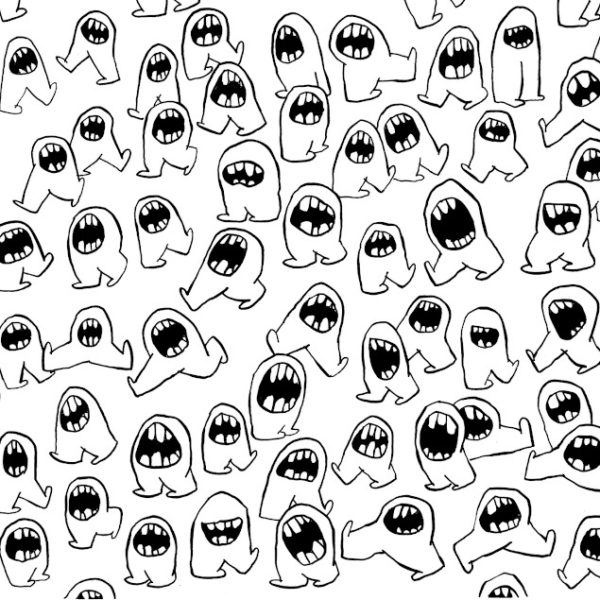Dans nos parcours de militant·es ou dans notre vie quotidienne, on a de plus en plus souvent affaire à la police et à la justice. Les avocat·es peuvent alors se révéler d’important⋅es allié·es. Mais nous avons rarement le temps de discuter pour leur demander quel regard ils et elles portent sur leur métier. Jef Klak a mis autour de la table cinq avocat·es pénalistes du barreau de Paris, pour nous aider à y voir plus clair dans la période d’état d’urgence que nous venons de traverser et dans celle d’état d’urgence permanent où nous entrons.
Télécharger l’article en PDF.
Avez-vous l’impression de pouvoir travailler pour plus de justice, ou certaines affaires vous donnent-elles parfois envie de tout arrêter ?
Martin Méchin : Beaucoup d’affaires m’ont dégoûté, mais en me donnant l’envie de me battre encore plus. J’ai souvent l’impression de perdre mon temps, et de ne servir à rien, c’est vrai. Mais on le sait d’avance. Par exemple, cet après-midi, je savais que la détention provisoire de mon client serait prolongée, et que je ne servirais à rien. Mais je joue le jeu, d’abord parce que c’est une question de dignité. Le mec a besoin qu’on parle pour lui, qu’on le défende. C’était important que le juge entende ce que j’avais à lui dire. Mais parfois, même si tu crois vraiment en ce que tu plaides et que les juges t’écoutent, tu te rends compte qu’en fait, le juge se plie aux réquisitions du procureur. Et là, tu te dis « j’ai vraiment pissé dans un violon ». Ça arrive à tous les avocats de sentir que si on n’avait pas été là, ça aurait été la même chose. J’ai défendu des accusés qui avaient avoué en long, en large et en travers, et à la fin ils se prennent la même peine que s’ils n’avaient pas « joué le jeu ». Ils ne comprennent pas, se demandent pourquoi ils ont parlé, pourquoi ils se sont fatigués à tout raconter. Ça ne me donne pas envie d’arrêter le métier, ça me donne envie de les faire chier encore plus, les juges. De ne jamais les lâcher.
Alice Becker : La clémence ou la sévérité de la peine ne sont que très rarement fonction de la qualité de la plaidoirie. On a besoin à chaque fois de se rassurer sur son utilité, en quoi on a pu servir dans le délibéré qui a été rendu.
Martin : Si je devais faire un pourcentage à vue de nez, je dirais que dans 70 % des cas, je ne sers à rien, dans 25 % j’ai été utile, et 5 % des fois, j’ai renversé la vapeur. Et je suis sans doute optimiste.
Raphaël Kempf : Je me rappelle de mes premières affaires, où l’on m’envoyait plaider des affaires perdues d’avance, je faisais mon possible pour rassurer les clients : « Vous n’avez pas baissé la tête, vous vous êtes défendus, on a dit ce qu’on avait à dire. » C’est une question de dignité qui est en jeu, assez forte.
Pour moi, mon pire souvenir, c’est toujours la dernière audience… Ces derniers temps, c’est difficile. Martin disait qu’il fallait toujours faire chier les juges, et c’est un truc vraiment important. J’ai appris que tu ne pouvais rien obtenir de la justice si tu ne les faisais pas chier. Si tu arrives uniquement en disant « Mon client est gentil », tu n’obtiendras rien.
Aïnoha Pascual : On n’a pas la possibilité de mettre en œuvre les moyens, le temps ni l’argent, qu’on devrait pour chacun. Ce n’est pas comme dans les films, où l’on a l’impression que l’avocat ne pense plus qu’à son affaire H-24, et va chercher la petite bête. C’est idéal, je rêverais de pouvoir faire ça mais, concrètement, c’est impossible. Ce n’est pas un reproche que je fais aux avocats, mais à l’institution même, à la façon dont est organisé notre métier et la justice.

Palais de justice d’Annecy
Martin : Si tu es bien payé, comme dans les gros cabinets pour riches, tu peux passer beaucoup de temps et démonter plus souvent le dossier de l’accusation. Mais pour nous qui sommes indépendants, la plupart des dossiers sont ceux de manifestants ou de petits délinquants.
Raphaël : D’autant plus que l’on doit plaider dans de nombreux cas de comparution immédiate, où il faut défendre le client tout de suite : vingt minutes pour prendre le dossier et l’étudier, et en avant ! Et ça n’a rien d’exceptionnel : à Paris, tous les jours, il y a une trentaine de dossiers de comparution immédiate.
Alice : Lorsque je reçois un dossier en urgence, comme en comparution immédiate, je sais que je n’aurai jamais le temps de le lire ligne à ligne. Avec l’expérience, je feuillette le dossier et je sais sur quels éléments je dois concentrer mon attention. Jeune avocate, je bloquais sur des choses insignifiantes. Et de la même façon, aujourd’hui, je répugne à donner le dossier au client, parce qu’il va se focaliser sur des points de détails dont le juge n’a que faire. Il va prendre la parole pour dire qu’il s’est passé ceci et cela, et que ça lui semble le nœud de l’affaire. Avec l’expérience, on essaie plutôt de deviner sur quoi le juge va tiquer et quel sera l’enjeu du débat, pour cibler les choses importantes sur lesquelles il faut s’arrêter et être plus efficaces.
Aïnoha : Mais l’efficacité par rapport à quoi ? Nous avons trop tendance à nous mettre dans la position de sachant, or il peut arriver qu’une fois de temps en temps nous passions à côté de quelque chose. Si on avait le temps de donner le dossier à chaque client et de se coltiner son retour, peut-être cela s’avérerait-il salutaire dans certaines affaires.
Martin : Habituellement, je dis à mes clients : ça dépend de ce que vous voulez. Soit on fait un procès dans lequel vous gueulez, et vous allez en manger plein la figure, mais vous serez fiers de vous. Soit vous essayez de vous en sortir au mieux avec les armes qu’on a décidées pour vous.
Alice : Nous, on est juste une voix. Le client décide. S’il veut faire le canard [c’est à dire avouer et s’excuser, ndlr], c’est son choix. Si toutes les preuves et les charges l’accablent, des caméras, trois témoins, des messages incriminants sur son téléphone, etc., la relaxe ne tient pas. L’avocat lui conseillera sans doute d’avouer en espérant une peine moins lourde, mais s’il veut persévérer et qu’on plaide la relaxe, on cherchera toutes les astuces dans le dossier qui viennent accréditer la thèse que la personne veut soutenir.

Palais de justice de Caen
Est-ce que l’augmentation de la répression due à l’état d’urgence a changé votre métier ?
Matteo Bonaglia : Il faudrait commencer par bien définir ce qu’est l’état d’urgence : cela n’implique pas nécessairement une augmentation de la répression, mais incontestablement des formes nouvelles dans le dispositif de contrôle et de répression administratif et policier. Dans ce sens, oui, je trouve que l’état d’urgence change notre métier
Raphaël : Au pénal, une personne est attaquée parce qu’elle est suspectée d’avoir commis un acte contraire à la loi. Dans le cadre de l’état d’urgence, une personne est poursuivie parce qu’on suppose qu’elle pourrait faire quelque chose, qu’elle pourrait être dangereuse. Elle sera alors sujette à une mesure de contrainte comme une assignation à résidence ou une interdiction de manifester qui, techniquement parlant, n’est pas une sanction, même si c’est ressenti comme ça. Pour la justice, c’est une mesure préventive de police administrative.
Ce n’est pas parce qu’un comportement ne ressort pas du Code pénal qu’il échappe totalement à la répression. L’état d’urgence pousse en cela une logique qui lui préexistait. Par exemple : depuis une loi européenne de 2012, le fait d’être sans papier n’est pas directement puni par la loi, mais des dispositifs pénaux continuent de sanctionner des comportements qui y sont liés, comme l’aide au séjour, l’entrée irrégulière sur le territoire, etc. Autre exemple : en France, la prostitution en tant que telle n’est pas punie par la loi, mais on poursuit le proxénétisme, qui peut parfois se réduire au fait d’aider une amie qui se prostitue. Le Code pénal ne punit donc pas seulement le mac qui s’en met plein les poches, mais aussi des prostituées qui s’entraident pour faire leur travail.
Matteo : Tout le problème est de savoir ce qu’on entend par sanction. Une assignation à résidence, par exemple, n’est pas considérée comme telle par le droit, mais c’est bien le sentiment de punition qui affecte celui qui la subit. La mesure peut ainsi lui interdire de quitter un village de cinquante habitants pendant un an, l’obliger à pointer plusieurs fois par jour au commissariat, sans même que cette personne n’ait été condamnée et sans qu’il lui soit possible de faire efficacement valoir ses moyens de défense. C’est davantage une mesure de privation de liberté qu’une mesure préventive de sûreté, et la logique pénale s’étend ainsi, sur ses bordures.
Martin : Dans le cadre pénal traditionnel, quand une personne est placée sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer au commissariat, le fait de s’en dispenser ne constitue pas un délit. Le juge pourra révoquer le contrôle judiciaire, pour placer la personne en détention provisoire, mais le défaut de pointage n’est pas une infraction en tant que telle. Dans le cadre des décisions administratives, c’est un tout autre schéma. Il m’arrive de défendre des supporters ultras du PSG, avec des mesures administratives comme l’interdiction de stade, ou bien des obligations d’aller pointer au commissariat lors de chaque match du PSG. S’ils ne respectent pas cette obligation, cela devient un délit, et ils se retrouvent devant le tribunal correctionnel. On voit bien qu’une mesure initialement administrative peut être tellement sévère et absurde qu’elle se fond dans le pénal. Surtout que ces obligations de pointer ne sont généralement pas prescrites pour avoir commis un acte délictueux, mais pour avoir été présent à un endroit où des actes répréhensibles ont été commis : si tu y es et que tu es fiché comme pouvant potentiellement y avoir participé, tu écopes de la mesure administrative. La mesure est décidée par le préfet, sans passer par un jugement. Il est possible de contester et de demander un jugement, mais en attendant, la mesure est prise.
Raphaël : Et les gens se retrouvent enfermés. Même si c’est de la préventive, cela reste de la prison. Donc, on peut dire que depuis l’état d’urgence, il est devenu normal d’aller en prison pour ce qu’on pourrait faire, et non pour ce qu’on a fait.
Matteo : Selon la conception libérale classique, tout ce qui n’est pas interdit est permis. Aujourd’hui, nous sommes passés dans une doctrine prescriptive. Ce n’est pas « Il est interdit de marcher sur la pelouse », et à chacun de voir où et comment il marche, c’est « Il faut marcher comme ceci sur le chemin ». Nous vivons la régression d’un État de droit, certes imparfait, qui se mue en un État policier, avec une discipline prescrite des comportements des citoyens. Cela se double de mesures qui ne sont pas prises par un juge du siège, censé garantir le minimum de libertés, car appelé à juger sur la base de preuves après la commission d’une infraction, mais par les préfets et les services de renseignement, à titre préventif. Donc sans procédure ni débat contradictoire, et sans séparation des pouvoirs : le préfet, c’est la voix directe du gouvernement. Les pouvoirs du judiciaire passent donc dans les mains de l’exécutif, sous couvert de prévention du risque.
Alice : Et à cela s’ajoute une moralisation des conduites : on va contrôler ton quotidien. Les fouilles de sacs et palpations pour « mesures de contrôle » sont devenues monnaie courante dans les lieux publics ou les magasins. Alors que ce n’est absolument pas permis par la loi, qui assimile la fouille des sacs à une perquisition et impose le respect d’une procédure précise. La violation de la loi par les agents de l’État ou de sécurité, sur ce point, est quotidienne, sans que cela pose problème. Si le droit était appliqué, il serait en certaines occasions protecteur, mais ce n’est pas le cas. Et cette longue habituation aux fouilles permanentes depuis Vigipirate (un dispositif d’« exception » en place depuis 1991 !) a permis de faire accepter la même chose à l’entrée des manifestations, et de se retrouver avec des procès pour port d’armes contre des gens qui avaient un tire-bouchon sur eux !

Palais de justice de Nantes
Raphaël : L’état d’urgence implique un renversement de la présomption d’innocence, c’est-à-dire que c’est aux citoyens de prouver tous les jours leur innocence et qu’ils n’ont rien à se reprocher. Alors que normalement, c’est à l’État d’apporter des preuves de la culpabilité. Dernièrement, un juge demandait à un accusé que je défendais : « À votre avis, pourquoi êtes-vous fiché S ? » Si le juge pose cette question, c’est que lui-même ne le sait pas, car c’est à la discrétion des services de renseignement. Or, ce n’est pas à mon client de s’épancher sur la question, mais au ministère public de justifier cet état de fait. Donc non seulement l’État apporte un élément à charge lors de l’audience sans en expliquer les tenants et les aboutissements (personne ne sait pourquoi cette personne est fichée, si c’est sur des bases solides ou pas), et en plus l’accusé doit, lui, s’en justifier.
Matteo : L’aveu était la reine des preuves dans l’ancien droit, arraché sous la torture. C’est le principe d’une justice de guerre. Or depuis quelques années, on assiste à un retour en force de la logique de l’aveu. Il suffit pour s’en convaincre de s’intéresser à l’introduction récente dans notre procédure de la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ».
Raphaël : Le droit au silence, de ne pas être poursuivi et condamné sur le seul fondement des déclarations faites sans avocat, existe, mais il est battu en brèche. Si la personne a gardé le silence, les policiers et le procureur lui font sentir que ça va avoir une influence sur son éventuelle détention provisoire.
Alice : Ils vont arguer qu’on ne peut pas relâcher le suspect parce qu’il y a un risque de concertation avec d’éventuels complices. Ou bien parce qu’il rechigne à s’expliquer sur les faits reprochés, et que ça, c’est suspect. Or se taire est un droit élémentaire, donc l’opposé d’un acte suspect !
Raphaël : Mais c’est un moyen détourné d’utiliser la détention provisoire pour faire parler les gens.
Matteo : La logique que les policiers et les procureurs essaient d’imposer aux juges, c’est qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Si la police t’a arrêté, c’est que tu as quelque chose à te reprocher. Et la machine judiciaire se lance : la comparution immédiate est proposée pour accélérer la procédure, en réduire le coût, permettre une réponse pénale rapide et systématique. La police fait alors croire à l’accusé apeuré qu’il a tout intérêt à accepter. On se retrouve devant un juge sans avoir préparé sa défense, fatigué par la garde à vue. On doit justifier son innocence avec un avocat qui n’a eu que bien peu de temps pour étudier les procès-verbaux face à un procureur qui veut faire du chiffre, et pour qui tout ce déploiement de forces de l’ordre, du parquet et du tribunal ne peut pas être absurde : l’accusé est là pour être jugé et condamné.
Martin : Après une détention provisoire, il est très rare que les juges se permettent de relaxer les suspects. Ce serait remettre en cause le bien fondé de l’enfermement de la personne et donc du processus judiciaire. C’est extrêmement intéressant d’aller à la chambre des détentions provisoires abusives, qui alloue les indemnités suite à une détention provisoire suivie d’une relaxe 1.
Raphaël : Oui, ces quelques personnes innocentées se reprennent une deuxième fois la violence de la justice, parce qu’il leur faut encore démontrer combien elles ont souffert d’être en prison pendant trois ans.
Matteo : Je connais un très vieil avocat du barreau de Paris, Roland Weyl, militant communiste de la première heure, dont je vous livre ici le constat, qui me semble très pertinent : notre époque est traversée par un double mouvement, vers le haut, au niveau de l’activité économique, on observe un retrait de l’État qui fait le choix du laisser-faire, laisser-passer, par exemple avec le plafonnement des indemnités prud’homales, la libre négociation au sein de l’entreprise ou la dérégulation financière… En revanche, il faut bien gérer les conséquences de cette politique sur les peuples, et en bas de la pyramide sociale, on observe un État de plus en plus interventionniste qui construit un droit de plus en plus précis et opprimant. Donc pour les riches, moins d’État, et pour les pauvres, un droit d’encadrement de plus en plus technique et inaccessible, répressif et injuste.

Palais de justice de Lille
Pourtant, on entend souvent dire que « La France est un État de droit »…
Martin : L’État de droit, cela veut tout et rien dire. Rien n’est plus facile que de s’en prévaloir : il suffit d’inscrire une loi dans le droit. Ce qui est prévu par l’État de droit n’empêche pas des lois liberticides et injustes.
Alice : Par exemple, les lettres de cachet de l’Ancien Régime relevaient de l’arbitraire de l’État, mais étaient en même temps l’expression de l’État de droit de l’époque. Aujourd’hui, ce que subissent les opposants politiques du fait de l’état d’urgence, en terme d’arbitraire, est tout à fait analogue à des lettres de cachet.
Matteo : La conception traditionnelle de l’État de droit n’empêche ni l’exploitation capitaliste ni les inégalités raciales, elle constitue néanmoins un minimum qui est actuellement battu en brèche. Si on appliquait sérieusement la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la police ne pourrait pas agir avec la latitude dont elle jouit en ce moment contre les militants de gauche, les musulmans ou les habitants des quartiers populaires. Mais on peut et on doit aussi prendre les choses par un autre bout, et se rappeler que le droit est toujours la traduction d’un rapport de forces au sein de la société. Si les 35 heures ou les congés payés sont passés dans la loi, c’est parce que collectivement, à un moment donné, une composante de la société a décidé qu’il n’était décemment pas possible de travailler 60 heures par semaine et que cela devait désormais figurer dans la loi. Donc un État de droit n’est rien sans une conception substantielle qui s’interroge sur le contenu de la norme.
Et plus qu’un référentiel normatif, la Justice doit se fonder sur un référentiel de valeurs, autrement dit, cela passe par penser collectivement le contenu que l’on veut donner au droit. Je suis convaincu qu’il existe un bon droit, qu’on devrait considérer comme substrat inaliénable, et qui ne soit pas uniquement constitué de libertés formelles (liberté de se réunir ou d’aller et venir, par exemple). Un droit qui ne fasse pas l’économie des questions de droit concret, matériel (se nourrir à sa faim, se vêtir chaudement, se loger dignement, travailler moins, moins jeune, moins vieux, bénéficier d’une sécurité sociale complète, etc.) ni de celles du pouvoir citoyen (comment remplacer le droit actuel, confisqué par certains et qui vise à gouverner des hommes, par une humanité libérée et maîtresse d’elle-même, qui dispose collectivement du droit d’administration des choses).

Palais de justice de Créteil
L’état d’urgence donne donc plus de libertés à la police et moins aux citoyen·nes ?
Raphaël : Oui, mais de manière pernicieuse : la police légitime son action, la plus illégale soit-elle, au nom de l’état d’urgence, alors même que l’état d’urgence ne le permet pas. Idem pour les magistrats : l’expression « état d’urgence » permet de couvrir les injustices les plus quotidiennes. Si un policier te fouille, il dira : c’est l’état d’urgence. Et un magistrat peut se permettre aujourd’hui de dire en pleine audience : « Pourquoi êtes-vous allé manifester, alors que c’est l’état d’urgence ? » Combien de fois je l’ai entendu ! Alors que techniquement parlant, l’état d’urgence n’interdit pas de manifester ni ne permet aux policiers de fouiller qui ils veulent. Il y a comme une idée qui laisse penser à tout le monde qu’on est en état d’urgence, et que donc, les citoyens devraient modeler leurs comportements sur un ordre sécuritaire.
Matteo : C’est Foucault qui, dans Surveiller et punir puis ses Cours au Collège de France, parle « d’orthopédie de dressage des corps et des esprits » : répéter la même rengaine fondée sur la peur finit par créer une norme comportementale.
Alice : La doctrine juridique qui prévaut aujourd’hui veut que le premier des droits soit le droit à la sécurité, et que toutes les restrictions qui priveraient des autres droits soient donc justifiées.
Matteo : Mais moi, je suis d’accord avec ça : sécurité de l’emploi, sécurité face à l’État, sécurité face aux coupures d’électricité d’EDF, sécurité sociale… !
Alice : Il faut distinguer l’état d’esprit général d’un côté, et les vraies implications de l’état d’urgence de l’autre. Faire attention au discours de militant qui dirait que la répression serait plus douce si on n’était pas sous l’état d’urgence. C’est faux ! Il y a plus de mesures restrictives, c’est-à-dire que le champ de la contrainte sur les libertés s’élargit, mais les peines ne sont pas forcément plus sévères en audience.
Matteo : Des lois récentes ont tout de même doublé la pénalité pour les délits d’outrage et de rébellion, et il y a une vraie criminalisation de la contestation politique…
Martin : C’est un climat global…
Aïnoha : Le problème, c’est que ce climat touche plus les quartiers défavorisés. En banlieue, le climat d’état d’urgence donne lieu à plus d’arrestations arbitraires, avec des accusés qui n’ont pas vraiment les moyens de se défendre, et implique plus de répression, car beaucoup finissent en prison pour trois fois rien – voire absolument rien.
Matteo : Le premier motif de procès-verbal pour les stups se fait bien souvent sur la base d’un « renseignement anonyme », recueilli de façon pas très nette par les policiers pour pouvoir ouvrir leur enquête. C’est une vieille méthode policière. On imagine donc bien quelle porte a été ouverte quand on leur a dit qu’ils pouvaient en plus perquisitionner à tout-va.
Aïnoha : L’état d’urgence a permis des mesures dérogatoires, comme ces perquisitions sans aucun fondement ni justification, uniquement sur une suspicion. Et cela a profité aux stups, à la BAC ou au commissariat local qui avaient déjà un suspect dans le viseur, sans pouvoir l’attraper en flagrant délit. Imaginez l’aubaine pour eux : pouvoir aller directement chez quelqu’un et le lever à 4 h du mat’ dans n’importe quelles conditions !
Martin : En effet, infiniment peu de procédures ouvertes par l’état d’urgence ont abouti à des poursuites pour terrorisme, alors que des peines de droit commun ont découlé de ces nouveaux pouvoirs de la police.

Palais de justice de Brest
Raphaël : Il y a eu seulement 23 enquêtes ouvertes pour association de malfaiteurs terroristes suite aux 4 600 perquisitions administratives depuis le début de l’état d’urgence 2 ! La loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », entrée en vigueur le 1er novembre 2017, consiste à mettre dans le droit normal certaines mesures de l’état d’urgence, dont assignation à résidence et perquisition administrative, et à donner à la police des pouvoirs supplémentaires… Avec un accent sur la prédiction de la dangerosité des personnes pour l’ordre public. Elle permet donc de pérenniser des mesures fondées sur le soupçon visant une personne, et pas sur les actes qu’elle aurait réellement commis.
Cette loi vient normaliser le paradigme du soupçon auquel on s’était malheureusement habitué pendant ces deux années d’état d’urgence. Il est devenu naturel, pour la police, pour l’administration mais aussi pour les juges, qu’on puisse priver de liberté une personne suspecte, c’est-à-dire non pas en s’appuyant sur l’infraction qu’elle aurait commise, mais sur ce que la police pense qu’elle pourrait faire à l’avenir. Il faut bien voir que cette logique renverse un principe du droit énoncé en 1789 et pour lequel une révolution a été faite : l’idée que tout comportement est autorisé tant qu’il n’est pas interdit par la loi. Avec l’état d’urgence, normalisé par la nouvelle loi dite « anti-terroriste », on va punir des citoyens pour un comportement qui ne viole aucune loi, pour des idées ou des relations qui ne sont constitutives d’aucune infraction. Voilà le premier danger de cette loi, au-delà des discussions de détail sur tel ou tel article.
Mais il faut aussi se coltiner les arguments employés par le gouvernement et sa soldatesque à l’Assemblée nationale : ils pensent nous rassurer en nous expliquant que cette nouvelle loi ne pourra viser que des « terroristes », contrairement à l’état d’urgence qui avait été utilisé contre des militants écologistes et des opposants politiques. C’est aller bien vite en besogne et oublier que le « terrorisme », en droit français, a une définition élastique. En d’autres termes, le terrorisme n’est pas défini au sens où le droit ne pose pas à cette notion de limites précises et déterminées. Or, c’est dans le flou de ce concept que se logent les abus de pouvoir. Rappelons nous l’affaire Tarnac, il y a bientôt dix ans, et ses inculpés qualifiés de terroristes. Ils ne le sont plus aujourd’hui, mais combien de temps et de procédures a-t-il fallu pour que la justice abandonne cette qualification ? Cet exemple est à mon sens révélateur du fait que toute loi finit par sortir de son lit et viser des personnes qui n’ont rien à voir avec son objet premier.

Palais de justice de Bordeaux
BONUS : Une lecture de cet article est disponible à l’écoute ici. Merci à Karacole et Val K.