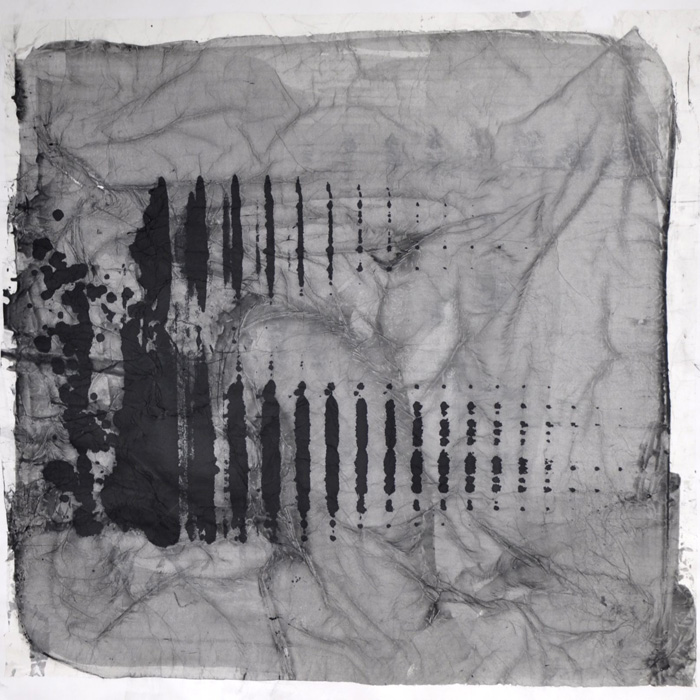Allers-retours à deux voix sur les pratiques et fantasmes BDSM, entre politique-fiction, soin et domination. Clélia Barbut est docteure en sociologie et en histoire de l’art, chercheuse associée et enseignante dans les universités Sorbonne Nouvelle et Rennes 2. Marianne Chargois est travailleuse du sexe (notamment dans la domination tarifée) performeuse, membre active du Strass – Syndicat du Travail Sexuel. Des parcours entre danse contemporaine et travail du sexe, empowerment et hypocrisie sociale… Quelles puissances et impuissances se nouent dans les jeux sexuels ?
Cet entretien est issu du quatrième numéro de la revue papier Jef Klak, « Ch’val de course », encore disponible en librairie.
Image de Une : Roberto Montenegro, Le masque / Antifaz, 1909.
Images insérées : Rod McIntosh.
Notre discussion s’est déroulée entre décembre 2016 et février 2017, à Tours, Paris, Falaise, Caen, Grenoble, dans le TGV, dans un amphithéâtre, un donjon, dans la rue, le soir sous la pluie ou au lit. Dans des entrelacements entre narrations orales, parcours scénique et travail du sexe, notamment dans le BDSM tarifé (bondage et discipline, domination et soumission, sadomasochisme). Dans l’impossibilité de nous rejoindre physiquement pour discuter en direct, l’échange a été réalisé sous la forme d’un dialogue par dictaphones interposés : les questions et les réponses ont donc été produites et écoutées dans des lieux et des moments déconnectés, sans face-à-face, en différé. Nous nous sommes parlé des heures, dialoguant à distance, disséminant nos adresses via fichier audio au fil des temps libres que nous avons pu trouver entre nos activités : répétitions et représentations scéniques, enseignement universitaire, séances de domination, siestes…
Nous nous sommes presque systématiquement attachées à poser les décors des enregistrements dans le détail : non seulement pour enclencher la prise de parole, mais aussi pour partager avec l’autre le contexte concret, matériel et visuel, dans lequel notre parole s’inscrivait. Ce dispositif troublant s’est vite révélé réjouissant et passionnant. Nous avons fait d’un exercice d’entretien classique un terrain de jeu où, de ces désirs initiaux, ont émergé des plaisirs nouveaux. S’adresser à l’autre sans la voir ouvre un espace de divagations assez intime et profond dans lequel la pensée parlée se déploie avec une liberté singulière. Écouter l’autre sans la voir donne aussi une épaisseur à l’écoute qui permet de construire la trame des questions avec une réflexivité particulière.
Nous nous sommes prises au jeu.
***
Enregistrement no 1
Nous sommes le 26 décembre 2016, c’est la fin d’après-midi, il doit être entre quatre et cinq heures.
Dans le premier Neon Wand 1, tu emploies l’expression de « performance de sexualité » pour parler de travail de BDSM. J’y lis l’idée que la sexualité est toujours écrite à travers des scénarios, des scripts, des feuillets de représentations et de fictions. Cette idée de performance de sexualité renvoie au jeu de rôles, à la mise en scène. Pourrais-tu parler de cette écriture au sens scénaristique de tes séances BDSM ?
Je suis ravie de te retrouver depuis Caen, en ce lundi 9 janvier 2017 à exactement 15 h 12 à l’heure de mon ordinateur. Je suis dans un appartement Airbnb, je me suis levée à 5 h 30 ce matin, parce que j’avais un train à 7 h en gare Saint-Lazare pour arriver à Caen à 9 h, pour commencer une nouvelle semaine de résidence sur la création Conjurer la peur de la chorégraphe Gaëlle Bourge.
Dans ce que je crée avec les clients, il y a effectivement comme une superposition de feuillets de représentations et de fictions. Une intrication d’imaginaires qui s’activent sur différents plans.
Un des imaginaires très fort, c’est celui de genre et d’hétérosexualité. De nombreux scénarios tournent autour de caricatures de la féminité telle qu’aime à la penser le monde hétérosexuel occidental, autour de figures de pute – en passant par le maquillage, le port de lingerie, de bas, de porte-jarretelles, de talons, etc. Tous ces fameux codes comportementaux dits « féminins », qui restent indépassables. On voit que le code fait le genre, et fait le comportement. En l’occurrence dans le scénario BDSM, ces codes créent la « femelle », qui peut donc être soumise et se faire pénétrer.
Outre la figure de la pute, il y a les soubrettes et les mères. Ç’a été une découverte pour moi de voir que les figures maternelles sont aussi demandées, en tout cas dans ma clientèle – et ça me fait rire de dire « ma clientèle ». Je pratique beaucoup ce genre de personnages, de maman, de nounou, de figure maternante qui prend soin du tout-petit, qui nettoie le pipi et le caca, qui fait prendre le bain, qui met la couche… Je leur donne le biberon, voire le sein. À un moment, j’avais énormément de clients bébés-adultes et j’ai commencé à avoir des petites crevasses qui se formaient aux tétons. Je crois que cela a un nom particulier, pour les vraies mères qui donnent la vraie tétée à de vrais bébés.
Une autre figure de genre « femelle » que je dois beaucoup performer est celle de l’infirmière, qui est peut-être une hybridation des figures de la pute et de la mère. Elle représente l’endroit du care, du soin et un mélange de douceur et d’autorité. Une autorité bienveillante. L’infirmière est associée dans les fantasmes à la petite jeune sexy à poil sous sa blouse, et accessible au toucher, disponible corporellement.
Et cet imaginaire, qui porte sur des codes comportementaux caricaturaux, porte aussi sur le genre masculin, avec des peurs abyssales de genre. Un scénario qui revient extrêmement souvent, c’est celui où je dois humilier les clients à cause de la taille de leur petit zizi. C’est le terme qui est employé, d’ailleurs, « petit zizi ». Je suis à la fois comme une maman, qui parle du petit zizi de son petit garçon, et comme une infirmière qui mesure le fameux organe à la règle, qui humilie et administre des traitements sous forme de pompe à sexe, de ballbusting, d’électricité, etc. Il y a des scénarios de castration également : je dois mettre les clients en cage de chasteté avec interdiction de jouir, interdiction de bander. Puis, cerise sur le gâteau, l’humiliation suprême, pour eux, est le fait que je puisse les sodomiser en gode-ceinture.
On voit bien les couches sur lesquelles repose l’identité masculine hétérosexuelle : à la fois un code comportemental bien intégré, qui reposerait sur le fait d’être materné et grondé par une figure maternelle ; et la peur d’être associé à l’homosexualité, donc avec le besoin de protéger absolument son anus, associé paradoxalement au fantasme absolu de se faire sodomiser – par une femme qui plus est. On trouve aussi la peur de l’impuissance, de la petite bite, qui ne permettrait pas la pénétration vaginale, ce genre de choses. Ça fait très caricatural, mais ces codes sont encore très effectifs, c’est extrêmement récurrent dans les fantasmes de mes clients. Il m’est arrivé, une fois, avec un client qui était sur ces scénarios de petit zizi, de parler de dick clit, de garçon trans, pour tenter de déplacer un peu ailleurs ses fantasmes. Parce que la verge, c’est un peu lassant au bout d’un moment. J’ai bien vu que ça ne marchait pas du tout, que ça cassait complètement son excitation. Il fallait vraiment rester sur les codes connus : un mec, ça doit avoir une grosse bite et qui bande bien dur. Voilà.
Par-dessus ces espèces de canevas de scénarios et d’imaginaires, il y a plein d’autres choses qui viennent se mêler, se superposer, se complexifier ou s’intriquer. Parfois, il y a l’actualité politique. Il y a un client qui voulait que je joue une Femen l’empêchant de réaliser la tentative d’attentat dans le Thalys d’Arras, il y a un an. Il y a aussi des choses plus sociales, par exemple avec des personnes au chômage, qui n’arrêtent pas de rater leurs entretiens d’embauche, qui sont dans la merde, qui sont prêts à s’humilier pour accéder à l’emploi. Également des dominations et humiliations politiques, notamment sur la racialisation. J’ai reçu plusieurs personnes racisées qui souhaitaient mettre en scénario le fait d’être insultées par rapport à leur couleur de peau, qui voulaient que je dise des choses du type « sale Niakoué, sale Noir, tu pourras jamais te taper une femme blanche ». Presque comme une forme d’exutoire. Pour moi, c’est très compliqué, je suis hyper mal à l’aise avec ça.
Et puis, toujours en lien avec la violence politique ou le pouvoir institutionnel, il y a évidemment tous les scénarios sur le sadisme médical et la violence de la médecine : des docteurs qui prétendent aider, être soignants, attentifs et bienveillants, et qui en fait font subir des sévices, font souffrir, avec un sourire et un sadisme très grand. Ça, c’est très courant.
Il y a aussi tout ce qui concerne le vécu personnel des clients, qui vient percuter des imaginaires plus structurels. Ce que je trouve intéressant dans les scénarios BDSM, c’est cette espèce de métabolisme entre l’absorption des dominations structurelles (des normes de classe, de race, de genre), remâchée avec des micro-événements plus affectifs et personnels. J’ai par exemple des personnes qui sont fétichistes de la laine ou d’aliments en particulier. Je ne sais pas à quoi c’est raccordé. Cette absorption-digestion-transformation mâche et recrée des imaginaires très reconnaissables, très lisibles, qui sont en même temps toujours particuliers, toujours uniques. Ces détails singuliers, propres à l’imaginaire de chaque client sont vraiment importants pour que le scénario puisse être excitant pour eux. Les détails ne sont pas que des détails.
On pourrait dire qu’il y a une forme de lien entre soin et domination. J’ai l’impression que dans ce que les clients viennent chercher, rejouer dans certains scénarios, ce sont parfois des histoires de réparations personnelles ou de réparations politiques. J’ai l’impression que parfois, de façon un peu aveugle, un peu mystérieuse, ou alors de façon tout à fait consciente, il y a une forme de soin par la remise en scène d’éléments de vécus subis dans la vie réelle, une réfection qui peut se faire parce que dans ce jeu de rôle-là, ce sont eux qui décident et sont les instigateurs. Il devient possible de passer d’une position de victime d’une situation objectifiante à celle d’acteur, dans une situation maîtrisée et érotisée.
Et il y a vraiment des allers-retours entre les clients et moi, je ne suis pas juste dans une position de don. Je pense que moi aussi, je viens chercher beaucoup, et je reçois énormément.
Là, je pense que je commence à être un peu empêtrée parce que je vois qu’il est 15 h 38, et je crois qu’il faudrait que je m’arrête pour être à l’heure au Centre chorégraphique national (CCN) de Caen, alors je vais essayer de finir en cinq minutes, ça va me forcer.
Je me mets vraiment au service des fantasmes et des scénarios qui me sont amenés. Même si les gens n’arrivent pas avec un scénario précis, écrit, je récolte suffisamment d’informations sur leurs fantasmes ou leurs recherches, pour créer un scénario qui respecte les pratiques et les détails qui ont l’air importants pour eux.
Ensuite, pour la mise en scène, il y a des éléments d’accessoires, de tenues. Mais je dirais presque que la mise en scène est plutôt homéopathique, au sens où c’est une trace extrêmement diluée de ce qui serait en réalité nécessaire pour vraiment bien jouer les scénarios qui sont demandés. Je reçois tous mes clients dans la même pièce, ce donjon qui est une pièce qui fait à peine 10 m2, avec des accessoires, et un sol tout pourri. Ça ne ressemble pas deux secondes à une salle d’hôpital, ni à une garderie, ni à un bureau de DRH. Les mecs voient bien qu’ils sont entourés par une croix de Saint-André et une cage, qu’on est enfermés dans une petite pièce éclairée par un néon rouge. En plus, je n’ai pas de lit d’enfant taille adulte pour leur faire faire la sieste. Ils la font recroquevillés sur la table de gynéco, au-dessus de la cage. Ils ne peuvent pas avoir l’impression d’être bordés confortablement dans un petit lit à barreaux.
Mais cette trace, sous la forme d’aiguille, de sonde ou de roulette de Wartenberg, de couche, de biberon, de lecture d’histoire… est suffisante pour rentrer dans le jeu. Le jeu de rôle est possible à partir du moment où le client plonge et joue le jeu, parce que moi, je ne peux pas le faire toute seule ; et inversement, eux ne peuvent pas plonger si je n’y vais pas suffisamment. Si on ne lâche pas prise, on se sent immédiatement ridicule, et ça n’est pas possible d’en jouir.
Finalement, ce qui est amusant, c’est que si je regarde ce que je fais en performance scénique, la notion de personnage ou de rôle est absolument inexistante. Je suis toujours mon propre personnage et… avec plutôt du non-jeu, des codes de présence qui reposent plutôt sur une espèce de sobriété, de non-personnage. D’ailleurs, je déteste le théâtre pour ça. Le peu de théâtre que j’ai fait m’a horrifiée parce que je ne supportais pas d’avoir à jouer d’autres personnages, je trouvais toujours ça ridicule. Sûrement parce que je ne m’y abandonne pas et que je n’y plonge pas, que je suis plus résistante que mes clients à plonger dans le lâcher-prise.
Enregistrement no 2
Marianne, salut. On est dimanche, c’est la fin de la matinée, je me suis réveillée il n’y a pas très longtemps. Je trouve ça bien, je crois, de te parler dans cet état d’entre-deux.
Je voulais te demander si tu te souviens de tes envies les plus lointaines de scène, tes premières envies de théâtre, de performance, les premiers moments où tu as fait ces choix-là : est-ce que ça t’est venu tôt ? Et est-ce que c’était un choix de travailler dans l’art, ou alors de travailler avec ton corps ?
Salut Clélia. Je suis actuellement au donjon. C’est une pièce dans un appartement, où je reçois mes clients pour des séances : une cage dans laquelle je peux mettre les clients à quatre pattes et qui fait table sur le dessus, sur laquelle ils peuvent s’allonger, avec des étriers, un peu comme chez le gynéco.
Je pense que mes premières envies étaient vraiment confuses. Je crois que c’étaient plutôt des envies d’exhibition, des envies de ne plus être quelqu’un de médiocre. Je me souviens à l’âge de 5-6 ans, à plusieurs reprises, d’avoir cherché à attirer l’attention des adultes sur mon corps nu, à montrer mon sexe. Alors que je n’avais aucune conscience d’avoir une vulve à cette époque – je n’en ai eu conscience qu’à mes 20 ans à peu près.
J’ai grandi dans un milieu et une famille qui n’avaient absolument aucun intérêt pour les arts. Pendant longtemps, mon seul contact avec une forme d’art si on peut dire, ça a été la musique qu’écoutait ma mère : Jean Ferrat et Francis Cabrel. Ah oui, et il y avait aussi Nana Mouskouri. Mes parents étaient divorcés, ma mère avait très peu d’argent, elle ne travaillait pas. On n’avait pas la télé, je n’allais pas au cinéma, mais par contre, il y avait les magazines de type Paris Match que ma mère achetait toutes les semaines, où je voyais des stars, des actrices. Je voyais des femmes très belles, très sexuelles, qui semblaient heureuses et épanouies. C’est une chose vers laquelle j’ai eu envie de tendre.
Adolescente, j’étais quelqu’un de très timide, je n’avais pas du tout d’amis, je ne me trouvais pas très jolie et c’était un gros complexe. Je m’étais fait le serment que, quand je serais adulte, je ne serais plus moche ni timide ni nulle ni pauvre. Donc ça n’a pas tant été un élan vers la scène et un amour du théâtre qu’une espèce de fantasme d’être une de ces figures de stars, un peu glamour. Et, en même temps, j’ai commencé à avoir très envie de me prostituer – j’emploie le terme de prostitution car, à cette époque, je ne connaissais pas le terme de travail du sexe – avec une forte envie d’être sexy et sexuelle.
Ah ! j’ai un client qui m’appelle sur mon téléphone du travail [sonnerie], donc je vais répondre et je t’embrasse fort.
Enregistrement no 3
Marianne salut. Après t’avoir écoutée, j’ai repris une autre écoute que je poursuis depuis quelque temps, celle du cours de Michel Foucault au Collège de France en 1978, Sécurité, Territoire, Population. Sa langue est très incarnée : il parle par exemple du concept de population en termes de « pénétrabilité » et de « désir ». Sa voix me plaît, et je crois que cela vient aussi de ce que je fais avec toi.
J’aimerais t’entendre parler de ta période de formation et d’apprentissage, de l’acquisition des compétences et des savoir-faire qui t’a menée à exercer les métiers que tu exerces aujourd’hui. Comment t’es tu projetée personnellement et professionnellement dans le travail de scène et de sexe ?
Bonjour Clélia. On est mercredi matin, je suis encore dans mon lit, il est 9 h 06. Je me suis levée, je me suis fait un café, j’ai un peu bouquiné pour me réveiller. J’attendais que la personne qui dort dans la chambre à côté de la mienne descende prendre son petit déjeuner pour pouvoir te parler sans être entendue. Dans moins d’une heure, je serai en train de répéter au CCN de Tours. J’ai une grosse semaine, un peu fatigante et stressante.
Je pense que mes deux parcours, le parcours scénique et celui du travail sexuel, se sont faits de façon complètement entrelacée. Dans les deux cas, ma formation a surtout été l’histoire de mes échecs à pouvoir intégrer des parcours fantasmés que je voulais rejoindre, ou des éjections par rapport à des expériences que j’aurais voulu vivre. Ce sont donc deux formations floues que je dirais avoir menées comme une mouche qui butte sans cesse contre une vitre.
Alors attends, je vérifie l’heure quand même. Oui, je continue à te parler encore un petit peu et après, il faudra que j’aille me doucher avant d’aller répéter.
J’ai passé un bac théâtre, puis je suis allée à Paris pour faire un conservatoire d’arrondissement de théâtre. J’ai fait une formation en mime, en théâtre corporel, et puis en contorsion. Parallèlement à ça, à plusieurs reprises, j’ai voulu me lancer dans le travail du sexe, faire des clients, tourner dans des films porno. À la fois pour des besoins financiers, parce que j’étais toujours très pauvre, et à la fois poussée par cette curiosité, ce besoin d’expérimentation physique, sexuelle, d’exploration de mondes.
Je pouvais me projeter dans une carrière dans le théâtre ou dans le cinéma, parce que ça n’était pas dévalorisé socialement. Je pouvais avoir des exemples de comédiens ou d’acteurs, ça pouvait se dire, il y avait des formations pour cela, etc. Tandis que dans le travail du sexe, je n’avais jamais eu de représentation claire des différents types de boulots possibles ni de modèles à suivre. Je ne savais même pas comment commencer, comment faire pour y entrer. À chaque fois que j’essayais, que j’avais rendez-vous avec des réalisateurs de films porno ou un rendez-vous pour une passe, il y avait toujours soit un petit copain, soit un pote – toujours des hommes – qui était complètement paniqué et voulait m’en empêcher. Ils faisaient tout pour ne pas que je le fasse, m’expliquaient que j’allais sombrer, devenir droguée, rentrer en réseau mafieux, et me faisaient sentir à quel point je n’allais pas bien. J’ai dû m’y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir mener à bien mes premières expériences en travail du sexe.
Écoute, là, je vais prendre ma douche.
[Coupure]
Clélia, me revoilà. Je profite de mon trajet jusqu’au théâtre, j’ai dix minutes à pied, donc je te parle en marchant. Telle l’agent Cooper dans Twin Peaks, je parle seule en m’adressant à toi.
J’ai travaillé pour la première fois dans un théâtre érotique, qui avait mis une annonce dans un journal gratuit, et qui s’appelait Paris Boom Boom. Ils recherchaient des danseuses nues – débutantes acceptées. Comme j’étais débutante, ça m’a rassurée. À partir de là, ont commencé plusieurs expérimentations dans le travail du sexe, où j’ai appris en faisant, en passant outre la peur et ces discours de protection qu’on m’adressait.
[Silence]
J’espère que tu m’entends, parce qu’il y a des voitures qui passent.
J’ai d’abord appris à faire des stripteases. Juste parce que j’étais une femme, on attendait de moi que, d’emblée, je sache exciter les hommes, que je sache danser de façon sexy, me mettre en valeur, me masturber. La dernière partie du striptease devait toujours se finir par une masturbation frontale, chatte très très écartée devant le client. Il fallait qu’il puisse voir de façon très détaillée la vulve, le trou. C’était très étrange pour moi, cela, à l’époque, car je ne m’étais jamais masturbée. Je baisais beaucoup avec des mecs, mais je n’avais jamais joui, j’avais un rapport à mon sexe assez lointain, une méconnaissance totale de ma sexualité. Les premières fois où je me suis masturbée, c’était devant un public masculin, en mimant quelque chose que je ne connaissais pas. Quand je me revois faire ça aujourd’hui, c’est assez drôle : je me frottais la chatte très vite et très mécaniquement. En me connaissant un petit peu mieux maintenant, je ne vois pas comment qui que ce soit pouvait croire que je pouvais me donner du plaisir de cette façon. Quoi qu’il en soit, le fait de performer la masturbation pour les besoins du travail a fait que, quelque temps après, j’ai commencé à vraiment me masturber chez moi et à pouvoir jouir. La performance sexuelle scénique a fini par devenir performative.
Une des bases du travail du sexe et de celui de performer, c’est le bluff. J’ai appris à bluffer. J’ai appris toutes les règles de l’arnaque par le peep show, étant donné qu’à chaque fois, je débarquais sans savoir-faire. J’ai commencé à faire de la domination alors que je n’avais jamais pratiqué de BDSM et que personne ne m’avait appris. À chaque fois, je me disais : « C’est pas grave, ce qui est important c’est que tout ait toujours l’air d’être fait exprès, maîtrisé, et moi j’improvise, je trouverai toujours une façon de m’en sortir. » Au peep show, je devais faire croire au client qu’il allait me baiser après avoir payé 2 000 € alors que c’était interdit par l’établissement. Je devais faire en sorte qu’il se branle, qu’il jouisse et qu’ils en soient content. Au bout d’un moment, j’ai développé une sorte de compétence : j’y arrivais, les clients payaient 2 000 €. Ils s’étaient branlés, ils ne m’avaient pas touchée, je ne les avais pas touchés et ils étaient contents. Enfin, disons qu’ils ne faisaient pas de problème. C’est pareil pour la domination : je crois qu’aucun de mes clients ne s’est rendu compte que j’étais complètement débutante.
En parallèle de tout ça, je faisais une école de théâtre corporel, de mime. J’avais des journées absolument exténuantes : je prenais des cours de danse classique le matin ; l’après-midi, j’avais des cours de mime extrêmement physiques et le soir, à 18 h 30, j’allais travailler au théâtre érotique pendant six heures. Je finissais à minuit et demi. J’ai enchaîné des journées comme ça, d’apprentissages corporels divers, pendant plusieurs années.
Dans l’apprentissage scénique (du théâtre, ou du cirque, de la contorsion), j’ai dû surmonter la honte. Mon sentiment de nullité et d’illégitimité était très fort. J’étais toujours la moins virtuose, souvent la plus vieille et la moins bonne. Ça m’a demandé de forcer le passage et de m’acharner malgré l’inconfort et malgré les divers professeurs autoritaires qui se valorisent et se narcissisent par le fait de toujours humilier les élèves – le moteur n’étant vraiment pas l’envie de les rendre autonomes.
Enregistrement no 4
Bonjour Marianne. On est vendredi matin, il est 11 h et quelques. Je suis actuellement dans un amphithéâtre, dans lequel je donne des cours depuis huit ou neuf ans. J’avais envie d’enregistrer ma question dans cet espace-là, parce qu’il m’a vue beaucoup changer, me transformer, et même muer. Les premiers moments étaient affreux, je ne dormais pas la veille du cours, je ne sécrétais plus de salive pendant deux heures, j’avais les mains qui tremblaient. Alors qu’aujourd’hui, je prends de plus en plus de plaisir et je suis assez heureuse d’avoir pu dépasser ces humiliations. Je peux employer ce mot aussi, parce qu’on n’avait absolument aucune formation, aucune transmission liée au fait de transmettre – ce qui est un peu étrange.
Qu’en est-il aujourd’hui, maintenant que tu es expérimentée, de ce rapport à la honte et de cette impression d’être une mouche qui bute contre une vitre ? Est-ce que c’est toujours le cas, ou est-ce que tu as le sentiment d’avoir aménagé des espaces de vivabilité professionnelle ?
Clélia, il est 14 h, on est dimanche 18 décembre, je suis dans le train Paris-Lyon qui m’emmène au festival Only Porn pour lequel je performe Golden Flux ce soir. Je suis contente de montrer cette performance, mais je suis complètement épuisée.
Je dirais qu’au fil du temps et des rencontres que j’ai faites, j’ai réussi à transformer mes endroits de fragilité en endroits de force. Je le lis peut-être comme ça maintenant que je suis très imprégnée des pensées queer. J’ai l’impression que dans mon identité professionnelle, il se passe la même chose que dans l’endroit queer, quand on récupère l’insulte à son profit pour en faire un endroit de force, de puissance et de singularité. Au fil des années, j’ai fait de mon travail sexuel un endroit de fierté, de puissance et d’affirmation. Pendant longtemps, il y avait une sorte de schizophrénie dans le fait de devoir jongler entre le monde légitime de la scène et le monde souterrain du travail du sexe. Aujourd’hui, j’ai l’impression que la jonction entre les deux se fait mieux.
Après, tout reste très précaire. Le travail du sexe est précaire, notamment depuis que la pénalisation des clients a été votée. Et bien sûr, le monde du spectacle, de la danse contemporaine, le régime intermittent du spectacle, sont extrêmement précaires également. Je jongle donc entre deux activités précaires.
Pour résumer, je dirais que je n’ai plus honte de ce que je fais, et que j’ai besoin à présent de construire les termes de ce qui me convient : conditions de travail pour le travail du sexe en travaillant en indépendante ; et invention d’espaces et de représentations en créant des festivals queers et des performances scéniques.
Enregistrement no 5
Est-ce que l’arrivée de la domination dans le champ de tes pratiques professionnelles prolonge des pratiques préexistantes ? Est-ce que ça s’articule avec une forme de sécurité ou d’autonomie dans le travail ?
C’est vrai que c’est un moment assez charnière dans ma construction. Je dirais que c’est une véritable colonne vertébrale pour moi. Avec toute la complexité que ça implique. Sur les termes, par exemple : j’ai vraiment une grosse difficulté à chaque fois que je dois me présenter, en public ou par écrit, c’est un moment qui m’angoisse, je me sens toujours coincée. J’aime bien me présenter comme « travailleuse du sexe » et, en même temps, c’est toujours un terme imprécis, parce que c’est un secteur qui regroupe beaucoup de métiers différents. Et puis, plus précisément, je me présente comme « dominatrice », ce qui en réalité ne me convient pas vraiment – c’est plutôt un terme par défaut.
Les mots « domination » et « dominatrice » ne me semblent pas tout à fait adéquats, mais je n’en ai pas d’autre. Peut-être que je devrais en inventer un qui me convienne mieux, car je n’ai pas du tout l’impression de dominer qui que ce soit. Je crois que, même pour mes collègues, personne ne domine personne. C’est plutôt très égalitaire, non pas qu’il y ait une symétrie dans les deux places, mais il y a suffisamment d’éléments de chaque côté pour qu’il n’y ait pas de rapports de pouvoir déséquilibrés. Les termes du jeu sexuel BDSM sont complètement négociés. C’est plutôt un code esthétique. La personne me paye, donc je ne fais pas n’importe quoi, je réponds à une commande. Je ne ferais jamais à un client quelque chose qu’il ne veut pas du tout, sauf si c’est dans un jeu, si c’est excitant pour lui de faire comme si c’était moi qui le forçais à faire quelque chose qu’il ne veut pas. Et à l’inverse, je ne me sens pas du tout dominée non plus par le client sous prétexte que je suis payée. Je maîtrise suffisamment les termes de la rencontre tarifée et du jeu pour avoir de la marge d’action et de décision. C’est assez équilibré comme rapport, à la fois dans le jeu sexuel dominant / dominé, et dans le rapport client / travailleuse du sexe.
D’ailleurs, pour parler du travail que je fais sur scène, je n’ai pas de terme non plus. Je n’aime pas employer la désignation de « comédienne » ni de « danseuse », parce que je n’ai pas de formation en danse. Dans les parties les plus chorégraphiées des spectacles, c’est parfois humiliant pour moi parce que je ne sais pas danser et pourtant je travaille avec des chorégraphes contemporains. Donc j’emploie le mot « performeuse » qui est un terme un peu flou, mais je m’en contente.
Plutôt que de dire « je suis dominatrice », ou « je suis performeuse en danse contemporaine », je préfère dire que « je travaille dans des spectacles de danse contemporaine », « je fais du BDSM tarifé » ou « je fais de la domination ». Je préfère dire je fais des choses plutôt que de dire je suis quelque chose. Parler en termes d’activité et non d’identité.
Le passage à la domination a été le passage à une possibilité de maîtriser les termes de ce que je fais : la possibilité de décider ce que je suis d’accord pour faire ou pas, quel service sexuel j’ai envie de rendre ou pas, jusqu’où je souhaite aller dans les actes concrets que je propose – pénétration ou non, fellation ou non, etc. – dans quelles conditions, avec quels tarifs… Je suis devenue ma propre patronne, c’est un moment de conquête d’autonomie, évidemment.
Enregistrement no 6
Une autre question sur la rencontre entre le travail de sexe et le travail de scène. Comment tes activités actuelles articulent-elles cet alliage entre sexuel et scénique ? Est-ce que ça s’est fait dans tes créations – Autoporn box, Golden Flux – ou alors à travers l’organisation même d’événements, tels les festivals ?
Enfin, à l’occasion d’une table-ronde, tu as exprimé l’idée que ton travail serait un travail de « restauration d’images manquantes 2 ». Qu’est-ce que c’est ce geste de restauration, que sont ces images manquantes ? Des images qui n’ont jamais existé ou qui ont été effacées ? De la mémoire collective, d’une histoire politique ?
Je pense que la jonction entre le travail du sexe et le travail de scène s’est faite au moment où j’ai commencé à être fière d’être pute, pour reprendre le titre du livre de Thierry Schaffauser et Maîtresse Nikita 3. Le fait d’assumer une identité de travailleuse du sexe, le fait d’adhérer au Strass (Syndicat du travail sexuel, créé en France en 2009), le fait de devenir militante et de savoir que j’appartenais à un groupe, celui des travailleuses du sexe. Avant cela, je vivais ces expériences de manière assez isolée, en vivant le mépris et les stigmates qui sont accolés aux figures des putes, donc c’était un parcours assez solitaire. Découvrir l’existence de ce mouvement collectif a été un moment clé où j’ai pu sentir que je faisais partie d’un collectif militant, qui partageait les mêmes expérimentations que moi. Vraiment, je crois que ça m’a rendue forte : l’appartenance au groupe m’a donné un socle solide sur lequel je pouvais m’appuyer. Le seul fait de savoir que ça existait, même théoriquement, me rendait déjà plus puissante. J’ai commencé à pouvoir assumer et à mettre en avant dans mes CV de spectacles contemporain mon parcours de travailleuse du sexe.
C’est pour cette raison que je parle de restauration d’images manquantes. Ce qui m’anime dans le travail que je mène actuellement est le fait de créer des représentations qui n’existent pas sur le travail du sexe, visibiliser des représentations qui sont minorées ou empêchées par ailleurs, c’est-à-dire toutes les représentations dans lesquelles des personnes qui exercent le travail du sexe sont actives et sont représentées avec des puissances d’agir, des capacités de discernement, de réactivité face à des situations complexes qu’on rencontre dans le travail du sexe. Toutes ces représentations sont absolument, dramatiquement manquantes. Politiquement, évidemment, parce que si nos droits sont déniés, c’est bien parce que nous ne sommes pas considérées comme des personnes adultes capables de discernement. Nous sommes toujours considérées comme des mineures, qui ne savent pas ce qu’elles font, qui sont soumises ou victimes, sous la coupe de tiers. D’où ces deux sempiternelles représentations de pauvres filles victimes et abusées qui tapinent dans la rue, ou de femmes glamours et vénéneuses qui seraient toujours sous l’emprise des autres, toujours des hommes. Et puisqu’on sait que les représentations sont aussi performatives, il me semble que ça n’est vraiment pas anecdotique d’œuvrer à inventer et à visibiliser des représentations variées, puissantes, complexes et diverses des profils et des vécus du travail du sexe. À force de ne jamais se voir représentées, on se retrouve à psychologiser ce qu’on vit et on l’expérimente dans la solitude. Si nous ne nous voyons représentées que dans des projections minables de vieux mâles occidentaux autour de figures féminines souillées, sexuelles et à sauver, nous nous retrouvons coincées, presque obligées de s’y identifier. Et je pense que ça commence à toucher un point d’insupportable.
Enregistrement no 7
Marianne bonjour, nous sommes vendredi 13 janvier 2017, il est très exactement 13 h 37. Je suis chez moi, assise à ma table de bureau / salon, entre les deux.
Je bois du thé dans un mug assez classique, mais qui est prolongé par une tête de licorne arc-en-ciel.
J’ai été intéressée par cette idée que tu envisages et pratiques la domination dans une perspective de soin, de care. Il y a peut-être quelque chose à penser à travers le même « feuillet de représentation », autour de la posture de l’enseignant.e, car c’est assez fréquent qu’il y ait des profils à la fois hyper maternants et très sadiques.
Aussi, je voulais prolonger une réflexion sur le sexuel, plus précisément sur l’équilibre entre maîtrise et lâcher-prise dans le sexuel. Je me demande comment s’articule pour toi ce rapport.
Bonjour Clélia, alors je suis ravie de te retrouver en ce dimanche 22 janvier où je te parle non pas depuis mon lit pour une fois, mais depuis mon canapé, et je suis tout de même vautrée. Ce qui me fait repenser à cette expression qui était utilisée au XIXe siècle pour parler des courtisanes, qu’on appelait les « grandes horizontales ». Je me disais que moi, dans le cadre du travail du sexe, contrairement à cette expression, je ne suis pas du tout à l’horizontale, mais complètement verticale bien au contraire, puisque je passe mon temps debout, courbée, au-dessus de ces messieurs. Je me faisais donc la réflexion que dans mon cas – et pas que dans mon cas, aussi pour la plupart des travailleuses du sexe –, ce serait bien plus pertinent de parler de grandes verticales ! Ce serait bien plus juste aussi, pas seulement par rapport à une position physique, mais aussi par rapport à une position active, politique, dans le travail du sexe.
Je dirais que ce qui se passe dans les jeux sexuels, c’est un tricotage entre une forme d’intelligence du corps, de compréhension par les sensations physiques et quelque chose de plus contrôlé, de plus conscient. Une espèce de gestion mentale de l’instant. C’est une danse entre ces deux dynamiques qui coexistent en permanence. D’ailleurs, ça me fait penser à une séance que j’avais faite avec un client. Je lui faisais lire à voix haute du Spinoza, enfin plus précisément Gilles Deleuze expliquant Spinoza, pendant que je lui donnais des décharges électriques sur le sexe, lui pénétrais l’urètre avec des sondes et le baisais en gode-ceinture. Très concrètement, pour lui, il y avait un garder-prise, une maîtrise de ce qu’il faisait : il gardait très bien sa lecture, il restait très concentré. J’étais même un peu surprise, presque un peu embêtée parce que j’avais peur que ça ne lui fasse absolument rien, pendant que je le branlais et le baisais dans tous les sens ! Je me disais : « Merde, mon jeu, il est nul, il se fait chier, comment c’est possible qu’il arrive à continuer à lire si correctement cette pensée complexe pendant que je le sollicite autant physiquement ! » On en a parlé après, et en fait, il a complètement adoré. Il m’a expliqué que le plaisir sexuel était très fort. C’est vrai qu’il bandait très fort, ça m’avait rassurée… Il avait adoré cette superposition de mécanique cérébrale, intellectuelle et de mécanique physique, ce mélange de plaisir intellectuel à lire Deleuze parlant de Spinoza avec le plaisir physique sexuel, à se faire sodomiser et branler, la difficulté à tenir la lecture alors que le plaisir et la douleur sont très forts.
Le rapport entre maîtrise et lâcher-prise existe aussi pour moi. Parfois, pendant les séances, j’ai de l’excitation sexuelle qui vient, c’est très rarement de l’excitation pour les clients, mais plutôt de l’excitation pour les situations. Dans ces excitations anarchiques, imprévues, j’arrive tout à fait à décider si je lâche prise, si je me laisse aller dans cette excitation, si je m’autorise à vivre un moment de sexualité ou si je décide de ne pas laisser cette excitation aller plus loin, de la contrôler et d’y mettre un terme. J’arrive à jouer avec ça. Ma priorité reste de m’occuper du plaisir du client, et ça, je ne le perds jamais de vue. Dans les jeux sexuels, le lâcher-prise, le plaisir physique, la conscience et la maîtrise de la situation s’entrelacent en permanence.
- Fanzine de l’association Polychrome, 2016. ↩
- Expression employée au Festival Explicit 2016 à l’occasion de la table-ronde « Travail sexuel : performer des corps militants » (avec Buck Angel et Thierry Schaffauser). ↩
- Maîtresse Nikita, Thierry Schaffauser, FièrEs d’être putes, éditions L’Altiplano, 2009. ↩