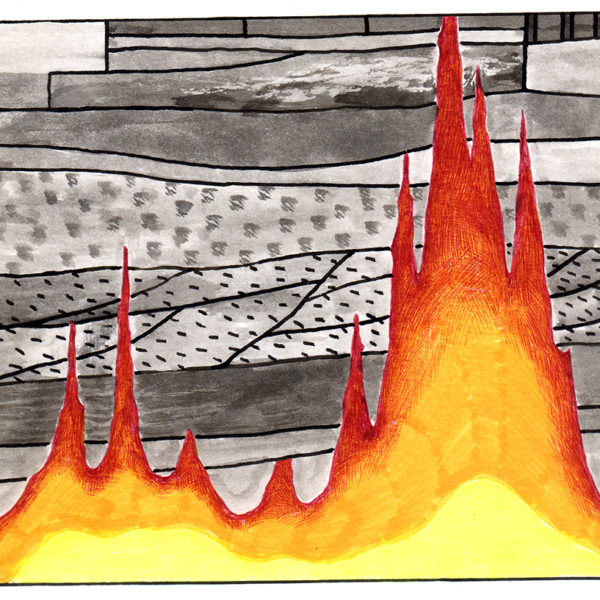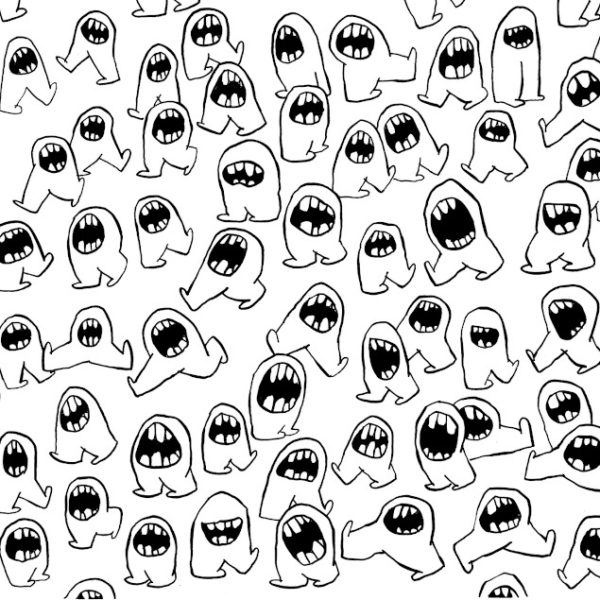Traduction par Nathalia Kloos et Ferdinand Cazalis
Article original sur Saltamos.net :
« Brasil, en la peor crisis política de su historia »
Dans un contexte tendu de réformes du code du travail portées par l’impopulaire gouvernement de Michel Temer – qui a remplacé celui de Dilma Roussef –, un enregistrement a récemment compromis le président, qui peut se voir destitué à tout moment. Accroché au pouvoir, Temer a alors envoyé un signal dangereux en promulguant un jour durant un décret autorisant le déploiement des troupes militaires dans la capitale pour contenir les manifestations qui demandent sa destitution. Le procès au Tribunal électoral supérieur devrait statuer, à moins d’un report, ce jeudi 8 juin 2017 sur la destitution du président. Au cœur du plus gros scandale politico-financier de son histoire, et dirigé par une élite corrompue jusqu’aux os, le Brésil traverse une crise sans précédent. Et le peuple est dans la rue.
Télécharger l’article en PDF.
Cet article sur la situation au Brésil pourrait être tout autre demain1. Le Brésil vit un épisode de non-fiction tragique au scénario imprévisible. Une année vient de s’écouler depuis la destitution de la présidente Dilma Roussef – élue par 54 millions de Brésiliens –, par l’un des Congrès les plus conservateurs et réactionnaires de l’histoire, au nom de Dieu, de la morale et des bonnes mœurs.
Dès la nomination du nouveau gouvernement du vice-président Michel Temer, membre du Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB) – investi suite à l’impeachment de Dilma Roussef –, tout était clair. Aucune femme, aucun noir. Seulement des hommes blancs et riches. Son discours d’investiture annonçait la déroute : entouré par tous ces messieurs, il cita une phrase lue sur un panneau au bord la route : « Ne parle pas de crise, travaille. »
En décembre de l’année dernière, le gouvernement gelait pour une durée de vingt ans les dépenses publiques dans la santé, l’éducation et la protection sociale. Nombre de programmes sociaux mis en place par les gouvernements progressistes disparurent, ou virent leur financement drastiquement réduit. La sous-traitance effrénée du travail fut relancée, et Temer s’entêta à faire approuver des mesures hautement impopulaires, telles que la réforme des retraites – à l’époque l’un de ses soucis principaux – qui, comme l’ont dénoncé les mouvements sociaux, « supprime le droit à la retraite pour la majorité des Brésiliens » ; et la réforme du code du travail, qui fragilise le droit des travailleurs face aux patrons. Bien que fortement combattues dans les rues, ces réformes commençaient à être débattues au Congrès, peut-être le seul soutien de Temer dans le chaos. Pour faire simple, le projet du gouvernement et de ses alliés était de faire porter par les épaules du peuple le coût de la crise. Rien de nouveau sous le soleil.
La bombe
Un taux de popularité désastreux ainsi que le rejet populaire des réformes avait progressivement sapé les appuis du président. Et voilà que, mercredi 18 mai, une bombe est lâchée. L’arrestation des patrons du groupe JBS – l’un des plus grands producteurs de viandes du monde –, visé par une enquête, était imminente. Afin de se protéger, grâce à la loi de négociation des peines par délation, les dirigeants de JBS acceptèrent de dénoncer d’autres personnes impliquées et de révéler les rouages de la corruption au sein de l’État, ainsi que d’enregistrer des rencontres avec les autorités. Le journal Globo, appartenant au groupe médiatique le plus puissant du pays, la Rede Globo, a ainsi dévoilé en exclusivité des enregistrements des conversations de Temer avec Joesley Batista (un des patrons de JBS) au cours desquelles il aurait donné son aval pour acheter le silence de l’ex-président de la chambre des députés Eduardo Cunha, du PMDB – le parti de Temer.
Figure centrale de l’impeachment et stratège machiavélique, Cunha faisait la pluie et le beau temps au Congrès avant son arrestation pour corruption, blanchiment d’argent et évasion fiscale. À cause de son pouvoir et de son travail infatigable en coulisses, son arrestation menaçait d’autres corrompus. Son silence était d’or. Dans la conversation, Temer dit à Batista que Cunha « a décidé de le punir ». Le patron lui explique avoir « réglé tous les comptes qui pourraient être en suspens » avec Cunha, et être « en bons termes avec lui ». Ce à quoi Temer répond : « Il faut que ça dure, entendu ? » Batista rajoute qu’il saura verrouiller la riposte, qu’il a un procureur de la justice qui lui donne des informations et qu’il tente d’en remplacer un autre.
Suite à une autre délation de Batista, c’est Aécio Neves qui est tombé. Jusque-là président du Parti de la social-démocratie brésilienne (PSDB), il s’était présenté aux élections présidentielles contre Dilma Roussef en 2014. Neves a demandé à Batista environ 700 000 dollars pour payer sa défense dans l’opération Lava Jato [Voir encadré : « Lavage Express »], une enquête sur la corruption dans le pays. Les révélations précipitèrent Temer au bord du gouffre, à tel point que sa démission devint une éventualité sérieuse – certains avancèrent qu’elle pourrait intervenir dès le lendemain même.
Mais il n’en fut rien. Dans un communiqué émis depuis le Palácio do Planalto – siège du gouvernement dans la capitale Brasilia –, Temer, visiblement en colère et nerveux, annonça qu’il ne renoncerait pas. Même posture adoptée le samedi 20 mai dans un autre discours, et dans un entretien accordé au journal Folha de São Paulo. Le coup des patrons de JSB a été magistral. Avant de lâcher leur bombe, ils ont pris soin d’acheter des dollars – dont le taux monte en flèche suite aux révélations – et de négocier un départ à New York en contrepartie de la délation. Ne laissant derrière eux que le chaos.

La sortie
« Le gouvernement Temer est fini », promet le professeur de sciences politiques et directeur de la Fondation école de sociologie et politique de São Paulo (FESPSP) Aldo Fornazieri. Selon lui, « Le gouvernement Temer ne peut pas durer, il n’a pas la moindre latitude politique ou morale pour gouverner, ni face au peuple brésilien ni face au monde. » Depuis ces révélations, la chute de Temer est très probable. On ignore simplement quand et comment elle aura lieu. Quelques heures après la nouvelle, huit demandes d’impeachment ont été déposées contre le président à la chambre des députés, qui s’ajoutaient à celles déposées auparavant pour d’autres raisons. La semaine suivante, l’Ordre des avocats du Brésil (OAB) en déposait une autre.
La décision appartient au président de la chambre des députés, Rodrigo Maia, du parti Les Démocrates, l’un des plus fidèles alliés de Temer. Pour Fornazieri, « ce serait la crise, c’est mauvais pour l’économie et pour l’emploi, et ce serait un processus très traumatisant pour le Brésil ». Il y a donc deux solutions à court terme : la renonciation par le président lui-même – difficile à imaginer – ou la destitution par le Tribunal fédéral suprême (STF) – jusqu’à présent aussi incertaine, car, selon Fornazieri, le STF « ne dispose pas du courage pour le faire ». Une investigation ouverte par le STF contre Temer et Aécio Neves est pourtant en cours sur les délits d’organisation criminelle, corruption passive et obstruction à la justice.
Si aucune de ces options ne se concrétise, il faudra attendre l’aboutissement du procès qui a repris le 6 juin au Tribunal suprême électoral (TSE), et qui doit statuer sur les irrégularités dans les dépenses de la campagne de Roussef et Temer en 2014. Dans ce cas, Rodrigo Maia assumerait le gouvernement intérimaire pour trente jours et devrait convoquer des élections. Ce qui induit de nombreuses polémiques autour du type d’élections qui devraient être convoquées : directes ou indirectes2.
Parmi ces scénarios, plusieurs ne sont pas prévus par la constitution, ou s’appuient sur des dispositions qui sont sujettes à des problèmes d’interprétation. Le politologue affirme : « Il n’y jamais eu une pareille situation, qui est sans l’ombre d’un doute la pire crise politique de l’histoire du Brésil. » À ce jour, la défense de Temer tente de délégitimer les enregistrements à l’aide d’arguments techniques. Selon Fornazieri, les alliés de Temer au Congrès jouent quant à eux la montre pour négocier une sortie, en cherchant le consensus sur un candidat, ce qui isolerait Temer et l’obligerait à renoncer.
Dans la rue
« Le peuple se lève, il se lève pour dire ciao, Temer, ciao, Temer ciao, ciao, ciao ; c’est le putschiste, sans aucun vote, qui veut voler le travailleur », c’est une version samba de Bella ciao qui résonne sous la pluie torrentielle de l’avenue Paulista à São Paulo. Le 21 mai a été un dimanche de mobilisations dans tout le pays, pour précipiter la chute de Temer et exiger des élections « directes maintenant3 ».
La journée de protestation massive à Brasilia, le mercredi 24 mai, appelée par les syndicats et des mouvements populaires, ponctuée d’incendies et de tags dans de nombreux ministères, a quant à elle été violemment réprimée par la police. Ce jour-là, Temer promulgue un décret appelant l’armée à « garantir la loi et l’ordre ». Les militaires entourent le palais du gouvernement et occupent les rues de la capitale. Des débats houleux s’en suivent entre parlementaires dans le Congrès, des manifestations spontanées ont lieu dans d’autres villes ; le décret génère une forte opposition. Sous la pression, Temer fait marche arrière en révoquant le décret dans la matinée du jeudi 25 mai. Cependant, le signal a été donné. Face à une telle crise, l’appel aux forces armées est une décision terrible, qui rappelle des moments néfastes de l’histoire du pays, ceux de la dictature militaire (1964-1985), et ne fait qu’augmenter le trouble.
Pour Natalia Szermeta, de la coordination du Mouvement des travailleurs sans abri (MTST), « la situation dans le pays est très tendue, et on ne peut plus délicate. Une “bombe” éclate à chaque instant, et les chances qu’a Temer de rester président s’amenuisent de jour en jour. Cela ouvre une nouvelle brèche dans la politique brésilienne, à mesure que s’intensifient la crise et l’extrême instabilité dans lesquelles le pays est plongé ». C’est pourquoi, explique-t-elle, « ce qui se joue à présent, c’est l’investissement de la rue pour exiger la démission immédiate de Temer. Le Brésil devient une honte pour le monde entier, non seulement à cause des scandales de corruption, mais aussi de la manière dont sont dirigées les affaires politiques, et nous devons absolument trouver une issue démocratique. Aucune solution qui ne respecte pas ce principe ne serait bonne pour le pays, et nous avons donc dès à présent besoin d’élections directes. »
Face à la possibilité d’élections directes – que ce soit par l’amendement de la constitution, ou suivant le calendrier électoral normal qui prévoit de nouvelles élections en 20184 –, à Curitiba [Voir encadré « Mondes parallèles »], il est clair qu’aujourd’hui encore les mouvements populaires et les syndicats appuient la candidature de l’ex-président Lula Da Silva. « Nous avons dit à la bourgeoisie que Lula est notre candidat, et nous ne permettrons pas que sa candidature soit invalidée, affirmait João Pedro Stédile, leader du Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST). Nous avons besoin de disputer les élections avec Lula, et de débattre d’un nouveau projet de société avec le peuple. »
Pour Fornazieri, le Brésil « traverse un vide politique, mais aucune perspective économique ou législative ne semble se dessiner : personne ne sait au juste de quoi sera fait le pays ». Dans un tel contexte, où Temer est rejeté par quasi toute la population, « les mouvements sociaux continuent de n’avoir qu’une faible capacité de mobilisation, ajoute-t-il. C’est le moment pour eux de se renforcer, en posant leurs revendications sur la table avec fermeté, et en étant les protagonistes du processus de négociation pour la sortie de crise ». Cela dit, négociation ne rime pas avec conciliation, souligne le professeur de sciences politiques. « On se doit même de créer une culture de la non-conciliation ! L’expérience même du Parti des travailleurs (PT) a démontré que l’arrangement avec les élites qui ont historiquement dominé le pays n’a porté aucun fruit. C’est aux mouvements sociaux de prendre les choses en main, en négociant leurs revendications en totale autonomie. » Selon le politologue, les secteurs progressistes l’ont déjà compris, et ils n’accepteront plus le « dialogue social », sachant bien à présent qu’on ne peut pas confier ses mots d’ordre et ses revendications à un gouvernement de la conciliation. Même dans un éventuel gouvernement à venir de Lula, « ils lui mettraient une grosse pression pour un vrai programme de gauche ».
Lira Alli, qui chantait plus tôt Bella Ciao au micro, fait partie d’un réseau de groupes de carnaval qui se sont unis contre l’impeachment, autour de cet accord commun : « dans l’immédiat », il faut exiger des « élections directes, parce qu’il est important que nos votes soient respectés ». Mais, dans une perspective plus vaste, elle pense que « les élections directes ne résoudront pas nos problèmes ». Pourquoi ? « Parce que l’un de nos problèmes principaux est que nous avons un système démocratique qui n’est pas démocratique, otage des grandes entreprises et du capital transnational. La démocratie subit une crise profonde, elle est questionnée en tant que forme même dans le monde entier, et nous ne réussirons pas à transformer radicalement ses structures si on garde les yeux rivés sur le Brésil. Ce dont nous avons besoin, c’est de nouvelles formes pour la construire à l’intérieur de nos communautés. »

ENCADRÉ : Lavage Express ↩
Par Jef Klak
L’opération anticorruption menée par le juge Sergio Moro porte ce drôle de nom : « Lava Jato » comme « lavage express » ou « lavage automatique ». Car c’est ainsi que l’affaire a commencé : après le témoignage en 2008 d’Hermes Magnus, à qui on avait proposé de blanchir de l’argent via son entreprise de composants électroniques, la police met en place une surveillance sur une station de lavage auto de la compagnie Petrobras, contrôlée par l’État brésilien. De là, ce géant du pétrole et une dizaine de grandes entreprises de BTP se retrouvent au cœur du plus gros scandale politico-financier de l’histoire du pays. L’enquête révèle une logique classique de cartel, réservant des contrats surfacturées à ses membres en échange de pots-de-vin reversés à la classe dirigeante de centre-gauche. Le PDG de la firme de BTP Odebrecht, par exemple, purge actuellement une peine de 19 ans de prison pour avoir distribué 30 millions de dollars d’enveloppes. Des miettes, quand on sait que c’est en tout plus de 10 milliards d’argent sale qui auraient transités au sein de cette affaire.
À l’époque, le très populaire Lula da Silva (Parti des travailleurs – PT) est à la tête du pays (2003-2011), et il est aujourd’hui accusé d’avoir pris sa part du gâteau, ainsi que d’avoir dissimulé un luxueux appartement au Trésor public. C’est d’ailleurs son chef de cabinet, José Dirceu, qui est suspecté d’être le chef d’orchestre de tout le système de corruption mise en place. Dilma Roussef (PT aussi), ancienne cheffe de cabinet et successeuse de Lula à la présidence, voulant cacher le déficit du pays avant son élection, a quant à elle été destituée en 2016 pour maquillage des comptes publics. Et c’est à présent au tour de Temer, ancien vice-président de Roussef, de tomber. En tout, 47 hommes et femmes d’État sont suspectés – sénateurs, députés, ministres du PT ou de l’opposition.
Des transnationales « françaises » comme Alstom (dont les actionnaires sont l’État français 20 %, Bouygues 8 %, Société générale 4 %) sont aussi sur la sellette. Selon les déclarations de Nestor Cerveró, ex-dirigeant de Petrobas, la société d’industrie lourde basée à Paris aurait versé 10 millions de dollars à Delcídio do Amaral, sénateur et porte-parole du PT au sénat sous Roussef, pour des transactions de turbines. Des accusations pratiquement pas relayées par la presse française, mais retenues par le juge et ministre de la Cour suprême Teori Zavascki. Lequel a depuis bêtement trouvé la mort dans un accident d’avion en janvier 2017. Ce magistrat anticorruption avait fait arrêter Amaral en novembre 2015. Et ce dernier échangea sa sortie de prison un an plus tard contre des aveux en 254 pages, impliquant (entre autres) Lula, Roussef, des ex-ministres, et le président de l’Assemblée Eduardo Cunha qui est accusé de s’être mis 40 millions de dollars dans les poches en banques suisses.
ENCADRÉ : Mondes parallèles ↩
Par Marcelo Aguilar
Les élections de 2018 sont déjà en train de se disputer. Le 10 mai, le juge Sergio Moro, qui a pris les rennes de l’opération Lavo Jato, a convoqué Lula pour une audition à Curitiba, siège de l’opération. L’ex-président, de concert avec les mouvements sociaux qui l’appuient, a fait de ce moment un acte politique. Des milliers de personnes sont venus de plusieurs endroits du pays pour le soutenir, et organiser un meeting devant l’université fédérale de Paraná, où ledit Moro donne cours. Les mouvements accusent le juge de s’acharner pour empêcher Lula de redevenir président. Selon un de ses avocats, Cristiano Martins, « l’opération Lava Jato mène une vraie guerre judiciaire, en manipulant les lois et les procédures pour pourchasser ses ennemis politiques ». Moro a été élevé au rang de « héros national » par les mouvements qui avaient soutenu l’impeachment de Roussef. Et est devenu le super-vilain pour les mouvements populaires. Peut-être peut-on voir le mur qui a séparé les manifestants pro et anti-impeachment pendant sa votation à Brasilia comme la matérialisation de cette profonde polarisation qui traverse le Brésil.
Ce sont des mondes bien distincts. À Curitiba, Antonia explique que « si Lula se présentait cent fois, et que je pouvais vivre aussi longtemps, je voterais cent fois pour lui ». Elle a voyagé trois jours depuis le lointain État de Piauí, dans le nord du pays. « La situation économique là-bas était très difficile. Combien de fois les enfants allaient-ils à l’école le ventre vide ? En arrivant au bahut, pas de cantine. Que faisaient-ils alors ? Ils s’évanouissaient ! On les amenait à l’hôpital, et là, pas de médicaments ! La situation était chaotique. C’était comme ça avant Lula », raconte-t-elle, pour expliquer sa position. Il y a là aussi deux femmes, en train de faire bouillir le riz et les haricots rouges dans la cuisine du campement de soutien à Lula, et qui ne veulent pas être identifiées, de peur des représailles du patron. Elles sont venues du nord de Paraná. « Nous sommes ici pour lutter. Ce que nous voulons, c’est de la terre pour semer », raconte l’une d’elles. Et sa camarade d’ajouter : « Je ne comprends pas grand-chose à la politique, mais je parviens tout de même à me rendre compte que ce gouvernement, sur une échelle de zéro à dix, c’est zéro. C’est un gouvernement pour les riches. Et comme le dit la chanson, le pauvre est chaque jour plus pauvre. » Et c’est cette femme, peut-être, qui nous donne une des clés pour saisir la faiblesse du gouvernement Temer : « La majorité de la population est pauvre, et c’est clair qu’on ne va pas accepter qu’il ne serve que les intérêts des riches, en nous laissant sur le carreau. Du coup, il va l’avoir mauvaise. Quand Dilma est tombée, il y en avait beaucoup dans la rue à penser que ça allait s’améliorer, et aujourd’hui, le peuple qui a soutenu ce président se rend compte du contraire. Le sort s’est retourné contre le sorcier. »
À quelques kilomètres de là, on trouve les « pro-Moro », qui se sont autoproclamés « République de Curitiba », là où « les lois sont respectées ». Ici, on vend des T-shirts à l’effigie du juge Sergio Moro, et l’on crie que « Le Glorieux » va réussir à envoyer Lula en prison avant 2018. Elizeth, une couronne de plastique dorée sur la tête et le passeport de sa « République » à la main, explique qu’elle cherche à « restaurer la citoyenneté des Brésiliens ». Pour autant, elle tient une position assez modérée dans le spectre des pro-Moro. « La question n’est pas de changer de président. Notre système continuerait de la même manière, financé avec le même argent. Ce qu’il faut faire, c’est changer de système, grâce à la justice et à la loi qui s’applique à tous. Le Brésil est un vieux pays qu’il faut transformer. » En ce sens, elle prône une « révolution culturelle » pour redonner vie au passé et construire une « démocratie partout », c’est-à-dire « dans les moyens de communication, dans l’éducation, la loi et la politique ».

Lors de la même manifestation, qui n’a pas réuni plus de cinquante personnes, il y a en effet d’autres oiseaux, comme Euro, retraité de la Force aérienne brésilienne, qui appelle à une intervention militaire pour sauver le pays, bien plus efficace que des élections : « Le peuple est déjà en train de se préparer pour le communisme, à cause des conspirations de gauchistes, qui tirent les ficelles dans tous les partis et cherchent à détruire l’État. » Pour lui, il serait bon « de laisser les gens avoir des armes, parce qu’un bandit ne va pas rentrer chez moi s’il sait que je peux lui tirer une balle entre les deux yeux ». Mauricio, fier d’avoir servi l’armée pendant la dictature militaire, rejoint la conversation pour ajouter son grain de sel : « La seule institution qui a toujours su former ses membres dans le respect de la morale et du patriotisme, c’est l’armée, et je peux te dire que s’il y avait une intervention militaire, ça remettrait le pays dans le droit chemin. » Euro dit qu’il les aurait tous tués. Pour ne pas faire de jaloux.
- Ce texte a été publié le 25 mai 2017 sur le site de Saltamos (NdT). ↩
- En cas de remplacement du président de la république dans les deux ans qui précèdent la fin de son mandat (dont la durée normale est de quatre ans), la constitution brésilienne prévoit des élections indirectes. Au lieu du suffrage universel, ce sont les 513 députés fédéraux et les 81 sénateurs qui élisent le nouveau président pour le reste du mandat. Si Temer venait à être destitué, des élections indirectes auraient donc lieu. Deux propositions d’amendement à la constitution ont été déposées :l’une à la chambre des députés en 2016 pour que les élections directes soient réalisées jusqu’à six mois avant la fin du mandat présidentiel ; l’autre au Sénat en 2017 pour qu’elles le soient jusqu’à un an avant la fin du mandat. Cependant, même si l’une de ces propositions était adoptée avant la destitution de Temer, elle ne serait applicable qu’à partir d’une nouvelle année électorale – soit 2018. Les élections directes restent donc une revendication populaire au Brésil. (NdT). ↩
- En écho au mouvement populaire contre la dictature militaire, « Diretas já », qui exigeait déjà, en 1983 et 1984, des élections directes et une nouvelle constitution. (NdT). ↩
- À l’issue du mandat actuel commencé par Dilma Roussef en 2014 (NdT). ↩