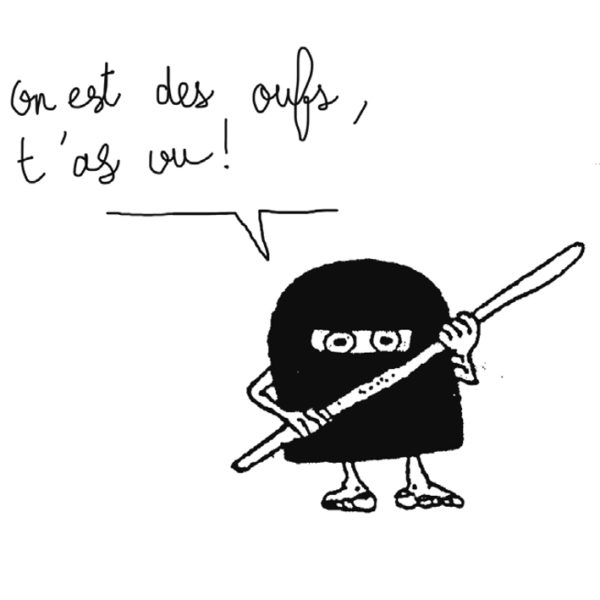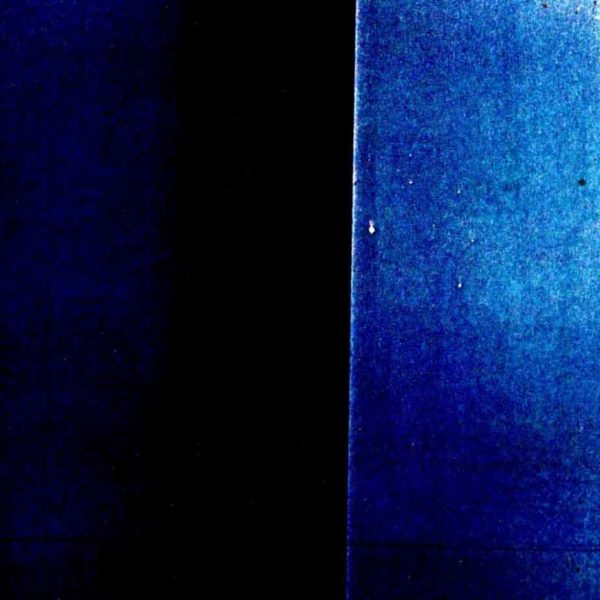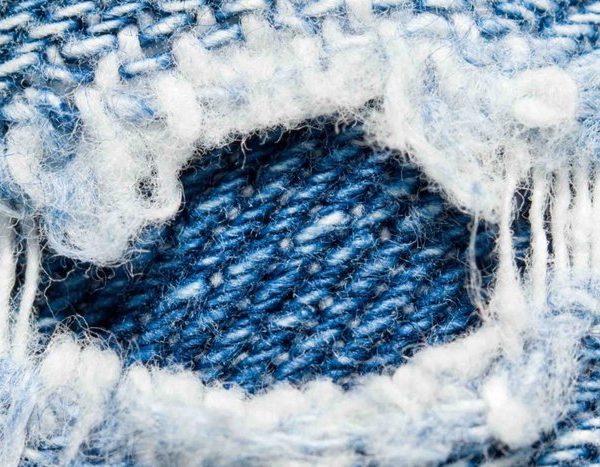Assimilée au capitalisme, à la futilité et à l’extravagance du style vestimentaire bourgeois, la mode est fortement dépréciée dans l’URSS naissante, au lendemain de la révolution d’Octobre. Prônant le rejet de la consommation ostentatoire, l’homme et la femme bolcheviques doivent faire preuve d’austérité et s’habiller simplement. Très rapidement pourtant, dès les années 1930, le concept de mode réapparaît, des politiques vestimentaires sont élaborées, une organisation bureaucratique statue sur la pertinence « soviétique » des modèles créés… Entretien avec Larissa Zakharova, historienne et auteure de S’habiller à la soviétique. La mode et le Dégel en URSS (éd. CNRS, 2012).
Ce texte est issu du numéro 2 de Jef Klak, « Bout d’ficelle », paru en mai 2015 et encore disponible en librairie.
Téléchargez l’article en PDF.
Comment en êtes-vous venue à l’étude de la mode soviétique ?
À Saint-Pétersbourg, j’ai commencé par travailler sur la redistribution du logement pendant la guerre civile (1917 à 1921). Le sujet n’avait rien à voir avec la mode, mais m’a poussée à définir le cadre théorique de ce que serait une histoire du quotidien en Union soviétique. Dans l’historiographie russophone des années 1990, l’histoire du quotidien était assez mal vue. On la considérait comme anecdotique, dissociée de la grande histoire événementielle qui elle, avait toute sa légitimité. Il se disait qu’aborder le quotidien revenait à faire une description statique et non problématisée des manières de vivre et de faire, laquelle n’avait pas un grand sens explicatif par rapport à l’expérience soviétique.
De cette historiographie russophone, je suis passée à l’historiographie francophone, et j’ai découvert les travaux de Michel de Certeau sur les arts de faire, les ruses anonymes et le bricolage qui composent le quotidien1… Il m’a semblé que ce cadre conceptuel et théorique convenait très bien à cette société de pénurie : en Union soviétique, les individus étaient contraints de s’adapter au manque et à la pénurie au quotidien, et devaient déployer toute une palette de manières de faire pour construire leur mode de vie et leur environnement matériel.
Puis j’ai découvert les travaux de Alf Lüdtke2 et de l’Alltagsgeschichte (histoire de la vie quotidienne) allemande. Ce courant insiste, de la même manière que de Certeau, sur la créativité des agents ordinaires, mais en lien étroit avec la sphère d’action politique et économique d’État. Quand je me suis intéressée à la mode en URSS, pour ma thèse de doctorat, j’ai défini le quotidien comme lieu d’intersection entre politiques d’État et réponses des individus. Ceux-ci peuvent à leur tour modifier le cours des événements et les cadres d’action des dirigeants, infléchir le cours des politiques.
Comment avez-vous procédé pour écrire votre histoire de la mode ?
L’essentiel de ma documentation provient des archives institutionnelles. De ce point de vue, l’historien de l’URSS est bien loti, parce que cet État bureaucratique a produit énormément de documentation, dans des domaines qui ne sont pas aussi bien documentés dans les sociétés démocratiques libérales. L’univers de la création vestimentaire était, parmi d’autres, une sphère très investie par l’État. Dans les sources institutionnelles, on trouve de nombreuses traces des interventions et négociations entre les dirigeants, les experts et les consommateurs.
J’ai avant tout travaillé avec les matériaux fournis par les instances de création vestimentaire : les « Maisons de modèles de vêtements ». Dans ces institutions étatiques, les créateurs étaient des fonctionnaires chargés de concevoir des modèles de vêtements pour les entreprises de confection, qui étaient souvent réutilisés par les ateliers de couture sur-mesure. Les modèles devaient correspondre au concept de mode socialiste qui avait été élaboré au préalable, et se distinguer de la mode « bourgeoise », incompatible avec la société soviétique. J’ai également consulté les fonds d’autres instances : le Conseil des ministres ; le Comité central du Parti, qui veillait à l’élaboration et à l’application des mesures prises durant l’époque khrouchtchévienne3. J’ai aussi travaillé avec les documents de la Direction des statistiques, parce que les dirigeants voulaient savoir ce que les individus consommaient, de quelle manière, et dans quelle mesure ils étaient satisfaits de ce que l’État leur offrait comme biens de consommation. Enfin, j’ai utilisé les enquêtes sur les budgets des ménages, réalisées par les Directions des statistiques à travers le pays. À partir du terrain de Leningrad (Saint-Pétersbourg), j’ai sélectionné un échantillon de 465 enquêtes, dans lesquelles j’ai analysé ce que les individus achetaient, combien ils dépensaient dans les magasins d’État ou auprès de particuliers qui vendaient sur les marchés ; combien ils dépensaient dans les ateliers étatiques de couture sur mesure ; combien chez les couturiers privés.
Tous ces documents m’ont donné un tableau général des politiques menées dans le domaine de l’habillement, ainsi que des pratiques de consommation des individus ordinaires pendant la période de dégel des années 1950-1960. J’ai ensuite complété ces matériaux d’archive par une vingtaine d’entretiens avec des consommateurs de cette période, qui m’ont permis d’aborder la question des cultures de consommation : pourquoi les gens s’adressent plutôt aux couturières privées ou à un atelier de couture sur-mesure ; qui achète dans les magasins d’État, et qui refuse par principe d’y aller ?
Pouvez-vous détailler ce que vous entendez par « mode soviétique » ? Comment ce concept a-t-il émergé, et comment est-il devenu un objet politique de l’URSS ?
La formulation même de l’expression « mode soviétique » rencontre souvent des sourires sarcastiques parmi les chercheurs – il s’agirait de deux termes inconciliables. Or, pour les acteurs de l’époque soviétique, le terme avait du sens, même s’il n’avait rien d’une évidence. L’élaboration de ce concept a fait l’objet d’âpres débats au fil des changements politiques de l’État soviétique.
Dans un premier temps, au lendemain de la révolution d’Octobre, la situation est particulièrement incertaine : les entreprises de confection et de textile ferment, puis sont nationalisées, mais elles ne peuvent fonctionner, puisque le pays est en guerre civile jusqu’en 1921. L’État n’a pas encore défini de politiques dans le domaine de l’habillement. En revanche, un milieu artistique émerge, et des créateurs expérimentent différents styles. On voit apparaître, par exemple, les courants du constructivisme révolutionnaire et de l’art industriel – que l’on voulait faire descendre dans la rue et rendre accessibles à tous. Les porteurs de ces concepts et de ces expériences artistiques possèdent souvent une formation prérévolutionnaire et connaissent des créateurs occidentaux, français notamment.
Nadejda Lamanova est l’une des figures fondatrices de la mode socialiste. C’est une couturière, qui avait créé des toilettes pour la cour impériale avant la révolution. Paul Poiré, avec qui elle était en contact, pensait qu’elle resterait travailler en France après la Révolution. Mais Lamanova faisait partie de ceux qui étaient très attirés par l’idéologie bolchévique. Elle est donc restée en Russie pour élaborer le cursus de formation des créateurs, appliqué au premier Institut textile fondé à Moscou en 1919. Elle élabore le principe du costume socialiste, qui devait être « rationnel » et fonctionnel, où la forme devait être adaptée aux circonstances, à la morphologie, au type de personnalité… Il s’agissait presque d’une théorie de la mode, mais qui ne s’opposait pas encore à la mode bourgeoise occidentale. Très vite pourtant, cette élaboration théorique a été utilisée dans les débats sur l’incompatibilité de la mode, phénomène d’origine bourgeoise, avec l’économie socialiste et la société soviétique, censée être égalitaire, où les distinctions sociales étaient prohibées. Ce concept de mode soviétique a donc été élaboré à l’époque de la Nouvelle politique économique (NEP – entre 1921 et 1928), qui introduit une relative libéralisation économique et le retour d’une certaine liberté dans le quotidien, pour dynamiser le pays suite à la guerre.
À la fin des années 1920, Staline s’impose à la tête du pouvoir et met fin à la NEP. Il nationalise et centralise l’ensemble de la production, et introduit une politique d’industrialisation à marche forcée, ainsi que des cartes de rationnement dans le quotidien. Toute réflexion sur la mode devient alors complètement inappropriée, puisque les usages politiques promeuvent l’ascétisme. Le terme même de « mode » est en quelque sorte banni du vocabulaire quotidien. Les magazines apparus dans les années 1920 changent de titre : ils ne portent plus ouvertement sur la mode, mais sur « l’art de s’habiller », qui défend les idées de rationalité, de fonctionnalité, de simplicité. On ne parle plus de mode.
À la fin de la NEP, les créateurs se réfèrent-ils à l’idée de formation d’un homme nouveau pour justifier les choix esthétiques des vêtements ? Les choix formels sont-ils articulés à une idéologie ?
Le concept de mode socialiste élaboré par Nadejda Lamanova s’inscrivait déjà dans un discours général sur l’homme nouveau. Elle n’était pas la seule à promouvoir ces idées, et dialoguait constamment avec d’autres personnalités, comme le commissaire à l’Éducation (Anatoli Lounatcharski), ou le commissaire à la Santé (Nikolaï Semachko), qui promouvaient l’idée d’hygiène sociale. Le débat sur l’hygiène peut paraître un peu éloigné de celui sur la mode, mais ils ont une vraie cohérence. Dans le projet de l’homme nouveau vivant dans une société égalitaire, les propositions de Lamanova allaient dans le même sens que celles d’autres penseurs de l’époque.
Après la période d’industrialisation, un nouveau revirement survient dans la deuxième moitié des années 1930. Suite au 17e congrès du Parti en 1934, Staline déclare que les fondements du socialisme ont été posés en Union soviétique, et que l’époque de l’ascétisme est terminée. « La vie est devenue meilleure et plus joyeuse », son fameux slogan, est affiché partout. C’est dans ce cadre qu’est lancée la campagne de lutte pour la koultournost’ (voir encadré), cette acculturation de l’homme nouveau. On estime que l’idée d’hygiène sociale n’a pas suffisamment été appliquée, et l’on entreprend donc d’expliquer aux Soviétiques ce qu’est être koultourny, un « homme civilisé ». Cette lutte pour la koultournost’ entraîne le retour en force de l’idée de mode : l’homme ou la femme soviétique est « civilisé » quand il sait s’habiller avec goût et selon la mode. Par cette idée d’éducation du goût, les créateurs trouvent leur fonction dans la société soviétique : ils sont chargés d’élaborer les tendances de mode, et peuvent ainsi éduquer les consommateurs au sens du « beau ». Dans la mesure où la mode socialiste vise à donner à tous un sens de l’esthétique, on estime alors que celle-ci n’est plus problématique, puisqu’elle ne produit pas de distinction sociale.
Mode et économie planifiée font-elles bon ménage ?
Difficilement. La mode, avec le concept d’évolution des tendances, implique en effet de changer périodiquement les vêtements avant leur usure matérielle. Or, d’après les économistes soviétiques, on ne peut pas jeter les produits issus du travail humain avant leur usure physique complète : ce serait irrationnel et contre-productif. Jusqu’à la fin de l’époque soviétique, les créateurs ont buté sur l’argument selon lequel la mode ne convenait pas à une économie planifiée. Ils ont donc tenté d’élaborer un rythme spécifique à la mode socialiste, moins rapide que la mode occidentale. Ils « ralentissent » la mode en proposant plusieurs lignes simultanées : parallèlement au « fond de collection4 » permanent, les créateurs alimentent le marché avec des tendances déjà produites lors des précédentes saisons, en même temps qu’ils produisent de nouvelles silhouettes. Ils offrent ainsi plusieurs rythmes de changements de silhouettes, et parviennent à justifier la présence de la mode dans le cadre de l’économie planifiée socialiste.
Sur quoi se fonde ce « sens du beau », censé être partagé par tous ?
Il se fonde sur la notion de « bon goût », qui implique que le « sens du beau » est le même pour tout le monde. Les créateurs élaborent des règles de bon goût complètement figées, qui n’évoluent pas dans le temps. C’est pourquoi l’idée de bon goût se substitue souvent à l’idée même de mode, jusqu’à la dénaturer, puisque la mode est censée évoluer et altérer les conventions du goût. Or les créateurs soviétiques définissent leurs fonctions sociales par un travail d’éducation des consommateurs au bon goût, et oublient que la mode peut jurer avec ses règles.
Concrètement, le bon goût de rigueur consiste à accorder les accessoires de la même couleur : le chapeau, les gants, les souliers, le sac, l’écharpe ou le foulard. Une autre règle préconise de changer de souliers en arrivant au théâtre : on laisse les bottes dans le vestiaire et on chausse des souliers élégants pour assister à un ballet, à l’opéra ou à une pièce de théâtre. Ou encore, on choisit ses vêtements en fonction des circonstances, comme cela se fait dans la mode occidentale : en France, la mode distingue les robes de cocktail, celles de l’après-midi ou du soir… Cette distinction est reprise par les créateurs soviétiques, qui y ajoutent des valeurs propres à la société socialiste. Ils introduisent par exemple la catégorie des vêtements de travail.
Le discours des créateurs est aussi beaucoup plus normatif que celui des journalistes de mode, français notamment. Les créateurs soviétiques, qui jouent également le rôle de journalistes, peuvent écrire dans la presse qu’« il est impossible de porter chez soi des robes démodées ». On cherche également à créer des vêtements d’intérieur, qui doivent eux aussi être à la mode : une des règles du bon goût dictait en effet de changer de vêtements en rentrant chez soi. On ne pouvait pas être habillé de la même manière du matin au soir, il fallait changer de tenue à plusieurs moments de la journée.
Dans vos travaux, vous parlez du rôle du Grand conseil artistique, qui sélectionnait les modèles avant leur production. Il semble que la question du bon goût faisait polémique parmi ses membres…
Le Grand conseil artistique réunissait des représentants de différents corps professionnels. Il sélectionnait les modèles élaborés par les créateurs, et pouvait imposer un véto à certains d’entre eux. On n’y discutait pas tant du goût, mais plutôt des besoins des consommateurs. Les membres de ce conseil avaient des interprétations très divergentes des ordonnances du gouvernement. Ce dernier demandait d’améliorer le quotidien des Soviétiques en fournissant aux consommateurs davantage de vêtements, beaux, pratiques, confortables, etc. Mais les termes des ordonnances étaient très vagues et c’était aux professionnels de les interpréter, de les décliner en fonction de leur définition de ce qu’étaient les « beaux » vêtements, convenables à l’homme soviétique.
Les différences entre cultures professionnelles créaient des blocages dans la communication entre les acteurs censés travailler de concert. Les « travailleurs de commerce » – les employés des magasins d’État – avaient par exemple leur propre procédé de suivi de la demande, qui se fondait sur ce qui avait été demandé pendant la période précédente. Cette définition de la demande jurait avec la notion de mode, parce qu’elle ne pouvait prendre en compte aucune nouveauté. Les travailleurs de commerce rejetaient d’emblée toute nouveauté radicale, parce qu’ils ne pouvaient être sûrs de son succès, et apparaissaient donc comme conservateurs au sein des instances de sélection.
Ces employés de magasins d’État choisissaient-ils eux-mêmes ce qu’ils faisaient entrer dans leur stock de marchandises à commercialiser ?
Les vendeurs et leurs chefs, qu’on appelait « experts en marchandises », devaient effectivement suivre la demande par le biais de feuilles de contrôle, en notant chaque transaction. La méthode de suivi n’était pas parfaite, car sans moyen de systématiser, on notait de manière un peu lacunaire, aléatoire. Il existait donc certains mécanismes de transmission de la demande. « Une femme est venue demander une robe noire pour des funérailles et n’en a pas trouvé » : c’était noté, et transmis aux entreprises de confection. Mais que faisaient celles-ci ? Elles produisaient 10 000 robes noires de funérailles, selon le plan quinquennal. Cela provoquait forcément un problème d’ajustement, entre une demande ponctuelle et ce type d’arrivages.
Il se pouvait aussi que la demande bute sur un problème de fourniture des matières premières. Si des consommateurs demandaient des robes en laine de telle silhouette, il était possible d’en obtenir le patron, mais que l’entreprise ne dispose pas de tissu en laine pour les produire en quantité suffisante. L’économie centralisée n’arrivait tout simplement pas à activer jusqu’au bout ce mécanisme de communication, qui était pourtant formellement instauré entre les différentes instances de production vestimentaire.
Pour revenir à l’idée des cultures professionnelles divergentes, c’est avant tout la nouveauté des lignes qui posaient problème aux travailleurs de commerce, qui se fondaient sur les observations des pratiques d’achat passées. Ces propositions de nouveautés étaient également problématiques pour les travailleurs des entreprises de confection. Ils avaient les chiffres du plan en tête et lorsqu’ils voyaient une ordonnance expliquant qu’il fallait produire plus de « beaux vêtements pratiques pour le consommateur soviétique », cela signifiait, pour eux, produire la même robe en 25 000 exemplaires. C’était simple : on activait les chaînes de production, et hop hop hop, c’était produit. Pour les créateurs, la mode, c’était au contraire la diversité, et produire plus de beaux vêtements voulait dire proposer une plus grande variété de silhouettes. Les entreprises étaient particulièrement résistantes à cette diversification, qui impliquait d’adapter le processus de production à chaque patron, chaque matière, et d’apprendre aux ouvrières à couper les nouveaux tissus. Dans les magasins d’État, on trouvait donc surtout des vêtements démodés, qui étaient produits selon le plan et non pas selon les propositions des créateurs.
Il y avait donc une immense différence entre ce que les créateurs proposaient et les vêtements qui parvenaient à la population…
Oui mais, néanmoins, les gens pouvaient très facilement se tenir informés des dernières créations. Les patrons des modèles validés par le Grand conseil artistique – non produits en masse – étaient présentés dans les magazines de mode. À chaque fois que l’on se rendait au cinéma, les actualités, projetées sous forme de courts-métrages avant le film, contenaient des défilés de mode ; et les émissions de radio donnaient des descriptions verbales des nouvelles silhouettes à la mode. Par ailleurs, les nouvelles collections de la Maison des modèles faisaient l’objet de présentations publiques. Les consommateurs pouvaient ensuite suivre ces suggestions, mais ils devaient se montrer ingénieux : trouver du tissu, une couturière, faire la queue dans un atelier de couture sur-mesure, ou coudre eux-mêmes. En revanche, il serait faux de dire qu’à l’inverse, les personnes qui se rendaient dans des magasins d’État choisissaient la facilité, car il s’agissait d’espaces de pénurie.
Des modèles non validés par le Grand conseil artistique pouvaient-ils circuler sur le marché ? Quelle était l’influence de ce Conseil ?
Entre 1950 et 1960, on peut aisément parler du règne des experts. Les hiérarques du Parti faisaient confiance à ces personnes issues du milieu de la mode : ils les estimaient capables de juger ce qui serait beau et approprié, puisqu’elles appuyaient leur savoir sur une conception presque scientifique de la mode socialiste. L’étendue du pouvoir de ces experts s’illustre particulièrement avec l’affaire des stiliagui. Il s’agissait de jeunes, des zazous5 soviétiques, qui ont commencé à porter des vêtements de production étrangère à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rapidement considérés comme des personnes inclinées devant l’Occident bourgeois et non dévouées à la cause communiste, les stiliagui étaient assimilés à des « parasites sociaux ». Cet épisode s’inscrit dans un contexte politique bien particulier, marqué par la lutte contre le cosmopolitisme de la seconde moitié des années 1940.
Les créateurs sont intervenus dans ce débat en récupérant les tendances des zazous et en les intégrant, petit à petit, à leurs créations. Le style des stiliagui s’illustrait notamment par des pantalons très étroits – on disait qu’ils devaient s’armer de savon pour les enfiler, et ces jeunes étaient comparés, dans la presse, à des perroquets. En réponse, les créateurs ont donc rétréci la largeur des pantalons, jusqu’à les faire apparaître sous cette forme dans les magasins d’État, à la fin des années 1950. Ils étaient d’ailleurs tellement étriqués que des consommateurs ont alors fait le signalement suivant : « Vos pantalons sont si serrés que les hommes soviétiques qui se respectent doivent se faire coudre des pantalons plus larges par leurs propres moyens. » En jouant un rôle de médiateur, les créateurs ont ainsi réussi à faire passer la mode antisoviétique pour soviétique : à partir du moment où la mode des stiliagui a été intégrée aux créations officielles, la stigmatisation a cessé. Cela a amené certains chercheurs à dire que le mouvement des stiliagui avait disparu à la fin des années 1950. En réalité, ils sont devenus moins visibles dans le paysage urbain, car plus de jeunes gens se sont mis à porter des pantalons étroits. Mais l’étiquette même des stiliagui qui avait une forte connotation péjorative était désormais davantage appliquée aux marginaux et aux déviants sociaux (« hooligans », « parasites », etc.) qu’aux jeunes habillés à la mode. Le fait même de porter un pantalon serré a perdu le sens politique négatif qui lui avait été assigné jusqu’alors.
Un vêtement d’inspiration occidentale n’était donc pas considéré comme une menace s’il était produit sur le sol soviétique ?
Tout en définissant la mode soviétique en opposition à la mode bourgeoise, les créateurs soviétiques se sont toujours tenus au courant de ce qui se faisait en Occident. À l’époque du Dégel (1953-1964), ils se rendaient très régulièrement en France avec l’autorisation des instances du Parti : ils avaient pour consigne d’utiliser l’expérience occidentale afin d’améliorer le système de production vestimentaire de l’URSS. Cependant, les ordonnances du gouvernement étaient très vagues ; elles ne spécifiaient pas ce qu’était l’« expérience occidentale », et laissaient la possibilité aux créateurs de rencontrer qui ils voulaient. Inspirés par leur culture professionnelle, par Nadejda Lamanova et ses contacts au sein de la haute couture, ils ont vite repéré Paris et Christian Dior – qui passaient pour l’incarnation du « meilleur ». Tandis que les discours publics relayaient, dans la presse, l’opposition entre mode bourgeoise et mode soviétique, les créateurs écrivaient, noir sur blanc dans leurs rapports de mission, à propos de la mode française, que « tout [était] parfait et [pouvait] être imité ».
Ils reprenaient ainsi les modèles parisiens dans leurs créations, et les faisaient passer pour de la mode socialiste. Il s’agissait d’un double langage, en quelque sorte, et forcément, cela ne passait pas inaperçu. Par exemple, quand les créateurs des pays socialistes se réunissaient à des congrès internationaux de mode, ils s’adressaient des reproches réciproques du type « Vos robes trapèzes ressemblent étrangement à une proposition récente d’Yves Saint Laurent », ce à quoi les créateurs interpellés répondaient « Non, c’est faux, nous nous sommes inspirés des robes traditionnelles russes à bretelles, les sarafanes ». Justifiés ainsi, ils devenaient irréprochables, puisqu’ils avaient évidemment le droit de reprendre les lignes des costumes folkloriques. Ce qui comptait, c’était les justifications qui paraîtraient dans la presse et qui permettraient de dire : « Ça, c’est de la mode socialiste ! » Au final, un citoyen soviétique qui aurait eu accès au patron d’une robe occidentale par voie de contrebande, et qui l’aurait fait reproduire chez une couturière, n’aurait pas été montré du doigt dans la rue, parce que le gouvernement faisait, tout simplement, la même chose que lui.
Contrairement à l’idée reçue d’une grande standardisation
des produits sur le marché soviétique, les vêtements présentaient donc une grande diversité…
C’est ce que l’on peut voir sur les photos prises par des particuliers – et non sur des photos officielles, car les photographes de presse devaient représenter la foule soviétique comme homogène. Entre 1950 et 1960, les silhouettes partagent de grandes similarités entre la France et l’Union soviétique, même si les conditions de production altéraient la qualité des matériaux et modifiaient les lignes des vêtements. Et puis, les citoyens soviétiques avaient aussi accès à des films étrangers dans le cadre de programmes de coopération culturelle, comme le festival de films néoréalistes italiens de 1957. Suite à la projection du film français Babette s’en va-t-en-guerre (1959) avec Brigitte Bardot, les femmes soviétiques se sont massivement coiffées « à la Babette ».
Existe-t-il une distinction sociale par la mode ? La haute couture existe-t-elle encore ?
Même si c’était une prétention du régime, la société soviétique n’a jamais été égalitaire. Très vite, les privilèges se sont institutionnalisés, et les élites ont bénéficié d’un accès facilité à des produits plus diversifiés et de meilleure qualité. Ces inégalités se justifiaient de différentes manières. À partir des années 1930, suite aux exploits d’Alexei Stakhanov, le stakhanovisme6 fait son apparition, avec le privilège, pour les « travailleurs de choc » d’accéder à un niveau de vie supérieur à celui des autres. Par ailleurs, il se disait aussi que les travailleurs dirigeants qui avaient de lourdes responsabilités, comme celle de représenter l’Union soviétique à l’étranger, devaient avoir une apparence convenable, respectable. C’est ainsi que les « distributeurs spéciaux » ont été créés : grâce à des systèmes de distribution spécialisés et fermés, les travailleurs des différents corps ministériels et du Parti avaient droit à des biens de meilleure qualité. Les élites artistiques bénéficiaient à peu près des mêmes avantages, et je me suis rendu compte, en menant des entretiens, que certains s’évertuaient, de plus, à établir des liens informels avec les Maisons des modèles, pour y acheter les pièces uniques qui avaient servi lors de défilés de mode, selon le principe de la haute couture. Les entreprises de confection avaient tendance à simplifier les patrons envoyés par les créateurs : par souci d’efficacité, l’idée créatrice était altérée. La pièce unique créée pour le défilé n’était donc jamais reproduite à l’identique, et était forcément de meilleure qualité, légèrement différente que les vêtements produits en masse. Donc oui, bien sûr, il existait une distinction sociale par le biais de la mode.
Vous pouvez peut-être en dire un peu plus sur les pratiques
quotidiennes des consommateurs ?
J’ai distingué, très schématiquement, trois cultures de consommation par rapport à la mode : ceux qui suivent la mode, ceux qui préfèrent le classicisme des magasins d’État, et les personnes qui empruntent aux deux. Ceux qui suivent la mode ne se rendaient jamais dans des magasins d’État : ils s’adressaient à une couturière privée, à un atelier de confection, ou cousaient eux-mêmes. Ces trois manières de fabriquer correspondent à des budgets différents – le plus cher étant d’avoir recours à des couturières privées, et le moins onéreux étant de coudre soi-même.
À partir des enquêtes de budget et des entretiens que j’ai réalisés, je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de lien de corrélation entre les revenus des gens et leur culture de consommation. On pouvait avoir de très faibles ressources et suivre une mode, à partir du moment où l’on avait une machine à coudre à la maison. Ma grand-mère, par exemple, cousait pour toute la famille. Elle suivait des patrons de couture, et y ajoutait sa marque de fabrique, son style… On reconnaissait chacun de ses vêtements.
C’était une pratique courante ?
Oui, et c’était aussi encouragé par l’État car, malgré la volonté du pouvoir de satisfaire les besoins des consommateurs, il existait des problèmes d’approvisionnement et de communication entre les différents maillons de la chaîne du système de production. Aussi, en parallèle de la production d’État, on trouvait un discours sur la nécessité, pour les jeunes filles, d’apprendre la couture – « C’est toujours pratique ». Je suis née en 1977, et j’ai appris à coudre à l’école, alors qu’en France, à la même époque, les cours de couture avaient été supprimés depuis longtemps dans l’enseignement général. Il existait même des cours du soir, pour celles qui voulaient se perfectionner. Les moyens mis à disposition par l’État étaient tels que l’on pouvait ensuite transformer cette activité en profession, et donc en activité illégale, puisqu’en théorie, on avait pas le droit de faire du profit chez soi. Malgré ce paradoxe, il existait un milieu très dense de couturières expérimentées, lesquelles avaient leur clientèle.
Elles ne couraient aucun risque ?
En cas de litige, un client aurait toujours pu dénoncer sa couturière – et dans ce cas, la milice constatait la production illégale, et condamnait la personne à un ou deux ans de travaux forcés – mais en réalité, le système fonctionnait bien, parce qu’il y avait une complicité et des intérêts communs entre clientèle et couturières. Cela complétait l’offre de l’État.
Finalement, cette diversité des pratiques, cette variété des silhouettes et l’image du bien-être qui se reflètent dans les archives privées découlaient de la participation de tous ces acteurs légaux, semi-légaux et illégaux. Ce qui comptait pour les dirigeants soviétiques, c’était le résultat final : la satisfaction du consommateur. Si la foule avait l’air contente, pourquoi chercher à embêter les couturières alors qu’elles apportaient leur pierre à l’édifice du bien-être général ?
On retrouve cette attitude ambivalente pour la revente des biens occidentaux, entrés en Union soviétique par voie de contrebande ou lors des divers moments d’ouverture à l’Ouest. Par exemple, le Festival international de la jeunesse et des étudiants de 1957 a été le théâtre de ventes massives de biens étrangers. Or, vendre des vêtements dans la rue était interdit puisque considéré comme une forme de spéculation. Aussi, des « dépôts-ventes » ont été mis à disposition des étudiants étrangers pour servir de points de revente, où ils pouvaient ensuite être légalement achetés par des consommateurs soviétiques ordinaires. Les objectifs économiques n’étaient pas toujours alignés sur le discours et la logique de pureté politique.
Où se fournissaient les stiliagui ? Dans ces magasins d’occasion ?
Suite à la Seconde Guerre mondiale, les biens étrangers entrent d’abord en Union soviétique sous forme de butin de guerre, de trophées saisis par les soldats et les officiers de l’Armée rouge. Ensuite, ils entrent avec les touristes. Des fartsovchtchiki – des spéculateurs, selon le langage officiel, qui vendaient des biens de production étrangère – allaient voir les touristes étrangers et leur demandaient d’acheter leurs chemises, leurs chaussettes, tout ce qu’ils pouvaient. Puis le trafic s’est développé, et des « touristes » bien informés amenaient intentionnellement des biens à revendre parallèlement au développement des magasins d’occasion.
Même si, au début, le stiliaguisme s’est fondé sur l’usage des biens de production étrangère, la plupart de ces jeunes fabriquaient des vêtements à partir de matériaux et de vêtements soviétiques. Avant que leur style ne soit repris par les créateurs, ils rétrécissaient leurs pantalons, ils amenaient leurs chaussures chez le cordonnier pour y faire mettre des semelles compensées. Ils bricolaient ce qu’ils imaginaient être de la mode occidentale. D’ailleurs, plusieurs mémoires écrits par des stiliagui racontent leur stupeur lorsqu’ils rencontrèrent la vraie jeunesse occidentale, lors du Festival de la jeunesse de 1957 : ce qu’ils avaient imaginé n’avait rien à voir avec les pratiques quotidiennes des jeunes occidentaux, habillés de manière très simple, beaucoup moins sophistiquée qu’eux.
Des règles officielles d’attribution de vêtements existaient-elles (quotas, contrôle de l’usure) ?
Non, hormis pendant les périodes où les cartes de rationnement étaient instaurées, et où il y avait des normes d’attribution des produits de consommation ordinaires. C’est-à-dire, lors de la guerre civile (de 1917 à 1921), puis avec les grandes politiques de planification et d’industrialisation (de 1928 à 1935), pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1948, puis sous l’époque gorbatchévienne, mais cela ne concerne alors que les biens alimentaires.
En deux mots, comment la mode socialiste a-t-elle évolué jusqu’à la fin du régime ?
Après la période du Dégel, dans les années 1960 et 1970, le système soviétique parvient à améliorer les conditions de production, les salaires augmentent, le pouvoir d’achat aussi (c’est ce que l’on appelle le contrat social brejnévien), le phénomène de reproduction des élites s’installe durablement, les canaux d’arrivage des produits occidentaux se multiplient, les jeans apparaissent sur le marché soviétique, l’industrie soviétique essaie de les reproduire…
Je n’ai pas fait d’enquête pour la période postérieure, mais je sais que la femme de Gorbatchev, Raïssa Gorbatcheva, a fait en sorte qu’un magazine de mode ouest-allemand, Burda moden, soit traduit en russe. Avec la Perestroïka, la distinction discursive entre une mode soviétique et une mode bourgeoise perd définitivement sa raison d’être.
La koultournost’
Dans une brochure moscovite publiée en 1938, la koultournost’ est définie comme « un ensemble d’attitudes dans la vie quotidienne : “l’homme cultivé’’ ne jure pas, ne crache pas… Il sait se tenir à table, se montrer galant avec les dames, il connaît les bonnes manières. Il apprécie la musique, le ballet, mais ce qu’il aime par-dessus tout, ce sont les livres. » Apparue dans les années 1930, la lutte pour la koultournost’ correspond à la volonté de « civiliser » les Soviétiques. La koultournost’ s’éloigne de la notion de capital culturel, car elle ne se réduit pas à une accumulation de connaissances dans les domaines de la culture dite légitime (art, littérature, musique, formation scolaire, etc.). Elle s’apparente davantage à la notion de « civilisation des mœurs » avancée par le sociologue Norbert Elias. Modèle de l’« homme cultivé », au même titre que la soznatel’nost’ (conscience sociale), la koultournost’ comprend une forte dimension hygiénique (aspect propre, apparence soignée), la diffusion des bonnes manières (gestes, expressions verbales), des normes du bon goût et du sens esthétique, le partage d’un niveau d’éducation jugé acceptable ainsi que des bases de connaissances sur l’idéologie soviétique. Cette stratégie d’intégration au moyen de valeurs et de pratiques communes était notamment dirigée vers les paysans qui arrivaient en ville pour gonfler les rangs des ouvriers.
- Michel de Certeau, L’invention du quotidien, I : Art de faire (1990) et II : Habiter, cuisiner (1994), Folio essais, Gallimard. ↩
- Alf Lüdtke (dir.), Histoire du quotidien, Paris, Éditions de la MSH, 1994 (1989). ↩
- Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste de l’URSS de 1953 à 1964 et président du Conseil des ministres de 1958 à 1964. ↩
- Ensemble des modèles qui restent inchangés d’une collection à l’autre, malgré les changements de tendances. ↩
- Courant de mode de la France des années 1940. Il s’agissait de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, et affichant leur amour du jazz. ↩
- Afin d’améliorer la productivité industrielle de l’URSS, le second plan quinquennal (1933-1937) est caractérisé par la création d’écoles techniques pour former et perfectionner les travailleurs, et élève au rang de « héros du travail » les ouvriers qui se démarquent par leur forte efficacité. Le plus célèbre d’entre eux est le mineur Alexeï Stakhanov qui, dans la nuit du 30 au 31 aout 1935, aurait abattu 14 fois plus de charbon que la norme établie. Cette propagande en faveur du sacrifice au travail s’accompagne de l’augmentation de contraintes et de sanctions encadrant sévèrement les ouvriers (suppression des salaires pour les travailleurs considérés inefficaces, rétablissement du livret ouvrier, allongement de la journée de travail, etc.). ↩