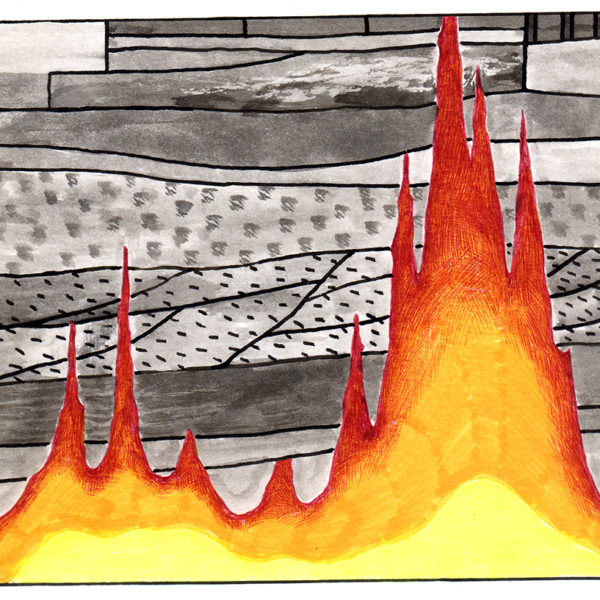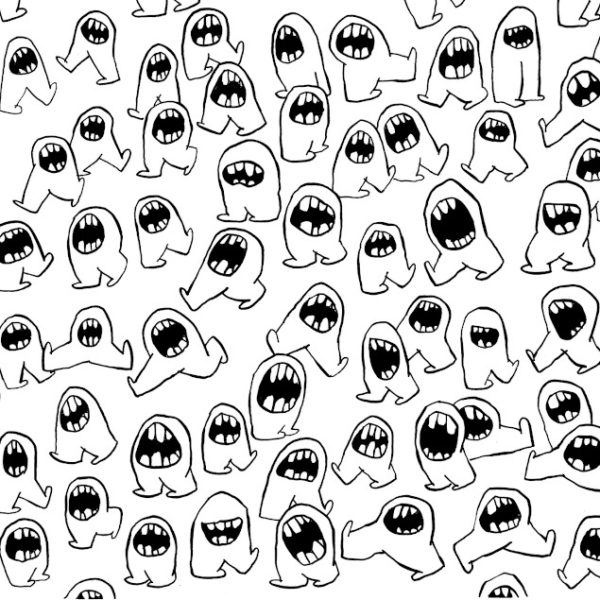Dernièrement, des députés français se sont demandé si les bêtes étaient en droit des « biens meubles » comme les autres, pour finalement leur accorder le statut enviable d’« êtres vivants doués de sensibilité ». Un juge de San Francisco a, quant à lui, considéré que la loi sur les droits d’auteur ne pouvait s’appliquer à un macaque qui s’était pris en photo avec un appareil volé. Jef Klak – dont le dernier numéro papier disponible en librairies, « Selle de ch’val » interroge notre relation aux animaux non humains – revient ici sur les exemples historiques de procès d’insectes nuisibles et autres animaux criminels, quand la justice des hommes considérait les bêtes sujets de droit.
Décembre 2015. Devant le Tribunal administratif d’Orléans puis en appel devant le Conseil d’État, les juges ont décidé de la mort de Santino, chien de berger belge âgé de 8 ans, accusé d’avoir mordu des passants à plusieurs reprises au cours de l’année dans les rues d’Orléans. Dès le mois de mars, après deux morsures publiques, le maire de la ville avait déjà ordonné l’évaluation comportementale du chien, et son propriétaire n’avait que très imparfaitement répondu à cette injonction.
Temps de chien pour les gitans
C’est après deux nouvelles morsures en avril et septembre que Santino est placé en fourrière et que des vétérinaires se sont penchés plus longuement sur son cas. Le docteur Leseur conclut alors son étude sans concession en préconisant « une euthanasie dans les plus brefs délais » en raison de sa dangerosité. Le maire d’Orléans émet quelques semaines plus tard un arrêté ordonnant ladite euthanasie.
Exécuter un animal pour quelques morsures sur lesquelles il n’a jamais eu la possibilité de s’expliquer ? Son propriétaire, Sébastien, ne l’entend pas de cette oreille. La presse locale nous apprend qu’il se définit comme un « gitan », qu’il vit seul dans une caravane, et que sa relation avec son berger belge l’empêche de sombrer. Recevant le soutien d’une association locale d’aide aux sans-abris, Sébastien attaque le maire en justice.
La procédure permet aux juges de constater que le molosse Santino « n’a mordu, dans un but exclusivement défensif, que des personnes qui ont eu des gestes agressifs à l’égard de son propriétaire sans jamais se montrer menaçant pour de simples passants sur la voie publique ». Cette ligne de défense ne convainc toutefois pas la justice, qui s’en remet aux expertises vétérinaires et confirme finalement l’euthanasie.
Dans ce procès, l’animal n’a jamais été jugé : ce n’est pas lui qui a été renvoyé en justice. Il n’a à aucun moment été question pour Santino de faire valoir des arguments de défense – au besoin par l’intermédiaire d’un avocat. On a considéré son propriétaire comme celui qui a agi, au nom du droit de propriété dont il jouissait sur son chien. Le juge du Conseil d’État n’a pas manqué de relever que « le fait pour une autorité publique d’ordonner l’euthanasie d’un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété ». La question a donc été uniquement de savoir si cette atteinte au droit de propriété était ou non justifiée.
La cour des bêtes
Dans l’histoire ancienne de la jurisprudence, on trouve pourtant de nombreux exemples de procès où l’animal criminel est – en son nom propre pourrait-on dire – renvoyé devant la justice pour y répondre de ses actes. Quelques morsures ne suffisaient cependant pas à conduire une bête devant un tribunal, il fallait généralement un homicide.
La pratique des procès d’animaux a en effet été courante au Moyen-Âge, en Europe occidentale, et surtout en France. L’historien Michel Pastoureau a pu recenser une soixantaine de cas en hexagone, de 1266 à 1586, mais il semble qu’il y en ait eu bien davantage. Les archives de ces procès sont en effet assez rares et, pour nombre d’entre elles, endommagées. À cette époque, il s’agit en tout cas d’une pratique assez courante pour que la justice lui offre son autorité et sa solennité.
On peut diviser ces procès en deux grandes catégories. La première concerne ceux que nous appellerions aujourd’hui « civils » et qui se déroulent au Moyen-Âge devant les tribunaux ecclésiastiques. Les poursuites sont généralement déclenchées par les habitants d’un village en proie à des invasions d’animaux nuisibles aux récoltes, comme des criquets, des rats ou divers insectes. Les plaignants sont donc des groupes de paysans qui attaquent en justice ces animaux, lesquels ne sont pas individuellement accusés pour tel ou tel crime, mais collectivement poursuivis devant le juge. Dans cette première catégorie de procès, les plaignants, défendus par un avocat, demandent au tribunal d’excommunier les animaux, afin de les faire fuir.
On trouve également toute une série de procès de type « criminel » ou « pénal », se tenant devant les juridictions séculières médiévales, et ayant pour objet de punir tel ou tel animal pour le crime précis qu’on l’accuse d’avoir commis à l’encontre d’une victime identifiée. Cette seconde catégorie de procès semble être moins bien documentée que la première, et nous disposons d’assez peu de jugements et pièces judiciaires proprement dites. Les archives recèlent en revanche de nombreux documents comptables recensant les frais d’emprisonnement des animaux criminels et de leur exécution.
Les procès d’animaux criminels
L’affaire de la truie de Falaise, en Normandie, est probablement le procès d’animal criminel le plus connu. En 1386, une truie infanticide grimée en homme est suppliciée, puis pendue par les jarrets devant une foule nombreuse composée de villageois et de ses congénères porcins. Comme le rapporte Michel Pastoureau, le vicomte a en effet, « invité les paysans à venir y assister non pas seulement en famille, mais accompagnés de leurs porcs afin que le spectacle de la truie suppliciée ‘‘leur fasse enseignement’’ ».
L’histoire de Falaise nous est connue notamment grâce à la facture émise par le bourreau pour son travail :
« Quittance originale du 9 janvier 1386, passée devant Guiot de Montfort, tabellion à Falaise, et donnée par le bourreau de cette ville de la somme de dix sols et dix deniers tournois pour sa peine et salaire d’avoir traîné, puis pendu à la justice de Falaise une truie de l’âge de trois ans ou environ, qui avoit mangé le visage de l’enfant de Jonnet le Maux, qui était au bers et avoit trois mois et environ, tellement que ledit enfant en mourut, et de dix sols tournois pour un gant neuf quand le bourreau fit la dite exécution ; cette quittance est donnée à Regnaud Rigault, vicomte de Falaise ; le bourreau y déclare qu’il se tient pour bien content desdites sommes, et qu’il en tient quitte le roy et ledit vicomte. »
Cette histoire semble avoir été remarquable et, si d’autres animaux furent jugés au Moyen-Âge, ils n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une telle mise en scène, avec la volonté de donner figure humaine, par le déguisement, à la truie criminelle.
Une fois l’animal confondu pour son crime, celui-ci est généralement mis en prison dans l’attente de son procès, ce qui engendre aussi des frais. Ainsi, en 1403, Symon de Baudemont, un officiel du bailli de Mantes et Meullant, recense les frais engendrés « pour faire et accomplir la justice d’une truie qui avait dévoré un petit enfant ». Les dépenses dues à l’incarcération de l’animal s’élèvent à la somme de six sols parisis, le salaire du bourreau à cinquante-quatre sols parisis et ses gants ont coûté deux deniers parisis…
Peu après, en 1408, c’est le gardien des geôles de Pont de Larche qui fait ses comptes et indique que la nourriture fournie aux prisonniers et à un porc détenu avec eux dans l’attente de son procès a coûté dix-neuf sous six deniers tournois. Le porc en question avait été conduit en prison le 21 juin 1408 et y était resté jusqu’au 17 juillet suivant, jour où il est pendu, par application de la condamnation prononcée par le bailli de Rouen pour avoir tué un petit enfant. Le coût de la seule incarcération de l’animal s’élève, selon le comptable, à deux deniers tournois quotidiens pendant vingt-trois jours, soit quatre sols et deux deniers, sans compter le prix de la corde qui servit à lier le porc pour qu’il ne puisse s’enfuir de « ladite prison où il avait esté mis ».
Les exemples comptables pourraient encore être multipliés, sans qu’on ne sache précisément ce qui est en jeu dans ces procès. Mais le cas du porc infanticide de Moyenmoutier est beaucoup plus précis sur la question de la raison d’être de ce rituel judiciaire. Déjà mentionné par Edward P. Evans dans The Criminal prosecution and capital punishment of animals, publié en 1906, la spécificité de l’affaire de Moyenmoutier n’est véritablement relevée qu’un siècle plus tard par l’historien Laurent Litzenburger.
Dans cette commune des Vosges, en 1572, un porc est accusé d’infanticide : il a dévoré l’un des enfants de son propriétaire. L’originalité de l’affaire réside dans les questions que se sont posées les juges et gens de robes chargés d’instruire et de juger l’affaire. Et leurs réponses s’expriment dans une sentence qui précise la fonction sociale de ce procès. C’est en effet « afin que les père et mère prennent meilleur garde à leurs enfants que ledit porc doit être pendu et étranglé en une potence au lieu où l’on a coutume de faire semblable exécution ». Voilà donc une des fonctions de ces procès : avertir, dissuader.
Dans le cas de Falaise, on voulait édifier les autres porcs du village qui, par l’exemple de leur semblable traîné et pendu, vont sûrement à l’avenir éviter de manger des enfants. À Moyenmoutier, ce sont les parents que l’on souhaite éduquer : l’exemple est là pour leur dire de ne pas laisser traîner leurs petits.
De quoi rappeler l’affaire d’Orléans en 2015 évoquée plus haut, dans laquelle la justice semble signifier à Sébastien qu’il n’aurait pas dû laisser traîner son chien Santino ; l’exécution du chien de berger belge sonne pour son propriétaire comme une lourde punition, laquelle s’ajoute à celle qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de la même ville : pour les faits de morsure, Sébastien avait déjà été personnellement condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortis d’une obligation d’accomplir un travail d’intérêt général.
Cela souligne par comparaison un trait marquant des procès d’animaux au Moyen-Âge dans lesquels, comme le relève Michel Pastoureau, « le propriétaire de l’animal n’est jamais responsable pénalement. Quelquefois on lui demande d’accomplir un pèlerinage, mais en général la perte de son pourceau, de son cheval ou de son taureau apparaît comme une peine suffisante. Ce n’est pas l’homme qui est coupable mais la bête. »
On voit enfin ce qui a manqué aux truies criminelles pour éviter la peine capitale : un avocat. Si les accusés, dans certaines de ces affaires, ont pu bénéficier de l’assistance d’un « deffendeur », l’absence de détails à leur propos frappe dans les archives et textes qui nous sont parvenus. On ne sait pas comment, s’ils étaient présents, ils se sont acquittés de leur tâche. On ne sait pas s’ils furent efficaces, s’ils purent parfois éviter la mort à leurs clients… Ont-ils argué du caractère déraisonnable de l’animal accusé pour soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une sanction ?
Ainsi, dans ces procès, si l’animal était effectivement un sujet de droit pouvant être cité en justice, il ne semble guère qu’il ait pu faire valoir ses arguments et sa ligne de défense grâce à un avocat. On en sait autrement plus du déroulement des procès civils qui ont eu lieu à la même époque, quand les animaux étaient non seulement entendus, mais pouvaient même aller jusqu’à gagner ces affaires.
Les procès civils d’animaux nuisibles
Le procès des coléoptères de Saint-Julien-en-Genevois au XVIe siècle semble typique d’un grand nombre de procès du Moyen-Âge. Ce village de Haute-Savoie produit alors un vin d’une certaine réputation. Mais en 1545, ses vignes sont envahies par une armée de charançons verdâtres. Et pour faire face aux dommages causés par ces coléoptères, les habitants portent l’affaire en justice.
Une tentative de conciliation avec les insectes, menée en présence d’un juriste, ayant échoué, les villageois introduisent une instance devant un tribunal ecclésiastique dépendant de l’évêché. Par l’intermédiaire de leur avocat, ils demandent au juge l’excommunication des charançons. Mais la procédure devant être respectée en toutes circonstances, le juge désigne d’office un avocat et un procureur pour assurer la défense des insectes.
Ces derniers contestent alors la validité de l’expertise ordonnée par le juge pour examiner les ravages commis par leurs clients et invoquent leur droit à se nourrir des fruits de la terre, tant et si bien que le juge ecclésiastique rejette la requête des habitants. Refusant ainsi d’excommunier les animaux, il se contente, par une ordonnance du 8 mai 1546, de prescrire des prières publiques, sans oublier de rappeler à ses ouailles l’impérieuse nécessité de payer la dîme. Faut-il croire que ce regain de foi chez les Saint-juliennois a fait fuir les insectes ? Toujours est-il que les archives judiciaires ne portent pas trace d’une nouvelle plainte des habitants.
Ce n’est que quarante années plus tard que ces mêmes villageois – ou plus sûrement leurs enfants – durent affronter à nouveau une invasion de ravageurs. À problème similaire, réponse identique, et les représentants des habitants n’hésitent alors pas à solliciter la réouverture de l’instance de 1545, entre les mêmes parties et devant le même juge. Par l’intermédiaire d’un procureur – en fait, une sorte d’avoué –, ils déposent le 13 avril 1587 une requête entre les mains du révérend seigneur Vicaire Général et Official de l’évêché de Maurienne demandant l’expulsion des animaux par excommunication ou « toute autre due censure ecclésiastique ». Une première audience se tient un mois plus tard au cours de laquelle sont désignés un procureur et un avocat pour les insectes. Le juge exige aussi des villageois qu’ils exécutent l’ordonnance rendue quarante ans plus tôt.
Les archives du procès, exploitées au XIXe siècle par le magistrat Léon Ménabréa, en font état :
« Les syndics et les habitants, ayant à leur tête un clergé nombreux, firent processionnellement le tour des vignes, chantant des psaumes, se frappant la poitrine, et suppliant Dieu de les délivrer du fléau qui les accablait : le curé dressa procès-verbal du tout, et revêtit cette attestation de sa signature. »
Les prières ne semblant pas avoir porté leurs fruits, on décide donc de plaider l’affaire. L’avocat des insectes invoque alors le fait que ses clients sont dépourvus de raison et qu’ils ne peuvent, par conséquent, faire l’objet d’une procédure judiciaire non plus que d’une excommunication ou de toute ordonnance qui leur ferait obligation de déguerpir. Mais il va plus loin encore, citant la Genèse et rappelant leur droit fondamental à la vie, et donc à se procurer leur subsistance : « Les insectes actuellement en cause n’ont fait qu’user d’une faculté légitime en allant s’établir dans les vignes des demandeurs. »
Il faut croire que l’avocat des habitants du village était quelque peu embarrassé : attiré sur ce terrain, il se contente d’affirmer que c’est en considération de l’homme et eu égard à l’utilité qu’il peut en retirer, que les animaux ont été créés, et que les bêtes doivent donc être soumises à l’homme et lui obéir. Et il finit par se référer aux arguments écrits déposés par son prédécesseur qui, quarante années plus tôt, avait plaidé dans le même sens.
La situation paraissant bloquée, l’issue du procès incertaine, les habitants, finissent par écouter les conseils de leur avocat, et « furent d’avis d’offrir aux amblevins une pièce de terre située au dessus du village de Claret, dans un endroit connu sous le nom de la Grand’Feisse », tout en sollicitant le droit de conserver une servitude de passage et de s’y réfugier en cas de nécessité, « promettant à ces conditions de faire dresser en faveur des insectes ci-dessus nommés, contrat de la pièce de terre en question, en bonne forme et valable à perpétuité ».
C’est donc un contrat, une transaction mettant un terme à un procès, dirions-nous aujourd’hui, qui est proposé aux insectes. Mais l’avocat des coléoptères, procédurier au possible, « déclara ne pas vouloir accepter au nom de ses clients l’offre faite par les demandeurs, attendu que la localité offerte était stérile et ne produisait absolument rien ». Le juge ecclésiastique prend alors la décision de nommer des experts pour trancher le litige sur la qualité du terrain offert. Malheureusement, on ne saura jamais le résultat de cette expertise, car la dernière page des archives du procès a été abîmée par le temps – ou par des rongeurs solidaires des charançons – et la sentence reste donc inconnue.
L’histoire du procès des coléoptères de Saint-Julien n’est pas isolée et nombreux sont les communes et les villages qui, au Moyen-Âge, ont décidé de recourir aux tribunaux de l’Église pour obtenir gain de cause contre des animaux. Le fait qu’une telle procédure respecte scrupuleusement les règles de droit montre en outre que pour la plupart des intervenants au procès – habitants, avocats, juges –, il était du domaine du possible de poursuivre des animaux en justice et de leur donner une voix par l’intermédiaire d’un défenseur.
On trouve d’ailleurs un certain nombre de textes qui proposent des modèles de requêtes, de plaidoiries et même de jugements, pour traiter ce type de procédures. L’avocat Gaspard Bally, qui fut apparemment un fervent partisan de ces procès et qui semble plutôt favorable aux habitants, a publié des modèles dans son Traité des monitoires, avec un plaidoyer contre les insectes en 1668. Un des points de droit litigieux de cette controverse consiste à débattre de la manière dont les animaux doivent être cités devant le tribunal. Dans le procès des rats d’Autun, en 1517, Léon Ménabréa rapporte que le fameux juriste Barthélemy de Chasseneuz défend ainsi ces bêtes :
« Quoique les rats eussent été cités selon les formes, il fit tant qu’il obtint que ses clients seraient derechef assignés par les curés de chaque paroisse, attendu, disait-il, que la cause intéressant tous les rats, ils devaient tous être appelés. Ayant gagné ce point, il entreprit de démontrer que le délai qu’on leur avait donné était insuffisant ; qu’il eût fallu tenir compte non-seulement de la distaqnce des lieux, mais encore de la difficulté du voyage, difficulté d’autant plus grande, que les chats se tenaient aux aguets et occupaient les moindres passages… »
Cette objection fondée sur le caractère déraisonnable des animaux jugés pouvait conduire les habitants à abandonner leur procès ou à juger les bêtes par contumace. S’engageait enfin, après avoir tranché les questions de procédure, le débat sur le fond du litige, et les défenseurs des habitants arguaient, comme le suggère Gaspard Bally, « qu’on ne peut pas punir un furieux et insensé du crime qu’il a commis pendant sa fureur, parce qu’il ne sait ce qu’il fait, toutefois on le pourra renfermer, et mettre dans des prisons, afin qu’il n’offense personne ». Et c’est en dernier lieu au nom de « la puissance que Dieu a donné à l’Église, l’ayant fait Maîtresse de tout l’Univers » qu’on prétendait que les bêtes pouvaient être frappées d’anathème, voire d’excommunication.
Il est en effet rappelé aux habitants que les périls auxquels ils font face du fait de l’invasion des animaux sont dus à leurs péchés. La conclusion coule donc de source : il leur appartient de se morfondre en dévotions, sans oublier de payer la dîme. Et, comme la longue durée de la procédure judiciaire a accompagné une disparition naturelle des ravageurs, tout le monde est convaincu de la puissance du juge ecclésiastique dont les anathèmes semblent les avoir fait fuir.
Dans ces procès, les animaux n’en demeurent pas moins de véritables sujets de droit. Les arguments avancés pour leur défense – même s’ils sont fondés sur leur absence de raison – sont entendus, par la partie adverse qui doit contre-attaquer en prenant en considération ces arguments, et par le juge qui doit rendre une décision sans ignorer les moyens de défense des insectes.
Avocat des bêtes ?
Les procès civils et criminels d’animaux apparaissent donc au Moyen-Âge comme un moyen de répondre à une question qui troublait l’ordre social. Si ces deux catégories semblent partager cette caractéristique commune, les procès de nature civile entre des villageois et des insectes peuvent durer des semaines, voire des mois, alors que les procès des animaux criminels sont conclus en quelques jours, l’exécution ayant lieu immédiatement.
Ces différences – sur la durée, le rôle de la défense, la nature de la juridiction et de la procédure – laissent penser que la fonction de ces procès n’était pas la même. Pourtant, ils partagent une croyance : celle de la légitimité de la justice – ecclésiastique ou séculière – pour se prononcer sur le sort d’animaux qui ont commis des torts à l’humanité. Pendant des siècles, il est ainsi tout à fait banal d’organiser des procès, de respecter des procédures, d’exécuter des sentences, de se référer au droit ou à la Bible pour juger des animaux.
Cette « normalité », aujourd’hui, étonne. Les historiens ont assez récemment tenté de l’expliquer. Et l’on a pu dire qu’il s’agissait d’une survivance des superstitions populaires, ce qui ne semble pas prendre en compte le fait que des gens de justice, considérés comme sérieux, donnaient leur imprimatur à ces procédures. Il a été dit que le but n’était pas, dans les procès criminels, de punir les animaux, mais leurs propriétaires coupables de négligence. En ce cas, il n’était pas nécessaire d’organiser un procès : une simple exécution eût suffi. D’autres encore invoquent la cupidité des seigneurs qui pouvaient retirer des bénéfices de l’organisation des procès…
Après avoir rappelé ces différentes hypothèses, l’historien Laurent Litzenburger propose de façon plus convaincante de penser ces procès « comme un mécanisme de protection des sociétés ». Face à des maux contre lesquels on ne sait lutter et qui surviennent spontanément sans qu’on puisse en réduire le risque, les procès constituent « la seule réponse collective qui est envisageable face à ce type de difficulté. Ces pratiques permettent alors de rationaliser l’indicible en redonnant l’initiative à l’homme ».
S’agissant plus précisément des procès civils de groupes d’animaux ravageurs, l’écrivain Jean Réal pense que le temps de la justice permet aux hommes de patienter : « les quelques semaines, ou mois, que durait la procédure étaient le temps nécessaire au rééquilibrage de la nature : les souris finissaient par disparaître avec l’hiver, les chenilles avec l’été, les criquets avec l’automne ».
Ces explications peuvent paraître convaincantes, mais semblent minimiser ce qu’on pourrait appeler le point de vue de l’animal. Car lorsqu’il est sujet de droit – comme dans ces procès – l’animal est plus qu’un nuisible ou un ennemi criminel : il est un être vivant auquel les humains accordent un profond respect en lui offrant procédures et avocats.
En 2015 à Orléans, un chien a été exécuté après un procès dans lequel il n’était pas partie. C’est pourtant cette même année que le Code civil a connu une petite révolution : son nouvel article 515-14, issue de la loi du 16 février 2015, affirme désormais que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
Cette modification veut dire très clairement que les animaux ne sont plus des biens, mais pas encore des personnes. Cette « sensibilité » que leur reconnaît la loi n’est pas une subjectivité juridique leur permettant d’agir en justice. Mais pourrait-on imaginer à l’avenir qu’au nom d’une vision élargie de cette sensibilité, les défenseurs des animaux tentent de faire valoir les droits de ces derniers devant un tribunal ?
Sources :
Émile Agnel, Curiosités judiciaires et historiques du Moyen Âge – Procès contre les animaux, Paris, Dumoulin, 1858.
Conseil d’État, Juge des référés, 11 décembre 2015, nº 395008, affaire « Santino ».
David Chauvet, La personnalité juridique des animaux jugés au Moyen Âge (XIIIe – XVIe siècles), Paris, L’Harmattan, 2012.
Peter Dinzelbacher, « Animal Trials: A Multidisciplinary Approach », The Journal of Interdisciplinary History, vol. 32, nº 3, p. 405, 2002.
Edward P. Evans, The Criminal prosecution and capital punishment of animals, Londres, William Heinemann, 1906.
Jen Girgen, « The Historical and contemporary prosecution and punishment of animals », Animal Law Review, vol. 9, p. 97, 2003.
Laurent Litzenburger, « Les procès d’animaux en Lorraine (XIVe-XVIIIe siècles) », Criminocorpus, https://criminocorpus.revues.org/1200, 2011.
Jean-Pierre Marguénaud, « Une révolution théorique : l’extraction masquée des animaux de la catégorie des biens », La Semaine Juridique Edition Générale nº 10-11, 2015, doctr. 305.
Léon Ménabréa, De l’Origine, de la forme et de l’esprit des jugements rendus au Moyen Âge contre les animaux, avec des documents inédits, Chambéry, Puthod, 1846.
Michel Pastoureau, « Les procès d’animaux – Une justice exemplaire ? », in Une histoire symbolique du Moyen Âge occidental, Paris, Seuil, 2004.
Jean Réal, Bêtes et juges, Paris, Buchet/Chastel, 2006.
Charles Sadoul, « Les procès contre les animaux – Condamnation des souris à Contrisson en 1733 », Le Pays lorrain, nº 12-227, p. 529, 1925.