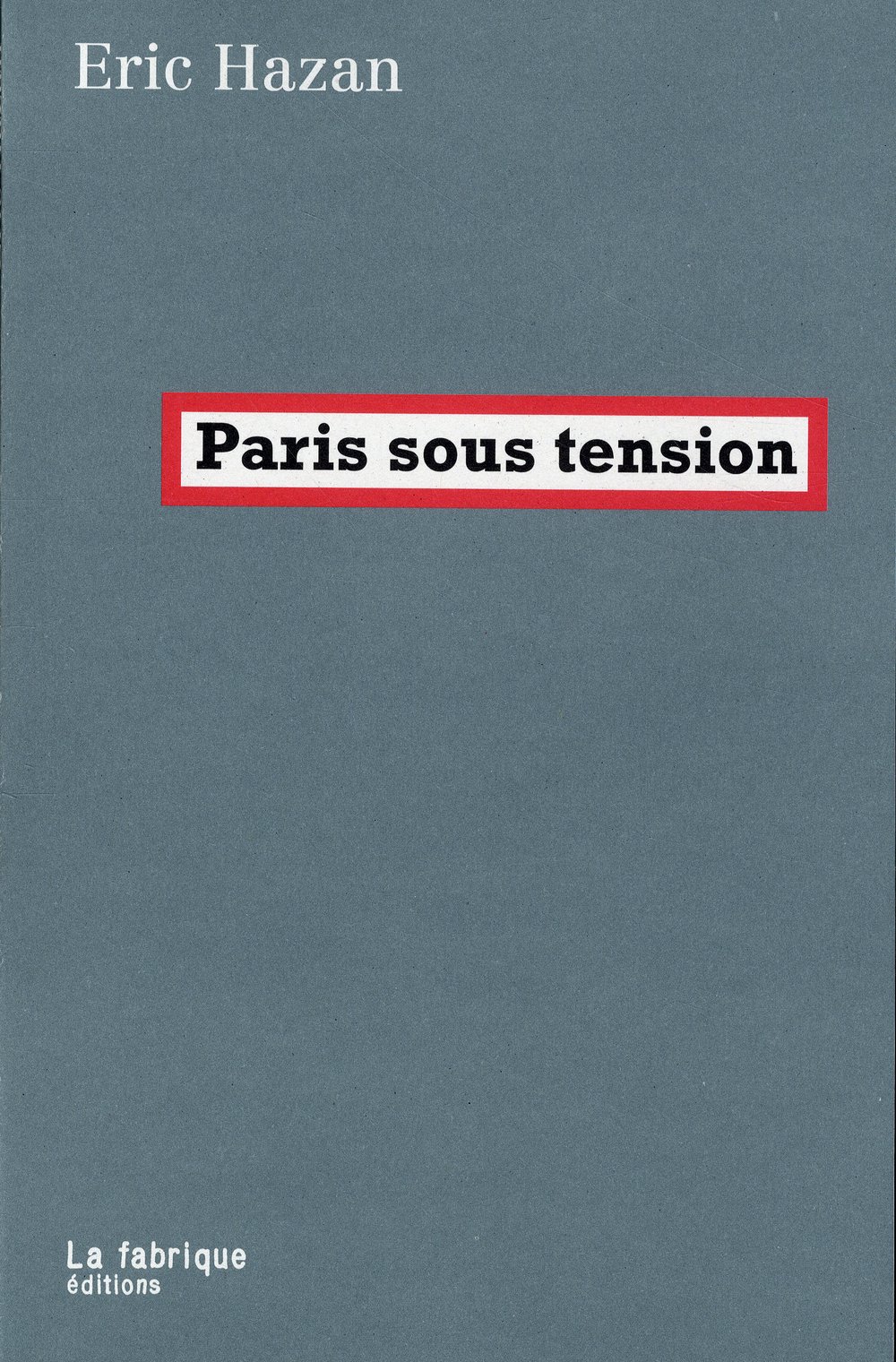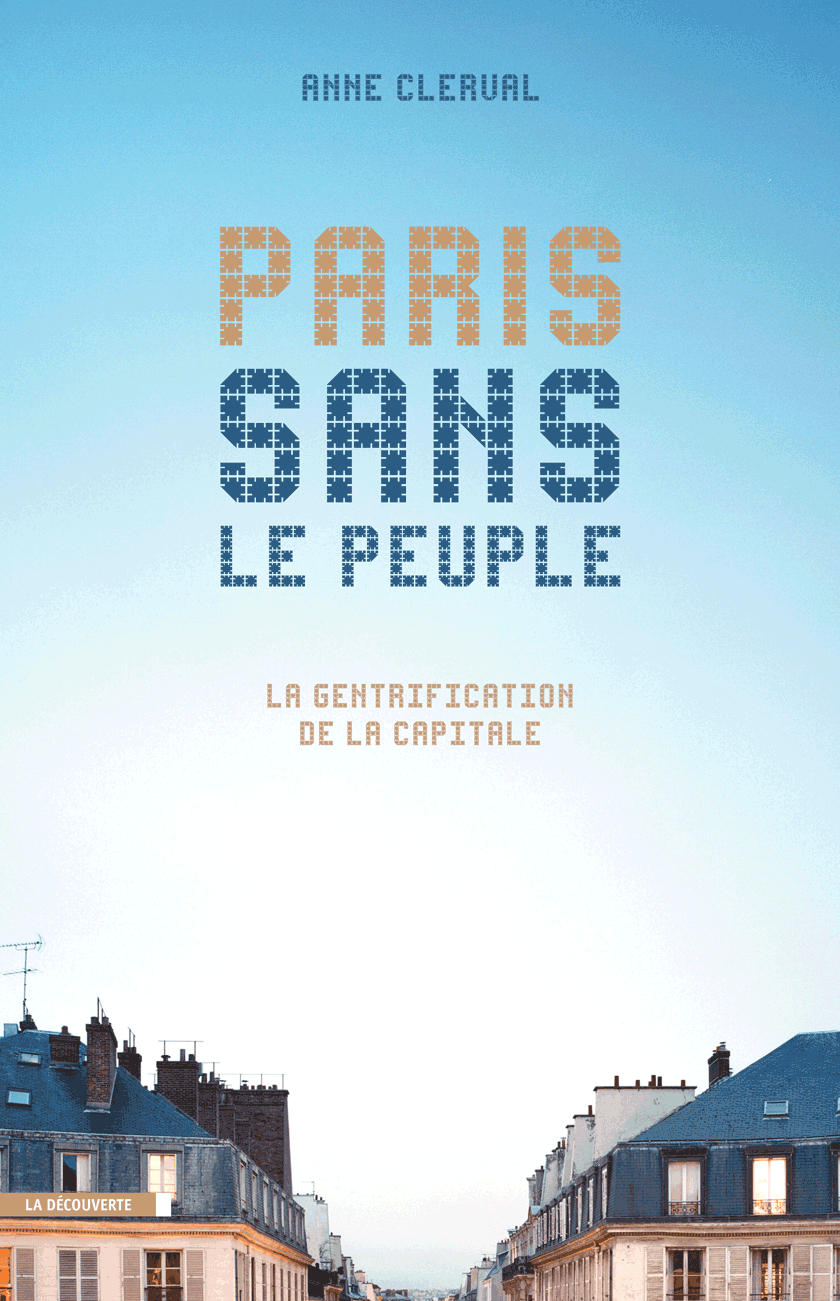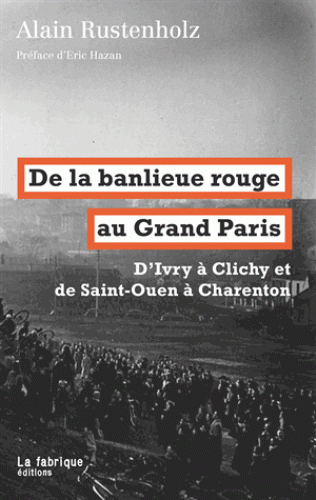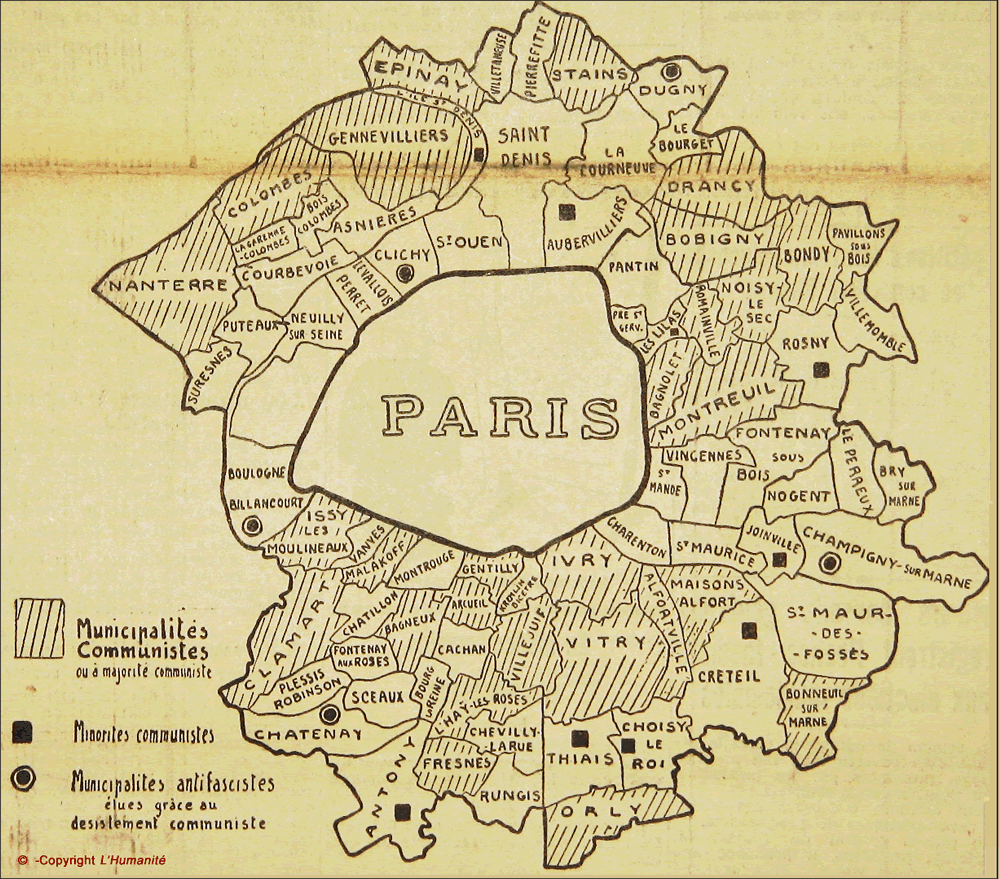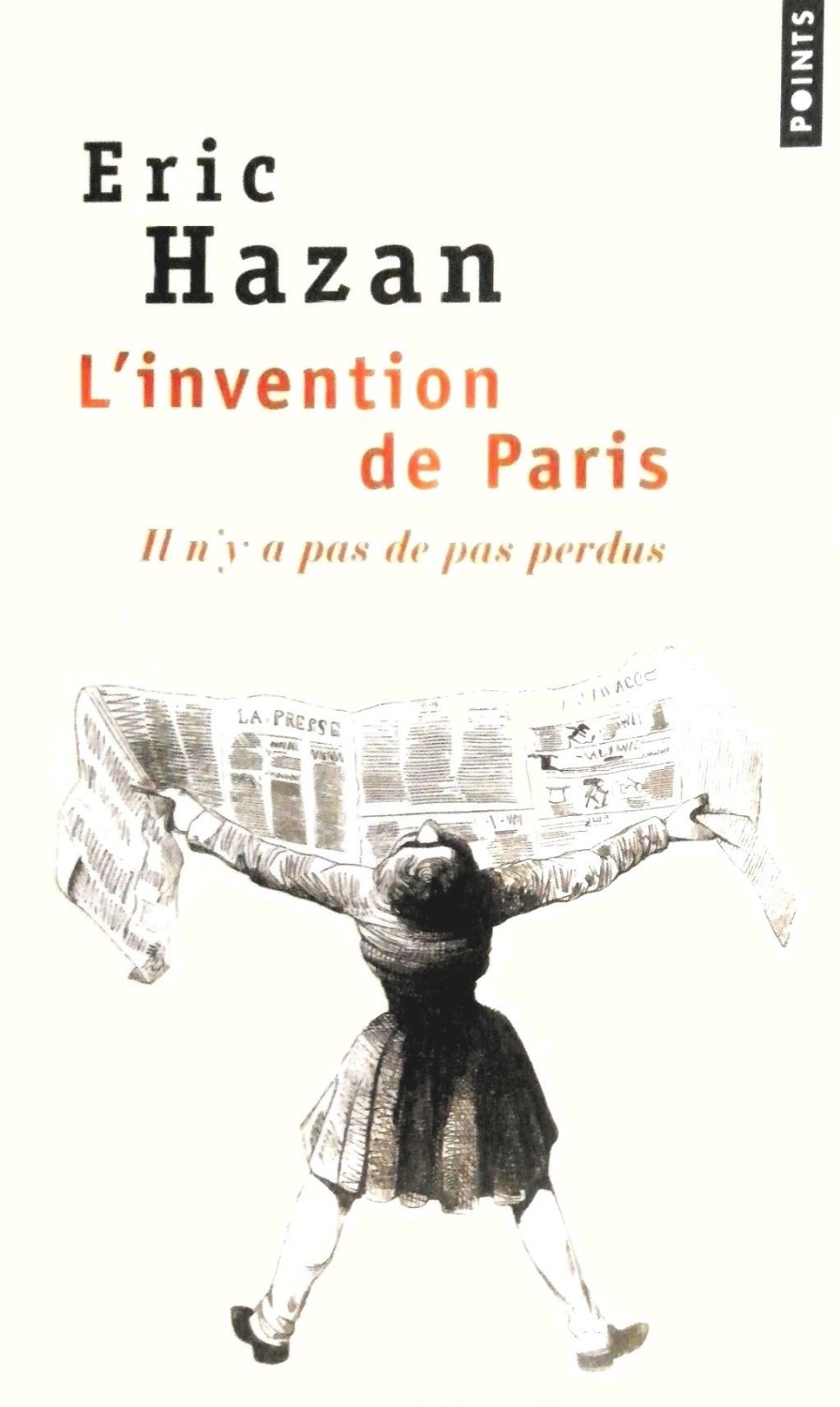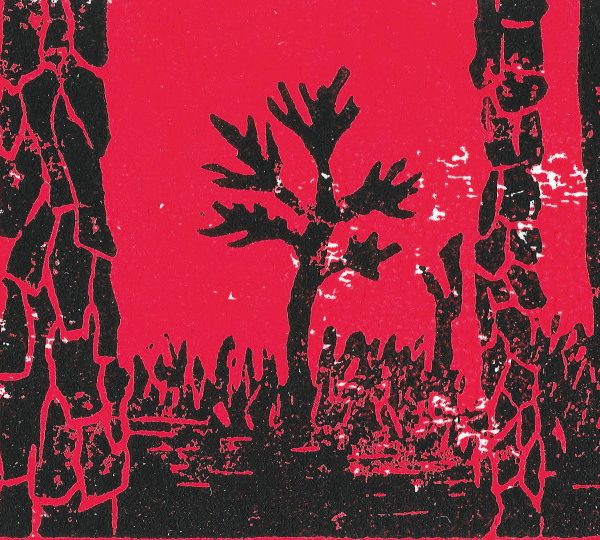Comment Paris s’est-elle transfigurée au cours des derniers siècles pour finir vidée de ses habitants les plus pauvres, emportant avec eux les amorces de mutuellisme et de solidarité populaire qu’ils avaient élaborés ? Comment s’est jouée en détail la gentrification depuis Belleville jusqu’aux couronnes qui entourent la capitale ? Que laissent présager les projets urbanistiques du Grand Paris en termes de nouveaux déplacements de populations, mais aussi de rapports de forces à réinventer ?
Entretien croisé avec Anne Clerval, géographe auteure de Paris sans le peuple aux éditions de La Découverte (2013) et Eric Hazan, auteur de L’invention de Paris (Seuil, 2002), Paris sous tension (La Fabrique, 2011) et plus récemment La dynamique de la révolte (La Fabrique, 2015). Eric Hazan est par ailleurs le fondateur des éditions La Fabrique qui viennent de publier un précieux travail sur l’histoire ouvrière de Paris d’Alain Rustenholz : De la banlieue rouge au Grand Paris (2015).
Quelles sont les grandes politiques urbanistiques qui ont transformé le Paris populaire en le détruisant ? Comment peut-on se figurer aujourd’hui ce qu’a pu être ce Paris populaire ?
Eric Hazan : Le grand moment de bascule date des années Malraux-De Gaulle-Pompidou. Avant, on ne construisait pas grand-chose dans Paris. Les premiers coups ont été portés dès le début des années 1960 dans les « quartiers rouges », le 13e et le haut du 20e, qui avaient le tort de voter communiste. L’opération Malraux 1 a eu un énorme impact sur les quartiers populaires : on a tout blanchi, tout rénové, et du coup les loyers ont massivement augmenté ; la population a changé. Dans les années 1950, le Marais que j’ai connu était un quartier noir de suie, sale et pauvre. Les hôtels historiques étaient en pleine décrépitude. Les cours étaient encombrées de charrettes à bras et d’appentis en tôle. Le quartier juif – la rue des Rosiers, la rue Ferdinand-Duval, la rue des Écouffes – était misérable. C’était d’ailleurs un phénomène ancien : dans Le cousin Pons, Balzac décrit déjà la décadence du Marais, depuis sa splendeur au XVIIe siècle, du temps de Madame de Sévigné. Sous Henri IV, sous Louis XIII, pendant la Fronde, le Marais était le centre politique et intellectuel du pays. Et puis, vers la fin du XVIIe siècle, la noblesse et la haute bourgeoisie en ont eu assez de ces rues étroites et sans lumière et ont émigré vers l’Ouest, où ils ont fait construire le faubourg Saint-Germain. Tout ce beau monde est parti vers les quartiers aérés, et le Marais est tombé en déshérence.
Je pense aussi à la Montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement, dont l’histoire est bien décrite dans Paris insolite de Jean-Paul Clébert 2. J’ai vécu dans cette rue dans les années 1960 : le quartier était un domaine de clochards, qui faisaient leur toilette sur la petite fontaine en face de ce qui était l’École Polytechnique, dominant la place de la Contrescarpe.
Les années Pompidou ont davantage transformé Paris que l’ère Haussmann. Certes, Haussmann a commis deux crimes urbanistiques impardonnables : il a détruit l’île de la Cité et ses dix-sept églises pour en faire un désert où règnent le sabre – la Préfecture de Police –, le goupillon et le bistouri avec l’Hôtel-Dieu. Il a creusé un immense trou dans le quartier turbulent du Temple, trou qui est devenu la place de la République. Récemment, on a bien essayé de la ressusciter, mais d’un trou on ne peut pas faire une place. Cela dit, ailleurs, Haussmann faisait attention à limiter les dégâts. La percée emblématique du boulevard de Sébastopol a évidemment démoli une partie du quartier, mais de part et d’autre, à 50 mètres, on a la rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis à peu près intactes. L’urbanisme de Haussmann ne visait pas à détruire des quartiers, mais à créer des axes de circulation, avec un objectif militaire évident : de la caserne de la place de la République (du Château-d’Eau à l’époque), on pouvait faire partir la cavalerie et l’artillerie dans toutes les directions, aussi bien vers Montmartre que vers Belleville.
Avec Pompidou, cet aspect militaire de l’aménagement urbain disparaît ?
Anne Clerval : Sous Haussmann, on est en plein boom industriel. Il y a un afflux énorme de ruraux et d’immigrants qui viennent renforcer la classe ouvrière parisienne. Quand, un siècle plus tard, Pompidou intervient, ce n’est pas du tout le même contexte : la désindustrialisation commence, le tissu d’activités se relâche. La réorganisation de la production a été un mouvement lent et progressif, mais elle a contribué à évincer de Paris les classes populaires. Pompidou est un accélérateur de ce phénomène, mais on y avait déjà pensé avant. Il y a une citation dans le livre d’Eric Hazan (L’invention de Paris), qui remonte aux années 1850 : « Paris n’a pas besoin de posséder en son sein tant de manufactures, tant de grandes usines. La destination de notre capitale, c’est d’être une ville de luxe et de plaisir. » (Auguste Chevalier) 3. Cela permet de comprendre l’édification des grands magasins sous Haussmann, mais les quartiers de misère ont continué d’exister, alors qu’ils furent peu à peu évincés sous Pompidou.
Or ces quartiers étaient tenus par un tissu social riche de sens, caractérisé par une forte interconnaissance locale et par des pratiques quotidiennes d’entraide et de solidarité (ce qui n’empêchait pas malgré tout les concurrences et les rapports de force, y compris violents). C’est ce tissu social qui a servi de creuset pour la politisation du peuple parisien. Du mouvement des associations ouvrières des années 1840 (associations de consommateurs permettant de baisser le prix d’achat des biens de première nécessité, et associations de producteurs qui sont les premières formes des coopératives) est né une multitude d’organisations collectives ouvrières dans la deuxième moitié du XIXe siècle. En plus des syndicats de travailleurs (légalisés en 1884), la vie quotidienne des ouvriers s’organise en marge du capitalisme – à travers les sociétés de secours mutuel, les coopératives d’achat, les cantines populaires autogérées (notamment inspirées du « mutuellisme proudhonien »). Les quartiers populaires parisiens, comme dans d’autres villes industrielles telles que Barcelone un peu plus tard 4, ont amorcé des pratiques d’auto-organisation sur une base de classe, qui donnaient corps au quotidien à une perspective révolutionnaire socialiste non autoritaire 5.
Outre les entraves et la répression qu’ont connues ces pratiques d’auto-organisation ouvrière au XIXe siècle, la désindustrialisation, et avant elle, l’atomisation des lieux et des collectifs de travail, ainsi que la rénovation urbaine pompidolienne ou l’éviction d’une partie du peuple parisien en banlieue, tous ces facteurs ont convergé vers l’affaiblissement de ces pratiques. De ce point de vue, la préoccupation sécuritaire (à des fins contre-révolutionnaires) n’a jamais disparu des politiques d’urbanisme, même si elle s’est euphémisée ou masquée. Mais l’hygiénisme est toujours à la fois sanitaire et moral, donc éminemment politique.
C’est tout ce tissu social et ces pratiques d’auto-organisation qui faisaient un quartier populaire et dont on ne retrouve que des traces dans ceux d’aujourd’hui, à travers des formes de solidarité quotidienne, des pratiques économiques autonomes, y compris illégales, dans un contexte de chômage de masse, et des associations locales, qui ne sont d’ailleurs pas toujours tenues par les classes populaires elles-mêmes.
EH : Mais pas intra-muros.
AC : Intra-muros, il y a encore aujourd’hui des formes de solidarités populaires, par exemple sur la base de l’origine nationale ou régionale des migrants (comme les Chinois de la région de Wen Zhou dans le 3e arrondissement et à Belleville). Ces formes de solidarité, non exemptes d’exploitation entre migrants de la même origine, permettent notamment aux commerçants chinois de réunir les sommes nécessaires à l’achat de commerce et la force de travail requise (en général fondée sur l’exploitation de la famille) pour faire tourner ce commerce. Comme on le voit dans cet exemple, il ne s’agit plus de formes de solidarités qui pouvaient se poser volontairement en rupture ou en marge du capitalisme et qui visaient l’abolition des rapports de classes. Cela n’est pas directement lié aux politiques d’urbanisme qui ont transformé les quartiers populaires, mais au contexte politique qui n’est plus le même, notamment en termes de mobilisation des classes populaires.
La désorganisation de la classe ouvrière est due à de multiples facteurs comme la réorganisation du travail sur un mode flexible, la désindustrialisation, la crise de la reproduction ouvrière à travers la massification scolaire, celle de la représentation ouvrière, elle-même liée à l’évolution bureaucratique des principaux syndicats, aux trahisons électoralistes des partis politiques sociaux-démocrates, et à l’histoire nationale et internationale du communisme autoritaire. Cette désorganisation a aussi une dimension spatiale, à travers la diversité de trajectoires résidentielles au sein des classes populaires entre les trajectoires des immigrés en France (nombreuses discriminations au logement qui confinent les primo-arrivants au logement privé dégradé ou sans confort et les cantonnent ensuite dans certains segments dévalorisés du parc social), celles des fractions stables des classes populaires (y compris immigrées ou issues de l’immigration) qui peuvent accéder à la propriété de plus en plus loin du centre, et celles des locataires du parc privé, souvent repoussés en périphérie par la hausse des prix immobiliers. Or ces trajectoires résidentielles sont de plus en plus contraintes par les pouvoirs publics 6.
De telles divisions, exploitées de toutes parts, s’inscrivent aussi dans l’espace : ce sont des gens qui n’habitent pas forcément les mêmes quartiers ; par ailleurs, habiter un pavillon de banlieue, un grand ensemble d’habitat social ou un petit appartement parisien, ce n’est pas la même chose. Ce sont des clivages très forts. Ce n’est pas ce qu’on observait dans le Paris ouvrier. Certes, le peuple de Paris était composite, fait d’ouvriers de divers secteurs, d’employés du commerce et de domestiques mais aussi d’artisans et de petits commerçants indépendants, sans compter la diversité des origines géographiques. Pourtant, par la cohabitation dans les mêmes quartiers, par la diffusion des pratiques quotidiennes de solidarité et d’auto-organisation, et par la mobilisation politique, il y avait une vraie cohésion de cet ensemble hétérogène.
Aujourd’hui, quel est le rôle des pouvoirs publics dans la transformation urbaine et sociale de Paris, notamment celle des quartiers populaires ?
AC : Je ne crois pas que les choses aient été « planifiées » en région parisienne : le processus de gentrification, c’est-à-dire l’embourgeoisement des quartiers populaires par la transformation matérielle du quartier (notamment de l’habitat), est avant tout lié au marché immobilier privé et à la réhabilitation des logements par des ménages ou par des promoteurs, avec l’aide des banques (notamment à travers la baisse des taux des prêts immobiliers permettant la diffusion de l’accession à la propriété dans les classes intermédiaires). L’agrégation de tous ces facteurs a bien plus transformé les quartiers populaires de Paris que les politiques de rénovation urbaine des années 1970-1980. Disons simplement que les pouvoirs publics peuvent être des facilitateurs à certains moments.
À Paris, ils ont mis un certain temps à comprendre qu’il y avait une opportunité pour eux à soutenir ce processus. Jusqu’au milieu des années 1980, ce sont même des mesures de réglementation des loyers comme la loi de 1948 (qui encadrait strictement les loyers dans les logements construits avant cette date) qui ont freiné la gentrification. Jusqu’à la libéralisation des loyers par la loi Méhaignerie de 1986, redéfinie par la loi Malandain-Mermaz de 1989, la spéculation immobilière passait surtout par la démolition d’un immeuble entier et son remplacement par un immeuble neuf où les loyers étaient libres. On voit bien ce type de résidences privées haut de gamme des années 1970 dans le 15e arrondissement ou le long du canal Saint-Martin (10e) par exemple. Dans les années 1980, des ménages de la petite bourgeoisie intellectuelle ont commencé à accéder à la propriété dans des logements anciens des quartiers populaires qu’ils ont fait réhabiliter. La libéralisation des loyers et l’augmentation qui en a découlé, parallèlement à la baisse des taux des prêts immobiliers, ont accéléré ce processus. Ce faisant, ils valorisaient, symboliquement et financièrement, les logements anciens, même dans un tissu urbain de piètre qualité comme celui qu’on dit « faubourien ».
Or, dans le même temps, les pouvoirs publics (l’État, puis la mairie à partir des lois de décentralisation de 1982-1983) ont mené une politique de rénovation urbaine, c’est-à-dire de démolition/reconstruction d’îlots entiers, dits insalubres depuis la fin du XIXe siècle, et dont on considérait que le tissu urbain n’avait aucune valeur. La rénovation au bulldozer côtoyait déjà la patrimonialisation de tissus urbains « nobles » comme le Marais ou le faubourg Saint-Germain (préservés et réhabilités suite à la loi Malraux de 1962). C’est assez tardivement par rapport aux débuts du processus de gentrification que les pouvoirs publics ont compris que le tissu urbain populaire, faubourien, pouvait lui aussi favoriser l’accumulation de la rente foncière.
En 1995, le nouveau maire de Paris, Jean Tiberi (RPR) abandonne officiellement la politique de rénovation pour des raisons d’abord liées à des rapports de forces politiques (six arrondissements du Nord-Est parisien étaient alors passés à gauche). Le faubourg Saint-Antoine est un bon exemple de ce virage : jusqu’ici, les plans d’urbanisme prévoyaient de détruire les cours intérieures utilisées par l’artisanat du bois, pour reconstruire en ouvrant de nouvelles rues ou en comblant les parcelles. À partir de 1995, un plan d’occupation des sols spécial est mis en place pour préserver ces cours. Ce tissu urbain est ainsi revalorisé, c’est-à-dire les formes urbaines, mais pas le tissu social – car l’artisanat du bois est mourant et les classes populaires ont déjà commencé à partir, du fait de la hausse des loyers. On a donc préservé la forme, les cours artisanales, mais il n’y a plus d’ouvriers ni d’artisanat du bois, seulement des plaquettes publicitaires et un guide Gallimard sur l’histoire du quartier. Cette histoire n’est plus vivante, elle n’est plus qu’une queue de comète, une trace de ce qu’ont emporté la réorganisation mondiale de la production de ces trente dernières années et la nouvelle division internationale du travail.
Néanmoins, la rénovation urbaine s’est en fait poursuivie dans les quartiers de friches industrielles de l’Est parisien comme les ZAC Bercy (12e arrondissement) et Rive gauche (13e). Elle est encore à l’ordre du jour, dans le nord de Paris cette fois, avec le vaste projet de reconversion urbaine « Paris Nord-Est », le long du périphérique, à cheval sur les communes de Paris et d’Aubervilliers. Il s’agit de créer un nouveau pôle d’affaires dans un quartier de logements sociaux. L’originalité consiste à changer complètement la nature du quartier sans détruire pour l’instant les logements sociaux. On commence par construire des bureaux pour des cadres, des commerces destinés à cette nouvelle clientèle et des logements privés neufs (par des promoteurs immobiliers qui récupèrent l’augmentation de la rente foncière) et même un peu de nouveaux logements sociaux (dont une partie pour les classes moyennes). On modifie le quartier non pas en déplaçant les gens, mais en changeant l’équilibre de la composition sociale du quartier, ce qui transformera à terme la norme dominante dans l’espace public. Il s’agit d’une opération de gentrification planifiée par la reconversion d’anciennes friches industrielles et la démolition/reconstruction.
Dans le cadre de friches industrielles de l’ampleur de l’ancien entrepôt Macdonald, situé dans l’ancienne zone des fortifications de Paris où les logements sociaux dominent, le risque financier est trop important pour qu’un opérateur privé se lance dans l’opération. D’où l’appui des pouvoirs publics, à la fois pour récupérer les terrains, assumer le risque financier, notamment durant le temps important nécessaire à l’opération, et piloter le projet d’aménagement (en concertation étroite avec les investisseurs privés). Mais l’opérateur principal du projet Paris Nord-Est est BNP-Paribas, déjà auteur de la reconversion en bureaux (pour une de ses filiales financières) des anciens Moulins de Pantin le long du canal de l’Ourcq. Ce projet est révélateur d’un changement d’échelle de la gentrification : l’acteur principal n’est plus l’accédant à la propriété de classe intermédiaire mais un grand groupe financier de rang international. Et ce changement d’échelle s’appuie sur l’intervention publique.
Même s’il est difficile de généraliser pour ce qui concerne la banlieue, chaque municipalité menant sa propre politique, on constate qu’il y a souvent un appui public à l’augmentation de la rente foncière dans des quartiers populaires où elle était jusque-là sous-évaluée (extension d’une ligne de métro, projet urbain sur une friche industrielle comme les Docks de Saint-Ouen par exemple). À Montreuil, Bagnolet, Aubervilliers ou Saint-Denis, le Plan national pour la rénovation des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), une aide publique à la réhabilitation privée, a été un facteur déterminant. De tels plans sont des accélérateurs, ils permettent notamment de mettre dehors de petits propriétaires qui n’ont pas les moyens de faire des travaux, ou de virer les occupants sans-titre.
Pour bien se repérer, quelle définition pourriez-vous donner des notions de « tissu urbain » et de « tissu social » ? Quelles différences et imbrications mutuelles comportent-elles ?
AC : À mon sens, le « tissu urbain » désigne le bâti d’une ville, habitat, équipements, bâtiments d’activité, espace public et notamment réseau viaire. La métaphore du tissu rappelle que cela forme un tout, auquel l’histoire confère une certaine cohérence (ou incohérence pour les tissus dits hétéroclites et entrecoupés de ce qu’on nomme des « coupures urbaines », voie de chemin de fer ou autoroute par exemple, qui entravent la circulation piétonne d’un endroit à un autre). Mais cette image du tissu renvoie aussi à la représentation organique de la ville comme s’il s’agissait d’un être vivant. Cette représentation de la ville comme un organisme est discrètement réactionnaire : elle justifie les hiérarchies sociales (il y a une tête qui ordonne et des membres qui exécutent) et, plus généralement, naturalise les inégalités sociales qui se manifestent dans l’espace urbain. Les dysfonctionnements de la ville qui en découlent sont considérés comme des maladies : on parle de métastases urbaines, de thrombose des axes de communication. Et on peut continuer de filer la métaphore avec la médecine et la chirurgie : plutôt que de remettre en cause le mode de production capitaliste de la ville, il s’agit de la soigner, s’il le faut avec l’aide du bistouri (comme le dit l’historien Louis Chevalier dans L’assassinat de Paris7). Il faut donc être vigilant quant à l’emploi de ce terme, notamment quand il est utilisé à la place de tissu social, charriant l’idée fausse selon laquelle on pourrait régler les questions sociales par une intervention sur l’espace urbain.
La notion de « tissu social » renvoie aux personnes qui vivent dans cet espace (pour ce qui nous occupe ici) et à l’ensemble des rapports sociaux qui les relient et les divisent. La gentrification a comme caractéristique de transformer à la fois le tissu urbain et le tissu social, révélant ainsi leur interaction.
EH : J’entends bien le danger du mot « tissu », si on le prend au sens de partie d’un corps vivant : ça tendrait à faire de la ville un organisme. Moi, je l’emploie au sens textile : une ville, ça se tricote, ce qui signifie d’une part lenteur – pour faire le beau centre d’Ivry, Renaudie a mis plus de vingt ans 8 – et d’autre part échelle réduite. Les bonnes opérations d’urbanisme sont de petite taille, avec comme ancêtre l’axe Place Dauphine-Pont-Neuf-rue Dauphine, première opération d’urbanisme concerté à Paris.
Les différentes étapes de gentrification qui ont commencé dans les années 1980, au faubourg Saint-Antoine puis à Belleville, se sont-elles faites en douceur ?
EH : Au début des années 1990, il y a eu une résistance organisée autour de l’association La Bellevilleuse, dans le bas-Belleville. Le processus de démolition était pourtant bien engagé, avec l’ensemble du Nouveau-Belleville, la rue du Pressoir, le long du boulevard de Belleville – qui est un désastre urbanistique total. L’idée de base était que tout le bas du quartier, entre la rue des Couronnes et la rue de Belleville devait être détruit. Et là, on a connu une résistance, pas extrêmement structurée, mais qui a rassemblé les gens du quartier, jusqu’à l’abandon du projet, il y a 10 ou 15 ans. Récemment, tout le monde s’attendait à ce que soit détruit le petit immeuble à l’angle de la rue Ramponneau et du boulevard de Belleville, un relais de poste du XVIIe siècle en quasi ruines. Sous la pression du quartier, je pense, il a été retapé, et pas si mal. Aujourd’hui, il existe donc une sorte de résistance informelle, qui reste relativement efficace.
AC : Ce qu’il est néanmoins important de relever dans cette histoire, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une lutte contre la gentrification, mais contre la rénovation. La victoire a consisté à arrêter le projet de démolition/reconstruction. Mais ceux qui ont mené cette lutte étaient les premiers gentrifieurs de Belleville, c’est-à-dire des gens qui avaient acheté et investi dans ce quartier très populaire, parfois délabré. Ils risquaient d’être expropriés et ont voulu défendre leur bien. Comme ils étaient de gauche, ils ont eu l’intelligence de tenir un discours sur la mixité sociale et sur l’importance de maintenir sur place tous les habitants pour préserver le quartier. Il y avait donc un double discours, non pas ambivalent, mais sur deux axes : la préservation du tissu urbain d’un côté et le maintien de la population sur place, du tissu social, de l’autre. Les arguments sur le tissu urbain ont fait mouche ; le 20e arrondissement est passé à gauche en 1995, et Tiberi a abandonné la rénovation en partie à cause de ce rapport de forces.
Pour autant, une fois que le projet a été abandonné, une Opération programmée de l’amélioration de l’habitat (Opah) a été lancée pour aider à la réhabilitation, sans préoccupation pour le maintien des habitants sur place : de fait, les loyers ont augmenté et le quartier a pris de la valeur. L’ambiance du quartier a progressivement changé, les cafés à la mode ont fleuri, puis le street art. Le ver était dans le fruit, puisque ceux qui ont mené la lutte ne faisaient pas partie des classes populaires – ils avaient bien une stratégie d’alliance de classes, mais que voulaient-ils sauvegarder le plus ? Le tissu urbain ou le tissu social ?
EH : Aujourd’hui, quand on se promène dans le quartier ou quand on y habite, on a l’impression que la rue ne représente pas l’habitat. Les gens viennent là parce qu’ils ont leurs habitudes, leurs cafés, leur marché, mais souvent ils habitent ailleurs, plus loin, en banlieue.
AC : Les vieux chibanis ont été obligés de déménager, mais ils reviennent tous les matins prendre leur café, parce que cela reste leur tissu social. Du coup, la rue renvoie l’impression d’être dans un vrai quartier populaire, mais quand on regarde la composition sociale des résidents, la part de cadres qui se sont installés là depuis une vingtaine d’années est sans commune mesure avec les banlieues populaires.
EH : Il y a cinq ans encore, l’idée qu’il puisse y avoir un jour une galerie d’art rue Ramponneau paraissait insensée. Aujourd’hui, il y en a moins cinq sur moins de 300 mètres. Depuis que j’y habite, il y avait une grande vitrine toujours fermée par un rideau de fer, une boutique d’articles religieux juifs. Et puis soudain, le rideau s’est levé sur une galerie d’art ! Rue Jouye-Rouve, qui est une petite perpendiculaire du boulevard de Belleville qui va vers le parc, c’est la même multiplication de galeries. Je ne comprends pas quelle est leur économie, leur public, comment elles survivent. Mais ce qui est sûr, c’est que les galeries d’art et les magasins bio sont deux signes symboliques et matériels de la gentrification.
AC : Matériels surtout, car concrètement, cela fait augmenter le prix des baux commerciaux et cela transforme la fréquentation. Il faut ajouter à cela l’effet de concentration : plusieurs galeries au même endroit, cela attire d’autres galeries. Or celles et ceux qui viennent dans ces galeries sont issu.e.s de la petite bourgeoisie intellectuelle, pas des classes populaires.
Par ailleurs, tous les logements sociaux ne sont pas bon signe : à Paris, beaucoup de « logements sociaux » sont destinés aux classes moyennes et contribuent donc à la gentrification. Ce qui se joue dans la question du maintien ou non d’une pratique ouverte au street art dans la rue Denoyez à Belleville relève d’une concurrence interne à la même classe : la petite bourgeoisie intellectuelle des artistes s’oppose à la petite bourgeoisie intellectuelle au pouvoir à la mairie. Les classes populaires n’ont pas grand-chose à voir là-dedans et ont toutes les chances d’être perdantes quelle que soit l’issue de ce conflit. En particulier, les demandeurs de logement sociaux, dont l’écrasante majorité appartient aux classes populaires, ne sont jamais consultés dans les projets urbains.
Que va modifier de plus le Grand Paris pour la ville et sa banlieue ?
EH : Je ne pense pas qu’il faille traiter la banlieue comme un tout, ce qu’on a tendance à faire dans trop de débats. La première couronne est en voie de gentrification ; par endroits, c’est déjà bien fait. Quand j’étais interne dans les années 1960, Levallois était un immense garage : de l’automobile d’occasion à perte de vue. Quand on voulait frimer, on allait acheter une décapotable là-bas. Aujourd’hui, c’est Thalès, la Sous-direction anti-terroriste (Sdat) et des résidences pour cadres.
Le bas d’Issy-les-Moulineaux était une grande friche jusque dans les années 1980, puis ça s’est transformé en zone de bureaux à toute vitesse. Ce phénomène ne se restreint plus à l’Ouest, il fait le tour, au Sud, Malakoff, Montrouge. Les éditions du Seuil sont boulevard Romain-Rolland, juste de l’autre côté du périphérique, mais toujours dans le 14e. Flammarion est au-delà de la BNF dans le 13e, presque à Ivry. À l’Est, ce n’est pas encore tout à fait le cas, Montreuil est sur la voie, mais pas entièrement. Pour la bourgeoisie, intellectuelle ou pas, il y a encore beaucoup à gagner dans l’Est parisien.
Ces avancées des classes moyennes signifient qu’une grande partie de la population qui habitait là est repoussée vers la couronne suivante. Chasser progressivement les pauvres vers la périphérie est un phénomène vieux d’au moins quatre siècles : c’est un processus historique lent, avec des moments d’accélération comme celui qu’on vit aujourd’hui, mais c’est un processus continu. Il n’y a jamais eu de retour des classes populaires vers le centre, pour l’instant.
AC : La banlieue n’est pas homogène, c’est vrai, de même que Paris. À Neuilly, on ne parle pas de gentrification, ç’a toujours été d’emblée une annexe des beaux quartiers. D’autres villes dans le prolongement, jusqu’à Saint-Germain-en-Laye ou Versailles, n’ont jamais vraiment été populaires. Ces beaux quartiers continuent de s’embourgeoiser, avec un renforcement de la présence des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Dans leur cas, on peut parler de filtrage social par le haut et de renforcement de leur exclusivité sociale. Le peu de classes moyennes et populaires qui y vivaient s’en va.
À Boulogne-Billancourt, à la fois ville bourgeoise et ouvrière, la fermeture des usines Renault et le projet d’aménagement de l’île Seguin ont joué le rôle d’accélérateurs. À Issy et Levallois, la gentrification a été planifiée par la droite. On a démoli puis construit des sièges d’entreprises et des logements haut de gamme.
Le projet du Grand Paris est un projet d’intensification de la gentrification, dans un contexte de métropolisation, c’est-à-dire de concentration des activités tertiaires stratégiques (finance, assurance, conseil, conception, etc.). Les futures gares du réseau Grand Paris Express s’accompagnent d’un Contrat de développement territorial (CDT), c’est-à-dire d’un projet d’aménagement urbain, de création ou de restructuration des nouveaux quartiers de gare : ce sont souvent des espaces peu denses qu’on va densifier. Les projets annoncent des bureaux, du logement haut de gamme, des équipements pour les nouvelles populations que l’on souhaite attirer, et aussi des logements sociaux. Tout le monde débat : y en aura-t-il 50%, 30% ou bien 20% ? Dans tous les cas, même si on en fait 50%, la moitié qui reste sera du logement privé neuf, donc cher et destiné aux cadres. Comme pour Paris Nord-Est, cela contribuera à la gentrification des quartiers actuellement populaires où est prévue l’implantation d’une gare du nouveau réseau.
EH : On a une chance, c’est qu’il n’y a plus d’argent public. Le drame des années 1960 dont on parlait, c’est que l’argent coulait à flots. Il y a eu un mécanisme de ciseaux malencontreux entre cette période où l’argent abondait et le moment le plus bas du niveau de l’architecture et de l’urbanisme français.
Sous Mitterrand, l’architecte Roland Castro est chargé en 1983 dans la banlieue lyonnaise de réaliser « l’achèvement du tissu urbain ». Est-ce que cette idée de « tissu urbain » n’intervient pas justement au moment où tout se désagrège ? Quel est ce lien entre tissu urbain et tissu social ? Quand on voit l’histoire des squats parisiens, à un moment donné, ce n’était plus possible, un squat ne tenait même pas un jour, donc forcément, on les trouve désormais à Montreuil, à Ivry, à Saint-Denis. Comment recréer une logique de tension, un rapport de forces avec le pouvoir ? Est-ce qu’on peut reprendre Paris ou bien faut-il lâcher le terrain ?
EH : C’est par la périphérie qu’on reprendra la ville. Paris ce n’est pas foutu, ce n’est pas irréversible. Il ne s’agit pas de l’abandonner, mais de la reprendre par une offensive venant de la périphérie. L’idée en vogue dans les milieux révolutionnaires, celle d’abandonner les métropoles, de partir vers d’autres territoires, ne me semble pas juste.
AC : Ça me fait penser à une planche de L’An 01 de Gébé, au moment où l’on construit les grands ensembles en banlieue : il représente Paris avec plein de tours autour, et puis un personnage dit : « Merde, on s’est encore fait virer de Paris ! », et un autre répond : « Non, mais ils sont complètement cons : on les encercle ! »
À partir de là, on peut réfléchir à comment relier tissu urbain et tissu social. Les quartiers populaires n’ont quasiment jamais été construits par les classes populaires elles-mêmes, sauf peut-être en banlieue, dans les petites zones pavillonnaires ; sinon, il s’agit de promoteurs privés, de petits-bourgeois qui ont créé des immeubles de rapport voués à la location. Cela dit, vu le manque d’intervention des pouvoirs publics et des propriétaires, les classes populaires ont tissé des formes sociales à partir de ces formes urbaines de piètre qualité et vite dégradées. C’est ce que je disais tout à l’heure à propos des pratiques d’auto-organisation ouvrière à Paris ou à Barcelone. Elles permettaient d’envisager ce que Lefebvre appelle le « droit à la ville », c’est-à-dire la capacité de décider collectivement de la façon de produire la ville et de ses finalités (versant urbain de la récupération et de l’autogestion de la production, afin de l’adapter aux besoins réels). Ce qui compte dans une perspective émancipatrice, ce n’est pas tant le tissu urbain que la capacité collective des habitants d’une ville à décider de la façon dont on le produit et l’utilise.
Au contraire de cette perspective, les urbanistes parlent de faire de la « couture » urbaine entre Paris et la banlieue. C’est une vision purement formelle qui n’a rien à voir avec le tissu social : il s’agit de recouvrir le périphérique, de faire de petits immeubles entre les grands immeubles pour recréer de la « continuité urbaine . On fétichise la forme urbaine comme si elle était productrice de tissu social sans remettre en cause le mode de production technocratique de la ville au service des classes dominantes et des intérêts du capital. Et tout cela est enrobé de discours sur le lien social, le vivre ensemble ou la mixité sociale, héritiers d’une pensée de collaboration de classe venue du catholicisme social au XIXe siècle pour faire barrage au socialisme. L’État n’a jamais autant mis en avant la mixité sociale que depuis le tournant de la rigueur du Parti socialiste en 1983 : depuis que le PS s’est rallié au capitalisme dans sa version néolibérale, le désengagement de l’État des structures keynésiennes de redistribution (relative) des richesses n’a pas cessé de s’approfondir. Or, plus les inégalités sociales augmentent, plus on exhorte au vivre ensemble des groupes sociaux de plus en plus antagonistes.
Remettre en cause la mixité sociale comme un dispositif de fabrique du consentement est déjà un premier élément de lutte contre la dépossession des classes populaires dans l’espace urbain. Mais en termes de stratégie politique, la priorité devrait être de retisser des solidarités de classe, par des pratiques d’entraide au quotidien, dans une perspective de lutte contre un régime politique et économique inégalitaire. Reprendre Paris semble pour l’instant difficile, mais il y a des choses à faire dans les banlieues populaires, notamment là où se trouvent les squatteurs, qui révèlent souvent malgré eux l’avant-garde du front de gentrification.
Aujourd’hui, on observe parfois un hiatus entre des gens qui sont héritiers des pensées et des pratiques du mouvement ouvrier, mais qui font le plus souvent partie de la classe intermédiaire, et les classes populaires, où la conscience de classe est très affaiblie. Pour retisser du lien social sur une base de classe et dans une perspective politique (ce qui est le contraire du lien social dépolitisant et consensuel que prônent les pouvoirs publics), il me semble qu’il faut s’appuyer sur ce qui existe déjà dans les banlieues populaires, notamment à partir des luttes de l’immigration et des descendants des immigrés. La défiance envers l’État est forte parmi les classes populaires racisées, il y a un travail de lien politique à faire avec elles. Mais pour cela, il faut accepter de partir des objectifs de lutte des classes populaires, qui peuvent aller de l’accès au logement social à la négociation avec les pouvoirs publics. Il y a parfois des refus dogmatiques de soutenir ce type de démarche au nom d’une certaine pureté politique. Or, historiquement, le mouvement ouvrier a politisé un nombre conséquent de personnes qui ont commencé à se battre pour seulement réduire le temps de travail, améliorer leurs conditions de travail et leur vie quotidienne. La radicalisation ne peut être un préalable aux luttes, elle se gagne dans les luttes.
Stratégiquement, on pourrait partir de là où sont les gens des classes populaires. Le but, c’est qu’ils s’organisent collectivement. Même si c’est juste pour un logement décent ou pour obtenir une indemnité de licenciement, le plus important, c’est le développement des pratiques d’auto-organisation collective et la politisation qui se fait à travers ces luttes. Et dans ces luttes, les militants comme des squatteurs peuvent se mettre d’emblée en position d’alliés et non de meneurs, pour ne pas reproduire les rapports de domination de classe et bien souvent de « race » – sans parler de la place que prennent les hommes dans ces luttes.
Pour aller plus loin :
Anne Clerval, Paris sans le peuple, éd. La Découverte, 2013.
Eric Hazan, L’invention de Paris, éd. Seuil, 2002.
Eric Hazan, Paris sous tension, éd. La Fabrique, 2011.
Eric Hazan, La dynamique de la révolte, éd. La Fabrique, 2015.
Alain Rustenholz, De la banlieue rouge au Grand Paris, éd. La Fabrique, 2015.
Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, quartiers ouvriers de la révolution, éd. CMDE, Collectif des métiers de l’édition, 2014.
Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), éd. La Découverte, 2014.
Sylvie Fol, Yoan Miot et Cécile Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, éd. PU du Septentrion, 2014.
Jean-Paul Clébert, Paris Insolite, éd. Attila, 2009.
Louis Chevalier, L’assassinat de Paris, éd. Ivréa, 1997.
- Notamment à travers la loi Malraux de 1962 qui facilite (défiscalisation) la rénovation de biens immobiliers anciens dans une perspective de conservation du patrimoine culturel. ↩
- Éd. Denoël 1952, rééd. Attila 2009 ↩
- Auguste Chevalier, Du déplacement de la population, de ses causes, de ses effets, des mesures à prendre pour y mettre un terme, 1850. ↩
- Voir notamment l’excellent petit livre de Chris Ealham, Barcelone contre ses habitants. 1835-1937, quartiers ouvriers de la révolution, Éditions CMDE, Collectif des métiers de l’édition, 2014. ↩
- Sur les prémices de cette conscience de classe ouvrière parisienne, voir la somme impressionnante de Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée (1789-1848), La Découverte, 2014. ↩
- Voir à ce sujet, une bonne synthèse des recherches en sciences sociales au sujet des mobilités résidentielles des classes populaires : Sylvie Fol, Yoan Miot et Cécile Vignal (dir.), Mobilités résidentielles, territoires et politiques publiques, PU du Septentrion, 2014 ↩
- Éd. Calmann-Lévy, 1977, Réed. Ivrea 1997. ↩
- Jean Renaudie est un architecte et urbaniste né en 1925. De 1971 à 1975 et de 1976 à 1980, il participe aux deux phases de rénovation du centre d’Ivry et l’essentiel de sa production porte sur le logement social et l’aménagement urbain. ↩