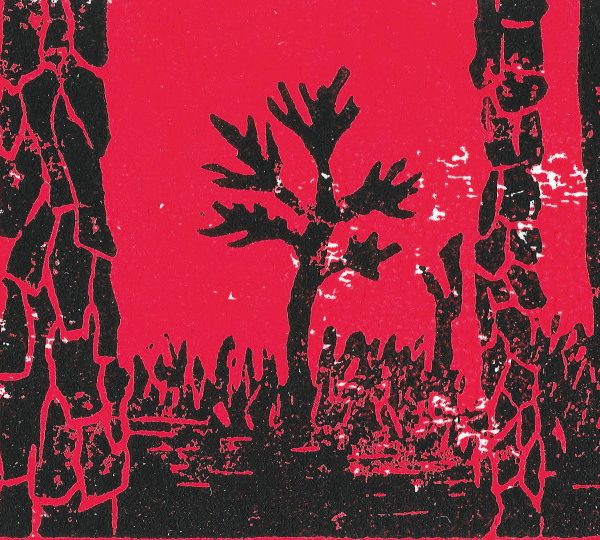En Palestine, le soixante-dixième anniversaire de la Naqba s’est soldé dans le sang, avec la mort de dizaines de manifestant·es tué·es par les soldat·es de l’armée israélienne. Ni l’absolution de la Maison Blanche, ni la complicité ou la couardise de la « communauté internationale », n’incitent à penser que le gouvernement israélien fera preuve d’une plus grande retenue dans un proche avenir. En revanche, tout indique que le cadre de lecture du conflit des vingt-cinq dernières années, alias le « processus de paix », est de l’histoire ancienne. Gargarisé d’impunité, Israël est renvoyé à sa contradiction originelle. Un nouveau champ de possibles, y compris les pires, s’ouvre pour le peuple palestinien. Et le mouvement de solidarité international se réinvente par petites touches.
Grande marche du Retour : neuf semaines d’un massacre par Mohammed Zaanoun & Oren Ziv / Active Stills
D’autres images du conflit israélo-palestien sur le site de photographes Active Stills.
*
Une véritable petite romance parisienne : c’était la troisième fois en moins d’un an, mardi 5 juin, que le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le président français Emmanuel Macron se rencontraient dans la capitale française. Où leurs échanges sont toujours très cordiaux comme en atteste cet émouvant « cher Bibi » dont Macron, l’œil brillant, avait gratifié le chef du gouvernement israélien le 16 juillet 2017 à l’occasion d’une commémoration de la rafle du Vel d’Hiv 1. Mardi, les deux hommes se retrouvaient cette fois pour le lancement de « la saison France-Israël », un événement « culturel » porté par l’Institut français 2, dont la tenue avait été souhaitée dès 2013 par François Hollande lors de sa première visite en tant que chef d’État à Tel-Aviv.
En marge de cet événement, ils ont parlé de l’Iran. Beaucoup moins de la Palestine. Comme toujours, c’est donc de l’extérieur des Palais de la République que sont venues les voix dénonçant le timing de cette rencontre programmée de longue date, mais survenue à peine trois semaines après le massacre perpétré par l’armée israélienne le long de la frontière avec Gaza. Plus d’une centaine de militant·es du mouvement de solidarité, scandant notamment « Israël assassin, Macron complice ! », se sont rassemblé·es en haut des allées Franklin Roosevelt, encadré·es par un très important dispositif policier. D’autres rassemblements avaient lieu en France. Fait rarissime, trois syndicats de journalistes (SNJ, SNJ-CGT et CFDT journalistes) ont publié un communiqué commun appellant « la France à exiger d’Israël que les responsables des tirs à balle explosives contre nos confrères palestiniens et l’ensemble des civils gazaouis soient recherchés et poursuivis ». Autant de manifestations visibles d’un rejet du gouvernement israélien qui, en France, est profond. Dans un sondage réalisé par l’Ifop pour l’Union des étudiants Juifs de France (UEJF), 57 % des personnes interrogées disent avoir une « mauvaise image d’Israël », 71 % estiment que « Israël porte une lourde responsabilité dans l’absence de négociation avec les Palestiniens » et 69 % jugent que « le sionisme est une idéologie qui sert à Israël à justifier sa politique d’occupation et de colonisation des territoires palestiniens » 3.

Forces israéliennes faisant barrage à la prière de musulman·es sur l’esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem, 28 juillet 2017. Photo : Martin Barzilai.
Comme après Gaza en 2014 ou Jénine en 2002 (entre autres opérations meurtrières de Tsahal), cette défiance s’est encore aggravée après la sanglante répression des manifestations commémorant l’anniversaire de la Naqba – la « Catastrophe », ainsi que les Palestinien·nes désignent l’expulsion et la dépossession dont ont été victimes 800 000 d’entre elles et eux entre 1947 et 1949.
Alors que chaque année, le 14 mai, les Israélien·nes fêtent la proclamation de leur État, et le 15 mai, les Palestinien·nes commémorent la Naqba, les dés semblaient jetés : ce soixante-dixième double anniversaire ne pouvait avoir un autre goût que celui du fer et de la cendre. Depuis le début de la « marche du grand retour » entamée le 30 mars dans la bande de Gaza, environ 4 000 palestinien·nes ont été blessé·es par les balles des soldat·es de l’armée d’occupation. Et 125 ont été tué·es 4, dont 61 lors de seule journée du 14 mai.
Un journée durant laquelle, à 79 km de là, la fille de Donald Trump, son gendre et une floppée de cadres états-unien·es fêtaient la pose de la première pierre de la future ambassade des États-Unis à Jérusalem. Donald Trump twittait « C’est un grand jour pour Israël » – Benyamin Netanyahou, lui, gloussait. On peut le comprendre : pour ces « noces de platine », le premier ministre le plus extrême-droitier de l’histoire du pays se voyait offrir le transfert de la représentation diplomatique de son puissant allié à Jérusalem et la liquidation radicale et impunie de pénibles indigènes arguant de leur « droit au retour »… Une séquence symboliquement très épaisse.
Le statut de Jérusalem et le Droit au retour des réfugié·es palestinien·nes sont deux des « dossiers clefs » historiques du conflit. Tenant compte de la charge politique, symbolique et religieuse de la ville, le plan de partage adopté par l’Onu le 29 novembre 1947 avait placé d’emblée Jérusalem « en corpus separatum sous un régime international spécial (…) administrée par les Nations-Unies » 5. Quant aux réfugié·es, soit « toute personne dont le lieu habituel de résidence était la Palestine entre juin 1946 et mai 1948 et qui a perdu son habitation et ses moyens d’existence au cours du conflit israélo-arabe de 1948 », la résolution 194 adoptée en 1948 leur garantit, ainsi qu’à leurs descendant·es, le droit « de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé (…) ». 6 Le 13 septembre 1993, la « Déclaration de principe sur les arrangements intérimaires d’autonomie » (les « accords d’Oslo », du nom de la ville où ils ont été négociés les mois précédents) est signée sur la pelouse de la Maison Blanche, mais Jérusalem, promise à devenir la capitale des deux futurs États, et les réfugié·es restent les deux premiers thèmes censés être négociés « le plus tôt possible » 7 (suivent « les implantations, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations et la coopération avec les autres voisins et d’autres sujets d’interêt commun »…).

Sur la place de Ras Al Amud, à Jérusalem, des centaines de Palestiniens musulmans se sont regroupés pour la prière, pour protester contre l’installation de portiques détecteurs de métaux a l’entrée de l’esplanade des mosquées, 21 juillet 2017. Photo : Martin Barzilai.
La mort d’Oslo
Vingt-cinq ans plus tard, en transférant leur ambassade à Jérusalem, les États-unis avalisent la vision sioniste d’une ville uniquement « capitale éternelle d’Israël ». Quant aux quelque 7,9 millions de réfugié·es palestinien·nes (dont 1,1 suite à la guerre de 1967), essentiellement réparti·es sur les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie, aucun·e n’est rentré·e chez soi 8. Insuffisant pour Benyamin Netanyahou, qui a fait savoir début janvier qu’il souhaitait la fermeture de l’agence dédiée à l’assistance aux réfugié·es palestinien·nes, l’UNRWA (United nation reliefs and work agency, mise en place le 8 décembre 1949 par la résolution 302 de l’ONU), affirmant sans rire qu’il s’agit d’« une organisation qui perpétue le problème des réfugiés palestiniens » 9.
On est désormais très loin, en Palestine, des espoirs suscités par les accords d’Oslo et le « processus de paix », dont la mort, en réalité, est déjà ancienne. Dans son ouvrage La Palestine d’Oslo, consacré à « l’échec de la construction de l’autorité palestinienne comme pseudo-appareil d’etat intégré au sein du dispositf de l’occupation israélienne », le politologue Julien Salingue montre comment la deuxième Intifada débutée en septembre 2000, était déjà, à peine 7 ans après la signature des accords, « l’expression de la crise structurelle » et donc irréversible d’un processus qui, depuis, n’a fait que se déliter 10.
Un seul chiffre suffit à résumer la dynamique régressive à l’oeuvre : en 2018, plus de 600 000 colon·nes résident en Cisjordanie, Jérusalem-Est comprise. En 1993, ils et elles étaient environ 280 000 – dont 5000 installé·es dans la bande de Gaza jusqu’en 2005. Date à laquelle Ariel Sharon, alors premier ministre prend la décision unilatérale de les faire évacuer. Un mouvement qui ne s’était pas opéré sans heurt entre l’armée et les colon·nes, et qui a fait de la bande de Gaza un territoire non plus occupé mais assiégé 11.
Le chiffre a plus que doublé en 25 ans. Au point qu’exfiltrer l’ensemble des colon·nes résidant aujourd’hui en Cisjordanie reviendrait (à quelques dizaines de kilomètres carrés et quelques milliers d’individus près) à vider le département du Gard de l’ensemble de sa population. À cette différence près que le Gard serait ensuite désert tandis que la Cisjordanie continuerait, elle, d’abriter 2,93 millions de palestinien·nes.

À Jérusalem, la police et l’armée israélienne évacuent les manifestant·es de Ras-al-Amud, 21 juillet 2017. Photo : Martin Barzilai.
Ce qui s’est, en réalité, refermé dans un énième bain de sang palestinien aux alentours du 15 mai, ce n’est donc pas Oslo, mais plutôt la longue transition qui a suivi la mort d’Oslo. De 2000 à aujourd’hui, l’idée d’une solution à deux États – dans les frontières dessinées au lendemain de la guerre de juin 1967 –, a été portée avec insistance par le processus, pour rester le cadre de réflexion de référence de l’ensemble des acteurs et intervenants du conflit : le gouvernement israélien, l’Autorité palestinienne, les États-Unis, l’Europe, les Russes, l’ONU. Faute de mieux, mais surtout parce que le « grand récit » de cette perspective maintenue, nourrie de maints « sommets de relance » (à Charm el Cheikh, Camp David…) et de milliers d’articles de presse, servait de nombreux intérêts : ceux des chancelleries occidentales, pas fâchées de pouvoir se retrancher dans un pseudo-rôle d’arbitre « neutre » plutôt que d’assumer une diplomatie offensive à l’égard de la puissance occupante ; ceux d’Israël, qui a vite compris que la réaffirmation régulière de son désir de « paix », complètement creux politiquement, suffisait pour qu’on le laisse poursuivre sans entraves sa politique expansionniste à Jérusalem et en Cisjordanie ; et même ceux de l’Autorité nationale palestinienne, appareil politique fantoche, mais structure pourvoyeuse d’emplois et de salaires dans la fonction publique (éducation, hôpitaux, police, etc.) et dont la seule raison d’être est vite devenue la poursuite du processus de paix. Le tout « cimenté » par l’aide europeénne prodiguée sous forme de fonds alloués ou d’ONG intervenant sur place et dont l’existence contribue à maintenir le statu quo : un seuil minimal de services, de denrées, de soins et d’éducation garanti pour les palestinien·nes. Permettant à Israël de se déresponsabiliser des conséquences de son occupation.

Arrestation d’un palestinien par la police israélienne suite aux affrontements du 21 juillet 2017. Les accès à la vieille ville avaient été interdits par les autorités israéliennes aux personnes de moins de 50 ans pour cette journée de manifestation. Photo : Martin Barzilai.
En dépit de toutes ces forces contraires, au fil des ans, l’évidence du terrain a fini par s’imposer : la solution à deux États est aujourd’hui devenue impossible, cet horizon-là s’est proprement dissout. Comment continuer d’envisager sérieusement une telle issue alors que les très maigres 22 % de la Palestine historique (Cisjordanie et bande de Gaza) dont Yasser Arafat et l’OLP avaient accepté de se contenter pour y établir un État, sont désormais eux-mêmes complètement morcelés, éparpillés en puzzle, mités par les blocs de colonies qui gangrènent le territoire? Qui peut croire que le gouvernement israélien évacuera 600 000 colon·nes dont une partie, par ailleurs armée, répond sans s’en cacher à une idéologie extrémiste ? Encore faudrait-il déjà qu’il en ait l’intention, ce qui n’est pas le cas : fin mai, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, connu entre autres pour avoir réfléchi à des transferts massifs et contraints de population palestinienne 12, annonçait la construction prochaine de 2 500 nouveaux logements en Cisjordanie 13.
L’avenir du commun
Comme l’écrivait en 2010, le négociateur de l’OLP Ziyad Clot, « il n’y aura pas d’État palestinien » 14 et d’autres voies, d’autres chemins de lutte doivent désormais s’ouvrir. Depuis déjà une bonne dizaine d’année, le débat autour d’un État unique a retrouvé de l’allant. La chercheuse palestinienne Leïla Farsakh 15, titulaire de la chaire de Sciences politiques à l’Université du Massachusetts ou l’éditeur Eric Hazan et le cinéaste Eyal Sivan 16, pour ne citer qu’elle et eux, se sont réintéressé·es de près à cette idée ancienne d’un État réunissant des citoyen·nes juif·ves et palestinien·nes qui seraient doté·es des mêmes droits. Hazan et Sivan invitent à s’emparer du concept de « partage » plutôt que de celui de « partition » dans la perspective de créer un « État commun » qui pourrait être « binational, fédéral, cantonal ou confédéral », le choix en revenant « au peuple de cet État ». Perspective supposant « que les arabes palestiniens et les juifs israéliens renoncent au rêve fatigué d’État nation ».

Village palestinien de Nabi Samuil, sur les hauteurs de Jérusalem. Les maisons palestiniennes nouvellement construites sont systématiquement détruites par les autorités israéliennes, avril 2017. Photo : Martin Barzilai.
Dans un texte plus récent, Leïla Farsakh, de son côté, appuie la réflexion sur la question des droits : « Aucune solution n’est possible si elle ne s’attaque pas aux causes profondes du conflit israélo-palestinien, à savoir l’iniquité engendrée par la Déclaration Balfour de 1917, l’injustice de la Nakba et le droit au retour des réfugiés. Pour paraphraser Hannah Arendt, pour aller de l’avant, il faudrait définir une organisation humaine qui ne serait pas un État ethnique, mais une organisation guidée par des principes de justice dans laquelle les “droits mutuellement égaux” de tous seraient reconnus et protégés ». Et l’universitaire invite les protagonistes à « s’atteler à deux tâches difficiles : premièrement, accepter “l’autre” comme égal en droits et en responsabilités, ce qui signifie que chacun devrait reconnaître la tragédie nationale de l’autre peuple, sans que l’une devienne un objet en soi, au détriment de l’autre ; deuxièmement, faire face à l’histoire et au destin communs des juifs israéliens et des Palestiniens. » Ce qui implique pour Israël rien moins que de « rompre avec le fondement colonial et orientaliste du sionisme » et par là de renoncer à « sa prétention irréalisable à être un “État juif et démocratique” ». Et pour les Palestinien·nes de « définir clairement ce à quoi pourrait ressembler la décolonisation, sans nier la culture et le patrimoine national qu’Israël a créés au cours des 70 dernières années » 17.

Lundi 17 avril 2017, à Bethléem, l’armée israélienne a lancé des gaz lacrymogènes contre des manifestant·es, suite à une manifestation de soutien aux 1500 prisonnier·es politiques palestinien·nes qui ont entamé ce jour-là une grève de la faim pour protester contre des “conditions de détention inhumaines”. Photo : Martin Barzilai.
Anciennes et nouvelles résistances
Dans le champ de la résistance intérieure israélienne, les organisations anticoloniales telles que les Anarchistes contre le mur, Ta’ayush ou Yeshgvul, encore actives il y a une dizaine d’années, ont pratiquement disparu du paysage. Restent, épars·es et non organisé·es collectivement, les Refuzniks, ces citoyen·nes israélien·nes refusant de servir dans l’armée et auxquelles le photographe Martin Barzilai a récemment consacré un ouvrage 18. Mais c’est du champ politique qu’est arrivée l’initiative la plus stimulante ces dernières années : la constitution, en 2015, à la Knesset, d’un groupe politique d’une quinzaine de député·es, la liste arabe unie, réunissant pour la première fois l’ensemble des partis arabes du pays 19. Les arabes israélien·nes, parfois appelé·es « Palestinien·nes de 1948 », environ 1,8 million de personnes, représentent 20 % de la population israélienne. Et subissent de nombreuses discriminations – biens documentées par le journaliste Ben White 20 –, au sein d’une société à laquelle leur seule présence rappelle, comme un caillou dans la chaussure, les contradictions et l’impossibilité de la fable sioniste d’un « État juif et démocratique ». À l’instar des réfugié·es, les palestinien·nes d’Israël étaient les grand·es absent·es d’Oslo. L’échec de ce processus qui les cantonnait dans un angle mort a fait remonter ces dernières années l’idée qu’aucune solution pérenne ne sera trouvée sans intégrer ces deux catégories de la population palestinienne.
Autant de pistes pour penser un autre avenir au proche-Orient en écartant la « solution à deux États », par trop restrictive et décrédibilisée. Elles ne peuvent cependant pas occulter que le cadre actuel demeure celui d’un déni absolu des droits nationaux du peuple palestinien dans une société israélienne qui ne cesse de se droitiser. Un cadre dans lequel l’Autorité palestinienne, qui n’hésite pas à collaborer avec la force occupante sur le terrain sécuritaire, et les différentes factions de la résistance armée, affaiblies et divisées, sont a priori incapables de renverser la table. Seul demeure le peuple, comme il l’a montré avec cette Marche du grand Retour violemment réprimée. Le peuple qui oppose depuis 70 ans à l’occupation israélienne son soumoud, cette déclinaison palestinienne de la résilience. Le fait de ne pas partir quoi qu’il en coûte. Persister. Une forme de résistance active et non-violente réinventée au quotidien, que la journaliste Amira Hass définit comme « la phrase fondamentale de la grammaire intérieure de la vie palestinienne ».
Une « phrase » de dominé·es, inaudible à l’échelle internationale où Israël bénéficie toujours, lui, de l’oreille des puissants. Si Obama détestait Netanyahou, sans que cela n’ait aucune traduction politique sur le terrain, Trump l’apprécie hautement, comme l’a montré l’épisode du transfert de l’ambassade. Dans le contexte de reconfiguration régionale autour du clivage Téhéran/Riyad, Israël peut aussi compter, toujours, sur le soutien de l’Arabie Saoudite et de l’Égypte. En France, dans la droite ligne de Sarkozy et Hollande, Macron assume son choix d’être un allié très fiable de Netanyahou.

Camp de refugié·es de Shu’afat, avril 2017. Photo : Martin Barzilai.
Pourtant, mercredi 6 juin, au lendemain du passage du chef d’État israélien à Paris, l’Argentine a, par la voie de sa fédération de football, annulé un match amical qui devait se tenir à Jérusalem le 9 juin 21. Rappelant ainsi qu’au plan des relations internationales, une autre voie, bien moins conciliante avec la politique isréalienne, est possible. Cette annulation n’est évidemment pas le fait d’une soudaine prise de conscience, à Buenos Aires, du sort des Palestinien·nes. Elle est survenue suite, notamment, aux pressions de la campagne Boycott désinvestissement sanction (BDS) 22. Une campagne à laquelle le gouvernement israélien, tout en faisant mine de la tenir pour anecdotique, accorde en réalité une grande attention : début janvier, il a refusé à une vingtaine d’organisations le droit de pénétrer sur son territoire 23. Car si BDS est encore loin d’avoir le même impact populaire que la campagne de boycott menée dans les années 1980 contre le régime sud-africain d’apartheid dont elle s’inspire en partie, elle a déjà enregistré de nombreuses victoires : artistes internationaux annulant leurs concerts en Israël, opérateurs économiques gelant des investissements, mise en échecs de partenariats commerciaux avec des sociétés israéliennes, etc. Lancée le 9 juillet 2005 – un an après l’avis de la Cour internationale de justice jugeant illégal le mur érigé par Tel-Aviv en Cisjordanie –, à l’initiative de 170 organisations non gouvernementales palestiniennes, BDS a essaimé un peu partout dans le monde et apparaît clairement aujourd’hui comme l’outil le plus performant du mouvement de solidarité international avec le peuple palestinien.
En France, nombre de ses militant·es ont rejoint une autre campagne, « 2018, le temps de la Palestine », lancée en janvier dernier en réaction à la « saison France-Israël ». Dans l’appel initial, les signataires refusent « de voir notre pays, la France, prêter la main à la gigantesque opération de propagande d’un régime de colonisation, d’oppression et d’apartheid qui foule délibérément le droit international » et appellent, pour « promouvoir l’année de la Palestine, de Gaza à Jérusalem », à « multiplier les manifestations et initiatives culturelles, partout en France ». Avec d’autres organisations historiques du mouvement de solidarité, telles l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) ou l’Union juive française pour la paix (UJFP), ils et elles ont organisé mardi 5 juin de nombreux rassemblements de protestation contre la venue de Netanyahou à Paris.
Au début des années 2000, la Campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien (CCIPPP) avait renouvelé le paysage militant autour de la Palestine en organisant des missions civiles sur place, par lesquelles des centaines de personnes sont passées et se sont sensibilisées aux enjeux de la question palestinienne. La campagne « 2018, le temps de la Palestine » renoue avec cette capacité à intervenir de façon directe, frontale et non-violente dans le conflit. Avec BDS, et d’autres initiatives plus ponctuelles telles celle de la flotille de la liberté (freedom flotilla) dont le bateau Al Awda (« Le retour ») a mouillé dans le port de la Rochelle du 7 au 9 juin 24, elle participe à dessiner les contours renouvelés du mouvement de solidarité avec la Palestine : débarrassé du carcan d’Oslo, rebranché sur les droits fondamentaux de l’ensemble du peuple palestinien (habitant·es de Cisjordanie et de Gaza, Palestinien·nes d’Israël et réfugié·es de la diaspora) et harcelant les puissants pour que les « cher Bibi » ne puissent plus être susurrés impunément.

Vue depuis le village Palestinien de Al-Nu’eman tout près de Jérusalem. Au loin la colonie israélienne de Har Oma, avril 2017. Photo : Martin Barzilai.
- « Vél d’Hiv : Netanyahou remercie Macron en français pour son “geste très très fort” », Huffington Post, 16 mai 2017. ↩
- On trouvera ici une présentation de cette saison « décidée au plus haut niveau des deux États » et qui se veut « centrée sur l’innovation, la création et la jeunesse comme axes d’un dialogue tourné vers l’avenir ». ↩
- Les Français et les 70 ans d’Israël, sondage IFOP pour l’UEJF, mai 2018. ↩
- Selon un chiffre donné par l’AFP le 4 juin 2018. ↩
- La résolution 181(II) adoptée le 29 novembre 1947 par l’Assemblée générale de l’ONU. ↩
- La résolution 194 (III) adoptée le 11 décembre 1948 par l’Assemblée générale de l’ONU. ↩
- Lire par exemple cet article de Jean-François Legrain : « Retour sur les accords israélo-palestiniens (1993-2000) », Maghreb Machrek, no 170, oct.-déc. 2000. ↩
- « Les réfugiés palestiniens en 2018 », document de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine (www.plateforme-palestine.org). ↩
- « Netanyahou réitère son appel à fermer l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens », RFI, 8 janv. 2018. ↩
- La Palestine d’Oslo, de Julien Salingue, éd. l’Harmattan, bib. de l’iReMMO, Paris, 2014. ↩
- « Évacuation des colons juifs de la bande de Gaza par les troupes israéliennes », France 2, août 2005. ↩
- « Le fascisme ordinaire d’un ministre israélien », Alain Gresh, sur son « blog du Diplo » Nouvelles d’Orient, 26 mars 2014. ↩
- « Israël va autoriser 2500 nouveaux logements de colons en Cisjordanie », Econostrum, 24 mai 2018. ↩
- Il n’y aura pas d’État palestinien, journal d’un négociateur en Palestine, de Ziyad Clot. Max Milo éditions, Paris, 2010. ↩
- « L’heure d’un État binational est-elle venue ? », Leila Farsakh, Le Monde Diplomatique, mars 2007. ↩
- Un État commun entre le Jourdain et la mer, de Eric Hazan et Eyal Sivan, éd. La Fabrique, Paris, 2012. ↩
- « Palestine-Israël : limites éthiques et politiques du combat nationaliste », Leïla Farsakh, Orient XXI, 21 fév. 2018. ↩
- Refuzniks, dire non à l’armée en Israël, de Martin Barzilai, éd. Libertalia, Paris, 2017. ↩
- « En Israël, la “liste commune” chamboule le paysage politique », Regards, 16 mars 2015. ↩
- Être Palestinien en Israël, ségrégation, discrimination et démocratie de Ben White. Ouvrage initialement paru en 2012 sous le titre Palestinians in Israel-Segregation, Discrimination and Democracy et traduit en 2015 aux éditions la Guillotine. ↩
- « Tempête en Israël après l’annulation du match de football contre l’Argentine », Le Monde, 6 juin 2018. ↩
- Pour en savoir plus, voir le site de la campagne originelle et celui de BDS France. ↩
- « Israël interdit de territoire une vingtaine d’organisations appelant à son boycott », France 24, 8 janv. 2018. ↩
- « La Rochelle welcomes freedom flotilla boat #Alawda », Freedom Flotilla Coalition. ↩